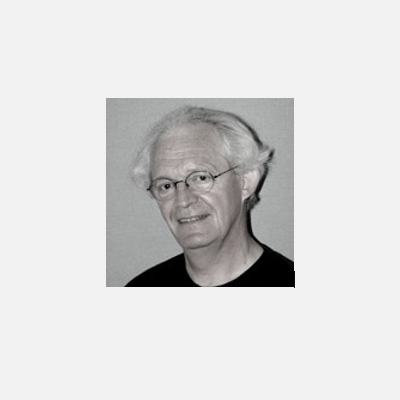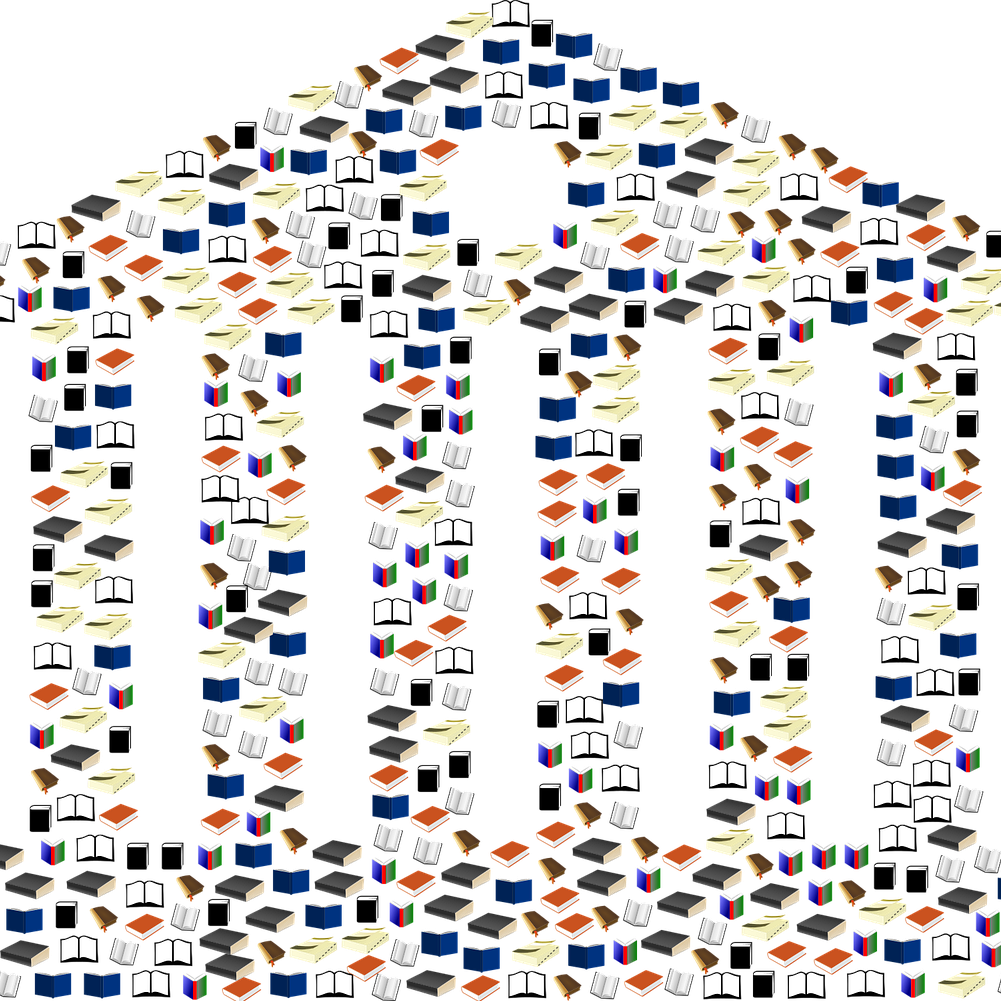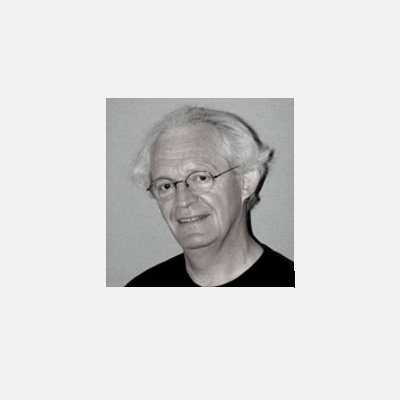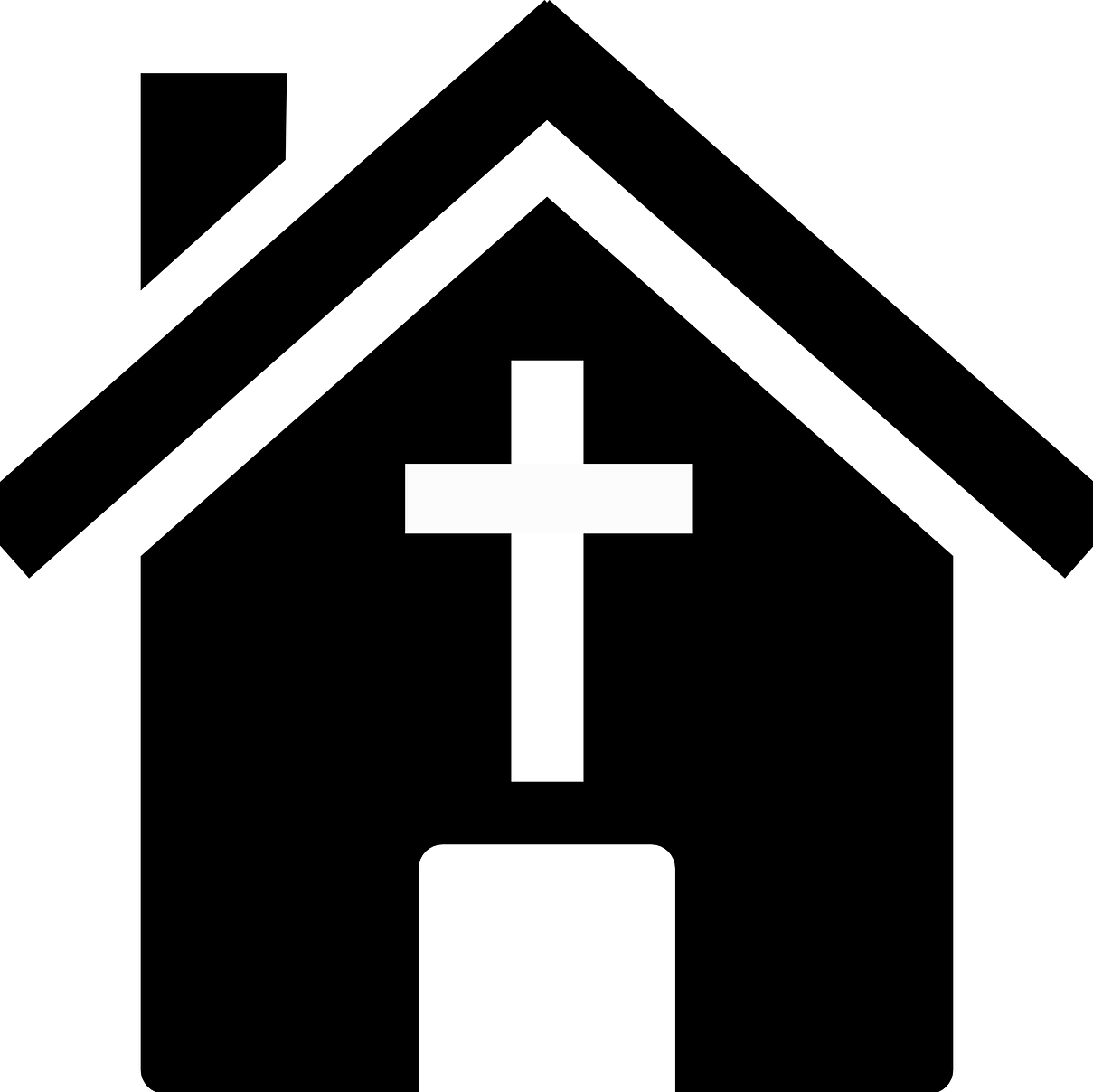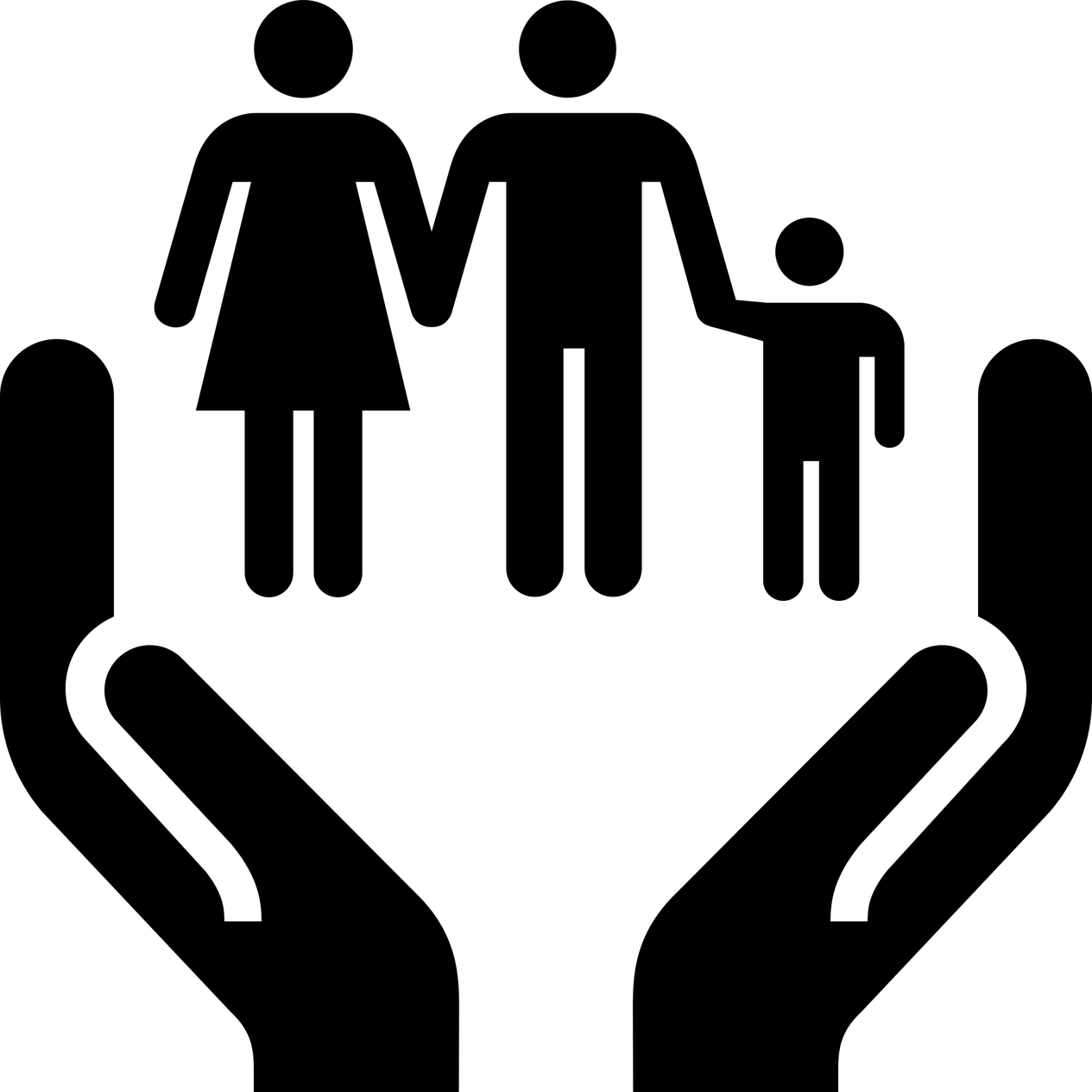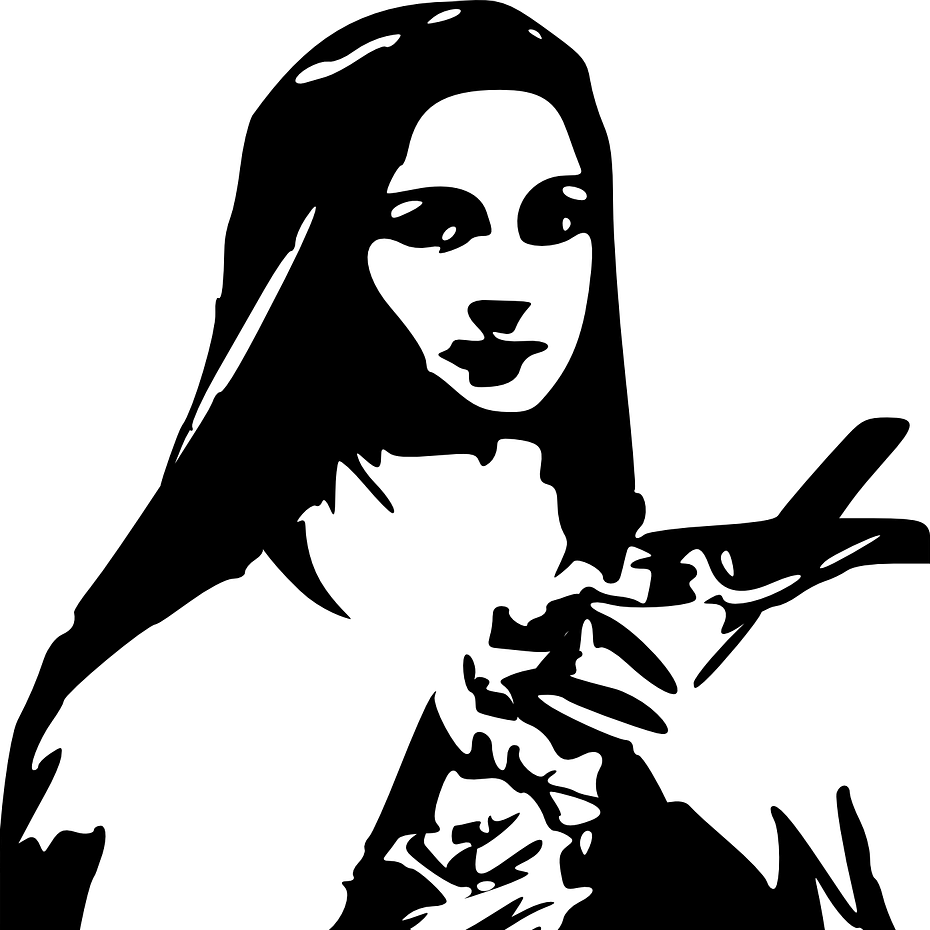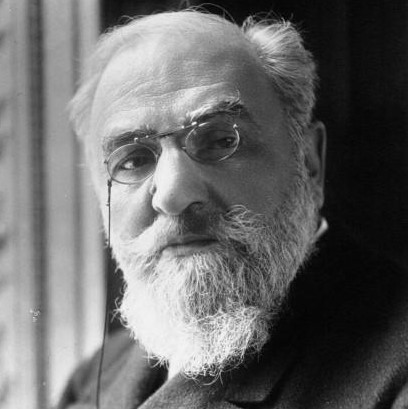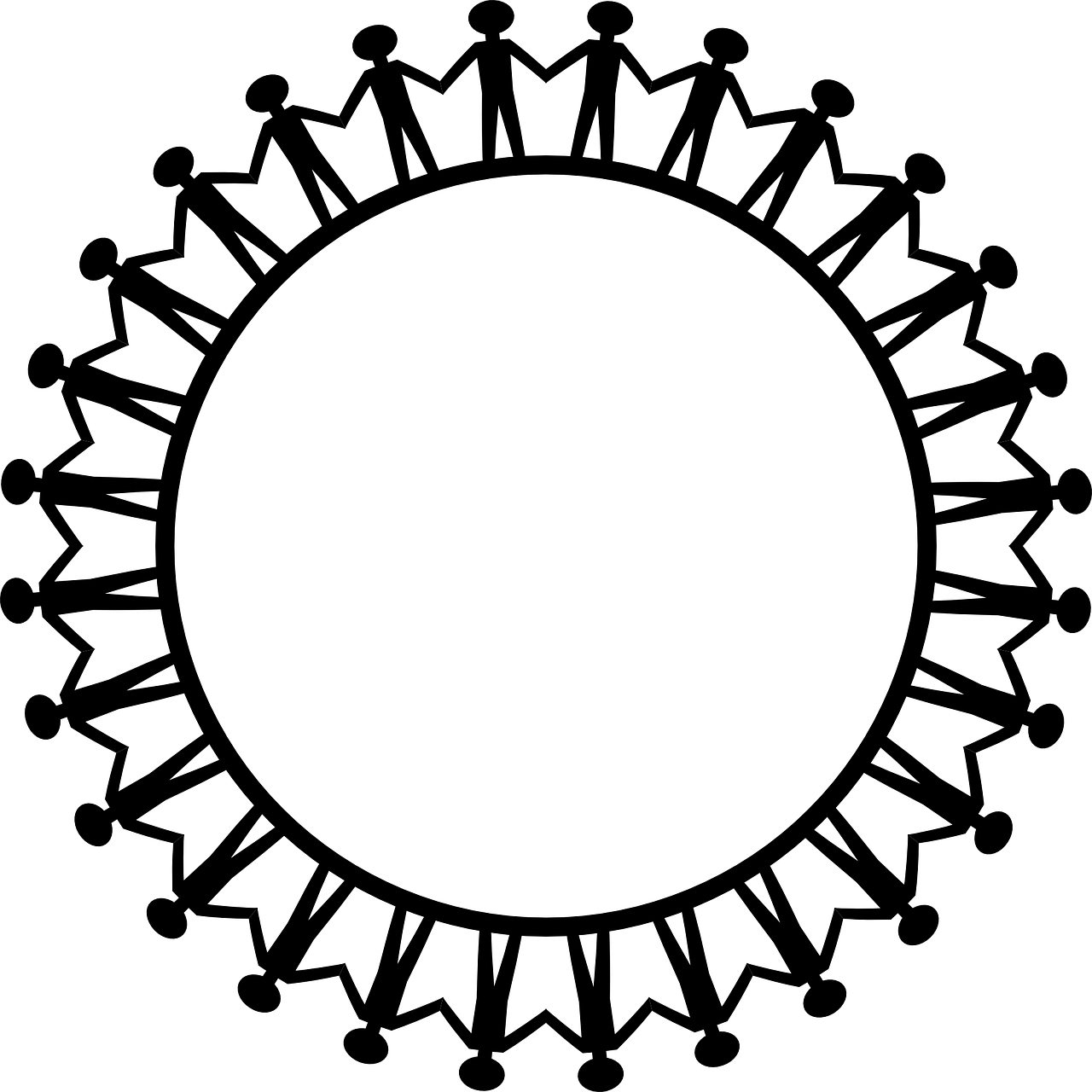Lyon se signale par un trait singulier qui serait la proximité entre l’hôpital et la sphère politique. Pouvez-vous nous expliquer l’origine du lien entre les deux mondes ?
Le rapport entre fonction hospitalière et fonction politique me paraît exceptionnel à Lyon tant du point de vue de sa qualité que de sa durée, puisque ce rapport se forme sous l’Ancien Régime1 mais perdure après la Révolution et la laïcisation des hôpitaux devenus Hospices civils de Lyon.
Pour comprendre ce que ce lien a d’exceptionnel, il faut partir d’une propriété négative. Sous l’Ancien Régime, Lyon n’a pas d’aristocratie. Ici, pas de noblesse de sang. Pas, non plus, de noblesse d’épée. Pas de parlement, donc de noblesse de robe. Sociographiquement, Lyon est une ville bourgeoise, non pas au sens psychologique du terme, mais au sens des catégories constitutives de l’Ancien Régime. On est bien dans une ville du Tiers État. Les seuls nobles que l’on y trouve sont les chanoines-comtes de la primatiale Saint-Jean qui, par définition, ne peuvent pas transmettre leur titre. C’est sous ces conditions que la ville va construire ses élites et parvenir à le faire sur un mode original.
Comment ? A dater de l’édit royal de Charles VIII, en 1495, on a pu être anobli, à Lyon, au motif qu’on avait exercé les fonctions échevinales, c’est-à-dire administré la ville. On pouvait, en fin de mandat, demander l’anoblissement, ce que faisaient la plupart des échevins. Cette noblesse a été désignée, non sans une certaine condescendance, comme noblesse de « cloche » ou d’échevinage. Mais le plus intéressant pour expliquer le lien entre fonction hospitalière et pouvoir politique a trait à ce qui suit : on n’accédait aux fonctions d’échevin qu’en ayant fait la preuve de ses qualités de bon gestionnaire dans l’administration des hôpitaux, Hôtel-Dieu et/ou Hospice de la charité. Pour reprendre la formule de l’historien Maurice Garden, être recteur d’un des deux établissements hospitaliers était « la première étape du cursus honorum conduisant à l’échevinat ».
C’est au même historien que l’on doit la formule selon laquelle les Bureaux des hôpitaux tiennent lieu de parlement à Lyon ! Il n’y a donc de noblesse civile dans cette ville que consubstantiellement liée au souci du bien public : bien public de la cité tout entière ; bien public particulier dont la visée est celle d’actes de bienfaisance, actes dont on répond sur ses propres deniers. La fonction hospitalière et la fonction politique sont ainsi inséparables ; elles percolent, si je puis dire. On ne peut pas penser cette ville, privée d’université, privée de parlement, sans cette singularité qui lui a valu de produire une « noblesse » autochtone, d’origine échevinale, sur le critère de la compétence en matière de gestion des tâches de bienfaisance.
Quelle place l’hôpital occupe-t-il alors ?
En premier lieu, entendons le terme hôpital dans le sens qu’il avait alors et à travers les fonctions de l’époque. Il s’agit de fonctions qui sont plus celles de l’asile ou de l’hospice que de l’hôpital contemporain. Il s’agit de lieux où l’on recueille des indigents, des malades, des vagabonds, des enfants abandonnés. Recueille et enferme, puisqu’il s’agit aussi de lieux d’isolement, voire de réclusion.
Ce qui est emblématique, c’est la situation de ces établissements. Hôtel-Dieu et Hôpital de la charité sont sis dans la partie bourgeoise de la ville, sur la Presque île, et mis en éminence, soit par le site où ils sont implantés, soit par leurs qualités architecturales. L’Hôpital général de Notre Dame de pitié du pont du Rhône et grand Hôtel-Dieu - tel était sa désignation exacte - est véritablement munificent. Tous ceux qui découvrent la ville en y accédant par l’unique pont du Rhône - le pont de la Guillotière - se trouvent face à ce très imposant monument et soumis à cet effet d’ostension de la fonction hospitalière, telle que la met en exergue l’élite bourgeoise locale.
Quelles différences y a-t-il entre la situation à Lyon et la situation dans d’autres grandes villes du pays ?
La question qui se pose, à l’époque moderne, est celle d’une ville qui a eu statut de capitale - capitale de plusieurs provinces romaines, a perdu ce statut, qui sait qu’elle est la place financière principale du royaume, qu’elle est un nœud commercial indispensable à l’Europe, qu’elle est le siège d’une activité manufacturière de très grande qualité, qui a donc une haute idée du rôle qu’elle a assumé et qu’elle assume mais qui, en même temps, est privée des symboles de l’autorité que confèrent les institutions parlementaire et universitaire. Il y a une contrariété manifeste entre l’aura religieuse, la puissance manufacturière, le rayonnement financier international de la ville, et son statut mineur du point de vue politique et intellectuel. C’est ce point qui retient mon attention et qui me paraît constitutif de la singularité de cette ville : un statut de ville majeure, ici, de ville mineure, là. A ma connaissance cette situation est sans équivalent. Dijon, Toulouse, Grenoble, Rennes, Aix, Bordeaux, ont leur université et leur parlement ! Plus au Nord, Douai a une université et un parlement ! On est bien obligé de penser Lyon sur un mode privatif. L’absence de ces deux institutions ne permet pas la production endogène d’élites intellectuelles ou d’élites politiques. Mais le génie du lieu travaille à constituer une élite locale sur d’autres modes, tels ceux induits par la fonction hospitalière.
D’où la place centrale de la fonction hospitalière ?
Encore une fois, là où il n’y a ni noblesse militaire ni noblesse civile, le fait hospitalier participe à une « aristocratisation » de la cité, ou plus exactement, à une hybridation de valeurs aristocratiques et bourgeoises. Le bourgeois doit savoir compter, produire de la richesse mais n’a pas vocation première à exhiber sa richesse. A l’inverse, de l’aristocrate on n’exige pas qu’il sache compter mais qu’il fasse ostension de son statut, de son lignage, de son rang, de sa « dignité ». Les bourgeois lyonnais vont « aristocratiser » leur statut, par l’anoblissement personnel, mais aussi, si vous acceptez cette formule, en « s’offrant » et en offrant à leur ville un palais : l’Hôtel-Dieu.
Il y a bien à Lyon un Hôtel de ville fort élégant, mais le véritable palais de la ville, l’immeuble qui, en tout cas, est de dimension palatiale, c’est l’Hôtel-Dieu 2.
Il y a, en effet, dès 1184-1185, un hôpital au débouché du pont du Rhône, mais celui-ci va être agrandi à grands frais, notamment, en 1622 puis de 1658 à 1663, et surtout, entre 1741 et 1761 avec l’édification de l’immense façade sur le Rhône et du grand dôme, à l’initiative de Soufflot. Quand, pour la première fois, je suis entré sous ce dôme, j’ai songé au Panthéon de Rome, plus précisément à son extraordinaire coupole, dont Soufflot s’est bien évidemment inspiré, à Lyon puis à Paris, quand il a édifié l’église sainte Geneviève, notre actuel Panthéon. A quoi ce dôme sert-il ? A garantir la circulation de volumes d’air utiles aux hospitalisés, sans doute. Mais aussi à attester du talent d’un architecte et de la munificence des élites urbaines, c’est-à-dire, à attester de la « grandeur dans la générosité », trait aristocratique par excellence !
N’est-ce pas paradoxal, si on se souvient qu’à l’époque l’hôpital est le lieu où sont soignés les pauvres, qu’il a une fonction d’accueil des indigents tandis que les riches évitent l’hôpital et se font soigner en ville ?Pourquoi une telle présence et magnificence hospitalières à Lyon ?
Pour moi, cela tient, notamment, au rapport entre la bourgeoisie qui administre la ville et la population laborieuse qu’héberge la ville ou qui environne la ville.
Mais il faut, ici, évoquer un paradoxe qui tient à la nature de l’activité principale qui fait la prospérité et la renommée de la première ville manufacturière de France : la production d’objets de luxe, soit les tissus de velours et de soie. Cette activité place la bourgeoisie lyonnaise en situation instable voire, à différents moments, périlleuse. Par définition le commerce du luxe est incertain et volatile. Il tient aux modes, il tient surtout à la prospérité de l’aristocratie qui passe commande de ce type de biens. A ce titre, l’activité de la Fabrique lyonnaise est soumise aux aléas, puisqu’elle dépend du ressort de l’ostension aristocratique et donc des heurs et malheurs des cours princières ou monarchiques, des vicissitudes des aristocraties européennes et mondiales. Quant à ceux qui battent les métiers au profit des fabricants », leurs revendications portent sur la question du « tarif », soit la rémunération de leur travail ; mais leurs valeurs, leurs principes vont les porter à annuler, d’un point de vue politique, la dissymétrie de principe existant entre aristocratie, bourgeoisie et peuple.
La formule connue du Chant des canuts « Nous tissons des draps d’or et nous allons tout nus » sera expressive de cette contradiction : comment vivre du luxe en contestant ses conditions de possibilité, soit l’écart des conditions et l’inégalité des statuts ? C’est sous cet angle, aussi, qu’il conviendrait de considérer la relation particulière de la ville aux deux régimes impériaux du 19e siècle.
Alors, pourquoi l’hôpital ? La réponse a été donnée : parce qu’il y a dans la ville une tension inhérente à la nature de la relation entre le capital d’un côté, la force de travail de l’autre. Parce que le chômage cyclique, les famines récurrentes, les épidémies créent les conditions d’une urgence permanente. Comme les échevins ne sont pas aveugles et sourds, qu’ils savent compter et administrer, ils créent les conditions de l’accueil du malade infesté, de la mise au travail du chômeur, de la rétention du mendiant vagabond. Ils instituent le secours alimentaire indispensable pour parer aux effets des famines. N’oublions pas que l’Hôpital ou, mieux, Hospice de la charité, institution qui a pu préjuger de fonctions qui seront celles de l’Assistance publique, a eu pour nom originel « Aumône générale ».
On dirait aujourd’hui qu’on achète la paix sociale ?
Ce n’est pas le langage de l’époque mais, effectivement, on veille à prévenir les incendies et, le moment venu, à éteindre le feu.
Vous dites que ce lien est pérenne et perdure après la Révolution.
La Révolution emporte une laïcisation de l’État et des hôpitaux. La désignation Hospices « civils », adoptée en 1802, l’atteste. On passe bien d’un lexique constitué, celui de la charité, à la langue nouvelle des « secours publics » et de la « bienfaisance nationale ». Mais, à certains égards, on peut considérer que la laïcisation a surtout affecté les murs… Le personnel soignant reste, en effet, celui des Sœurs hospitalières, dont la présence se remarque dans les hôpitaux lyonnais jusque dans les années 50-60 du 20e siècle, preuve d’une continuité certaine entre « ancien » et « nouveau » régime. Il est par ailleurs notable que nombre de maires de Lyon de la Révolution au départ du 20e siècle sont des médecins. Et celui qui rompt clairement avec cette tradition en 1905 - Édouard Herriot, qui n’est pas lyonnais et qui est professeur de lettres - prend pour épouse la fille d’un professeur de médecine, s’entoure du conseil de médecins, comme les professeurs André Latarjet et Jules Courmont, confie au talentueux architecte Tony Garnier la construction de l’hôpital pavillonnaire Grange Blanche.
Peut-on revenir sur le lien entre l’hôpital et la religion, tel qu’il s’est noué à Lyon ?
Le lien est initial, originel. C’est bien le propre du christianisme d’avoir permis l’identification de la figure de la divinité et de la figure de l’indigent, du malade. C’est bien le propre du christianisme d’avoir suscité l’essor de corps religieux - les congrégations - ou laïques - les confréries - voués au soin des malades, au secours des miséreux, des prisonniers. Et à Lyon, comme ailleurs, les premiers hôpitaux seront des asiles voués à l’accueil des pauvres, des pèlerins, des voyageurs de condition modeste. Mais ce n’est pas sous l’effet du hasard que Lyon a pu s’honorer du titre de « capitale des aumônes ».
L’aumône n’est pas là comme simple geste que l’on dirait aujourd’hui « humanitaire », elle est condition et gage de salut éternel… Le propre de Lyon est d'avoir nourri ce souci des " bonnes oeuvres ", d'en avoir imposé la charge à ses élites et d'avoir installé, en cœur de ville, cette véritable « cité hospitalière » constituée de deux grands hôpitaux, aux fonctions distinctes et complémentaires. La trace insistante de cette histoire vous la trouvez aujourd’hui encore dans le patrimoine immobilier des Hospices civils, fruit de legs et donations, comme dans les institutions telles que les hôpitaux Saint-Jean-de-Dieu ou Saint Joseph-Saint Luc.
Mais considérons, aussi, l’histoire de l’hôpital public du Vinatier, ouvert en 1876, sous l’appellation Asile d’aliénés de Bron. Qui s’est mis dans les pas de Philippe Pinel, qui a plaidé des années durant, à Lyon, en faveur du passage de l’enfermement au soin ? Un médecin de l’hôpital de l’Antiquaille voué à ce « rebus du rebus » qu’étaient les aliénés et les syphilitiques. Ce médecin, Joseph Arthaud, a été co-fondateur, avec Frédéric Ozanam, des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul ; il était par ailleurs membre de l’Œuvre de la propagation de la foi… Arthaud est ce personnage emblématique qui allie compétence médicale, foi religieuse intense et zèle en faveur de populations en déshérence 3.
Mais alors comment se fait, positivement, la transition de l'idée de charité à celle de philanthropie, de l'idée de bienfaisance à celle de "santé publique" ?
Le propre de Lyon est d’être une ville dont l’assiette politique va se constituer, à la charnière des 19° et 20° siècles autour du radicalisme. Or le radicalisme a comme corpus doctrinal le Solidarisme. Celui-ci, dont les ascendances idéologiques sont plutôt juives, protestantes, maçonniques, se doit de contester la valeur de charité au profit d’une valeur concurrente, la philanthropie. Avec la philanthropie, on s’éloigne du schème de l’identification religieuse des figures humaine et divine au profit d’un autre schème d’identification : honorer l’homme en tant qu’homme, secourir l’autre en tant qu’autre moi-même.
Par ailleurs, la vertu du Solidarisme a été de rendre pensable et possible l’adoption des premières lois sociales visant à réparer les effets funestes, pour la condition des populations laborieuses, de l’accident du travail, du chômage, de la vieillesse. Le Solidarisme préjuge de ce que sera, après la seconde guerre mondiale, le système universel de sécurité sociale. Herriot, député et maire radical-socialiste, président du parti radical-socialiste, ne pouvait pas ne pas servir la cause de cette politique philanthropique. Il était, par ailleurs, l’héritier de ces maires-médecins qui avaient œuvré en faveur de l’hygiène publique. Le monument au docteur Gailleton témoigne encore, au débouché du pont de l’Université, de cette représentation hygiéniste de la médecine et de l’urbanisme. Et l’on peut voir dans la conception pavillonnaire de l’hôpital Grange Blanche une suite et un effet de cette tradition hygiéniste liguant le corps médical et le corps des édiles municipaux lyonnais.
Tout a changé, tout change, certes : la conception de la médecine, le statut du médecin, la nature de l’institution hospitalière. Mais quelque chose me semble demeurer de l’ordre d’un lien intime entre fonctions publiques et fonctions hospitalières.
N’est-ce pas le cas partout ? Le lien entre médecins et politiques est présent ailleurs, notamment au plan national pour des raisons pratiques qui font que les fonctions politiques sont assumées par des médecins, des avocats ou des fonctionnaires ? Est-ce que ce qui était singulier à Lyon l’est encore ?
Que les médecins soient sur-représentés, notamment à l’Assemblée nationale, c’est l’évidence. Ce qui me semble significatif, si l’on considère Lyon, sur l’échelle chronologique qui court de la Révolution à nos jours, c’est la part prise par les médecins dans l’administration de la cité : que les médecins assument la fonction de premier magistrat urbain, qu’ils se trouvent dans l’entourage politique immédiat du maire ou encore qu’ils assument des fonctions de conseil4. Les rôles récemment joués par un Jean-Michel Dubernard, par un Jean-Louis Touraine dans le conseil municipal, celui d’un Thierry Philip au conseil régional ressortissent, de mon point de vue, aux caractéristiques de cette histoire longue.
En outre, le fait que de grands opérateurs de l’action humanitaire internationale, comme Handicap International ou Bioforce, soient nés et implantés à Lyon, à l’initiative de médecins, me convainc un peu plus que nous sommes toujours dans cette configuration qui rend étonnamment poreuse la frontière entre sphère médicale et sphère politique.