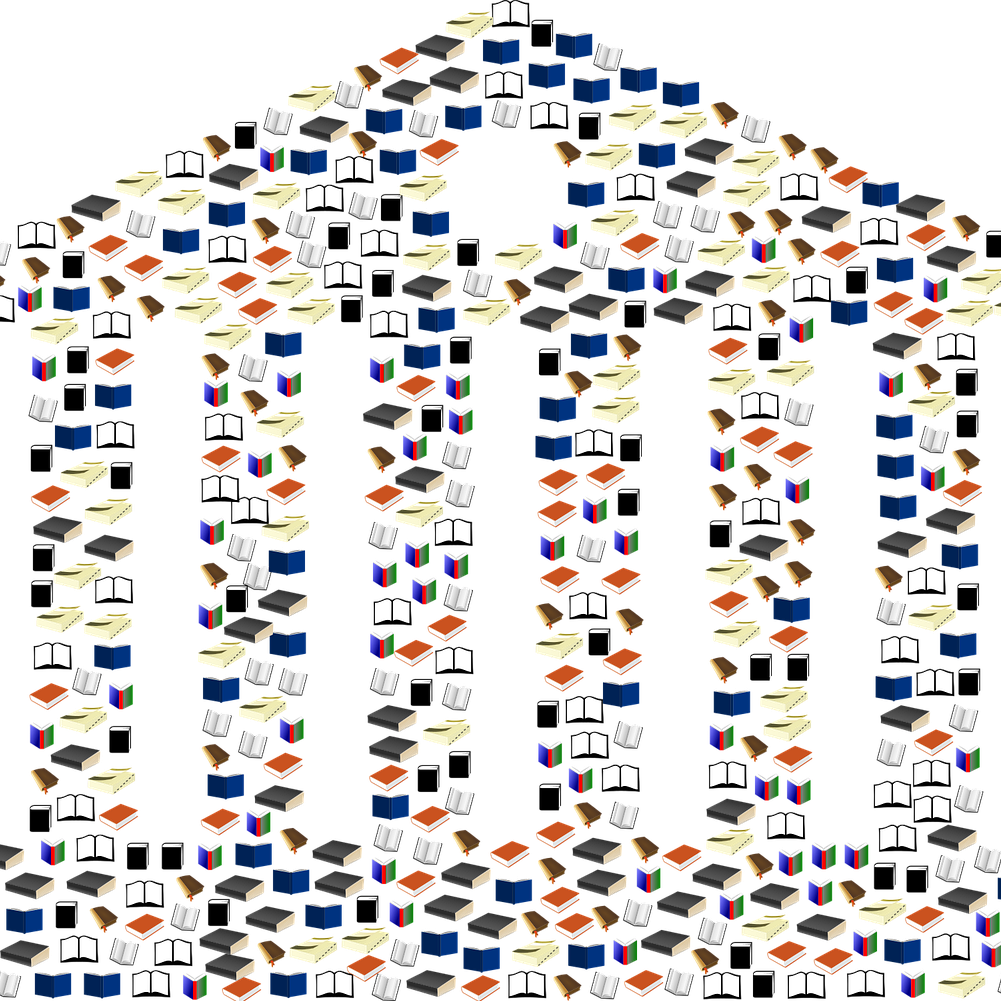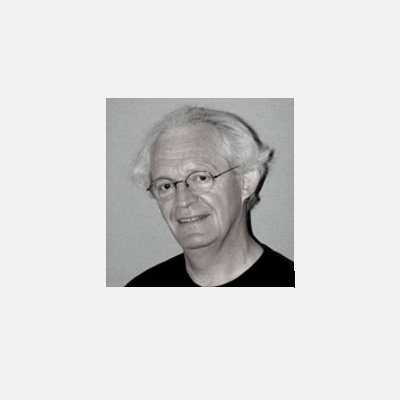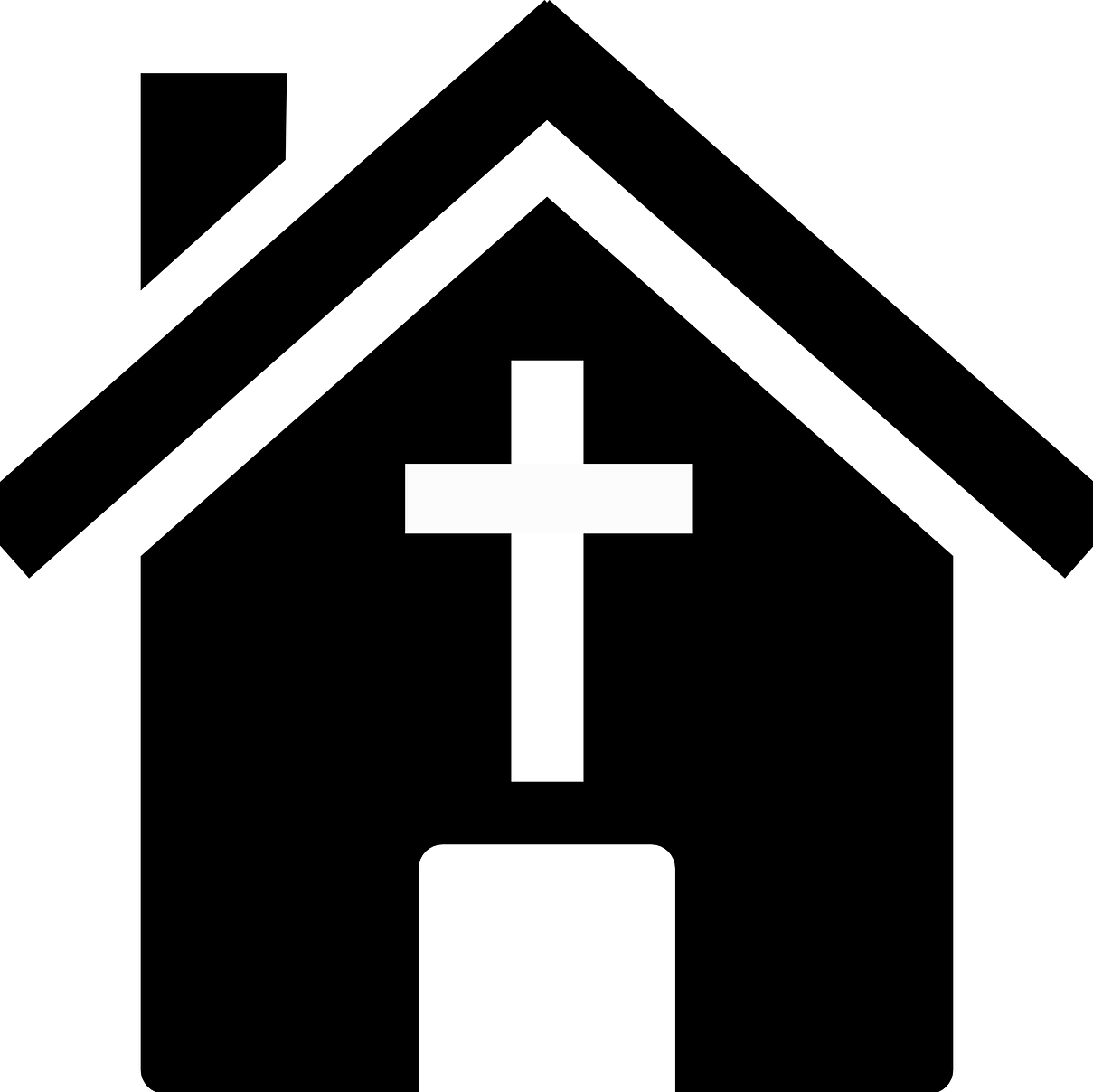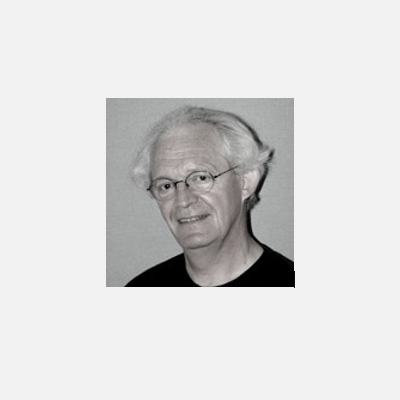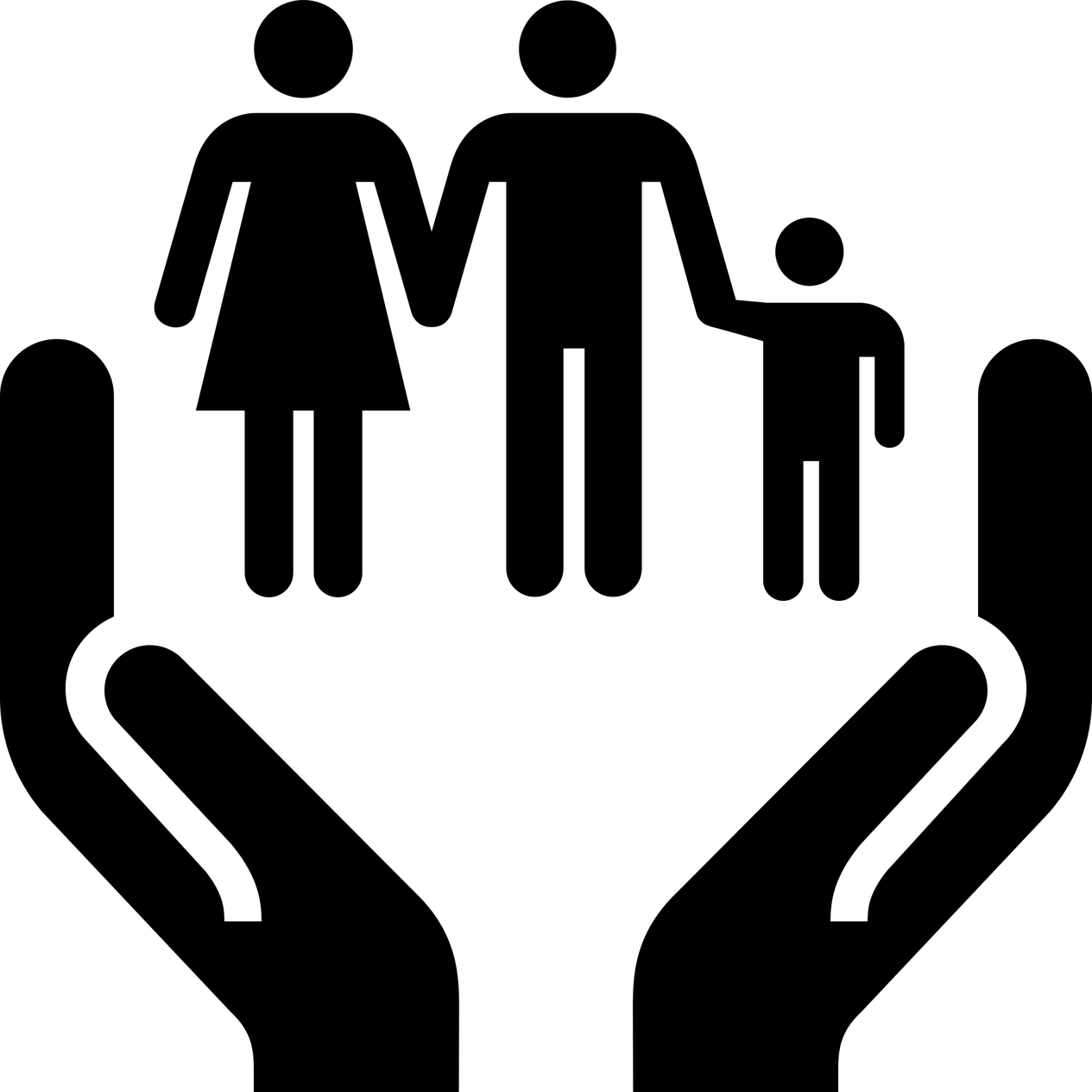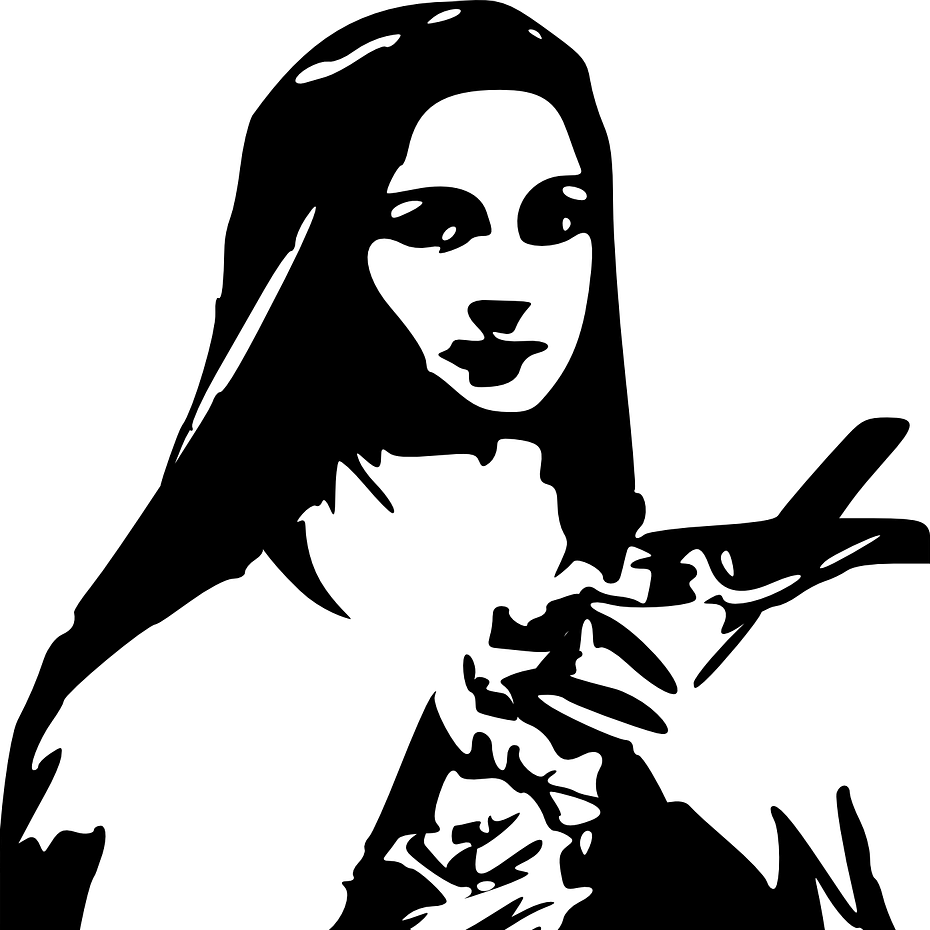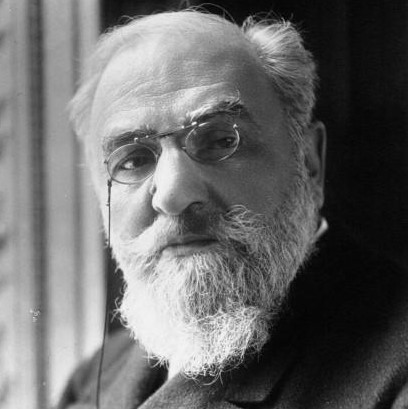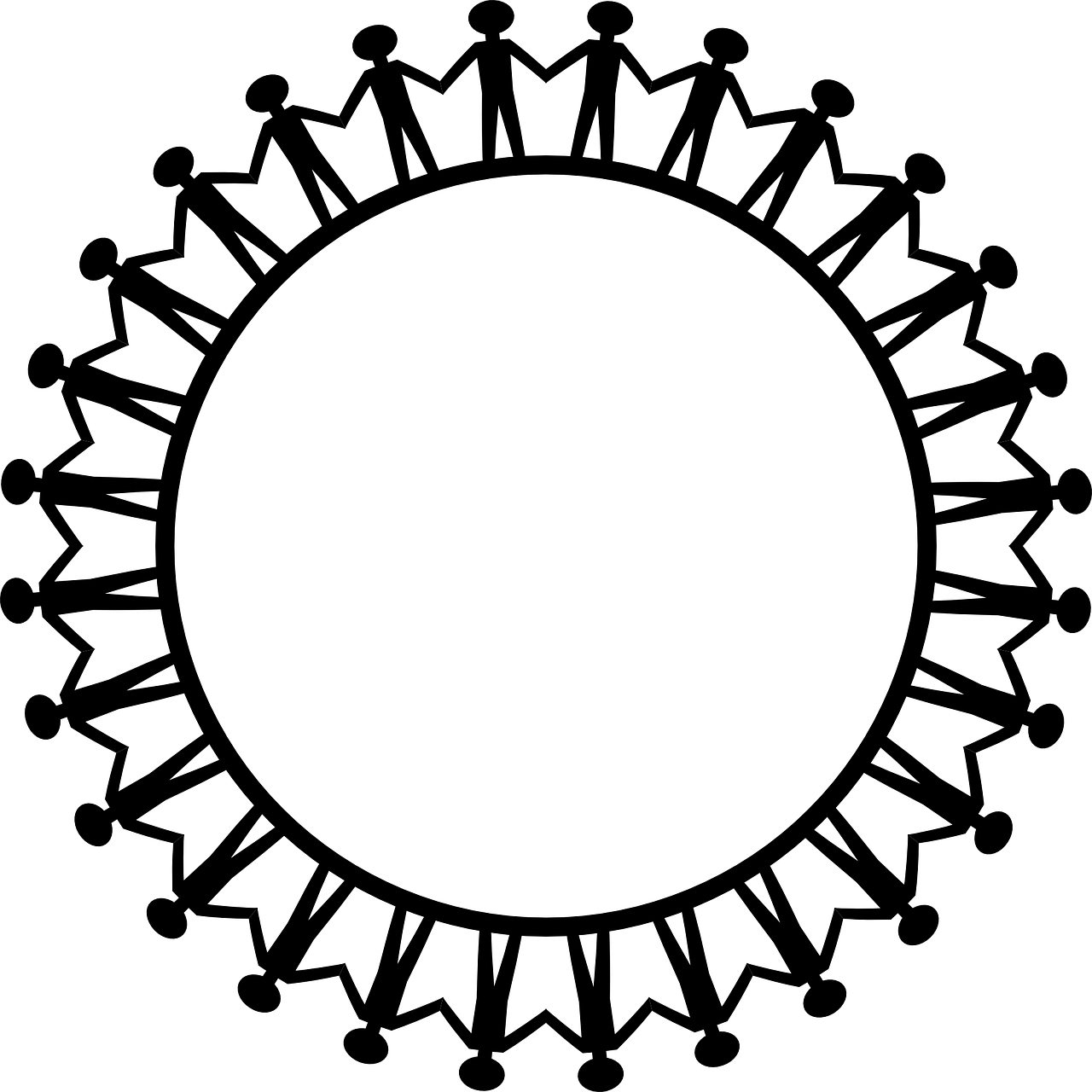Les impensés de l’organisation envisagée par la nouvelle gestion publique
« La théorie en vogue veut que la stratégie s'élabore à partir d'analyse. Or, la stratégie ne relève pas de l'analyse, elle relève de la synthèse. On n'élabore pas une stratégie d'entreprise comme Moïse descendant de la montagne avec les dix commandements. La stratégie est apprise sur le terrain par les gestionnaires d'expérience capables de voir la forêt plutôt que les arbres. Elle peut prendre forme sans être formulée, et elle émerge à la suite de nombreux efforts d'apprentissage informels plutôt que d'être créée à partir d'un processus formel. Pour moi, la stratégie se rapproche de l'artisanat plus que de la science. La science vient plus tard, dans l'analyse des données. Mais ces données ne forment pas la stratégie, elles permettent d'en programmer les conséquences. (…) L'expression top management est stupide. Le pdg d'une entreprise ne devrait pas être en haut de l'entreprise, il devrait se trouver au centre ! » (Henry Mintzberg, interview par S. Dansereau, 2009)
Fusions de services et réduction des coûts : qui évaluera les réformes et les formes administratives qu’elles envisagent ?
Cet article interroge la tendance des réformes de « modernisation » à se focaliser sur l’organisation administrative, laissant de côté l’analyse des conditions d’exercice du service public. Nous montrons que les réformes privilégient une vision gestionnaire du management public ; elles se centrent avant tout sur l’organigramme et la forme de l’organisation. Les fusions de services, la réduction des coûts, les réductions d’effectifs, sont les instruments de réforme privilégiés pour améliorer l’efficience de l’administration. Mais celle-ci manque de retours sur les effets produits par les réorganisations : l’évolution des professions, des liens fonctionnels entre échelons de l’action publique, ou des services rendus dans les territoires.
Il apparaît paradoxalement que le corpus gestionnaire qui sous-tend ces réformes nuit à l’agilité de l’organisation dans le management de l’action publique territoriale. Les réformes, qui s’imposent et exigent le changement, oublient de penser leurs propres modalités d’analyse critique.
Mobilisant un corpus de recherche sur l’analyse de l’action publique, nous discutons certaines croyances constitutives du modèle de réformes qui s’impose actuellement. Celui-ci envisage la réforme à travers les effets attendus des fusions organisationnelles, plutôt que d’appréhender le changement institutionnel comme un processus, devant être questionné en permanence, orienté vers l’action publique.
Cet article se fonde sur les résultats d’une étude doctorale au sujet des fusions des services déconcentrés de l’État lors de la Révision générale des politiques publiques et de la Réforme de l’administration territoriale de l’État (RGPP et RéATE, 2007-2012). Ces réformes affichent un accroissement de « l’efficience » de l’intervention de l’État grâce à une « simplification » de son architecture organisationnelle. Ces réformes se sont toutefois focalisées sur la réorganisation formelle des services (fusions, constitution d’agences, réduction du nombre de services déconcentrés) et sur la contraction des budgets de fonctionnement (non-remplacement de fonctionnaires, baisse des dotations) (Bezes & Le Lidec 2010, 2016). Les contenus professionnels des missions sont restés des impensés des réformes, de même que leur évaluation et le suivi des changements importants qu’elles ont généré dans l’action publique. Nous analysons plus particulièrement l’évolution du positionnement et de l’expertise professionnelle des services déconcentrés de la Cohésion sociale, résultant de la fusion des services de la Jeunesse, des Sports, de l’Action sociale et de la Politique de la ville.
Dans un premier temps, cet article aborde de manière critique le corpus gestionnaire utilisé par les réformes. En envisageant l’institution essentiellement à travers son coût et son organisation, ces dernières génèrent de la centralisation et davantage de hiérarchie. Dans un deuxième temps, nous illustrons notre critique par les processus de division des tâches au sein des services fusionnés de la Cohésion sociale. Ces processus sont peu pensés en amont par les réformes. Dans un troisième temps, nous proposons des pistes d’analyse du fonctionnement des organisations, pour permettre d’envisager des réformes soucieuses du service public rendu.
1. Un cadre d’analyse restreint pour appréhender un système administratif de plus en plus complexe
Les réformes de l’État depuis les années 2000 s’appuient sur un cadre restreint d’interprétation du fonctionnement des organisations et de la bureaucratie. Le postulat de ces réformes est que l’administration est coûteuse, peu coordonnée et souffre de doublons et redondances. Il conviendrait donc de développer des outils de gestion pour limiter la dépense, de fusionner et d’intégrer les différentes branches des systèmes partenariaux et de restaurer des lignes hiérarchiques claires afin de coordonner mieux l’action. Ce corpus largement répandu est pourtant discutable.
Réduction des coûts et rationalisation budgétaire comme horizons de la gestion publique
Le discours médiatique et politique sur l’action publique ces trente dernières années renvoie systématiquement au champ lexical de la dette, de la contrainte budgétaire et de la nécessité de baisser des coûts de fonctionnement exorbitants. Une analyse sémantique de l’actualité conduit assez rapidement à envisager des acteurs publics gloutons, anémiés et au bord de la faillite.
Dans les années 80 et 90, un certain nombre de pays anglo-saxons et d’Europe du Nord expérimentent des politiques structurelles inspirées des doctrines néo-libérales : public choice, new public management, privatisations (Dunleavy 1991, Lamarzelle 2008). Elles visent spécifiquement l’introduction dans le service public de méthodes de gestion issues du secteur privé. Dépassant le seul cadre de la rationalisation de la bureaucratie, ces politiques focalisent la réforme de l’État sur la réduction de son intervention sociétale et un cadrage budgétaire contraint à tous les échelons d’action publique – Union Européenne[1], Etat, collectivités territoriales, établissements, associations, etc. Cette remise en cause de l’État Providence s’appuie sur des outils de gestion visant la « maîtrise de la dépense », la « performance au moindre coût », la « rationalisation budgétaire ».
En France, cette tendance est également présente, même si plus récente (Bezes 2009). Dès les années 60, un outil de planification des dépenses budgétaires de chaque ministère a été testé par le ministère du Budget, nommé Rationalisation des choix budgétaires (RCB). Abandonnée provisoirement en raison de son coté « usine à gaz » (Spenlehauer 1999), cette idée est réactivée durant les années 90. Il s’agit de gérer l’action publique sur le mode de la performance, en systématisant l’utilisation d’instruments de gestion et de mesure (Lascoumes & Le Galès 2004). Cette tendance a finalement été légiférée à travers la Loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF). Les budgets annuels de l’État intègrent désormais une nouvelle architecture budgétaire qui tente de désectoriser les politiques publiques, en proposant des entrées par lignes budgétaires opérationnelles et des objectifs de performance mesurés sur la base d’indicateurs (Projets annuels de performance). Chaque ligne est scrutée selon une logique de séparation entre autorisation d’engagement et déblocage des crédits de paiement. La mise en œuvre des programmes reste néanmoins très verticalisée selon la ligne ministère-région-département. Cet outil confère à Bercy une importance capitale dans la gestion des budgets de chaque ministère avec un pouvoir de veto sur les dépenses engagées (Calmette 2008).
Les réformes qui suivent cette loi d’orientation budgétaire sont toutes empreintes de cette mentalité « cost killer » de réduction des coûts. La RGPP (2007-2012), puis la Modernisation de l’action publique (MAP 2012-2016) et l’actuel Comité action publique 2022 (CAP22) visent à réduire le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique d’État et à auditer les politiques publiques de manière à en augmenter le niveau d’efficience.
Valérie Boussard (2008) s’interroge sur les effets pervers de la prolifération de l’utilisation d’instruments et de mécanismes de contrôle issus de l’entreprise privée sur la coordination du travail public. Ces outils établis sur les principes de la mesure gestionnaire relayent l’injonction de l’augmentation de la productivité et de la performance. Pour elle, la gestion constitue la nouvelle forme sociale qui s’impose dans les manières de penser l’action et la vie sociale, internalisant l’objectif capitaliste de la constitution du profit. Il s’agit de réduire la dépense publique, ce qui implique de renforcer les contrôles internes (au sein des organismes) et externes (auprès des bénéficiaires), visant à détecter les erreurs ou les abus. Cet ensemble de pratiques devient la forme sociale évidente de conduite des affaires. Elle se développe de manière performative et s’émancipe progressivement des conditions de son intervention pour servir de modèle à toute organisation sociale : PME, services publics, associations (Boltanski & Chiapello 1999).
Dans cette perspective, les professionnels de la gestion jouent un rôle crucial, comme « faiseurs de performance ». Ils développent ce que la chercheuse appelle un « logos gestionnaire » reposant sur trois principes d’action : la Maîtrise, la Performance et la Rationalité. « La Maîtrise est représentée par le pilotage, au sens de conduite maîtrisée vers un but. Le fonctionnement d’une organisation Performante vise l’efficacité. Pour l’atteindre, la gestion adopte une démarche scientifique, dite Rationnelle » (Boussard 2008). Hauts fonctionnaires, ingénieurs, comptables, etc. diffusent ce « logos gestionnaire » dont le contenu (en savoirs, en expertise) est situé à des niveaux intermédiaires : c’est à dire ni ancrés dans la praxis locale ni revendiqué en tant que discours idéologique ou stratégique. La chercheuse insiste sur la diffusion performative de ce « logos gestionnaire », à la manière d’une mode, de plus en plus hégémonique, reconnue comme seule forme de pensée et de choix légitime, organisant la vie sociale.
Le problème réside dans le fait que la gestion n’est pas forcément le mode de gouvernance le plus efficace. Nous allons voir que la gestion et ses instruments d’application doivent leur pérennité à la croyance qu’ils suscitent auprès d’acteurs de plus en plus nombreux et fidélisés à cette « forme sociale totale ».
La fusion comme « recette » et comme « mythe » de la rationalisation des organisations
Dans le cadre sémantique et médiatique dominé par la gestion, des « recettes » de réformes du secteur public sont proposées par des organisations transnationales telles que l’OCDE et appliquées au contexte français des années 2000 (Pollitt & Bouckaert 1999). Elles s’appuient sur une critique importante du fonctionnement de la bureaucratie, qui s’avérerait inefficace, trop centralisée, focalisée sur son propre développement et transformant la personnalité même des fonctionnaires (Merton 1940). Il est entendu que les systèmes partenariaux de production de services publics sont fragmentés, affaiblis par des chevauchements et des dédoublements, insuffisamment coordonnés, fonctionnant « en silo », minés par les guerres de clochers, le chaos et le gaspillage, mal assurés par des fonctionnaires trop chers et souvent en arrêt maladie.
La baisse des coûts est ainsi censée passer par une évolution structurelle de ces systèmes d’organisations partenariales, visant leur intégration fonctionnelle par fusion au sein de grandes organisations contrôlées par une autorité hiérarchique unique. Trois vertus sont prêtées à la fusion :
- La première est de nature économico-budgétaire, dans la mesure où il faut réduire le nombre de fonctionnaires et de structures administratives.
- La deuxième est politique, puisqu’il faut rationaliser les processus de décision, contraindre les acteurs administratifs tout en réduisant les coûts de coordination.
- La troisième est managériale : « une organisation resserrée offre une meilleure lisibilité vis-à-vis de l’extérieur et des usagers et favorise l’amélioration du service rendu, en dépit de la réduction du nombre d’agents de guichet (front office), grâce aux guichets uniques (one stop shop) » (Bezes & Le Lidec 2016).
Les réformes s’appliquent ainsi concrètement en utilisant les instruments suivants : fusions de services et intégration des différentes tâches sous une même autorité, refonte des organigrammes, verticalisation des lignes hiérarchiques et de communication, mutualisation des « fonctions support » dans des plates-formes reliées à la direction, réduction des effectifs de fonctionnaires, instauration de guichets uniques centralisant les demandes des « usagers », informatisation de la mesure de la performance et de la gestion des ressources humaines et financières[2].
Ces préceptes passent dans le management public, relayés de manière opérationnelle par les hauts fonctionnaires et les plus grands cabinets de conseil, spécialisés dans l’ingénierie des réformes de l’État[3]. Issu du management commercial des grandes firmes et des pratiques des « fusions-acquisitions », ce modèle néo-libéral est devenu le standard dominant en ce qui concerne la rationalisation des organisations publiques. Martin Kitchener et Linda Gask (2003) parlent à ce titre de « mergermania » (manie de la fusion).
Philippe Bezes et Patrick Le Lidec (2016) soulignent la construction sociale et culturelle de ces « mythes rationnels » du management public, la circulation de croyances qui prêtent à ces instruments des vertus quasi mythiques et l’homogénéisation des formes organisationnelles (isomorphismes institutionnels) qui en découle. C’est moins l’efficacité réelle des outils que le souci de correspondre aux exigences de conformité avec les standards dominants qui préside à l’évolution actuelle des formes organisationnelles.
En France, l’utilisation à grande échelle de l’instrument managérial que constitue la fusion organisationnelle est présente dans le script de toutes les réformes du secteur public de ces dernières années : constitution du ministère du Développement durable, fusion des sous-préfectures, constitution de Pôle Emploi, constitution des Agences régionales de Santé, fusion des services déconcentrés dans le cadre de la Réforme de l’administration territoriale de l’État. Les lois MAPTAM (incitation à la fusion des communes, fusion des services départementaux et communautaires dans les Métropoles)[4] et NOTRe (réforme de l’intercommunalité, fusion des régions)[5] continuent de prôner cette forme de restructuration en ce qui concerne la décentralisation.
Il est interpellant de constater que très peu d’évaluation en bonne et due forme de l’utilisation de la réorganisation par fusion de services n’est réellement menée. Alain Dupuis et Luc Farinas (2010), au sujet des fusions des services sociaux au Québec, expliquent que les études sur les réformes adoptent en général comme cadre d’interprétation le même archétype organisationnel que celui que les réformes mobilisent, c’est-à-dire les principes de l’organisation rationnelle et unitaire dirigée par un gestionnaire imputable[6]. Ce schéma organisationnel est un modèle mental et culturel ; il est tenu pour acquis et n’a pas a être vérifié. Les études ont ainsi tendance à expliquer pourquoi les gestionnaires ont tant de difficultés à implanter le modèle, ce qu’on attribue en général à l’obstruction des intérêts en présence (« résistances au changement »). Elles cherchent également à mettre en lumière le travail des dirigeants dans ce contexte de changement, beaucoup moins le travail opérationnel des agents ou les pratiques professionnelles.
Certains travaux du courant de la policy analysis américaine vont jusqu’à mettre en doute le fait que les réformes structurelles par fusion et intégration verticale et hiérarchique apportent davantage de coordination ou de performance. Ils démontrent certaines conséquences bénéfiques des doublons dans l’action publique, qui permettent un contrôle réciproque des administrations et un enrichissement mutuel des politiques publiques (Chisholm 1989). L’évolution vers les guichets uniques ou la simplification du nombre d’administrations n’est pas réellement mesurée. La réduction du nombre de fonctionnaires, si elle est effective dans la fonction publique d’État, a largement été compensée par le développement de la fonction publique territoriale. La création de plateformes gigantesques de gestion est dénoncée au sein des directions métiers, qui y ont perdu de l’autonomie. Eugene Bardach (1998) souligne le fait qu’un consensus existe dans les études sur l’évolution des administrations publiques dans le domaine sanitaire et social, selon lequel les réorganisations produisent peu de valeurs au vu du coût très élevé qu’elles représentent en temps, en énergie et en anxiété personnelle pour les agents[7].
Un modèle de réformes « par le haut » : centralisation contre ajustements mutuels
Les réorganisations sont ainsi pensées sur le modèle de l’intégration fonctionnelle et de la fusion, qui doit permettre de générer un meilleur contrôle de la dépense et davantage de coordination. Il conduit à une organisation hiérarchique et mécaniste des systèmes partenariaux. Ce modèle centralisateur est proposé « par le haut » (ministères, hauts fonctionnaires, top management) et selon une logique d’application descendante, voire mécanique. La pensée gestionnaire envisage les réorganisations en se focalisant sur l’évolution des organigrammes, supposant qu’une organisation différente produira les évolutions attendues.
Cette application par le haut a tendance à mépriser l’ensemble de la mise en œuvre de l’action. Les pratiques en place sont rarement réfléchies ou étudiées et la fusion s’impose de manière descendante, gommant toute référence historique aux anciens fonctionnements et aux pratiques.
Or, les systèmes en place reposent sur des routines de fonctionnement élaborées avec le temps. « Il existe des mécanismes de coordination « invisibles » au regard de la théorie classique de l’administration, qui focalise son attention sur l’autorité et les règles formelles, la hiérarchie, l’unité de direction, la définition précise des responsabilités, la division poussée du travail, la division du travail de conception et d’exécution, et le plan d’ensemble » (Dupuis & Farinas 2010). Ces mécanismes « invisibles » reposent sur des relations d’échange, de négociation et d’ajustements réciproques entre partenaires, sur des conflits actifs et des consensus négociés entre corps professionnels concernant l’interprétation des problèmes et de l’action, sur des communautés de pratiques entre partenaires bien différenciés, mais organisés pour l’action (Lindblom 1965).
Les interdépendances non formalisées, les logiques tacites de fonctionnement, les processus d’ajustements mutuels sont des mécanismes extrêmement importants de résolution de problèmes et de fonctionnement des organisations. Même s’ils sont peu rationnels, sous-jacents, sous-estimés et qu’ils restent peu étudiés et méconnus, ils sont les principaux éléments qui font que l’organisation fonctionne, sur les plans interne et externe. Le travail des secrétaires, loin de la vision des fonctions supports à mutualiser, est un exemple de la dimension non rationnelle du fonctionnement d’une administration. Plus généralement, c’est au moment des pauses, dans les espaces interstitiels, dans les moments de non-travail, dans les discussions informelles et personnelles, dans les constructions relationnelles entre agents que se construit la solidarité organisationnelle et le sens au travail (Fustier 2012). Charles Lindblom (1959) évoquait la « science de la confusion »[8] pour tenter de décrire le fonctionnement d’une administration publique : les processus d’ajustements mutuels entre acteurs des différents services et partenaires, le contournement systématique des règles par les agents pour agir à la marge, le bricolage permanent qui caractérise la fabrique de l’action publique.
Donald Chisholm (1989) insiste sur le risque important de sur-coordonner et d’augmenter inutilement le niveau d’interdépendance dans un système organisationnel : le modèle de l’organisation bureaucratique et mécaniste provoque régulièrement des cercles vicieux qui font en sorte que les « solutions » peuvent causer plus de problèmes, qu’on tente ensuite de résoudre par les mêmes « solutions ». De toute évidence, après le « choc » provoqué par les fusions, les routines administratives et les ajustements mutuels se remettent progressivement en place, dans le cadre imposé et au-delà. Toute puissante et centralisée qu’elle soit, la hiérarchie est incapable de contrôler l’ensemble des actions de ses agents et les évolutions endogènes de l’organisation.
Une tendance des travaux sur l’évolution de l’action publique consiste à renvoyer tous les maux de l’administration à l’expression « new public management ». Nous invitons ici à distinguer le fait que l’approche gestionnaire que nous décrivons, utilisée notamment par les hauts fonctionnaires à la manœuvre en France, est une version partielle d’un courant très large, qui constitue davantage un « puzzle doctrinal » qu’une idéologie cohérente (Hood 1991). Elle n’utilise qu’une partie des outils de gouvernement décrits par Christopher Hood (1983). Selon le théoricien du new public management, un des éléments essentiels pour le gouvernement est de parvenir à se positionner au sein des réseaux de politiques publiques (nodality) pour maintenir son autorité. Il s’appuie pour cela sur des relais de terrain (detectors), qui assurent une prise permanente d’informations, permettent la détection des problèmes et les font remonter. Ce type de position constitue dans la grille du new public management les éléments d’un soft power, qui complète efficacement le gouvernement régalien par la contrainte (authority), par les finances (treasure) ou par l’organisation rationnelle de l’administration (organization) (Hood 1983). On note donc qu’aux côtés de l’administration de gestion et des problématiques régaliennes, il est nécessaire de maintenir une administration plus autonome, moins structurée par l’organisation et la hiérarchie, garante d’un soft power nécessaire à la connaissance territoriale et à l’implication auprès des acteurs sociaux.
2. Le paradoxe de la gestion : les fusions créent davantage de division des tâches. L’exemple des services déconcentrés de la Cohésion sociale
Il s’agit d’aborder ici certaines conséquences de l’application de la pensée gestionnaire. Nous défendons le fait que les réorganisations descendantes créent de la désorganisation si elles ne sont pas confrontées au vécu des agents et aux objectifs de l’action publique. Elles ont des conséquences sur l’activité et les pratiques professionnelles, sur l’autonomie des agents, sur les relations partenariales avec les acteurs de terrain, sur les choix d’activités valorisées ou dévalorisées par les managers. Cette désorganisation demeure si les enjeux des positionnements, des pratiques professionnelles, des échanges avec le territoire, des problématiques de formation et d’apprentissage des agents ne sont pas abordés.
La Réforme de l’Administration Territoriale de l’État (RéATE - 2010) constitue le volet organisationnel de la RGPP. Dans cette réforme, la focalisation sur l’organisation des services déconcentrés de l’État est particulièrement évidente. Envisagée par un petit groupe de hauts fonctionnaires, elle s’applique de manière descendante, ignorant les pratiques, les logiques d’action des agents – notamment des cadres intermédiaires – et la chaîne d’application des politiques publiques. Nous illustrons notre propos à travers le cas des nouvelles administrations de la Cohésion sociale, résultant de la fusion des anciens services de la Jeunesse et des Sports (DDJS), de l’Action sociale (volet social des anciennes DDASS) et de la Politique de la ville[9] (ACSé).
Management contre professions : problèmes de légitimité et de verticalité
Historiquement, dans une administration fondée sur l'application de l'action publique, les directeurs des services déconcentrés de l’État fondent leur légitimité sur leur appartenance au plus haut corps de leur domaine professionnel (Gervais 2007) : Inspecteurs principaux de l’Action sanitaire et sociale, de la Jeunesse et des Sports, des Services vétérinaires ou de la Concurrence et de la Répression des fraudes.
Les fusions de services remettent en cause le principe de légitimation des chefs par la profession. C’est une évolution fondamentale, qui n’a pas forcément été préparée en amont des réformes. Les nouveaux directeurs doivent intégrer le fonctionnement de plusieurs groupes professionnels. On assiste ainsi à une dissociation entre le management et les « directions métiers », désormais considérées comme des « pôles » au sein des services fusionnés. De fait, les nouveaux directeurs se distancient de l’action, pour prendre en charge le management interne et externe de structures dont l’assise est plus large, regroupant un plus grand nombre d'agents, sur un panel plus important et diversifié de missions.
La réforme génère ainsi de la verticalité. On constate une prolifération de l'encadrement intermédiaire dans les services, avec la mise en place de chefs de pôles. Ceux-ci ont paradoxalement de moins en moins d'agents opérationnels sous leurs ordres (cadres de terrain, catégories B et C), du fait de la corrélation entre les réorganisations, la mutualisation des fonctions support et les réductions d’effectifs. Il en résulte pour les agents une augmentation de la charge de travail (moins d’agents pour autant de missions) et de reporting (plus d’échelons de référence).
Le travail de managers consiste à identifier et valoriser les capacités d'adaptation des agents et leur attachement à leurs métiers, afin de continuer à donner du sens au travail dans les services. Mais cette dissociation entre management et professions peut poser des problèmes de légitimation des équipes de direction. Une des contradictions de la RGPP, peu portée sur l’accompagnement du changement vécu par les agents de terrain, est de laisser seuls les directeurs des services déconcentrés, qui concentrent les tensions générées par ces contradictions, l’absence de préparation des réformes, ainsi que l’absence d’évaluation des changements à l’œuvre (Debar 2011).
Pilotage contre mise en œuvre : la séparation des tâches dans le cadre de l’« État stratège »
Le modèle de l’« État stratège » s’impose dans les réformes de l’État dès le milieu des années 90. Il établit une séparation formelle des fonctions dites stratégiques (pilotage et contrôle) et des fonctions de mise en œuvre (exécution opérationnelle) de l’action publique (Bezes 2005).
La RéATE applique concrètement ce modèle. Elle institue l'échelon régional comme niveau pertinent d'élaboration et de pilotage des politiques territoriales. Les directions régionales doivent également assurer des fonctions ressources pour le niveau départemental opérationnel (Poupeau 2013). La question des compétences est ici cruciale, sans qu’elle soit réellement envisagée par la réforme. Par injonction, le niveau régional est institué comme le lieu où s’agence désormais l'action publique territoriale. Les agents régionaux doivent développer des fonctions d’intermédiation dans la conduite des politiques publiques. Olivier Nay et Andy Smith (2002) décrivent ces fonctions d’intermédiaires à travers l’activité du « courtier », qui consiste à obtenir une entente minimale et à organiser des rencontres et des échanges entre les acteurs ; et l'activité du « généraliste », qui cherche à construire du sens commun autour d’idées et de valeurs. Mais ces activités d'intermédiation, d'animation de réseaux, de pilotage politique, nécessitent des savoir-faire d'ordre technique et relationnel : construction de réseaux et de systèmes d'observation, analyse des besoins, détermination de priorités, évaluation, intégration des productions des différents niveaux…
En pratique, l’articulation entre l’échelon régional, qui dispose du contrôle de l’utilisation des moyens (en personnels et en crédits), et l’échelon départemental opérationnel, est particulièrement tendue dans le domaine de la Cohésion sociale[10]. On a pu constater des ruptures de dialogue entre les directions. La réforme descendante a déstructuré les fonctionnements intégrés des services de l’État. À ce titre, la suppression des Directions régionales et départementales de la Jeunesse et des Sports (DRDJS) dans les départements chefs-lieux de région pour recréer deux niveaux est particulièrement critiquée[11].
Par ailleurs, les acteurs du territoire restent dubitatifs quant à la capacité des directions régionales à instaurer un espace de coordination stratégique et opérationnel pour l’action publique locale. Les acteurs départementaux et locaux (directions départementales, collectivités territoriales, établissements, associations) s’accordent sur le fait que le niveau régional est trop lointain vis-à-vis de l’action et qu’il est illusoire d’envisager de coordonner l’action publique sans agents sur le terrain. Les propositions régionales sont alors considérées comme des orientations trop larges, manquant de sens et ne répondant pas aux exigences du terrain.
Enfin, les agents des DRJSCS soulignent les injonctions paradoxales auxquelles ils sont soumis entre les réductions d’effectifs et le maintien des missions sectorielles, entre la demande d’assurer ces nouvelles missions stratégiques, l’absence de soutien des administrations centrales et le manque de compétences sur le terrain pour ce faire.
Prescripteurs contre opérateurs : la recentralisation de l’action publique
On constate le rétrécissement des services de l’État dans les territoires. Les transferts de compétences vers les collectivités territoriales et l’externalisation des fonctions de guichet vers les opérateurs de politiques (associations, établissements) favorisent les logiques de prestation, l’utilisation des marchés publics, la délégation de services publics au privé.
Dans le domaine de la Cohésion sociale, cette logique est bien implantée et tend à se renforcer. Les gros opérateurs privés et associatifs répondent à des appels d'offres très importants pour la délégation ou l'exercice des services publics. Les interlocuteurs privilégiés de l’État sont ainsi de gros établissements et associations comme France terre d’asile, la Croix rouge, le 115-Samu social, la Fondation Abbé Pierre, les Fédérations d'éducation populaire, etc. Ces acteurs connaissent une forte montée en compétences et en emplois depuis les années 2000, ce qui les amène à revendiquer leur autonomie dans les choix effectués de mise en œuvre des politiques publiques déléguées.
Pourtant, l’État central continue de fixer des objectifs très précis pour les territoires et de contrôler la distribution des subsides (via les agences notamment). Paradoxalement, le retrait de l’État territorial s’accompagne d’un renforcement des injonctions de l’État central (Aust & Cret 2012). Les acteurs de terrain dénoncent ainsi des formes de recentralisation de l’action publique, à travers une formalisation des échanges avec l’État, des conditions de financements plus compliquées, des annexes techniques plus serrées et un contrôle a posteriori renforcé. On constate ainsi une formalisation du dialogue entre l’État « injoncteur » et « prescripteur » et ses opérateurs, des marges de manœuvre qui se réduisent pour les territoriaux et pour le développement local, une remise en cause de l’autonomie associative à travers ces logiques de prestations.
Identités professionnelles contre identités professionnelles
La fusion des administrations autour de la notion de Cohésion sociale a rapproché de fait un nombre important de corps de fonctionnaires et d'identités professionnelles. Ces corps sont autant de groupes professionnels, attachés à l'exercice autonome de leurs métiers, de fonctions précises et d'une expertise propre (Demazière & Gadéa 2009). Dans les nouveaux services, construits au pas de course, les agents ont été juxtaposés, sans travail de préparation ni réel soutien de la part des administrations centrales.
Le constat sans appel fait par les agents des nouveaux services est que la notion de Cohésion sociale n’arrive pas à faire tenir ensemble ces logiques d’action diversifiées. Le principal point de tensions, récurrent, concerne l’opposition entre deux approches contradictoires de la Cohésion sociale :
- Les pôles Action sociale, axés sur la gestion de l'urgence, orientent leur action sur le palliatif et la réparation sociale. Ils gèrent des subventions de plusieurs millions d’euros affectées à de gros établissements intégrant l’ensemble de la gestion des politiques sociales (associations gestionnaires, établissements d’accueil, etc.), considérés comme des « opérateurs » ou des « prestataires ».
- Les pôles Jeunesse et Sports, quasi dépourvus de budgets, développent une culture du préventif et du conseil, délivrés à de petites associations, clubs sportifs, centres de loisirs. Leur expertise se fonde sur le diagnostic territorial et la connaissance de l’environnement local. L’intervention de terrain de ses agents se fait dans l’interaction et sur le mode de la mise en réseau, ce qui leur permet un accompagnement des projets des acteurs intermédiaires et une évaluation compréhensive des conditions de réalisation de l’action.
Le déséquilibre entre ces deux logiques et la tendance récurrente des services et des Préfectures à prioriser la gestion de l’urgence sont considérés comme une menace pour les personnels de Jeunesse et Sports et leurs approches professionnelles. Huit ans après la mise en œuvre de la RéATE et la constitution des Directions de la Cohésion sociale, les logiques métiers et les anciens fonctionnements restent prégnants en leur sein. De nombreuses Directions départementales ont renoncé à élaborer un projet de service intégrant les différentes missions gérées par les agents.
Valorisation de l’innovation, dévalorisation des pratiques et du fonctionnement
Les processus de réformes managériales prônant la réorganisation ont pour conséquence de gommer les références au passé de l’institution. Le changement présenté comme hautement désirable se doit d’être innovant. « Il met en scène l’avenir comme seule temporalité acceptable pour l’organisation. En étant résolument anhistorique, en refusant d’appuyer la réflexion sur une intelligence du passé, l’approche managériale ne laisse pas de place au sujet commun. Le collectif n’est plus lié par son histoire, mais par le seul intérêt de chacun de ses membres. C’est un collectif fragile qui s’effrite dès que l’intérêt individuel entre en contradiction avec l’intérêt commun. » Le manager, qui seul maîtrise la complexité, devient le seul liant, le guide à suivre. L’adaptabilité des agents est présentée comme une nécessité pour la santé de la nouvelle institution, mais en réalité, cette approche remet en cause les compétences acquises par l’expérience. Il en résulte une remise en cause des pratiques professionnelles et, rapidement, une personnalisation du problème. « L’individu isolé et défaillant devient résistant au changement » (Simon 2012).
Les domaines d’action publique sont valorisés différemment selon le rapport qu’ils entretiennent avec l’innovation. Le développement durable ou le développement économique, réputés dynamiques, qui prônent une approche prospective, un fonctionnement en réseau, cluster, plateformes, bénéficient d’un soutien politique et d’intéressantes mannes d’investissement. Le domaine des politiques sociales, en revanche, plus classique, repose sur une bureaucratie professionnelle jugée trop importante, hiérarchisée, coûteuse. Ses coûts de fonctionnement jugés trop importants sont particulièrement visés par les objectifs gestionnaires de diminution des dépenses. Cette dévalorisation du fonctionnement augmente la méfiance par rapport à toute dépense et limite l’autonomie des agents.
3. Envisager les différentes facettes de l’institution pour imaginer une organisation plus agile
Cette partie propose quelques pistes d’analyse pour réfléchir de manière plus large aux implications des réformes organisationnelles. Un processus de fusion ou une réorganisation profonde du fonctionnement des services peuvent être approchés de différentes manières, se déclinant autour de quatre pôles : organisation, institution, professions, individu/sujet. Globalement, c’est en appréhendant le changement sous la forme d’un processus plutôt que comme un moment que les choses ont le plus de chance de bien se passer. On en vient in fine à l’action, qui doit être envisagée à travers les finalités et les buts qu’elle souhaite atteindre, plutôt qu’à travers la forme qu’elle se donne. Dans le secteur public, cette finalité reste le service public.
Situer l’organisation dans l’espace, dans le temps et à travers ses composantes humaines et professionnelles
Quatre approches complémentaires permettent d’analyser l’organisation et le changement, se déclinant de l’organigramme formel à l’individu.
a) De l’approche organisationnelle à l’approche stratégique
Il ne s’agit pas ici de nier l’apport de l’approche organisationnelle. L’étude de l’organisation formelle de la structure ou de l’institution, à travers son organigramme officiel, la hiérarchie établie, les fiches de poste, la circulation de l’information et les processus décisionnels, les procédures de gestion et de contrôle, le recensement des ressources humaines et financières constituent une base essentielle à une compréhension du fonctionnement organisationnel.
Cependant, la sociologie des organisations y a depuis longtemps ajouté la nécessité d’appréhender et d’étudier un certain nombre d’éléments concrets du fonctionnement des organisations. En plus de la description des éléments formels, officiels, écrits et juridiquement actés, l’analyse stratégique de l’organisation invite à se pencher sur son fonctionnement en situation et en actes. Une analyse compréhensive de l’organisation en train de fonctionner s’attache à étudier dans l’espace et dans le temps les processus de prise de décision, les équilibres de pouvoir selon les moments, les rapports de force qui se jouent entre des groupes d’acteurs plus ou moins organisés, les stratégies plus ou moins formelles d’accès aux ressources, l’utilisation des marges de l’organisation pour accéder à la prise en compte de ses intérêts propres.
Ainsi la description d’une journée de travail d’un cadre, par exemple, montre les marges d’autonomie dont bénéficie l’acteur, la manière dont il se saisit des contraintes de la situation, des incertitudes qui la caractérise, les interactions qu’il construit avec ses collaborateurs ou les acteurs externes, toujours orientées vers l’action. L’étude de ces « systèmes d’action concrets » permet de reconstituer les jeux qui se jouent au sein de l’organisation. Elle oblige à se poser la question : « comment les acteurs sont-ils concernés, comment confrontent-ils puis coordonnent-ils leurs points de vue sur les problèmes? » (Crozier & Friedberg 1977).
Ce raisonnement implique de penser l’organisation comme un système intégré de conduites, de comportements, d’acteurs interdépendants qui poursuivent des stratégies propres. Penser ces interactions de manière systémique permet, face à un dysfonctionnement, de montrer en quoi la conduite de l’acteur ou le mécanisme incriminé est en fait rationnel. Une dysfonction n’implique pas un coupable ou un vice de structure, mais une rationalité cachée s’articulant sur le système, qui peut être trouvée. Ainsi, pour qu’il y ait changement, il faut que l’ensemble des éléments retrouve une autre logique interactive (Amblard et al. 1996).
L’approche stratégique est donc une étude en situation des arcanes du fonctionnement organisationnel, s’attachant à l’étude des acteurs en situation, mettant en évidence l’importance des mécanismes stratégiques propres aux acteurs, quelque soit leur statut et leur rôle au sein de l’organisation, pour une meilleure compréhension de l’action.
b) De l’institution à l’analyse institutionnelle
Les institutions sont généralement envisagées comme des données monolithiques. Durkheim ou Marx en font des éléments fondamentaux de la vie en société et de l’organisation du pouvoir, structurées, structurantes et d’une solidité à toute épreuve. Elles sont des manières collectives d'agir et de penser ; elles ont leur existence propre en dehors des individus.
L’analyse institutionnelle, elle, envisage l’institution comme un processus en évolution permanente. Au sein même de l’institution, des forces instituantes essayent en permanence de modifier une situation instituée. L'évolutions construite selon ce processus dialectique est appelé institutionnalisation. Autrement dit, l’institution peut être définie comme un mécanisme d’ajustement permanent issu d’une confrontation entre ses forces internes. Le conflit, les rapports de pouvoirs, les négociations et ajustements permanents entre les parties, font partie intégrante de l’institution. Elle suit une trajectoire historique, cumulative, expérientielle, faite de moments et de rebondissements, autant d’éléments qui peuvent être utilisés pour analyser le présent et pour porter un regard réflexif sur l’état de l’institution.
Ce processus d’institutionnalisation doit être appréhendé largement, en prenant en compte l’environnement large de l’organisation : organisations alliées et opposantes, autres parties prenantes, etc. Ce processus vise à resituer l’organisation et ses composantes vis-à-vis de son histoire longue et dans un système d’acteurs en interdépendance. L’analyse institutionnelle est une démarche d’analyse qui vise à mettre à jour les rapports de pouvoir réels qui se camouflent sous la fausse banalité de l’évidence (Hess & Authier 1993).
c) Groupes professionnels, identités et sens au travail
Les professions traversent les problématiques organisationnelles et font référence pour l’individu. Elles reposent sur des pratiques qui légitiment leur constitution en groupes professionnels. Les professions doivent être analysées comme des « écologies liées » (Abbott 1988) : à la fois groupes fermés visant leur propre perpétuation et en lien de concurrence/collaboration les uns avec les autres. Ce fonctionnement renvoie à des problématiques d’identités professionnelles et nourrit la problématique du sens donné au travail.
Dans les corps de la fonction publique, l’identité professionnelle, les notions de « métier » et de « service public » sont fondamentales. Le sentiment de « remise en cause des cœurs de métiers » est souvent avancé dans les entretiens pour exprimer les changements auxquels sont confrontés les agents au sein des structures fusionnées. Est dénoncée également l’injonction paradoxale du maintien des missions, avec moins de moyens, de temps et d’agents pour les réaliser.
« Le métier est constitué des ressources, connaissances, doctrines, méthodes, qui ne s'imposent pas de façon innée, mais résultent d'apprentissages formels et informels. Ces ressources ne sont pas figées, mais s'inventent quotidiennement dans la pratique, et s'expriment dans des configurations locales très prégnantes. La prise en compte de ces problématiques du métier est donc facteur d'aisance et de santé dans le travail et dans l'activité productive » (Ughetto 2011).
Là encore, le mouvement et le processus sont convoqués. Le cadre interprétatif de la réorganisation managériale pense peu les pratiques professionnelles, l’autonomie des professions, voire s’en méfie. La bureaucratie professionnelle traditionnelle est considérée comme lourde, peu flexible, centrée sur ses propres intérêts. L’approche gestionnaire tend alors à instaurer des procédures de contrôle de l’activité dans ses moindres détails, remet en cause l’autonomie des professions, tente de fusionner les corps et les groupes, etc. Il en résulte une perte de sens à l’action dans les services, et parfois de la souffrance au travail. Yves Clot (2008) dénonce la généralisation de la souffrance au travail dans les organisations, qu’il estime partout liée à la même impossibilité : celle de donner aux collectifs de travail les moyens de définir et d’exercer un travail de qualité. Le modèle de la profession s’est construit autour de la revendication de l’autonomie de la définition du travail bien fait. La réflexivité, c’est à dire l’exigence de mener collectivement un « travail sur le travail » au sein du groupe professionnel, est un point fondamental du fonctionnement serein des organisations.
d) Les changements organisationnels et l’individu
À côté du statut, du rôle et de la fonction dans l’organisation, se joue également la question de la place de l’individu (Herfray 1993). L’implication de l’individu dans l’organisation est une condition du fonctionnement de celle-ci. Elle repose sur un accord tacite autant que contractuel de l’individu sur les conditions de travail, mais aussi sur les finalités de l’action. « Le sujet n’est pas seulement un acteur positif dans une optique de production. Le sujet est objet de désir, confronté à des manques, pris dans des conflits internes, défendant son intégrité, c’est-à-dire un sujet vivant et psychiquement pris dans un ensemble intersubjectif. L’individu n’est pas réductible à un objet de management, si participatif soit-il » (Simon 2012). En tant que sujet, il est traversé par des ressentis, concerné par le sens que prend son action, peut être soumis à des réactions irrationnelles.
Les contextes de crise des organisations et institutions sont ceux où l’aspect irrationnel du comportement des individus prend une place prépondérante et mine le fonctionnement du collectif. L’organisation et le management entrent ainsi dans des spirales négatives de réactions formelles à des comportements irrationnels, qui peuvent empirer les choses plutôt que les apaiser.
Une forme d’évitement parmi les plus courantes dans les organisations consiste à évacuer des discours institutionnels tout ce qui touche aux fondements de l’action, aux individus, pour ne conserver comme objet de la parole que l’aspect formel, organisationnel. Il y a là une perte de la maîtrise de l’action au profit de la maîtrise de la forme. « Lorsqu’une direction ne maîtrise pas la tache primaire de l’institution, elle cherche alors à maîtriser les hommes. Lorsqu’elle perd sa capacité d’intervention sur la raison d’être d’une institution, il n’est pas rare qu’elle entre dans un contrôle tatillon des actes et des horaires de travail qui se présente avec la prétention de faire travailler les acteurs de terrain » (Simon 2007).
Penser l’organisation publique à partir des objectifs d’action qu’elle se fixe
Trois pistes d’action pour envisager le changement et l’évolution de l’organisation.
a) Penser simultanément le management public et l’analyse de politiques publiques
L’approche organisationnelle du management public, que nous critiquons depuis le début de cet article, doit s’ouvrir davantage à l’analyse et à l’évaluation des politiques publiques.
Focalisée sur le management des organisations, l’approche managériale a comme postulat de départ la parenté des problèmes de gestion entre tous les types d'organisations, quelles que soient leurs finalités. En termes pratiques, cela se caractérise par une observation permanente des nouveautés - plus ou moins réelles - de démarches, méthodes, principes d'action, instruments de gestion qui se développent notamment au sein de l’entreprise, considérée comme le milieu le plus dynamique. « Le problème central est celui des limites à la pertinence de ce transfert et/ou des adaptations nécessaires aux démarches importées pour tenir compte des particularités de l'action publique et des organisations publiques » (Gibert 2002). En effet, l’entreprise a une finalité essentiellement interne, visant la réalisation de profit. Le secteur public a quant à lui une finalité exclusivement externe, visant la régulation, le changement ou la préservation des états de la société. Quand la gestion publique n’est plus orientée que vers l’interne, elle se limite à poursuivre des objectifs seconds, souvent quantifiés. Un déplacement des buts s’opère avec la dépublicisation de la gestion publique, vidée de son sens (Gibert 1994).
À ce sujet, Valérie Boussard (2001) développe l’exemple de l’importance prise par les indicateurs de gestion dans la régulation des institutions publiques telles que les Caisses d’allocations familiales. Alors que l’action des CAF est mesurée à travers des dizaines d’indicateurs de gestion, les investigations de la chercheuse démontrent l’importance prise par un seul de ces indicateurs, relatif à une partie spécifique de l’activité, qui irradie pourtant dans toute l’organisation. Cet indicateur est le « stock-retard », qui mesure le retard dans le traitement des dossiers par le service Prestations et les liquidateurs de dossiers, ces agents qui versent les prestations aux bénéficiaires. L’indicateur « stock-retard » devient alors « prégnant », focalisant l’attention sur le travail de traitement des dossiers, qui devient la mesure phare du fonctionnement de l’organisation, alors même que les agents liquidateurs ne représentent qu’une partie des activités de la CAF – on pense notamment à son rôle d’action sociale et la dimension relationnelle du travail d’autres personnels. La chercheuse dénonce alors les effets pervers d’un « gouvernement par les indicateurs » où l’objectif premier de l’action publique devient l’atteinte de certains seuils pour une poignée d’« indicateurs prégnants », au détriment du sens et des résultats réels et nécessairement plus globaux de la politique publique (Boussard 2001).
Il apparaît opportun alors d’envisager l'étude des conditions concrètes dans lesquelles les autorités publiques déploient l’action publique. L’analyse de politiques publiques s’intéresse à l’ensemble de la chaîne d’application des politiques publiques, depuis l'inscription à l'agenda d'une situation faisant problème jusqu'à la réalisation ou la non-réalisation d'une évaluation. Elle questionne la conception, la mise en œuvre, la finalité des politiques, les logiques de services, les envisageant comme un ensemble tourné vers l’action, intégrant toutes les parties prenantes de la tête pensante au prestataire opérationnel. Elle a pour objectif de proposer des pistes d'amélioration du management des affaires publiques. On constate ainsi une proximité entre le management et l’analyse de politiques publiques. Penser cette complémentarité entre les deux approches est susceptible d’enrichir considérablement l’action publique, d’envisager concrètement une évaluation utile et constructive des politiques publiques, et de nourrir la finalité du service public (Gibert 2002).
b) Envisager des administrations plus légères, plus agiles, plus autonomes
Un management public plus à l’écoute des finalités de l’action dans le secteur public est susceptible de prêter attention aux critiques qui émanent de la part des agents intermédiaires, opérationnels ou des prestataires de terrain.
La taille des administrations fusionnées, souvent importante, conduit à une centralisation des fonctions de directions. L’exécutif des administrations publiques, à l’image de l’exécutif français, est centré sur le président (et son cabinet). Les circuits de décision, verticaux, sont considérablement allongés. Des propositions simples, émises par les agents proposent de réduire le circuit du parapheur. Cela peut passer par exemple par une plus grande autonomie laissée aux chefs de projets et chefs de missions ou par une délégation plus importante de pouvoir aux adjoints ou vice-présidents. La rapprochement des élus et des services techniques autour de mandats d’action publique semble une piste d’amélioration pertinente pour l’action publique. La renégociation des conventions d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et les associations sociales et socioculturelles lyonnaises à la fin des années 2000 propose un exemple de mobilisation forte du « système d’action politico-administratif » entre l’adjoint à la Vie associative, bénéficiant d’un mandat du maire de Lyon sur ce dossier, et de la mission Vie associative. Les outils de suivi technique élaborés par le service (étude d’impacts, évaluation des conventions, analyse des besoins) sont utilisés pour élaborer la stratégie politique permettant la renégociation en interne et avec les associations. On voit alors comment une administration de mission peut être mobilisée par un élu bénéficiant d’un mandat pour négocier au nom de l’intérêt communal (Angot 2011, Grillet 2012).
La sensation de verticalité et d’éloignement des services administratifs vis-à-vis du commandement est renforcée par deux phénomènes. Le premier est un manque d’intérêt de la ligne hiérarchique au sein de l’administration pour la mise en œuvre opérationnelle des projets. Focalisée sur les problématiques de gestion, de coûts et de maîtrise de l’information, la hiérarchie se désintéresse de la mise en œuvre opérationnelle des projets (temporalités, moyens, techniques, contradictions éventuelles). Il en résulte un manque de soutien des agents, chargés de missions ou de projets, en position d’intermédiation entre les diverses parties prenantes de l’action publique (prestataires, autres institutions publiques et privées), mais néanmoins dépendants de la hiérarchie interne. Le second phénomène d’éloignement est lié à la mutualisation des fonctions supports (secrétariat, ressources humaines, ressources financières, services informatiques et de gestion), qui se traduisent parfois par une diminution importante des effectifs de secrétaires et d’adjoints administratifs et par un éloignement des directions métiers. Celles-ci ont parfois l’impression de devoir quémander des moyens et du soutien auprès de plateformes gigantesques et opaques. Davantage de soutien peut être accordé aux agents intermédiaires en situation de mise en œuvre.
Enfin, l’accompagnement des évolutions professionnelles des agents est un point important d’amélioration du fonctionnement des organisations publiques. Les cadres constatent une évolution importante de leur rôle de la prescription vers l’animation/coordination de projets, intégrant davantage de transversalité et une dimension de participation citoyenne. Cela tout en restant dans les lignes hiérarchiques de l’administration traditionnelle (Barrier et al. 2015). Les agents techniques constatent l’évolution de leurs rôles de la spécialisation professionnelle vers une demande croissante de polyvalence, intégrant divers secteurs de politiques. Dans le secteur social notamment, les éducateurs intègrent davantage de données et un suivi plus précis des publics qu’ils reçoivent, qui impose de faire évoluer leurs connaissances et de confronter davantage leurs pratiques avec leurs pairs (Fustier 2012). Ces évolutions du travail demandent un accompagnement de la part des services de formation, une attention particulière portée au développement de la réflexivité sur le travail et sur l’autonomie au travail des professionnels.
c) Envisager les fusions comme des processus d’apprentissage organisationnels
En faits, la fusion déplace les frontières entre secteurs et objets de l’action publique. Elles créent de la désorganisation et de l’incertitude, qu’il est nécessaire d’appréhender pour faire évoluer l’institution vers un nouveau fonctionnement. Elle crée une période de transition pendant laquelle les fonctionnements sont remis sur le tapis. Elle constitue un moment privilégié d’interrogation sur le sens de l’action de l’organisation. On constate qu’elle est rarement appréhendée comme un moment d’apprentissage, davantage imposée « d’en haut », les salariés étant censés faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité pour intégrer le changement.
Les fusions, comme processus de transition, peuvent ainsi être pensées comme des moments de remise à plat du fonctionnement, permettant de repenser l’institution par rapport à elle-même, au-delà de son organisation. Deux attitudes existent par rapport à l’apprentissage organisationnel :
L’évolution organisationnelle procède traditionnellement du développement de routines administratives. Dans cette conception, le changement est lent, procède par hybridations et par sédimentations au fil du temps. Une analyse de ce processus d’apprentissage montre l’importance des interactions collectives qui produisent des évolutions de comportements. Elle prête attention aux formes, règles, procédures, conventions, stratégies et technologies autour desquelles les organisations, se (re)construisent. Mais également, sur les plans individuel et collectif, sur les structures de croyances, les fondements, les paradigmes, les visions du monde (référentiels), les codes, les cultures, les savoirs, qui soutiennent les routines formelles (Levitt & March 1988).
Une seconde théorie de l’apprentissage organisationnel est élaborée notamment par Chris Argyris et Donald Schön (1988). Plus proactif que celui des routines, ce concept fait référence aux connaissances, savoir-faire, techniques et pratiques diverses qu'une organisation peut développer et mettre en œuvre pour faire évoluer son positionnement stratégique. Cette théorie renvoie aux individus qui composent l'organisation et au degré d'engagement des agents dans le processus d'apprentissage collectif. Les auteurs théorisent l'importance d'une « double boucle » d'apprentissage. Pour eux, il ne suffit pas d'une simple évolution des variables d’administration pour engager un apprentissage organisationnel :
1. La plupart des processus de changement se contentent de simples modifications des normes existantes et de la stratégie d'action. Le changement se fait alors de manière relativement descendante et suscite des réactions défensives de la base. Cela compromet le potentiel de croissance et l'apprentissage.
2. La double boucle d'apprentissage correspond à une remise en question des normes du système, contestées et modifiées, puis engendrant une adaptation. Le paradigme même de l’action et des représentations du fonctionnement de l’institution doit être requestionné. Cela comporte plus de risques en ce qui concerne les confrontations potentielles au sein de l'organisation, mais le travail sur le sens qui résulte de ces confrontations constitue un réel apprentissage organisationnel.
La démarche de l’administration apprenante implique que la modernisation ne vienne pas que du haut, mais d’un échange entre le centre et le terrain. Les outils et méthodes doivent être mis en œuvre, évalués, capitalisés et suffisamment appropriés pour que les services (ou les partenaires) s’en emparent sans « consigne » centrale et sachent faire les évolutions nécessaires au regard d’objectifs et enjeux qu’ils participent à construire.
Par exemple, les démarches d’Analyse de pratiques professionnelles, développées depuis longtemps dans la formation au travail social (groupes de travailleurs sociaux en activité se réunissant pour analyser ensemble leurs pratiques) ou dans les métiers de l’éducation (IUFM, animation, éducation populaire) proposent des espaces réflexifs aux praticiens, partant du principe que l’action et l’expérience de l’action sont sources de connaissances au moins autant que les savoirs théoriques de la formation initiale. Si la dénomination « analyse des pratiques » renvoie à des dispositifs très variés, certaines démarches permettent d’interroger les cadres et modèles d’action traditionnels qui orientent les pratiques au travail. Réunis en groupe ou en équipe, les professionnels interrogent à la fois leurs pratiques et les savoirs qui se constituent dans l’expérience. « Ces démarches partent du principe qu’une partie importante du travail ne peut être prescrite, quand le praticien est dans l’obligation de construire en permanence des réponses adaptées à des situations toujours singulières. » Elles sont aussi identifiées comme un moyen de professionnalisation, dans le sens où elles permettent de « travailler la dimension identitaire dans la construction du métier » (Lagadec 2009). Considérant que les situations professionnelles sont marquées par la complexité, l’incertitude ou les conflits de valeurs, que les problèmes n’arrivent pas tout déterminés entre les mains du praticien, celui-ci doit savoir reconstruire le problème en un problème qu’il peut résoudre. Donald Schön (1994) montre l’importance d’un « praticien réflexif », capable de construire un cadre de lecture des situations (une problématisation), des hypothèses envisageant différents cadres pour l’action et une analyse de l’action et des résultats obtenus.
***
Cet article montre l’ampleur des impensés des réformes de modernisation de l’administration, envisagées souvent à travers une réorganisation purement formelle des collectifs de travail : fusions de services, intégration hiérarchique, réductions des effectifs, réduction des coûts. L’exemple des fusions de services dans le secteur de la Cohésion sociale et dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques est mobilisé pour montrer le déficit de prise en compte des problématiques de légitimité managériale, de division des tâches, de remise en cause des professions, de redéfinition des partenariats.
Nous montrons que les réorganisations génèrent de la désorganisation. Nous critiquons radicalement le manque de préparation, de prospective, de stratégie, inhérent à ces réformes pensées avant tout comme des évolutions de structures et d’organigrammes. Dans ces périodes de transitions permanentes et de réformes à répétition, l’État reste centré sur lui-même, cherchant à reconstruire des routines administratives et à panser ses plaies. Dans ce contexte, l’apprentissage organisationnel, interrogeant de manière réflexive les pratiques et l’historicité de l’institution, est peu encouragé. Cela donne lieu à un arrêt partiel de la production de services publics dans les territoires.
Nous montrons enfin que les problématiques auxquelles sont confrontées les fonctionnaires révèlent moins la résistance au changement que la problématique du sens donné au travail à des fins publiques. Quelle que soit l’organisation, l’action publique doit penser sa finalité d’action. Et cette finalité du service public a besoin des savoir-faire professionnels des agents pour être assurée.
Bibliographie
ABBOTT Andrew (1988), The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, University Of Chicago Press
AMBLARD Henri, BERNOUX Philippe, HERREROS Gilles, LIVIAN Yves-Frédéric (1996), Les nouvelles approches sociologiques des organisations, Paris, Seuil
ANGOT Sylvère (2011), « L’évaluation comme processus stratégique orienté vers le changement : un partenariat en situation de tension entre une collectivité et ses associations », Communication aux Journées françaises de l’Evaluation, Nantes, 30 juin
ARGYRIS Chris, SCHÖN Donald (2002) [1996], Apprentissage organisationnel. Théorie, méthode, pratique, Paris, DeBoeck Université
AUST Jérôme, CRET Benoît (2012), « L’Etat entre retrait et réinvestissement des territoires. Les Délégués régionaux à la recherche et à la technologie face aux recompositions de l’action publique », Revue française de sociologie, n°53
BARDACH Eugene (1998), Getting Agencies to Work Together, Washington, Brookings Institution,
BARRIER Julien, PILLON Jean-Marie, QUERE Olivier (dir.) (2015), « Les cadres intermédiaires de la fonction publique », Gouvernement et action publique, n°4, vol.4
BEZES Philippe (2005), « Le modèle de "l’État-stratège" : genèse d’une forme organisationnelle dans l’administration française », Sociologie du travail, n°47, pp.431-450
BEZES Philippe (2009), Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, Presses Universitaires de France
BEZES Philippe (2012), « Etat, experts et savoirs néo-managériaux », Actes de la recherche en sciences sociales, n°193, pp.16-37
BEZES Philippe, LE LIDEC Patrick (2010), « L’hybridation du modèle territorial français. RGPP et réorganisations de l’État territorial », Revue française d'administration publique, n°136
BEZES Philippe, LE LIDEC Patrick (2016), « Politiques de la fusion. Les nouvelles frontières de l’État territorial », Revue française de science politique, n°66, vol.3, pp.507-541
BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve (2001), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Seuil
BOUSSARD Valérie (2001), « Quand les règles s’incarnent. L’exemple des indicateurs prégnants », Sociologie du travail, n°43, pp.533-551
BOUSSARD Valérie (2008), Sociologie de la gestion. Les faiseurs de performance, Paris, Belin
CALMETTE Jean-François (2008), « La LOLF comme nouvelle approche des politiques publiques », Informations sociales, CAF, n°150, pp.22-31
CHISHOLM Donald (1989), Coordination without Hierarchy. Informal Structures in Multiorganizational Systems, Berkeley, University of California Press
CLOT Yves (2008), Travail et pouvoir d’agir, Paris, PUF
CROZIER Michel, FRIEDBERG Ehrard (1977), L’acteur et le système, Paris, Seuil
DEBAR Anne (2011), « Les transformations de l’État territorial (2007-2010), saisies par l'analyse de l'activité des directeurs départementaux en matière de gestion des personnels », Thèse de doctorat de sociologie, sld. Gilles JEANNOT, Université Paris Est
DEMAZIERE Didier, GADEA Charles (dir.) (2009), Sociologie des groupes professionnels, acquis récents, nouveaux défis, Paris, La Découverte
DUNLEAVY Patrick (1991), Democracy, bureaucracy and public choice, Londres, Harvester Wheatsheaf
DUPUIS Alain, FARINAS Luc (2010), « La gouvernance des systèmes multi-organisationnels. L'exemple des services sanitaires et sociaux au Québec », Revue française d’administration publique, n°135, vol.3, pp.549-565
FUSTIER Paul (2012), « L'interstitiel et la fabrique de l'équipe », Nouvelle revue de psychosociologie, n° 14, vol.2, pp.85-96
GIBERT Patrick (2002), « L'analyse de politique à la rescousse du management public ? Ou la nécessaire hybridation de deux approches que tout, sauf l'essentiel, sépare », Politiques et management public, n°20, vol.1
GIBERT Patrick (1994), « Ménager la publicitude », Communication à l’Ecole de Paris du management, 24 avril
GRILLET Sven (2012), « Cohésion sociale, territorialité et observation », Note de travail pour la constitution d’un observatoire du développement territorial, Ville de Lyon
HERFRAY Charlotte (1993), La psychanalyse hors les murs, Desclée de Brouwer
HESS Rémi, AUTHIER Michel (1993), L'analyse institutionnelle, PUF
HOOD Christopher (1983), The Tools of Government, Londres, Macmillan Press
HOOD Christopher (1991), “A Public Management For All Seasons?”, Public Administration, n°69, vol.2, pp.3-19
KITCHENER Martin, GASK Linda (2003), « NPM Merger Mania : Lessons from an Early Case », Public Management Review, n°5, vol.1, pp.19-44
LAGADEC Anne Marie (2009), « L’analyse des pratiques professionnelles comme moyen de développement des compétences: ancrage théorique, processus à l’œuvre et limites de ces dispositifs », Recherche en soins infirmiers, n° 97, vol.2, pp.4-22
LAMARZELLE Denys (2008), Management public et modernisation des services publics, Europa
LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick (dir.) (2004), Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris
LEVITT Barbara, MARCH James (1988), “Organizational Learning”, Annual Review of Sociology,
LINDBLOM Charles (1959), “The science of muddling through”, Public Administration Review, n°19, vol.2
LINDBLOM Charles (1965), The Intelligence of Democracy, New York, the Free Press
MERTON Robert K. (1940), “Bureaucratic Structure and Personality”, Social Forces, n°17, pp.560-568
MILLY Bruno (2012), Le travail dans le secteur public. Entre institutions, organisations et professions, Presses Universitaires de Rennes, Collection Didact Sociologie
MINTZBERG Henry (1982), Structure et dynamique des organisations, Paris, Les éditions d’organisation
NAY Olivier, SMITH Andy (dir.) (2002), Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans l’action publique, Economica, Paris
POLLITT Christopher, BOUCKAERT Geert (1999), Public Management Reform : A Comparative Analysis, OUP Oxford
SCHÖN Donald A., (1994) [1983], Le praticien réflexif, à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montréal, Les Editions Logiques
SIMON Bruno (2007), « Eléments pour une distinction opérationnelle entre crise et conflit », Cahier de l’actif, n°358/361
SIMON Bruno (2012), « Le management face aux crises : la représentation d'un sujet défaillant »Nouvelle revue de psychosociologie, n° 13, vol.1, pp.181-193
SPENLEHAUER Vincent (1999), « Intelligence gouvernementale et sciences sociales », Politix, n°48, vol.12, pp.95-128
UGHETTO Pascal (2011), « Pour ne pas se tromper de gestion de la santé au travail. Les niveaux d’un management attentif au "métier" », Revue française de gestion, n° 217, vol.8