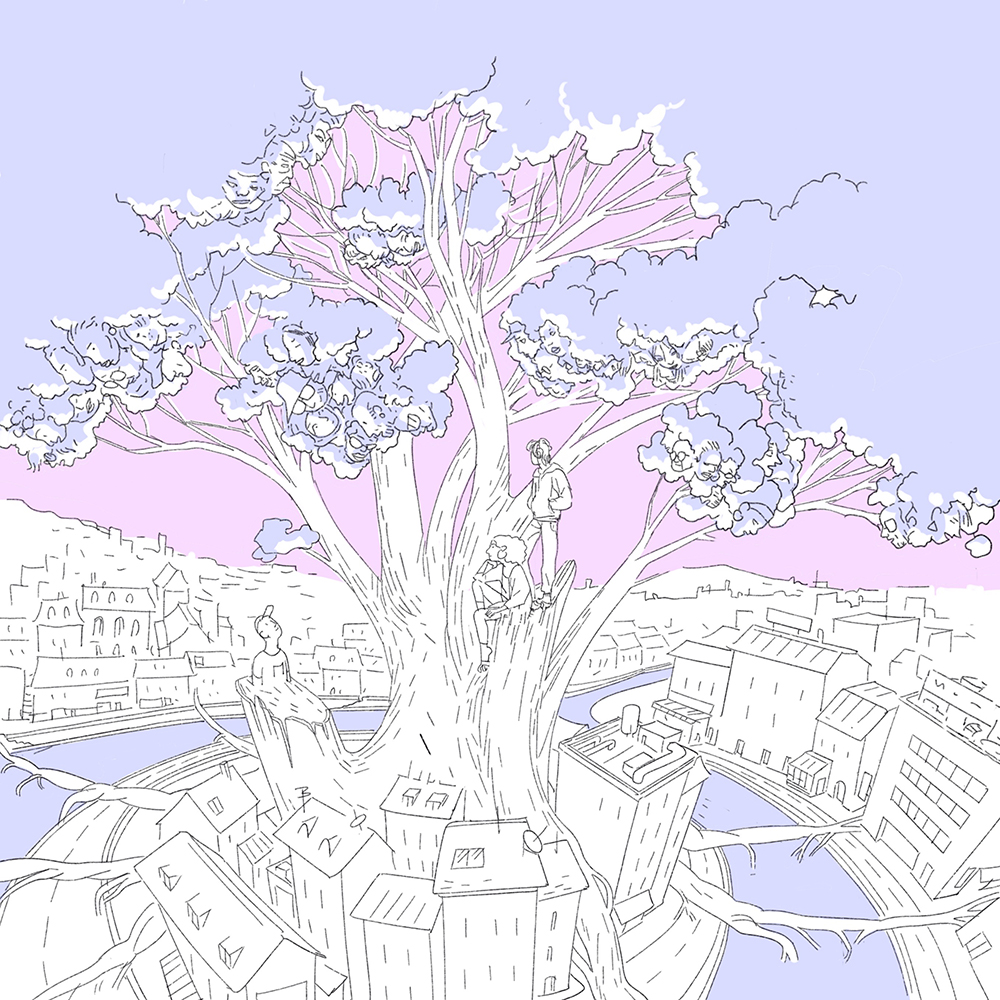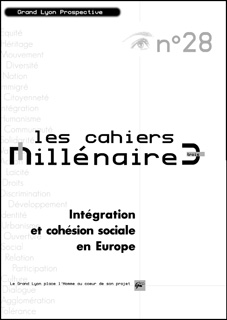La plupart de nos débats sont alimentés par une profonde angoisse sur la nature même de la société et sur ce qui fait que nous vivons ensemble, solidaires en dépit de toutes les forces qui nous séparent et nous dispersent. La sociologie est née, après les ruptures révolutionnaires, de la question de savoir de quoi est faite la vie sociale, si l’ordre social n’est plus ni sacré ni naturel. La première réponse est l’idée même de société. La vie sociale est perçue comme un ensemble organique, fonctionnel, dans lequel la division du travail sépare les individus, tout en les inscrivant dans un ordre cohérent où chacun est nécessaire, défini et reconnu par son utilité et sa fonction. Mais pour que ce système social soit pleinement intégré, il faut aussi que les individus partagent des valeurs et des croyances communes et que des institutions créent des symboles et des sentiments d’appartenance capables de résister aux effets destructeurs et atomisant du capitalisme. À terme, l’intégration sociale est conçue comme l’ajustement des individus à leur position sociale. Cette conception a conduit à identifier la République aux institutions de socialisation, notamment à l’école. La société étant associée à la nation incarnée par la République qui a éradiqué les patois, créant une culture commune, un patriotisme, une foi dans le progrès, mais ne visant nullement à bousculer l’ordre social. La seconde réponse, qui se conjugue souvent à la précédente, porte une formule plus politique qu’organique. Les sociétés modernes étant dominées par l’égalité, la liberté et la diversité des intérêts, par la lutte des classes, l’intégration sociale est produite par des mécanismes d’institutionnalisation politique.
Dans cette configuration, la démocratie tient la société. Ce sont les associations, notamment les syndicats et les partis représentatifs, qui fabriquent l’intégration sociale en institutionnalisant progressivement les demandes sociales, en créant des droits sociaux, en forgeant l’État-providence, en protégeant successivement les groupes les plus démunis.
La solidarité républicaine comme fil conducteur du récit social
Ces deux visions se sont combinées et se sont articulées autour du thème de la solidarité républicaine. Elles sont à l’origine de plusieurs croyances et récits sociaux qui sont particulièrement forts en France, et vivants à gauche où la défense de la République, des droits sociaux et de l’école républicaine ont été mêlées dans un imaginaire commun porté par le mouvement ouvrier et la petite bourgeoisie d’État. Parmi les récits nationaux canoniques et aujourd’hui quasiment sacrés : l’intégration nationale par l’école et par la promotion de l’élitisme républicain. Un autre récit est celui des conquêtes sociales : les grandes grèves, Juin 1936, la Libération, Mai 1968 ont transformé des conflits en acquis. C’est aussi le récit du « creuset » français dans lequel l’intégration des travailleurs immigrés se faisait par l’école et par le travail, au prix d’une dilution des identités culturelles dans un modèle français à la fois universel, national et laïque. Le changement le plus décisif est venu sans doute du déclin des capitalismes nationaux maîtres de leur monnaie et de leurs frontières, capables de pratiquer les politiques keynésiennes. Dans cette nouvelle phase de développement du capitalisme, l’État-nation a abandonné une part de sa souveraineté, dans la mesure où il dépend de plus en plus d’instances supranationales. Il a perdu aussi une part de son homogénéité culturelle avec l’entrée dans des sociétés plurielles, dans lesquelles la mobilité, les métissages culturels et l’attachement aux droits individuels déstabilisent la vieille image de l’intégration sociale et nationale. Et sur ce plan, une société aussi culturellement homogène que la société française est particulièrement déstabilisée.
Une mutation vécue comme une menace
De manière générale, cette mutation est vécue comme une menace et une nécessité. Elle engendre un sentiment de crise, de dégradation et de déclin. Les sondages indiquent avec constance que les Français ont le sentiment que tout va toujours plus mal. Ces changements ne sont pas seulement de l’ordre de l’imaginaire et des représentations. Les grandes institutions sont en crise, alors même que leur emprise sur la société n’a cessé de s’étendre. Or toutes ces institutions, l’école, l’hôpital, la justice sont moins définies par les valeurs qu’elles incarnent que par leurs capacités de répondre aux demandes, inépuisables et parfois contradictoires, des usagers. Alors qu’elles n’ont jamais été aussi performantes, elles sont critiquées de toute part : elles créent des inégalités, ne résolvent guère les problèmes sociaux, sont soumises à des changements continus… Aussi les professionnels des institutions républicaines se sentent-ils menacés, ont-ils l’impression de perdre leur légitimité et leur autorité quand ils n’incarnent plus l’intégration sociale.
Nous avons une conscience aiguë des nouveaux problèmes sociaux. Les inégalités entre les classes d’âges, entre les régions, entre les sexes, entre les groupes culturels, peu visibles ou plus ou moins supportées, nous paraissent scandaleuses et choquantes. Jusque-là subsumées par les seules inégalités de classes, elles émergent comme des problèmes nouveaux. Les sciences sociales et la statistique jouent un grand rôle dans la prise de conscience de ces nouvelles lignes de clivage et, surtout, elles soulignent la façon dont les institutions chargées de produire de l’intégration participent parfois à la construction de ces inégalités, contribuant ainsi au désenchantement. Par exemple, bien que l’école soit plutôt moins inégalitaire qu’autrefois, les inégalités scolaires sont de moins en moins tolérées.
Le changement le plus sensible est sans doute le passage d’une question sociale identifiée à la question ouvrière, vers une question urbaine incarnée par les banlieues et les émeutes des jeunes. On parle moins d’exploitation que d’exclusion, d’inégalités que de ghettos, de culture populaire que de différences culturelles… Dans une large mesure, nous retrouvons la figure des « classes dangereuses » où se mélangent pauvreté, relégation, dépendance, délinquance et révoltes sociales. Au moment où les politiques de la ville conduites depuis plus de vingt ans ont déçu, la question de l’intégration nationale et culturelle se mêle à la vieille question sociale et les acteurs s’en saisissent en évoquant l’histoire coloniale française. Au bout du compte, ce sont les mécanismes mêmes de l’intégration sociale qui semblent se défaire. Ces problèmes et ce climat changent nos perceptions de la justice sociale. Le thème de l’égalité des chances se substitue progressivement, y compris à gauche, à celui de l’égalité sociale, pendant que les enjeux de la discrimination positive, qu’elle soit plus ou moins cachée derrière des politiques sociales générales, finissent par s’imposer dans les esprits. En réalité, tous ces changements sont fondamentaux, car nous pensons moins en termes d’intégration qu’en termes de juste distribution ou, pour le dire plus brutalement, d’inégalités justes.
L’individu n’est plus l’ennemi
La fin du modèle ancien de l’intégration se recompose par le biais de la notion de cohésion sociale. Une de ses caractéristiques est qu’elle déplace l’action publique des institutions vers les individus. La bonne société est moins la société intégrée que la société bonne pour les individus qui la composent. Il s’agit moins de donner des garanties et des positions que de développer des moyens d’agir. Considérant que les sociétés sont plus mobiles, il faut armer les individus plutôt que de leur offrir des protections dans un ordre social stable. D’où l’insistance sur la formation, sur l’éducation de base, sur l’empowerment, sur les « capabilités » des individus (selon le terme de l’économiste Amartya Sen), afin que ces individus disposent de ressources et de capacités d’agir en fonction de ce qu’ils trouvent bon. Évidemment, dans ce modèle, l’individu n’est plus l’ennemi qui atomise la société, il est l’acteur de base de la vie sociale, alors qu’il était l’ennemi égoïste et cynique de l’intégration.
La cohésion choisit la mobilité contre l’assignation aux positions. Beaucoup se demandent s’il est sage de défendre une mixité urbaine que nous sommes incapables de réaliser, alors qu’il faudrait assurer la mobilité des groupes et des individus. Quand on les interroge, les habitants des grands ensembles de banlieues défavorisées ne se plaignent pas toujours des équipements publics et sociaux — parfois de bonne qualité. Ils jugent intolérable d’être assignés à résidence, incapables de partir et de bouger dans l’espace urbain. De manière générale, le modèle de la cohésion sociale suppose que les acteurs puissent agir, se déplacer, bouger, changer d’emploi, se former afin d’être actifs et responsables de leur propre vie.
Les politiques publiques universelles deviennent ciblées, combinant l’action de l’État à celle de la société civile et des associations. Évidemment, ces politiques plus mixtes, plus décentralisées et plus éphémères sont souvent vécues comme un abandon à la toute-puissance et à la rationalité de l’État. Pourtant elles visent à développer la mobilisation des associations, des segments de l’État, des individus dont on attend qu’ils produisent la cohésion sociale, des manières de vivre et d’agir ensemble. Beaucoup voient dans cette orientation un recul de l’État et de l’intégration.
Les organismes internationaux comme l’Europe, l’OCDE et la Banque mondiale construisent aujourd’hui une véritable théorie de la cohésion sociale à travers un ensemble d’indicateurs comparant les divers pays. L’égalité et l’adhésion aux mêmes valeurs ne suffisent plus. Il importe que les sociétés soient actives et confiantes, que les institutions soient efficaces en termes économiques, qu’elles permettent l’adaptation et la mobilité. Dans la société de la connaissance, l’éducation consiste moins à cloner les individus pour les intégrer qu’elle ne vise à produire une capacité de développement économique. On discute moins de savoir si les inégalités sociales sont justes ou injustes que de savoir si elles sont « supportables » et utiles à l’économie ; on discute moins des valeurs de l’éducation que de l’efficacité et de l’équité de l’école. À terme, alors que l’intégration sociale supposait de socialiser le capitalisme, de « l’enchâsser dans la société » selon l’économiste Karl Polanyi, la cohésion sociale renverse le raisonnement en affirmant que la vie sociale doit être favorable au développement du capitalisme et à la survie des sociétés dans une compétition généralisée. Il serait assez tentant de ne voir dans la cohésion sociale qu’une des multiples ruses du néolibéralisme. Ce serait à la fois facile et dangereux. Facile, parce que cette position conduit à conférer au modèle de l’intégration un ensemble de vertus qui tiennent plus de la nostalgie que des faits. Dangereux, parce qu’il y a peu de chances que l’identification de la société et de l’État-nation résiste longtemps aux mutations économiques et culturelles. Dès lors, il s’agit moins de refuser le modèle de la cohésion sociale que de lui donner un contenu démocratique et solidaire, ce qui suppose, à gauche notamment, beaucoup de courage et d’imagination. •