Le skate et sa mise en images
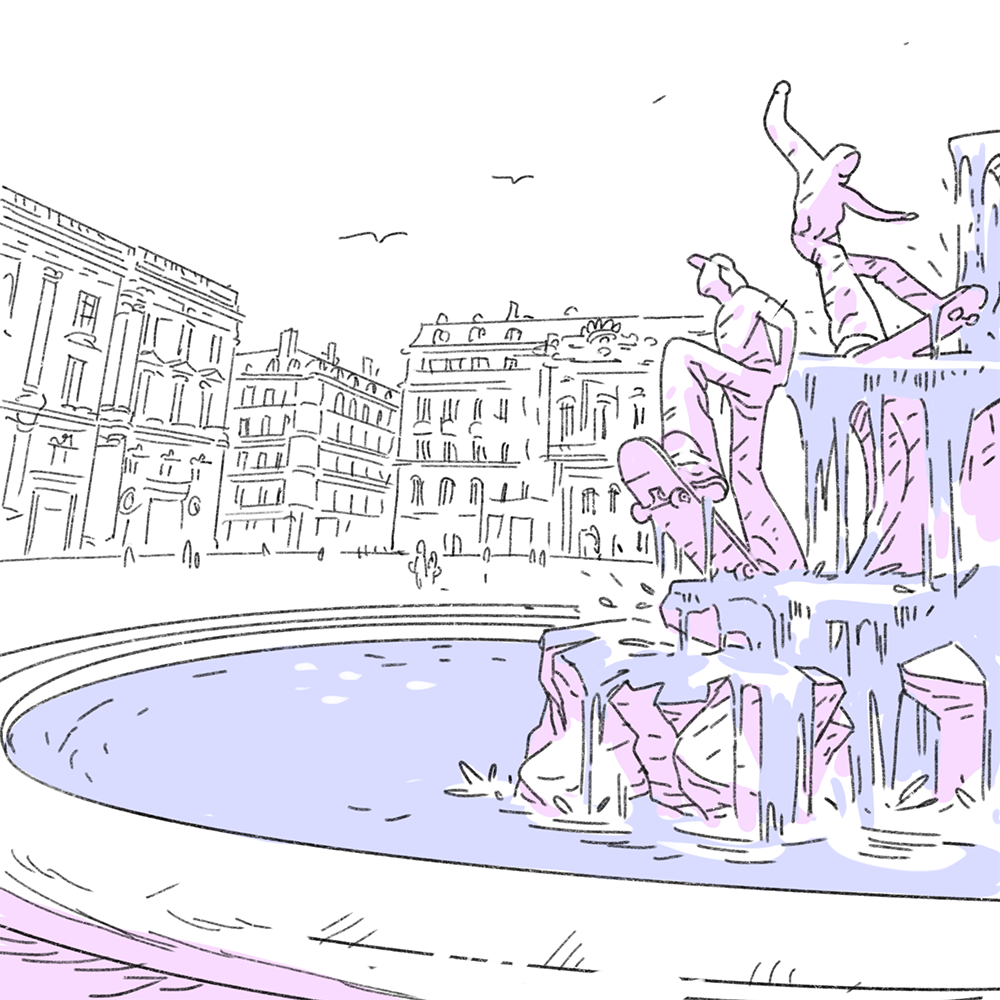
Article
En étudiant les rôles de la mise en images du skateboard, cet article vise à faire émerger des places qui peuvent être accordées à cette pratique dans la ville.
< Retour au sommaire du dossier
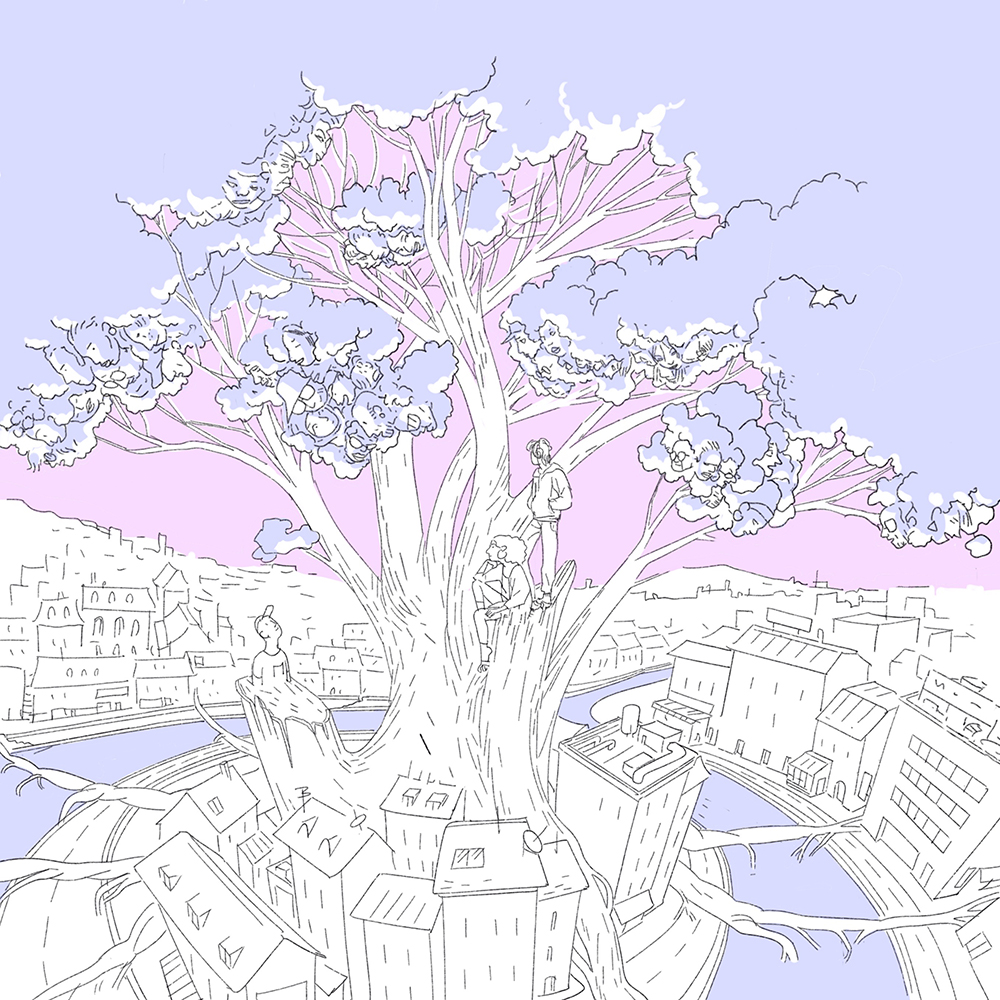
Article
La construction des identités et des sentiments d’appartenance s’inscrit dans des processus historiques. Autrement dit, la façon que chacun à de bâtir la représentation de qui il est et des groupes auxquels il appartient, varie selon les lieux et les époques. Il n’y a encore pas si longtemps, les individus étaient fortement déterminés par leurs conditions de naissance, ou encore leurs relations avec les grandes institutions sociales, telles que l’Église ou les syndicats. Les déterminations ne sont peut-être pas moins fortes, aujourd’hui, mais elles sont différentes, davantage plurielles, et l’on constate une plus forte mobilité des identités.
Mais, si on ne construit pas son identité aujourd’hui comme hier, qu’est-ce qui a changé ? Comment comprendre ce qui nous définit ? Les collectifs auxquels on se sent appartenir ? Ceux qui nous reconnaissent comme leurs ? Plus largement, qu'est-ce qui explique que des personnes partagent une identité et des valeurs communes dans une société contemporaine où, plus rapidement que jamais auparavant, les équilibres se transforment et se renégocient ?
À travers 10 entrées, nous explorons ces processus sociaux en tension. L’évolution des processus d'individualisation et de socialisation. La façon dont marges et centralités s'articulent. Les modalités souvent conflictuelles de transmission des cultures. Ou, encore, comment s’ajustent sentiments d’identité et d’altérité. À chaque fois, l’objectif est de nous outiller intellectuellement pour mieux comprendre les dynamiques sociales à l’œuvre, qui favorisent ou freinent les mouvements de cohésion, d’identité collective, et les rapports des individus entre eux.
Pour la Métropole, l’enjeu n’est pas nouveau. Elle a déjà exploré ces phénomènes d’identité, par exemple en étudiant ses potentiels emblèmes et ce qui détermine ses identités traditionnelles, ouvrières, religieuses, etc. Mais celles-ci se transforment pour se cristalliser autrement, se transmettre différemment. Ainsi, s’appuyant sur les notions posées, le dossier dans lequel s’inscrit ce texte vise à décrire de nouveaux collectifs de socialisation et des formes émergentes d’appartenance.
Les individus sont traversés d’un double mouvement consistant à les faire exister comme des personnes singulières, et à leur donner les codes communs leur permettant d’être pleinement intégrés à un ou plusieurs groupes sociaux. Le premier processus relève de l’individualisation, le second, de la socialisation. C’est dans cette tension constante entre distinction et identification que se travaille l’identité de chacun. Par exemple, un jeune pourra s’identifier à son quartier pour se distinguer lorsqu’il se trouve au sein de son arrondissement. « Je suis des États » lui permet de marquer une particularité, relativement aux autres jeunes venant « de Monplaisir ». Mais, comme eux, il pourra dire « Je suis du 8è » lorsqu’il est dans le centre-ville, ou de Lyon s'il est à Montpellier, selon un processus de références gigognes.
Le processus d’individualisation est donc un processus de séparation et de distinction. Pour les philosophes, ce processus est fondateur des sociétés modernes. Pourquoi ? Parce que l'idée de « contrat social » suppose l’existence d’individus libres qui engagent leur responsabilité. De fait, « dans les sociétés modernes, l’individu prime, en tant que principe de valeur […] et d’organisation, sur le “tout collectif”, c’est-à-dire sur la conscience collective, la tradition et le principe hiérarchique » (Dumont, cité dans Federico Tarragoni, 2018). La modernité repose donc sur le principe d’une fabrique d’individus autonomes, voire émancipés du collectif.
Ce processus est généralement décrit comme double : l’individuation et l’individualisation. L’individuation, plutôt objet de la psychologie, renvoie à l’aptitude naturelle d’un enfant à prendre progressivement conscience de lui-même comme personne distincte des autres, capable de penser son environnement et d’agir sur lui. L’individualisation, plutôt analysée par la sociologie, définit « l’individu social », c’est-à-dire la façon dont expériences et appartenances sociales façonnent la singularité de chacun. Pour le sociologue Serge Paugam, l’évolution des formes de la modernité s’accompagne d’une évolution de l’individualisation, sans doute plus poussée qu’elle ne l’a jamais été dans l’Histoire où « Libérés des carcans collectifs et des assignations statutaires, nous serions désormais soumis à l’injonction sociale d’“être soi”, un “soi” authentique et singulier” (2010). De cette manière, l’individualisation peut amener chacun à définir son identité au-delà des cadres d’identification collectifs. Ce même jeune s’identifiant comme étant « des États » pourra par exemple préciser qu’il ne « traîne pas au quartier à Jet d’eau » pour se singulariser par rapport à certains de ses pairs.
La socialisation est un mouvement symétrique. C’est le processus par lequel chaque individu intègre, grâce à ses expériences sociales, les normes communes à un groupe et se définit non plus comme individu singulier mais comme membre d’un collectif. Là encore, il est généralement décrit comme double. La socialisation dite « primaire », au sein de la famille ou de l’école, et la socialisation dite « secondaire », par le travail, par exemple. L’une comme l’autre se font par le biais d’institutions formelles (l'école, les institutions religieuses, les associations, les syndicats, etc.) et informelles (la rue, les réseaux sociaux, les pairs [i.e les amis], etc.). Si la socialisation primaire se situe dans l’enfance, la socialisation secondaire qui la prolonge est en perpétuelle transformation.
La transmission et le contenu des normes, représentations, usages, valeurs, etc., sont fonction des institutions et des groupes de socialisation. Par exemple, les groupes syndicaux ou l’école vont opérer une socialisation plutôt homogène, avec des règles relativement similaires. À l’inverse, la socialisation par les pairs ou par le travail est plus hétérogène. La notion d’habitus de Pierre Bourdieu désigne le cadre référentiel des individus, attaché à une catégorie sociale, et qui leur permet d’apprécier les situations qu'ils vivent et d'y apporter des réponses pratiques adaptées. Pour autant, malgré leur appartenance à une classe sociale, la diversité des instances de socialisation et des expériences individuelles expliquent la singularité des individus. Ainsi, pour le sociologue Bernard Lahire, les individus peuvent être pluriels, c’est-à-dire mobiliser plusieurs cadres de référence hétérogènes.
Nous faisons l’hypothèse que, parce qu’ils sont situés dans le temps et l’espace, les modes d’individualisation et de socialisation présentent, dans la métropole lyonnaise, des éléments distinctifs. « Être Grand-Lyonnais » n’est pas qu’une question de domiciliation, c’est aussi (surtout) se reconnaître une appartenance à un groupe, laquelle peut se traduire de plusieurs façons.
Dans ce dossier, nous avons ainsi cherché à décrire des spécificités locales dans les modes de socialisation. Un article s’intéresse par exemple à la socialisation par les pairs et la pratique du skate-board à Lyon, où la réputation de ses sportifs a acquis une renommée internationale telle qu’elle permet à la fois de se distinguer et de s’identifier. Un second article porte sur un autre processus informel de socialisation, les réseaux sociaux numériques, et en particulier les groupes qui produisent des mèmes mettant en image les éléments d’identité de Lyon. Ces deux exemples montrent tout l'intérêt de réfléchir non pas à partir de généralités théoriques, mais en enracinant la réflexion dans des cas concrets et circonstanciés au territoire.
Identité(s) et altérité(s) sont deux notions précieuses pour penser la complexité de la formation et la transmission de sentiments d’appartenances individuelles à des collectifs. Entre le sentiment d’être « d’ici » (à travers les figures de l’autochtone, de l’insider et du conformiste) et celui d’être « de là-bas » ou « d’ailleurs » (à travers les figures de l’étranger, de l’outsider et du marginal), les sentiments d’appartenances se construisent de manière complémentaire à ceux de non-appartenance. Ainsi les constructions identitaires s'élaborent-elles en contre, à travers des mouvements de différenciation et de refus, voire de rejet et de discrimination. Identité(s) et altérité(s) sont mises en jeu dans les phénomènes d’appropriation ou d'opposition par lesquels se forment les frontières de territoires physiques et symboliques. Intrinsèquement liées l’une à l’autre, elles désignent le processus par lequel se négocie le positionnement réciproque d’individus et de collectifs, entre assignation et revendication.
En soulignant la proximité des phénomènes d’identité et d'altérité, nous insistons sur deux points. D’une part, ces notions comportent toutes les deux de multiples dimensions relatives les unes aux autres : identité sociale/altérité sociale, identité linguistique/altérité linguistique, identité culturelle/altérité culturelle…. À chaque fois, il s'agit de couples en tension qui interviennent dans les processus d’individuation et de socialisation et leur transformation. On insiste d'autre part sur la subjectivité des individus et des collectifs. Identité et altérité doivent alors être appréhendées par rapport à des sujets en particulier, à travers les ajustements qu'ils opèrent entre le regard et le discours qu'ils portent sur eux-mêmes et les autres.
En observant des phénomènes sociaux à l’échelle d’un quartier, d’une rue ou d’un établissement, le sociologue Erving Goffman (1956) a analysé les mécanismes de construction d’une identité en interaction. Il montre comment la présentation de soi se déploie de manière plus ou moins intentionnelle et consciente, et toujours en relation à un ou des autres. À travers des enquêtes ethnographiques, cette approche vise à décrire en quoi les pratiques sociales ordinaires, tels que les gestes et les prises de paroles, redessinent l’image qu’autrui se fait de lui-même, comme l’image qu'il se fait d’autrui (Amossy, 2010). À l’échelle de la Métropole de Lyon, le projet PoliCité initié en 2016 à Vaulx-en-Velin interroge les relations que de jeunes habitants entretiennent aux institutions policières. Cette recherche-action vise notamment à observer les mécanismes par lesquels certains habitants se sentent assignés à une identité de personnes présumées coupables et toujours en sursis, à décrire en quoi l’intériorisation d’une telle image de soi (re)configure le rapport de ces personnes à leur propre liberté d’action dans l’espace public et, enfin, à penser comment elles peuvent infléchir leurs propres marges de manœuvre.
Dans une perspective complémentaire, mais à une autre échelle d’observation des phénomènes sociaux et anthropologiques, Paul Ricœur offre une théorie précieuse sur le rôle du langage et du récit dans la transformation d’une identité dans le temps. Le philosophe montre comment le fait même de se raconter participe de la transformation d’identité, et donc du rapport que l’on entretient à soi-même et aux autres. C’est notamment la visée des thérapies ethnopsychiatriques proposées aux personnes en situation de migration en proie à des troubles sociaux et affectifs, notamment. Coupées de leur territoire, de leur famille, ayant subi un traumatisme dû au voyage et à des événements qui souvent ont précipité un départ, elles sont accompagnées afin de se raconter pour mieux se retrouver et se reconstruire. Ces séances leur offrent également une autre possibilité d’exister, en se réappropriant leur propre récit, au-delà des normes et des attentes de l’administration. Cette dynamique de reconnaissance peut aussi bien agir de manière positive que négative. Dans ce dernier cas, le regard, les paroles et les actes d’autrui renvoient à des mécanismes de contraintes et d’assignation identitaire, qui vont parfois jusqu'à déshumaniser les personnes.
Ainsi, à rebours d'une approche monolithique de l’identité et de l’altérité, nous insistons sur l'idée que sentiments d’appartenance et de non-appartenance, à des collectifs ou des territoires, sont mouvants. Qu’est-ce qui crée des liens ou des ruptures entre des personnes se sentant appartenir ou assignées à des collectifs hétérogènes ? Comme l’explore l’article sur le don du sang, quels sont les processus selon lesquels des identités sont valorisées ou stigmatisées, et quels groupes se trouvent inclus ou exclus d’une communauté (qu’elle soit nationale, humaine) ?
Pour la Métropole de Lyon, une partie de la réponse dépend de la façon dont elle-même se positionne comme le personnage de son propre récit polyphonique, impliquant des auteurs et des voix multiples. Par quels récits, en effet, reconfigure-t-elle les différentes facettes de sa propre image, pour ses propres administrés ou auprès d’autres territoires ? De la même façon, on peut s'interroger sur le récit qu'en font d'autres acteurs, qu'ils soient habitants ou non du territoire, et la façon dont celui-ci sert de support d'identification. Notre dossier aborde cette question du point de vue de rappeurs ou de mèmeurs. Et, quels enjeux sous-tendent la revendication ou le refus d’une appartenance à un territoire, selon des emboîtements à différentes échelles ? « Mon identité ne sera jamais nationale », scande Marc Nemmour du groupe La Canaille dans l’album La Nausée. Ces mots rendent compte des tensions éprouvées de la revendication assignation à une appartenance, qui sont par ailleurs analysées avec méthode par la sociologie et les sciences politiques (Noiriel, 2007 ; Fassin, 2015). Mais cette appartenance pourrait-elle être régionale ou métropolitaine, par exemple, pour lui ou pour d’autres ?
Le discours se comprend comme l'acte de production d’une parole, incluant le produit de cette action de l’oral à l’écrit, des textes anciens aux formes plus contemporaines qui circulent dans des réseaux sociaux numériques. Son analyse ne peut être dissociée des pratiques sociales (aussi bien celles qui président à la production d’un énoncé que celles dont parle un récit) et des représentations collectives (des imaginaires plus ou moins, sédimentés, conscientisés et intériorisés) qu’il interroge ou occasionne. En tant que médiation du sens, les discours sont constitués de deux facettes indissociables : ils permettent à la fois de dire des mondes et de faire des mondes (Goodman, 1978 ; Eco, 1978). D’une part, ils mettent en récit des expériences, en faisant référence à des événements et des espaces déjà vécus et à d’autres dans lesquels se projeter de manière utopique. D’autre part, ils (re)configurent l'ordre social et symbolique des interactions entre des individus et des collectifs, sculptent les images de soi et d’autrui, et mettent en jeu des idées et des imaginaires à interroger, déconstruire ou (ré)inventer.
Les discours, qu’ils soient officiels et médiatisés sur la scène publique, réservés aux intimes et préservés dans la sphère privée, voire tenus confidentiels et rendus anonymes, tiennent une place toute particulière dans l’organisation de la vie d’une société. Entre des paroles sacrées à ne pas profaner et les échanges les plus triviaux du quotidien, ils se structurent dans des langues et des langages qui se transforment dans le temps, par emprunts réciproques ou à sens unique, par détournements de formes et de significations, par ajustement au milieu où ils se déploient. Aussi les discours ne sont-ils pas des objets inertes, parce qu’on les interprète constamment et les redécouvre au fil du temps, et ne sont pas produits ex nihilo parce qu’ils sont toujours à situer dans une relation entre des espaces, des temps et des acteurs de leur production/réception.
Objet vivant et fuyant, dont on ne pourrait fixer l'interprétation de manière assurée, toute communication assemble trois dimensions de façon plus ou moins maîtrisée et maîtrisable : l’ethos, le pathos et le logos, notions héritées de la philosophie d’Aristote (Barthes, 1970 ; Plantin, 2016). L’ethos réfère aux positionnements éthiques et moraux des (inter)locuteurs selon une négociation de leur légitimité. Le pathos renvoie à leurs implications affectives et la gestion de leur sensibilité. Enfin, le logos et sa logique rendent compte du style de leur raisonnement et de l'exercice de leur rationalité (Basso Fossali, 2017). Selon quelles stratégies et quelles tactiques des locuteurs cherchent-ils à créer des liens d’affinité avec les destinataires de leur énoncé, à souligner des relations de proximité intellectuelle ou à marquer la distance ?
Dans une approche dynamique de la production-réception de discours, on identifie deux grandes tendances vers lesquelles nous orienter dans nos enquêtes.
D’une part, à partir des études en narratologie (notamment représentée par Mikhaïl Bakhtine ou Gérard Genette), on s’intéresse aux interactions entre des discours, où saisir les entrelacements de voix, les convergences et conflits de points de vue (Rabatel, 2008). Il s’agit alors de décrire en quoi le choix des mots dépasse la stricte interprétation de ce que l’on cherche à dire et participe de la négociation d’un rôle social et symbolique des langages.
D’autre part, à partir des travaux pionniers de l’ethnographie de la communication (Gumperz, 1989) et de la sociologie du langage (Garfinkel, 1967; Sacks, 1984), les discours peuvent être étudiés au-delà et en-deçà de la dimension verbale des énoncés, en intégrant les pratiques langagières dans un ensemble plus vaste d’interactions. Il s’agit alors de porter une attention particulière aux manières de se tenir et de se vêtir, de se regarder, de se rapprocher ou de s’éviter, à des attitudes qui parlent parfois à notre place, voire nous trahissent (par exemple, quelqu’un pensait « avoir les codes », mais finalement non et « perd la face »).
D’un point de vue méthodologique, la question se pose alors de savoir comment mettre en évidence les décalages, ou les contradictions, entre des pratiques effectives et des représentations qui en sont données. Comment arbitrer entre ce que l'on pense savoir d'un milieu socioculturel, ce que nous en disent d'autres personnes, et ce qu’on en comprend ? Comment aller au-delà du visage que des personnes ou des institutions veulent présenter d’elles-mêmes au premier coup d’œil, à la première rencontre ? Nous souhaitons porter une attention toute particulière à cette tension entre une préservation et un déchirement des liens sociaux en discours. À quels discours et quels supports une institution comme la Métropole de Lyon peut-elle avoir recours pour (re)dessiner et (re)valoriser l’image protéiforme et forcément multiple de son territoire ? Que traduisent les paroles et les actes des habitants, vis-à-vis des relations qu’ils entretiennent à « leur » ville, à « leurs » territoires ? Que ce soit dans les espaces publics ou à travers les réseaux sociaux numériques, ces relations structurent la pratique des mèmes et du rap, comme on peut le voir dans deux articles de ce dossier.
Dès lors, les expressions de sentiments d’appartenance à un territoire ne sont pas conçues comme des images figées, à dénicher et à interpréter de manière univoque. Elles relèvent de processus dynamiques d’appropriation de l’espace (Lamizet, 1997) construits par des discours et des actes qui mettent en jeu des attitudes et des interprétations multiples et non-maîtrisables à l’avance, comme cela peut être le cas de la pratique du skateboard, qui impliquedes formes de détournements des usages de la ville, de ses architectures.
Afin de comprendre les manières de partager, d’appartenir et de transmettre dans la métropole lyonnaise, nous ne pouvons faire l’économie d’une entrée par la culture, ou peut-être même par les cultures. En effet, le terme culture se trouve mobilisé par trois types d'acteurs différents, et pas toujours dans le même sens. D’abord, par les institutions culturelles (musées, écoles, mairies, théâtre, etc.) qui œuvrent à mettre en place des actions culturelles. Ensuite, par les Grands-Lyonnais, qui se sentent liés à des cultures territoriales, des cultures de métiers ou d’entreprise, des cultures sportives, des cultures musicales plus ou moins underground, traditionnelles ou alternatives, ou encore à des cultures culinaires. Enfin, par les chercheurs en sciences humaines et sociales, pour qui le terme de culture est un concept clef, permettant de saisir des spécificités d’un groupe. La cohabitation entre les différents usages du terme est parfois source d'ambiguïtés et demande quelques clarifications.
Nous avons observé une enseignante de lycée, à Vénissieux, dire à ses élèves : « Je fais ce métier pour vous apporter un minimum de culture ». L’un d’eux lui répond alors : « Mais madame qu'est que vous connaissez de nos vies pour dire qu’on manque de culture ? », Et une autre rebondit : « Oui venez voir chez nous, on a une culture incroyable, c’est pas juste de dire ça ». De fait, les élèves ont bien leurs propres cultures (familiale, territoriale, etc.), au sens utilisé dans les sciences humaines et sociales, « qui renvoie aux modes de vie et de pensée » (Cuche, 2010). C'est la culture au sens anthropologique. L'enseignante fait, elle, référence à une mission de l'école de transmettre la « Culture » (l’usage fréquent de la majuscule signalant sa grandeur) (Lahire, 2006). Reconnue des institutions, cette dernière peut être qualifiée de culture légitime, et a une fonction importante pour obtenir du capital culturel (Bourdieu et Passeron, 1964). Dans ce dossier, nous parlons aussi bien de Culture au sens légitime, que des cultures au sens anthropologique. Les deux acceptions du terme sont prises en tant que processus à étudier, non comme des catégories acquises a priori.
La culture légitime, sens le plus ancien du terme, remonte à la culture en tant qu’action, celle de cultiver, d’abord la terre, puis son esprit et les facultés humaines. Elle recouvre des réalisations et œuvres artistiques et intellectuelles : les « œuvres de l'esprit, qui sont d'abord celles de l'art, de la poésie ou littérature et de la pensée conceptuelle (sciences et philosophie) ». (Kambouchner, 1995). Ce sens classique fait partie de nos quotidiens. Sa définition est plutôt stabilisée, même si ce qui fait partie de cette culture est en constante évolution. Le rap et la danse hip-hop, par exemple, sont aujourd'hui valorisés par des musées et collectivités comme une culture à part entière, légitime à s’inscrire dans l’action culturelle, alors qu'ils ont été considérés comme cultures émergentes jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, Villeurbanne, capitale européenne de la culture 2022, organise des concerts de rap et des spectacles de danse hip-hop. Parler de culture légitime ne veut pas dire qu’il existe des cultures illégitimes en elles-mêmes. Mais pour nous, cela permet d’analyser les processus de reconnaissance d’une culture et les enjeux de la domination symbolique émanant des inégalités culturelles (Bourdieu, 1977).
En contre, la notion de culture au sens anthropologique se développe à la fin du XIXe siècle avec une double ambition : élargir la culture aux productions autant matérielles qu'immatérielles, et aller au-delà de la dimension normative de la culture légitime. Les premières définitions d’anthropologues comme Edward Tylor ou Bronisław Malinowski tentent de définir les cultures par des caractéristiques propres que partage un groupe donné, identifié de manière durable. Ce sont les pensées, les comportements, les croyances, les sentiments, les modes de productions, de reproductions, de filiation, de pouvoirs et d’économies.
Ces définitions, construites pour parler de sociétés éloignées des chercheurs, présentent le risque de classifier les populations, comme si les cultures étaient des catégories homogènes et hermétiques. Avec la diversité culturelle croissante dans les métropoles, la notion de culture évolue. Elle s'applique désormais dans nos propres villes ou pays, justifiant les enquêtes sur des groupes de musique (blues, rock, jazz), des jeunes défavorisés, de communautés urbaines, générationnelles, professionnelles.
Ainsi vient l'idée que tout groupe réuni autour d'un sens commun, porté par une activité pérenne, agit avec une culture particulière. Émerge alors la notion de cultures populaires. Celle-ci naît « d’un refus du légitimisme, des hiérarchies académiques des objets nobles et ignobles. Elles se fixent sur la banalité apparente de la publicité, des émissions de distraction, des modes vestimentaires, (..) portent infiniment moins sur les figures héroïques des dirigeants que sur la sociabilité quotidienne des groupes, le détail des décors, pratiques et coutumes » (Mattelart et Neveu, 2008).
Pourtant, il est assez vite reproché à ces visions culturalistes de pratiquer ce que l’on nomme l’essentialisme culturel. Celui-ci consiste à réduire un individu à son origine culturelle, comme si son essence propre le destinait à n'exprimer qu'une culture en particulier. Outre l'assignation à une culture d'origine, « le danger consiste donc à traduire la diversité [...] en une somme d'entités distinctes » (Abdallah-Pretceille, 1999).
De ce risque va naître une nouvelle définition anthropologique de la culture, qui insiste sur son aspect dynamique et non plus statique. Il s’agit alors de voir comment les interactions entre groupes et entre individus deviennent motrices d'innovations culturelles. On peut ne pas venir de la même culture et pourtant partager une culture commune. On peut aussi se sentir liés à plusieurs cultures présumées différentes les unes des autres, c’est pourquoi la notion de sous-culture, qui vient de l’anglais sub-culture, n’est pas péjorative mais descriptive et évoque des sous-ensembles culturels d’une culture plus large. Certaines sous-cultures dites underground ou alternatives peuvent ainsi cohabiter au sein d’une culture légitime et se nourrir réciproquement.
Par exemple, l'École Pierre, qui se définit comme « une école pour bâtir l'Église », permet à ses élèves d’enregistrer un album de rap dans le cadre de l’action culturelle de la paroisse Sainte-Blandine. D’autre part, des jeunes du lycée Saint-Just, dans le 5è arrondissement, peuvent se retrouver sur les quais du Rhône avec d’autres jeunes des Minguettes et partager une culture commune dans la manière de se saluer, de s’habiller ou d’écouter de la musique rap, d'échanger et rire des mèmes de Lyon, alors qu’ils ne se connaissent pas et ont grandi dans des milieux culturels différents. C'est cette définition plus contemporaine de la culture que nous privilégions. Elle s’attache à étudier les processus d’élaboration et de partage résultant « d'un ensemble d'individus réunis pour jouer ensemble et se trouvant en situation d'interaction durable. Tous participent solidairement, mais chacun à sa manière, à l'exécution d'une partition invisible. La partition, c'est-à-dire la culture, n'existe que par le jeu interactif des individus » (Cuche, 2010).
Dans le quotidien de la métropole lyonnaise, des cultures hétérogènes (populaires, légitimes, familiales, professionnelles, territoriales, générationnelles…) se côtoient et interagissent. À travers ces contacts, s'opèrent des dynamiques culturelles, marquées par des continuités, des changements, des résistances, des hybridations. La prise en compte de ces dynamiques est nécessaire pour comprendre les enjeux d’appartenances qui participent à la vie sociale et culturelle de la métropole. Pour ce faire, il nous faut introduire les notions d'enculturation, d'acculturation, de filiation, ou encore d'appropriation culturelle.
En anthropologie, l’enculturation désigne une volonté d’inculquer une culture, ou certains de ses éléments, à des membres nouveaux ou extérieurs, comme l’école avec les élèves, les associations culturelles ou sportives avec des arrivants, les anciens d’une entreprise avec les jeunes recrues, etc. Ce sont des changements culturels intentionnels et organisés par un groupe. L’enculturation s'apparente à une prise de pouvoir d’un groupe sur un autre. C’est ce que dénoncent les critiques adressées à des dispositifs d'assimilation culturelle verticale. Mais l'enculturation peut également être désirée en tant qu’occasion de transmission et d'apprentissage, notamment dans la découverte d’une culture à laquelle on veut s'initier. Par exemple, dans un « open mic » de rap, les anciens transmettent les règles régissant la prise du micro aux nouveaux qui souhaitent participer à ce type d’événement.
À une échelle plus globale, la notion d’acculturation désigne « les phénomènes complexes qui résultent des contacts directs et prolongés entre deux cultures différentes, entraînant la modification ou la transformation de l’un ou des types culturels en présence » (Gresle et al., 1994). Ici, à la différence de l’enculturation, les transformations culturelles ne sont pas imposées, elles naissent du contact prolongé (qui peut être fortuit) entre deux cultures. Si dans un premier temps, en situation coloniale, les travaux en anthropologie et en sociologie se sont focalisés seulement sur les changements de la culture dominée, on prend aujourd'hui en compte tous les acteurs de l’interaction culturelle. Par exemple, si l’on étudie comment des populations primo-arrivantes se transforment culturellement en arrivant à Lyon, on peut aussi s'intéresser à la manière dont les cultures d'un quartier d’arrivée évoluent à leurs contacts.
Ces deux processus mettent les individus en tension entre changements et continuités culturelles. Les individus sont susceptibles de vouloir y résister, ou au contraire de les accepter, voire de les provoquer. La notion de filiation est une clé pour comprendre comment des individus et des groupes sont alors amenés à réagir à ces changements culturels.
Au sens figuré, la filiation peut désigner les parentés culturelles d’un individu. Il s’agit de saisir les « représentations que se font les individus du lien filiatif (origine, généalogie, vécu commun, etc.) » (Steinberg, 2010). Autrement dit, la filiation culturelle, c’est ce sentiment de venir de ou d’être fils/fille de telle culture. Elle permet par exemple de se sentir soi-même un peu enfant de la Croix-Rousse, alors qu'on n'y a jamais vécu mais qu'on a un père ou une mère croix-roussien. Au fil de notre parcours, on peut se sentir fils de ou fille d’une personne morale, d’un personnage emblématique, d’un territoire ou d’une pratique. On peut par exemple se revendiquer fils du hip-hop, en retraçant la genèse de cette culture.
Le sentiment filial est profondément subjectif, c’est une rencontre entre le passé et un individu, qui en retient des éléments signifiants pour lui. Dans le quartier Saint-Jean à Lyon, des groupes identitaires se revendiquent enfants du « vrai Vieux-Lyon », « celui d’avant », sans avoir eux-mêmes vécu cette époque. La filiation du quartier à un passé français fantasmé se heurte à son architecture, qui donne à voir des influences différentes (italienne, protestante, juive, etc.). L’émission de Radio Canut « Fils de pentes » choisit quant à elle de montrer comment le rap s’inscrit dans la filiation populaire et « rebelle » des Pentes de la Croix-Rousse. La filiation n’est pas figée mais relève avant tout d’un processus, co-construit par les individus dans un contexte particulier. Pour paraphraser le philosophe Paul Ricœur (1983) : le passé n’existe qu’à travers les enjeux du présent. Malgré ce caractère dynamique, la filiation peut être un moteur puissant du sentiment d’appartenance et des pratiques qui en découlent.
Les conflits qui surgissent potentiellement des situations interculturelles nous invitent également à investiguer les rapports de dominations des cultures entre elles. Parce qu'elle est « héritée », la filiation semble s'opposer à l'appropriation culturelle, qui consiste justement en des emprunts abusifs d'éléments matériels ou immatériels d’une culture. Les polémiques récentes à ce sujet sont liées, d’un côté, à la question des inégalités dans les contacts culturels et, d’un autre, à la légitimité filiale des individus et des groupes. L'appropriation culturelle relève ainsi davantage du pillage et de l'imposture d'une société dominante sur une société dominée. À la base positive, cette notion anthropologique désigne la capacité à faire siens des éléments culturels autres ou éloignés de soi. Par exemple, la culture sportive du cricket a été importée en Inde par les Anglais puis réappropriée dans la culture indienne, en développant son propre style de jeu et d’entraînement (jusqu'à s’imposer dans les compétitions internationales). Cependant, lorsque c’est la culture dominante qui emprunte des éléments de cultures minoritaires ou populaires, sans mettre en avant ses acteurs, l’appropriation culturelle peut prendre un sens négatif et peut être considérée comme un emprunt illégitime.
Comme l’explique le sociologue Éric Fassin : « L’appropriation culturelle, c’est lorsqu’un emprunt entre les cultures s’inscrit dans un contexte de domination ». Le fait de ne pas être affilié à une culture de par ses origines ou son parcours n'empêche pas d’emprunter des éléments d'une culture autre. Il s'agit simplement de prendre conscience du contexte d’interaction et des rapports de pouvoir entre ces cultures, et tenter de respecter, voire de mettre en lumière, ses acteurs affiliés. Ces questions se posent aussi bien envers les minorités culturelles que les « sous-cultures ».
Par exemple, dans le cas de l’appropriation du graffiti, certaines grandes marques ou institutions mettent à l’honneur des graffeurs et leur offrent une reconnaissance culturelle, tandis que d’autres se contentent de prendre des photos de graffitis existants ou bien de les reproduire, sans mention ni autorisation des artistes. À l’inverse, d’autres pratiques s’approprient des expressions d’appartenance à une communauté, à un territoire et ses institutions, à une culture perçue comme dominante, comme cela peut être le cas des mèmes de Lyon.
Ce balancement complexe entre continuité et transformation culturelles nous mène à la question centrale de la transmission. Les pratiques, représentations, normes, sentiments d'appartenance ne pourraient perdurer sans être soutenues par des manières de transmettre, partager et apprendre : « ces processus qui, connectant les individus, contribuent à la perpétuation du culturel » (Berliner, 2014). La transmission culturelle n'est pas un processus linéaire. Elle est faite d'accords, de refus, mais également de rétroactions. Ainsi les acteurs qui transmettent des pratiques et des valeurs prennent aussi quelque chose de celui à qui ils transmettent. À l'échelle de la métropole, il nous semble important de chercher à comprendre comment ces espaces de porosité interculturelle et ces échanges se font à double sens, même quand seul l’un des deux est recherché et d'abord identifié. Concrètement, cela permet de comprendre comment une institution change au contact de son public.
Les notions « d’être-au-monde » et « d’habiter » sont en pleine reconfiguration ces dernières décennies dans le champ des sciences humaines et sociales. Elles diffusent dans le reste de la société, comme outils pour penser la place de l’humanité dans de grands bouleversements contemporains (dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, urbanisation des modes de vie, digitalisation, mondialisation et augmentation des flux, etc.). Nous pensons qu’elles sont aussi précieuses pour saisir finement la construction des sentiments d’appartenances sur le territoire.
Comment décrire les relations que nous entretenons avec notre milieu et la manière dont nous pensons notre place en son sein ? Anthropologues et philosophes ont particulièrement renouvelé ces dernières années la manière d’appréhender cet « être-au-monde », à travers la critique des dichotomies qui caractérisent le mode de pensée occidental (nature/culture, corps/esprit, théorie/pratique, etc.) et l’observation de sociétés « éloignées » (les Achuar en Amazonie, les Skolts de Laponie…). Ainsi l'anthropologue Philippe Descola a montré que les cultures entretiennent des relations pratiques et symboliques différentes des nôtres avec leur milieu, et que le concept de « nature » est une construction sociale propre aux sociétés occidentales. Ce prisme culturel distingue un Homme émancipé de toutes limites planétaires, séparé de la « nature », alors objet de domination. Comme le résume l'anthropologue Tim Ingold (2013), « Le monde ne peut exister comme nature que pour un être qui n’en fait plus partie, et qui peut y porter un regard extérieur, semblable à un scientifique détaché, à une telle distance de sécurité qu’il est facile de céder à l’illusion qu’il n’est pas affecté par sa présence ».
De nombreux penseurs de toutes disciplines proposent aujourd'hui d’aller à rebours de cette approche occidentale et de penser organismes et environnement comme une totalité indivisible. Et si l’un ne peut exister sans l’autre, alors il faut étudier leurs relations pour saisir leur constitution mutuelle. Dans le champ de la géographie, Augustin Berque développe depuis plusieurs années la « mésologie », une perspective qui vise à dépasser le dualisme et l’objectivisme pour appréhender ce qu’il nomme « l’écoumène », c’est-à-dire la relation existentielle qui unit les hommes aux lieux.
Le philosophe et sociologue Bruno Latour s'est lui aussi penché sur cette question, avec une visée politique plus explicite. Pour lui, notre manière de penser notre « être-au-monde » (détaché, extérieur) nous rend aveugle à la gravité du dérèglement climatique. Nous aurions donc besoin de nous « reconnecter », de redevenir « terrestres » pour reprendre conscience de nos « terrains de vie », ceux dont nous dépendons pour notre survie. Quant aux philosophes Vinciane Despret ou Baptiste Morizot, ils nous invitent à revoir notre relation au vivant.
D’un point de vue macrosociologique, nous retenons de ces cheminements que les sociétés humaines ne peuvent s'abstraire de leur environnement, mais sont, au contraire, indissociables des territoires qu’elles occupent et des représentations qu’elles ont de leur « être-au-monde ». Comment comprendre une société animiste comme celle des Achuar sans prêter attention à ce que Philippe Descola a appelé les « non-humains » ?
À un niveau microsociologique, les situations sociales se comprennent, de même, en prenant en compte l’environnement. Une interaction dans une église, un hôpital ou un parc, sera très différente en fonction de l’écologie du lieu (c’est-à-dire ses caractéristiques physiques, sensorielles, et symboliques) dans laquelle elle prend place. Pour nous, cela souligne l’importance de l’expérience de terrain dans le travail d’enquête.
La notion d'être-au-monde ne suffit pas à épuiser les façons de décrire notre rapport à l'environnement. L'habiter est ainsi une autre façon de rendre compte de notre lien à cet espace. Olivier Lazzarotti identifie deux approches de l'habiter. D’une part, une approche phénoménologique (Heidegger, Merleau-Ponty) selon laquelle habiter, c’est simplement être dans le monde. D’autre part, dans une approche pragmatiste, habiter, c’est faire avec l’espace. Marion Ségaud propose quant à elle la définition suivante : « Habiter c’est, dans un espace et un temps donnés, tracer un rapport au territoire en lui attribuant des qualités qui permettent à chacun de s’y identifier ».
Cette dernière définition fait en partie écho à l’approche psychologique qui postule que l’espace est structurant pour l’identité des individus. Pour elle, « habiter » est un universel anthropologique dans le rapport à l’espace, tout comme les actions de « fonder », « distribuer », et « transformer ». Au-delà de ces quelques invariants, l’humanité a développé de multiples manières d’habiter son environnement. Il faut noter la diversité des cultures, mais aussi des âges, des sexes et des statuts sociaux, qui, inscrits dans un système de sens spécifique, agissent également sur les manières d’habiter. Ainsi, « si l’habiter est un phénomène général, il y a autant de manières d’habiter que d’individus » (Ségaud, 2010).
Pour comprendre l’habiter, la notion d’appropriation est incontournable (de Certeau, 1980). Processus qui mène au chez-soi (Ségaud, 2010), l’appropriation désigne un ensemble de pratiques d’organisation et de marquage ritualisées (variables selon les cultures, les époques, les individus), qui établit une relation entre l’espace, soi et autrui : nettoyer, aménager, nommer, associer des symboles, disposer des objets, codifier le passage des seuils, etc. Tout cela permet d’identifier des lieux, de leur donner du sens, et de s’y identifier en retour. Cela mène au « territoire », qui peut être défini comme un espace « approprié et investi de sens par un groupe social donné » (Depraz, 2016). L’organisation et le marquage des espaces se font selon des modèles culturels partagés au sein d’une société : ainsi le territoire et les modes de l’habiter deviennent supports et expressions des identités collectives et individuelles.
Habiter, c’est aussi « distribuer » l'espace, en l'organisant et en lui attribuant des qualités et des fonctions. En Occident, l’urbanisme et l’aménagement occupent explicitement ce rôle. Mais à côté de cet effort conscient et maîtrisé, se repèrent d'autres dynamiques, plus discrètes et implicites. L’anthropologue Michel Agier parle à ce propos de « dynamique urbaine » pour comprendre « comment les gens font la ville ». Pour lui, là où l’on pense ritualiser de la socialité, on ritualise en fait de la localité. Autrement dit, en ritualisant les relations au sein de la société (passage à l’âge adulte, mariage, funérailles, passage religieux, etc.), on délimite des espaces (religieux, privés, civiques, etc.), donc on produit de la localité. On comprend alors que le social se territorialise, comme le territoire se socialise (Ségaud, 2010). Cette dynamique est continue, et le sens et les qualités des espaces évoluent au gré des transformations sociales. Pour nous, cela souligne combien la compréhension de l'espace en train de se produire ne peut reposer que sur sa fabrique institutionnelle. La transformation urbaine s'appréhende aussi par les usages émergents, les détournements, la ritualisation, etc., comme l'illustre parfaitement, dans le dossier, l'exemple de la pratique du skate à Lyon.
Pour poursuivre cette réflexion sur la dynamique des lieux et les transformations sociales, il nous faut introduire les notions corollaires de « centralité » et de « marge ». Le géographe Samuel Depraz (2016) propose de définir la marge comme une « portion d’espace qui, à une échelle donnée, se situe à l’écart d’un centre – que cet écart soit de nature économique, politique et/ou social – et qui ouvre à d’autres réalités territoriales ». Un centre est entendu comme « tout lieu d’exercice du pouvoir et d’une domination sur le reste de la société ».
Depraz pose huit principes qui aident à saisir ce concept de marge. Tout d’abord, elle se décline à toutes les échelles (1). Selon la focale choisie, les départements d’outre-mer peuvent être à la marge de la France métropolitaine, la province à la marge de la capitale, et dans la capitale en dehors des espaces de concentration des pouvoirs et des richesses, la marge est partout ailleurs. Ensuite, au-delà des référents économiques, la marge implique des critères politiques, sociaux et culturels qui peuvent même être contradictoires entre eux (2). Il faut donc l’aborder en termes de différences sociales vis-à-vis du centre (3). La marge est également un territoire ouvert (4), qu’il nous faut penser dans une relation ternaire avec le centre, et ce qu’il y a au-delà de la marge. En lien avec cette identité hybride, elle est un espace de mobilité et d’échange (5). La marge est également un espace de mise à distance de la norme, par opposition au centre qui cristallise l’ordre établi (6). Cela lui confère un potentiel d‘innovation (7). Une dimension d’ailleurs directement convoquée par les pouvoirs publics, à travers les programmes d’urbanisme transitoire et d’occupation temporaire. Enfin, la marge est un principe évolutif (8). Toujours dans le registre urbain, on peut penser à l’évolution de quartiers comme le Vieux-Lyon, qui dans les années 1970 était un quartier pauvre et en ruine, loin de la centralité touristique et économique qu’il incarne désormais. Ce qui est marge aujourd’hui ne le sera donc peut-être plus demain, et inversement. La marge est bien « une construction sociale relative à une époque et à un critère d’appréciation de la marginalité » (Depraz, 2016).
Le terme de marginalité renvoie à une approche davantage sociale que spatiale, qui « décrit le fait qu’un individu ou un groupe social se trouve à l’écart de la norme sociale » (Depraz, 2016), de manière subie ou choisie. Cela renvoie, en sociologie, à la notion de déviance, que le sociologue Howard Becker définit comme « le produit d'une transaction effectuée entre un groupe social et un individu qui, aux yeux du groupe, a transgressé une norme ». On parlera également de marginalisation pour qualifier un processus qui met à distance territoires et groupes sociaux, et conduit à l’état de marge (Depraz, 2016).
Un espace n'est pas marginal en soi, mais tributaire dans cette caractérisation des politiques publiques qui y sont menées (offres de mobilités, accès aux services publics, etc.), et des représentations qui en sont faites (espace attractif/répulsif). Idem pour les individus et groupes sociaux, car « Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des déviants. De ce point de vue, la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne, mais plutôt une conséquence de l'application, par les autres, de normes et de sanctions à un "transgresseur" ». (Becker, 1963).
Qu'elle soit sociale ou territoriale, la marge est ainsi directement un effet des rapports de pouvoir qui organisent les liens entre centralité et marginalité, tout comme entre norme et déviance. Par exemple, la distribution des individus sur le territoire relève de rapports de pouvoir entre différents groupes sociaux. Cette distribution résulte en partie de processus conscients de mise à distance exercés par les centres. L'expulsion de populations précaires (SDF, réfugiés, etc.) sans autre destination « qu’un peu plus loin, en tout cas pas ici », en est un exemple parlant. Car, « ce qu’expriment les marges, c’est finalement une manifestation constante de la "distinction" bourdieusienne, cette recherche de la "bonne distance", tant symbolique que matérielle, entre groupes sociaux » (Depraz, 2016). Comme pour la déviance, il s’agit fondamentalement d’une production de la différence. Liées par le territoire, support des identités individuelles et collectives, marges et déviances sont ainsi en perpétuel contact.
Pour certains, les marges sont des espaces où s’inventent d’autres usages et représentations, par la mise à l’écart de la norme dominante, voire sa transgression. Le sociologue Hugues Bazin voit cet écart comme une nécessité au sein de la société, une soupape sociale « face aux rigidités potentiellement sclérosantes et stéréotypées de l’ordre établi » (Depraz, 2016). Nous en revenons au potentiel d’innovation des marges. Mais cette mise à l'écart de la norme fait de la marge un espace en tension avec l’autorité publique : entre tolérance et répression, la marge offre un espace privilégié pour appréhender la lutte entre groupes sociaux dans la qualification des espaces et des pratiques. Par exemple, les Marches des Fiertés peuvent être vues comme une contestation de l’hétéronormativité, hétéronormativité qui exclut notamment des personnes souhaitant donner leur sang. Dans un autre registre, dans Bande organisée (single de l’album 13’Organisé produit par le rappeur Jul) la célèbre phrase « C’est pas la capitale, c’est Marseille bébé » peut s’entendre comme le rejet d’un centre dont on ne veut plus être la marge. Dans les deux cas, on peut y voir une tentative de recréer sa propre centralité en affirmant positivement sa situation marginale.
Cela nous invite à penser les marges et centres à travers la subjectivité des individus qui les vivent. En effet, les groupes sociaux qui constituent nos sociétés modernes ne partagent pas tous les mêmes représentations : un territoire peut être vécu de manières très différentes selon les individus, en fonction des liens pratiques et symboliques qu’ils y entretiennent. Dans une perspective alternative et contestataire, la marge peut être recherchée pour s’échapper de/lutter contre l’ordre établi. On pense notamment aux mouvements collapsonautes ou survivalistes, qui fuient les centres, alors symboles de fragilités et d’oppression dans leur lecture globale d’un « effondrement » prochain. En naviguant à travers les échelles et les multiples points de vue qui composent la vie sociale, on accède donc à une réalité plurielle et en tension. La Zad Notre Dame des Landes apparaît tantôt comme l’épicentre d’une dynamique positive de contestation de l’ordre établi, tantôt comme une marge dangereuse et à détruire.
Nous retenons de cette exploration que les notions de centre/norme, et de marge/déviance désignent des constructions sociales propres à un espace-temps donné, et non une caractéristique intrinsèque à des espaces, pratiques ou groupes sociaux. En perpétuelle évolution, la dynamique qui les articule révèle des rapports de domination, et est vécue différemment selon les points de vue. Plutôt que de considérer la marge comme un espace à « reprendre » par la centralité, il nous semble important de chercher à voir ce qui s'y invente et que la centralité, du fait même de cette position dominante et normative, a du mal à percevoir. Pour nous, cela invite à rechercher les effets de domination qui sous-tendent la relation entre les territoires de la métropole et à regarder les effets produits sur les territoires identifiés comme marge. Mobilisent-ils les attendus de la norme majoritaire, ou revendiquent-ils leurs propres normes, au risque de la rupture, voire de la sécession ?
Les normes peuvent être définies comme un ensemble de références, de règles et de valeurs, à partir desquelles des pratiques seront perçues et jugées plus ou moins adéquates et appropriées à un milieu, à une situation. Contraignantes, avec un pouvoir de collectivisation, voire de cohésion, les normes séparent autant qu’elles relient des individus et des collectifs. La notion de normes est marquée par une complexité théorique et pratique tout à fait particulière, selon le terrain de leur exercice (professionnel ou informel, intra- ou extra-familial, etc.) et les domaines sociaux de leur application (scientifique, juridique, artistique, etc.).
Dans son ouvrage portant sur la force des normes, le philosophe Pierre Macherey (2009) distingue normalisation et normativité, à la suite de Michel Foucault notamment. La première relève d'un processus normatif rigide, « qui renvoie au modèle juridique de la loi et qui semble à cet égard trop restrictive pour rendre compte de la fonction de la norme et de ses effets, dans l’ordre matériel de la vie et de l’action humaines » (Sabot, 2016). Macherey oppose ainsi ce processus à celui, plus souple, de normativité « qui laisse place potentiellement à la plasticité et même à la contestation des normes établies, à l’inventivité de nouvelles normes et de nouvelles formes de vie » (Sabot, 2016). Il faut alors souligner que les normes et les valeurs ne sont pas forcément reconnues, acceptées et transmises de manière intentionnelle.
La reconnaissance d’une légitimité de pratiques et de valeurs qui leurs sont attribuées dépend selon Bourdieu de dispositions inculquées à travers un processus de socialisation et d’apprentissage qui est « long et lent » (Bourdieu, 2001). Et il en va de même pour le processus inverse de reconnaissance d’une illégitimité et de désapprentissage (Jaquet, 2021). Un défi se pose alors pour toute société qui consiste à construire des bases communes, tout en gardant à l’esprit que celles-ci doivent être (ré)interprétées et (ré)interrogées pour être mieux comprises, dans un monde qui évolue : les principes dont se dote une société « ne relèvent pas de l’évidence ».
La norme n'est donc pas toujours partagée par tous. Elle vaut ici et maintenant, et pour certains, selon un principe de hiérarchie des normes. Ainsi existe-t-il des espaces d'autonomie, où chacun est en partie libre de suivre des normes et d'en mettre d'autres à distance, plus ou moins consciemment. S'ouvre alors un espace de discussion entre les normes. Le terme de « juge » mobilisé par Howard Becker (1963) éclaire les liens entre les dimensions juridiques et sociales des normes, lorsqu’il définit quand et comment il y a marge et déviance, quand et comment il y a respect ou transgression des normes. En effet, quand « un individu est supposé avoir transgressé une norme en vigueur, il peut se faire qu’il soit perçu comme un type particulier d’individu, auquel on ne peut faire confiance pour vivre selon les normes sur lesquelles s’accorde le groupe. Cet individu est considéré comme étranger au groupe [outsider]. Mais l’individu qui est ainsi étiqueté comme étranger peut voir les choses autrement. Il se peut qu’il n’accepte pas la norme selon laquelle on le juge ou qu’il dénie à ceux qui le jugent la compétence ou la légitimité pour le faire. Il en découle un deuxième sens du terme : le transgresseur peut estimer que ses juges sont “étrangers à son univers” (Becker, [1963] 1985 : 25-26) ».
Travaillant lui aussi sur les conflits entre individus et groupes sociaux, Erving Goffman a érigé au rang de concept sociologique le terme de stigmate. Pour le sociologue, le stigmate « renvoie à l’écart à la norme : toute personne qui ne correspond pas à ce qu’on attend d’une personne considérée comme "normale" est susceptible d’être stigmatisée. Le stigmate s’analyse donc en termes relationnels. Il renvoie autant à la catégorie à proprement parler qu’aux réactions sociales qu’elle suscite et aux efforts du stigmatisé pour y échapper » (Rostaing, 2015), comme ceux de groupes de militants structurés à l’échelle locale ou nationale pour redéfinir les catégories de pratiques « à risque » pour le don du sang.
Que ces efforts soient accompagnés ou supportés par des institutions comme l’école, ou seulement pris en charge de manière informelle, ces « efforts » renvoient à des retournements du stigmate dont des individus et des collectifs font l’objet. Ce retournement se déploie notamment en s’appropriant des contre-normes, à travers des ruses et des tactiques inventives qui redéfinissent les usages déjà programmés et les normes maîtrisées (de Certeau, 1980). On peut ainsi souligner qu’« une remise en cause de la norme comme trait définitoire et légitime d’un groupe peut faire émerger de nouvelles pratiques langagières distinctives » (Bourdieu, 2001 ; Colonna, 2021).
Le respect et la transgression des normes engagent alors une négociation entre des valeurs morales (des mœurs et des coutumes collectives) et des valeurs éthiques (une vision et une appropriation singulières), avec les autres et avec soi-même : on peut déceler des conflits de normes entre personnes et groupes sociaux, et un individu peut aussi être tiraillé dans un conflit de norme interne. L’émergence d’écarts ou de conflits par rapport à certaines normes est en effet occasionnée par un agencement d’appartenances à des groupes, qui ne sont pas forcément compatibles partout, ni tout le temps, pour tous. En discours, si l’on se positionne en tant que skateur et que l’on critique les comportements de cyclistes ou d’automobilistes, à quel point gomme-t-on le fait que l’on est aussi parfois soi-même cycliste ou automobiliste ? Comment négocie-t-on sa propre appartenance à des collectifs dont les pratiques et les valeurs sont parfois antagonistes ?
Ici, on peut reprendre l’argument selon lequel tout acteur social est un « agent double » (Fabbri, 1988 ; Basso Fossali, 2017) qui doit gérer son appartenance à plusieurs terrains en même temps, selon une plasticité à faire partie d’une collectivité, d’une équipe ou d’une clique (non-institutionnelle) façonnées par des manières de parler et de se taire (Goffman, [1973] 2015). Dès lors, quand respecter des conventions pour ne pas être en dehors du cadre, les briser pour pointer leurs travers ? À quel point peut-on s’imposer sur la place publique pour faire respecter des valeurs qui ont été bafouées ou qui mériteraient d’être reconnues, juridiquement ou symboliquement ? Et pour la Métropole de Lyon, quels discours instaurer et quelles modes de vie promouvoir, sans courir le risque d’ériger le portrait d’un « citoyen-modèle », dans lequel les habitants devraient nécessairement se reconnaître, et auquel ils devraient se conformer ? Comment gérer les potentiels hiatus entre des normes sociales et politiques en vigueur au sein de la ville (ne pas faire du skate n’importe où, ne pas écrire sur les murs) et la volonté de mettre des pratiques sociales et culturelles sur le devant de la scène (promouvoir le street art) ? Dans les discours et les pratiques, où et quand émergent des accords ou des ruptures entre des « nous », des « vous » et des « eux » ? Et pour ce qui est des études proposées dans ce dossier, à quel point celles-ci engagent une négociation de normes et de valeurs, que ce soit vis-à-vis des sujets abordés, ou pas, et des manières dont on en parle ?
Le sociologue Émile Durkheim distinguait deux ressorts de la solidarité des sociétés. Le premier, « mécanique », désigne les liens qui se créent entre les individus du fait de la similitude de leurs rôles sociaux, comme c’est particulièrement le cas dans les sociétés traditionnelles. Mais dans les sociétés modernes, fondées sur une forte division du travail et la spécialisation des rôles, la solidarité est le fruit de l’interdépendance des individus. Elle est alors dite « organique ». Dans ces deux cas, toutefois, la solidarité s’entend comme un principe de liaison fonctionnelle entre les individus au sens moral, qui prévaut le plus souvent aujourd’hui – et désigne les mécanismes assurant la cohésion sociale, terme qui apparaît en 1893 dans l’ouvrage du sociologue De la division du travail social.
On ne peut toutefois s’en tenir là, car alors, comment expliquer que dans une même société, la cohésion ne soit pas stable ? C’est que les mouvements d’agrégation coexistent avec d’autres qui tendent à la fragmentation. Il faut insister : la cohésion sociale est un processus dynamique en tension qui se transforme en fonction des conditions historiques, sociales, culturelles (Forsé et Parodi, 2009 ; Guibet, Lafaye et Kieffer, 2012). Un autre sociologue, Robert Castel, explique par exemple comment un processus de désaffiliation a pesé, à la fin du 19e siècle, sur la cohésion sociale : urbanisation et exode rural mettent en péril la cohésion bâtie sur « la proximité sociale et géographique entre des individus liés par des relations d'interconnaissance » (2013). Ainsi, plus qu’un mécanisme automatique, la cohésion sociale doit s’envisager comme un processus en travail, qui est aussi le produit de la volonté du corps social de faire bloc ou sécession. Pour Jacques Donzelot, la cohésion sociale n’est plus le résultat d'une mécanique objective et extérieure. « Elle devient le fait d’une mobilisation politique de la société civile face à l’ensemble des risques qu’elle encourt, en appui sur des individus libres et responsabilisés […] » (Donzelot, 2011).
Comment se construit cette cohésion d’une société ? Classiquement, plusieurs leviers sont décrits. D’abord celui des institutions qui assurent la diffusion des normes et des valeurs à l’ensemble des individus. C’est, ainsi que le rappelle Robert Castel (2013), le rôle assigné par la République à l’école : agréger les individus de sorte qu’ils puissent « intérioriser la commune appartenance à l'ensemble social, la nation ». On peut citer d’autres institutions, telles que l’entreprise, les syndicats, la religion, etc., effectuant également la socialisation des individus et les agrégeant autour de valeurs communes. La protection sociale, et plus largement l’État social, est un autre levier de la cohésion sociale. Initialement construit sur le salariat, puis progressivement élargi à partir du principe des minimas sociaux, assurant la protection des personnes et œuvrant à la réduction des inégalités, il intègre les personnes à une « société de semblables » (Léon Bourgeois) malgré leurs différences de situations. Dans tous les cas, l’enjeu est de créer un sentiment d’appartenance à un ensemble commun.
Qu’en est-il aujourd’hui de ces mécanismes ? Pour beaucoup de sociologues, ils peinent à assurer leur rôle. Outre la désaffiliation, déjà évoquée, les sociologues pointent un affaiblissement des corps intermédiaires. Plus spécifiquement, François Dubet parle de désinstitutionalisation pour décrire cet affaissement du rôle socialisant des institutions. Zygmunt Bauman, pour sa part, évoque la difficulté d’assurer la stabilité sociale d’une « société liquide », constituée d’individus-consommateurs volatils. Constatant une individualisation de plus en plus importante, Norbert Elias parle d’une « société des individus » qui rend plus complexe la cohésion sociale. Ainsi, tous évoquent une société mécaniquement moins cohésive, avec des risques accrus de fractures. Conséquences : des aléas pour la stabilité de la République et des freins à sa gouvernabilité. Pour ces raisons, le concept de cohésion sociale a, depuis les années 1990, migré vers la sphère politico-médiatique et la « fracture sociale » est devenue un leitmotiv politique.
En synthèse, on peut citer au moins six piliers identifiés par les sociologues pour fonder la cohésion sociale : la confiance des citoyens dans des institutions légitimes (1), la reconnaissance des personnes (2), leur intégration et leur participation à la vie sociale et économique (3), la justice sociale (4), ou encore l’existence d’un récit commun (5). Enfin, l’existence de processus de débat contradictoire et des formes de régulation des désaccords (6) permettant à la conflictualité de produire du consensus autour d’un projet commun. Cela permet de conclure avec la conception de la cohésion sociale développée par Forsé et Parodi (2009).
Pour ces auteurs, il s’agit du degré d’écart existant entre la société réelle (ou en tout cas la perception que chacun s’en fait) et la société « bien ordonnée », conception qu’ont les individus d’un ordre idéal. En ce sens, la cohésion sociale s’atteint par deux biais distincts : la définition collective d’une société souhaitable, et le travail social et politique à l’œuvre pour y parvenir. « Dans cette perspective, concluent-ils, la cohésion n’est pas l’absence de conflits, de désaccords ou de divergences mais ce qui assure la coexistence dans le cadre raisonnable du respect de l’égale liberté de chacun ». La redéfinition des catégories et des pratiques traitées dans l’article du don du sang implique ces six piliers, où se manifeste la revendication d’une existence et d’une égalité à la fois juridiques et symboliques.
Ces considérations sur la cohésion sociale peuvent paraître tellement générales qu’elles en seraient déconnectées de toute application territoriale. Il n’en est rien. Au contraire, il nous semble que le raisonnement, tel qu’il s’applique à l’échelle de la nation, vaut également pour l’échelle de la métropole lyonnaise. Pour nous, l’enjeu se déploie à deux niveaux, ce qui le rend d’autant plus crucial. Le premier niveau rend compte de l’échelle locale. Comment la Métropole produit-elle les différents éléments de cohésion sociale (reconnaissance, intégration, participation, etc.) à l’échelle de son territoire pour faire exister un sentiment d’identité commune ?
La fameuse « communauté de destin », horizon politique de la Courly puis de la Métropole de Lyon. Qu’est-ce qui autorise un possible sentiment d’appartenance au même territoire entre un ouvrier retraité habitant à Grandclément et un jeune cadre en informatique de la Croix-Rousse ? Le second niveau correspond à l’articulation des échelles locale et nationale. Quelle place la Métropole tient-elle dans l’animation d’un récit qui la dépasse pour s’arrimer au récit national ? Dans quelle mesure arme-t-elle les habitants pour qu’ils contribuent et adhèrent à l’ensemble national ? Comment le fait d’être Grand-Lyonnais permet une contribution à ce qu’est être Français ?
Dans la construction d’un sentiment d’appartenance à un territoire, la temporalité des pratiques sociales est un facteur déterminant pour que puissent se partager tout à la fois un rapport au passé (des patrimoines hérités ou choisis), au présent (des formes de cohabitation, d’interaction et d’engagement) et au futur (des manières de se représenter l’avenir et de se projeter).
Les espaces, qu’ils soient ruraux ou urbains, sont constitués de couches accumulées où chacune porte les traces d'une époque passée, sous la forme du millefeuille ou du palimpseste. Aussi la transformation contemporaine de ces espaces est-elle soumise à une tension entre présent, passé et futur. Un exemple des plus intéressants est celui des recherches archéologiques dites préventives, initiées lors d’une phase de chantier de renouvellement urbain. Elles saisissent l'occasion de ces travaux pour sonder les fondations du futur bâtiment. Selon les résultats, qui peuvent interrompre la construction, les traces du passé sont soit intégrées au site, soit exposées dans un musée, soit détruites. Ainsi s'élabore un processus concret de patrimonialisation qui fait le tri entre les traces du passé que l'on conserve – et comment – et celles que l'on efface – et pourquoi.
Liée aussi bien à une communauté restreinte (la famille) qu’à une communauté élargie (la société, l’humanité) (Nora, 1997), la notion de patrimoine est le plus souvent approchée sous l’angle des politiques publiques, notamment à travers des dispositifs de protection matérielle et immatérielle (Heinich, 2009). Ces dernières définissent les règles applicables aux objets culturels du passé par lesquelles ils accèdent au statut de biens communs. De cette norme découle un ensemble de pratiques patrimoniales (acquérir, restaurer, conserver, exposer, etc.) dans des espaces dédiés (archives, mémoriaux, musées, bibliothèques) qui jouent chacun un rôle différent dans la conservation et la transmission de cette mémoire. Cette dimension administrative et institutionnelle se double d’une dimension culturelle et symbolique, en jeu dans tout processus de patrimonialisation (Davallon, 2006), comme cela peut être le cas dans la muséalisation ou la mise au rebut d’objets hérités du passé, la reconnaissance ou non d’une responsabilité d’événements historiques plus ou moins lointains.
Dans ce processus de (re)construction d’un passé, il faut distinguer mémoire et histoire. En effet, si « la mémoire est la vie, portée par des groupes vivants et à ce titre en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l’amnésie […] », l’histoire « est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n’est plus » et « appelle analyse et discours critique » (Nora, 1997 : 24-25). Et c’est cette dialectique entre un passé vécu en expérience et un passé représenté en discours qui est à l’origine de lieux comme le Mémorial National de la prison de Montluc de Lyon ou le Rize de Villeurbanne. Dédié à la « mémoire ouvrière, multiethnique et fraternelle des villes du 20e siècle », ce dernier se donne pour missions notamment de « transmettre un récit commun de la ville, construit à plusieurs voix à partir des archives, des mémoires des habitants et des travaux des chercheurs associés », en menant notamment des inventaires participatifs.
Les patrimoines culturels matériels et immatériels comme les patrimoines naturels symbolisent un passage de témoin et interrogent nos responsabilités individuelles et collectives, à la fois dans leur préservation et leur disparition. Mais si chercher une prise sur son passé est une chose, chercher une prise sur le devenir d’une société en est une autre. Dans ce que nous pouvons appeler une « adresse au futur », on trouve une dynamique de projection qui tend à anticiper un futur collectif, en le planifiant et en le programmant à travers des projets urbains qui, à rebours, pourront être appréhendés comme autant de futurs antérieurs.
De l’autre côté, on identifie l’impossibilité pour toute société de déterminer à l’avance son propre devenir, par exemple, sur le plan économique (Canu et Ducourant, 2018). De même, elle n'est jamais assurée des traces qu’elle laisse sur son environnement au-delà des discours, dont on ne pourra saisir les effets en partie que de manière rétroactive. De ce point de vue, les capsules temporelles représentent un enjeu social, politique et culturel intéressant, en ce qu’elles témoignent de la conception que chacun se fait à la fois du présent et du passé, et de ce qui compte à transmettre aux générations futures. C’est dans ce même esprit que l’architecte Luc Schuiten envisage les villes de demain, en portant un regard critique sur leurs architectures et leurs paysages qui conjuguent un imaginaire suscité par des formes déjà existantes et la création d’une nouvelle relation entre l’homme et son environnement naturel.
Hier encore, l'intensification de la mondialisation (économique, technologique et culturelle) a pu nous faire penser que le 21è siècle serait celui de l’uniformisation. Cette hypothèse laissait présager que nous vivrions tous dans une sorte de grand « village global », partageant les mêmes pratiques, normes et valeurs, en somme la même « culture-monde » connectée.
Aujourd’hui, le quotidien d’une grande métropole comme celle de Lyon témoigne d’une expérience sensiblement différente, mêlant de multiples identités, mettant en interaction des traditions et des modernités, et donnant ainsi à penser une complexité nouvelle. Si les identités peuvent faire l’objet de clivages et sont souvent pensées sur le mode des frontières, voire de l’antagonisme, elles sont aussi (voire avant tout) sources et produits de liens sociaux, et révèlent des parts de communs dans la diversité. Mais alors, comment penser cette notion afin de sortir de cette contradiction ?
Des chercheurs en sciences humaines ont largement alerté sur la notion d'identité(s), qui porte en elle un danger d’essentialisation des individus et de leurs différences. Invoquer « l'identité », c’est faire référence à une grille de lecture qui a longtemps façonné nos façons de se penser, soi par rapport à l’autre, et dont on ne parvient pas facilement à se détacher. Or, elle ne permet pas de saisir toute la richesse de la dialectique qui lie chacun de nous à celles et ceux qui ne sont pas lui. Les concepts explorés dans ce texte nous aident alors à aborder avec plus de finesse ces notions d’identité et d’altérité, en s’attachant sans cesse à décrire leur caractère dynamique, plastique et multiple. Il nous semble que c'est à cette condition que nous pourrons en explorer les enjeux contemporains.
Enfin, les enjeux d’identité(s) ne peuvent s’extraire de leur dimension territoriale. Après que l’idée du « village global » a fait long feu, les questions des espaces, des géographies, du proche et du lointain ont été remises en jeu dans le débat pour comprendre comment et pourquoi nous nous identifions ainsi plutôt qu’autrement. D’où l’importance d’interroger les notions d’identité(s) et d’appartenance(s) à l'échelle du territoire de la Métropole de Lyon. En jeu : reconnaître en quoi le territoire de la Métropole peut faire lien, car il n’est pas seulement une somme de diversités, mais aussi un espace de rencontres, de mobilités et d’ouverture.
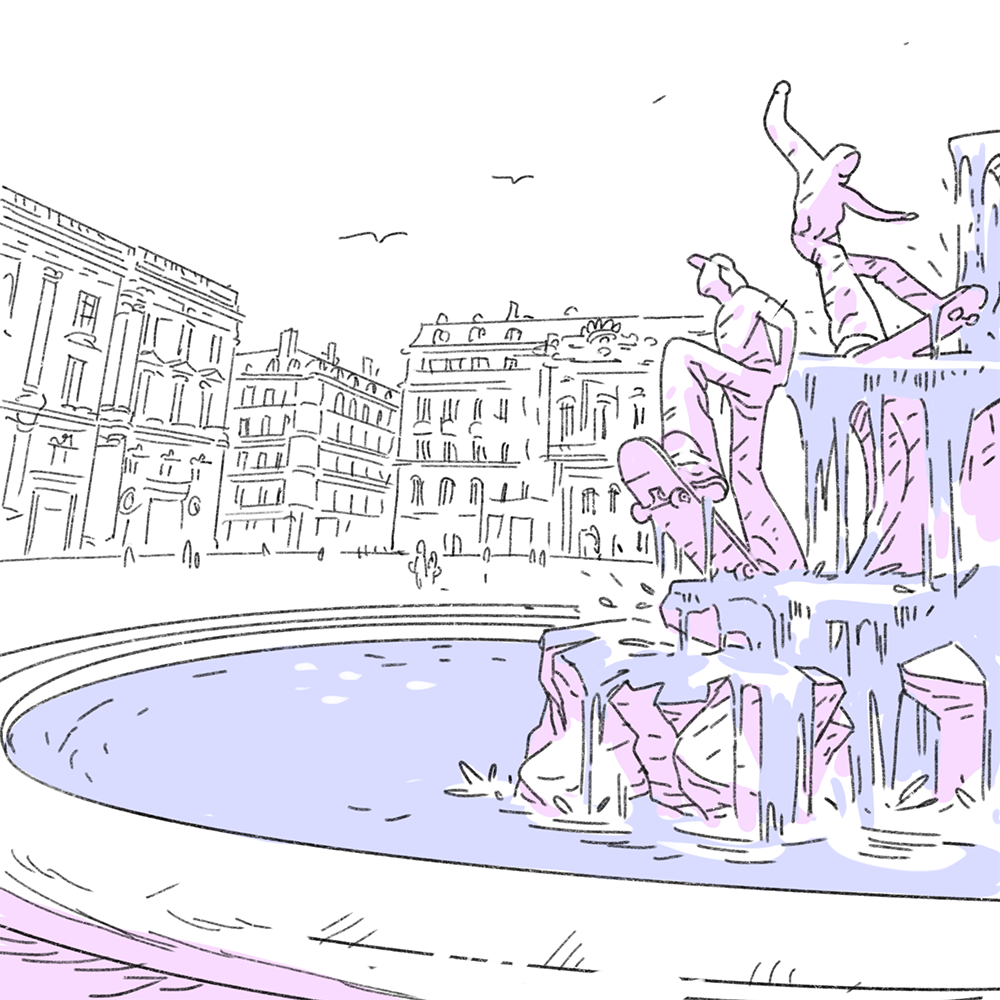
Article
En étudiant les rôles de la mise en images du skateboard, cet article vise à faire émerger des places qui peuvent être accordées à cette pratique dans la ville.
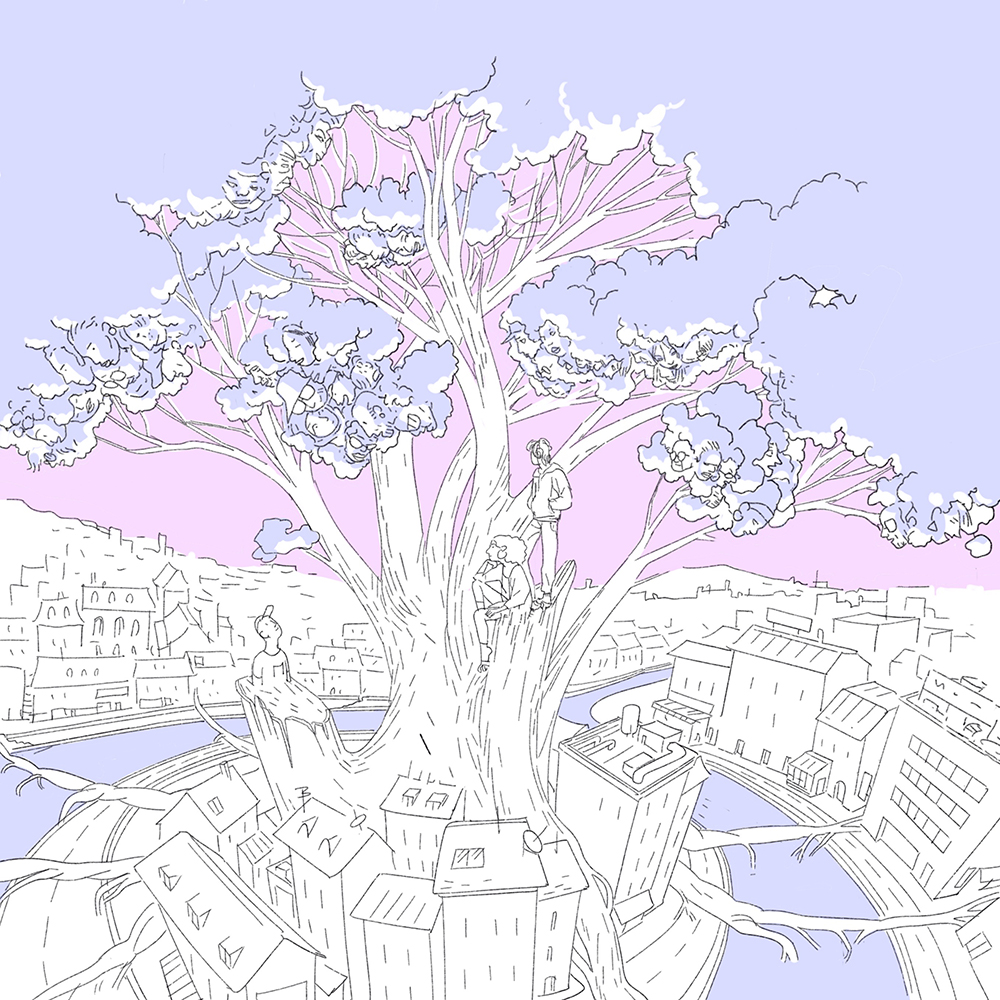
Article
Négocier et construire ses appartenances c’est faire une série de choix qui influent sur notre point de vue sur le monde et la position où l’on nous situe dans la société. Ces processus complexes sont au cœur des apports des sciences humaines et sociales.

Article
En 2022, la loi bioéthique ouvrait le don du sang aux homosexuels dans les mêmes conditions aux hétérosexuels. En matière de sentiment d’appartenance à une catégorie sociale, que nous apprennent les controverses qui ont abouti à cette évolution ?

Article
De quelle façon les mèmes se sont-ils inscrits dans une forme d’identification à un territoire ?
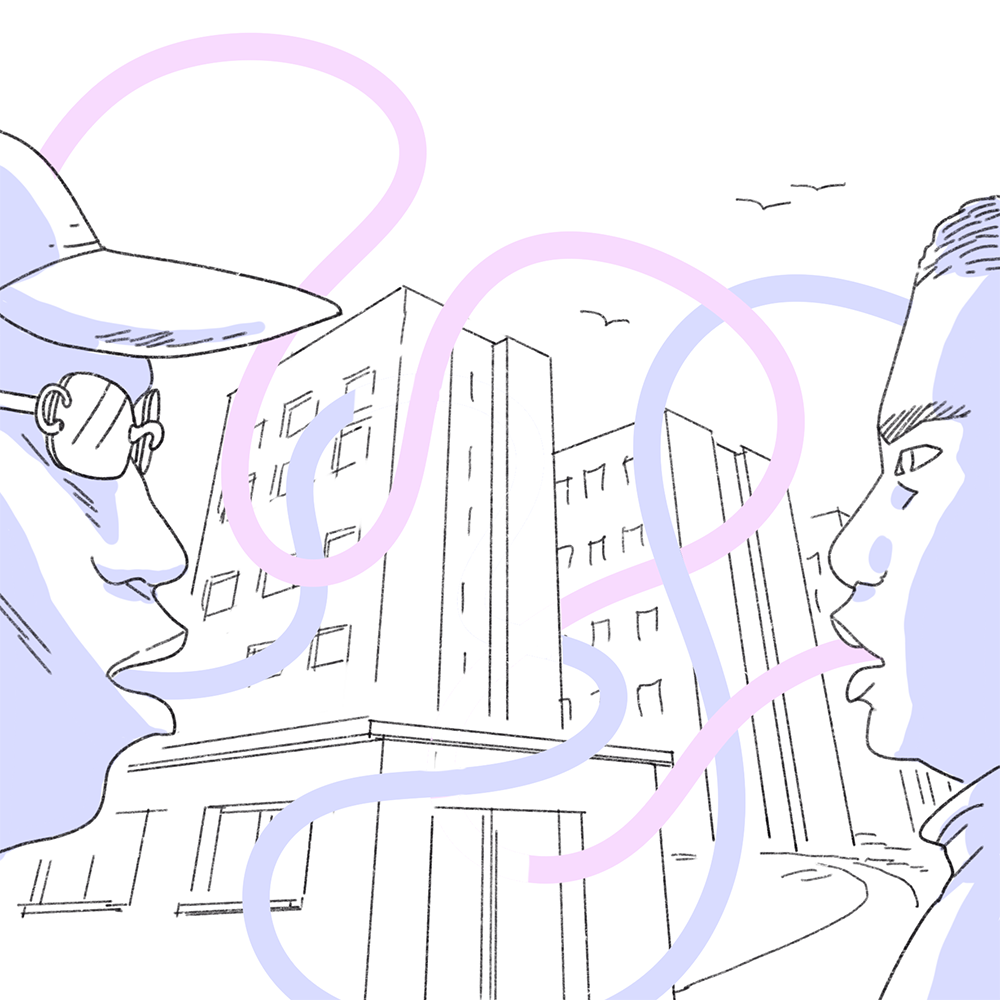
Article
A priori, pour le grand public, le Grand Lyon n’est pas une place forte du rap hexagonal. Pourtant, de nombreux acteurs ont solidement posé depuis 30 ans les fondations de la scène locale, à l’échelle d’une agglomération qui regorge de talents cachés.

Interview de Corinne Lachkar
Costumière

Article
Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.

Article
Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

Interview de Lionel Arnaud
Professeur en sociologie à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et directeur adjoint du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP)

Interview de Claudia Palazzolo
Maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 et auteure

Interview de Michel Agier
anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et directeur d’études à l’EHESS.

Depuis leurs origines, la prospective de la Métropole de Lyon et le Défilé ont une histoire commune, liée à la naissance d’un nouveau sentiment d’appartenance au territoire grand-lyonnais

Politique de la ville, mixité sociale, vivre-ensemble : comment s’articulent les différentes dimensions inclusives de cet évènement ?