[Vidéo] Les publics du Défilé

Article
Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Michel Agier
Michel Agier est anthropologue, directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le développement et directeur d’études à l’EHESS. Ses recherches ont d’abord été menées dans des grandes villes d’Afrique et d’Amérique latine, dans des quartiers populaires. Elles ont porté sur les mobilités sociales, les assignations, les mobilisations culturelles, ethniques et raciales, avec une attention particulière aux carnavals et fêtes religieuses.
Son ouvrage Anthropologie du carnaval. La ville, la fête et l’Afrique à Bahia (éditions Parenthèses, 2000) a rendu compte d’un travail monographique considérable sur le carnaval de Salvador de Bahia au Brésil. Ses enquêtes plus récentes ont porté sur la condition d’étranger, l’hospitalité, les peurs.
Dans cet entretien réalisé en liaison avec une enquête sur le Défilé de la biennale de la danse, Michel Agier montre comment ce moment de transgression offert par le carnaval pendant lequel la rue est au peuple peut être utilisé par des minorités comme un espace de construction identitaire, de conquête d’une fierté, et finalement de négociation d’une meilleure place dans la société, au moins sur le plan symbolique.
Mais peut-on transposer ces mécanismes carnavalesques au sein de notre société très policée ?
À Lyon, si le Défilé de la biennale de la danse est réputé exercer un effet réparateur envers certains territoires ou groupes sociaux, ses mécanismes fondamentaux reposent moins sur la primauté de l’auto-organisation, voire du désordre, que sur une orchestration finement réglée par les organisateurs.
Comment le carnaval est-il devenu pour vous un objet de recherches ?
Ce n’était pas a priori un goût pour les carnavals. Cet objet de recherche a trouvé sa source dans ma réflexion quand je travaillais en Afrique de l'Ouest, dans les pays qui forment le Golfe de Guinée, une région qui autrefois était appelée la côte des esclaves parce qu’elle a fourni, à la fin de l’esclavage, un grand nombre d’esclaves aux Amériques. L'Institut de recherche pour le développement m’a donné la possibilité d’élaborer des programmes de recherche au Brésil, alors que j’étais encore entre le Cameroun et le Togo. Mes questions étaient : Que sont devenues et que deviennent encore les cultures nées en Afrique dans les contextes américains, post-esclavagistes ? Qu’est devenue l’Afrique hors d’Afrique ?
C’était le moment où émergeaient les cultural studies, les ethnic studies, le thème du Black Atlantic de Paul Gilroy était en train d’arriver, sur les communautés diasporiques formées par les descendants d’Africains dans les Amériques et Caraïbes… Je me suis rendu compte qu’il existait une littérature considérable, notamment historique, sur les Afriques aux Amériques, des travaux classiques aussi sur les liens entre l’ancienne côte des esclaves et l’État de Bahia au Brésil et sa capitale Salvador, tout un pan de recherche afro-brésilienne également. Une fois sur place, mes collègues brésiliens, intéressés aux questions de changement social, m’ont fait plonger dans la modernité brésilienne. À Salvador de Bahia, je me suis intéressé aux productions culturelles qui étaient réalisées au nom de l’Afrique, dans un contexte de domination raciale, puisqu’au Brésil il y a un background raciste et post-escalavagiste.
Comme tout le monde, au moment du carnaval, j’aimais « sauter (« pular ») au carnaval », comme on dit pour les gens qui ne sont pas inscrits dans des blocs. J’étais fasciné par le carnaval, sans en faire, au départ en tout cas, un objet de recherche. Le grand quartier où je me suis établi pendant deux ans (j’en ai passé sept au Brésil) était populaire et ouvrier, pauvre, noir et métis, avec une partie occupée par des favelas. C’est là que j’ai commencé mon travail de terrain, d’abord par des enquêtes sur les questions de pauvreté et de mobilité sociale. Il se trouvait que dans ce quartier, s'était formé vingt ans plus tôt, en 1974, Ilê Aiyê, le plus grand bloc carnavalesque afro du Brésil, sur lequel j’ai ensuite concentré mes travaux. C’est ainsi que je suis arrivé à m’intéresser à la question du rituel carnavalesque, et à considérer le carnaval comme un rituel.
Pourquoi qualifier le carnaval de rituel ?
Un carnaval est une fête populaire, un événement touristique, un événement qui transforme beaucoup de choses. Il dure un jour, deux jours, cinq jours, il peut en durer douze. Avant même que le rite ne prenne le nom de carnaval, il existait des rituels de passage de saisons. Rome fêtait ainsi les Saturnales, chaque année, à la fin du mois de décembre. Elles faisaient partie des fêtes agricoles qui, commencées en automne, se prolongeaient jusqu'au solstice d'hiver... Il existait bien des formes de fêtes de carnaval, très ritualisées, qui viennent de l’ancestralité, en l'occurrence européenne très largement. Par rituel dans le carnaval, j’entends un espace-temps qui a un début et une fin, donc un espace délimité dans le temps et l’espace physique, qui permet des choses qui se situent en dehors de la vie ordinaire, comme le déplacement des identités, des transgressions. On se met en dehors de la vie ordinaire, dans le temps et dans l'espace qu’on appelle carnaval, et auquel on a pu donner d’autres noms, les fêtes dionysiaques par exemple.
Dans les rituels qu’on retrouve au 11ème siècle en Europe, dans les différentes fêtes de carnaval, on trouvait des hommes costumés en femmes, des gens qui miment les enfants, des curés ivres, etc. Tout n'est pas unifié dans le carnaval, mais vous avez un dispositif de scène où se passent des choses qui ne pourraient pas se passer dans un autre contexte que celui-là. C’est un temps et un espace dans lequel on est autorisé à se déguiser, à insulter les gens, à se moquer, à faire des grossièretés. L’historien Daniel Fabre a pu intituler un de ses livres « Carnaval ou la fête à l’envers » (1992). Je ne pense pas que tout soit inversion dans le carnaval, mais tout est mis dans le désordre, un désordre néanmoins qui fait partie d’un certain ordre, dans lequel vont s’exprimer un certain nombre de choses. Évidemment, c’est une permission qu’une société se donne, ou qu’au départ le peuple se donne, ce qu’on retrouve maintenant dans les carnavals en Amérique latine par exemple, ou dans la région du Pacifique colombien.
La présence du peuple dans la rue est aussi une permanence dans la définition du carnaval. D’ailleurs au Brésil, à Bahia, quand on ouvre le carnaval, le cri de carnaval c’est “la rue est au peuple” (« A rua é do povo »). Ça y est, pendant cinq jours, la rue est au peuple. Ceux qui n'aiment pas s’en vont. Peu de villes en France pourraient supporter ce qui s’y passe. En comparaison avec Rio par exemple, qui est davantage un carnaval de spectacle, Salvador est un carnaval de rue, et pas un carnaval du spectacle.
Quelle est la différence entre un carnaval de rue et un carnaval de spectacle ?
Un carnaval de rue, c’est simplement quand les gens descendent dans la rue. A Salvador, on compte un à deux millions de personnes. Pour avoir un minimum d'ordre, 10 ou 15 000 policiers circulent. Il y a beaucoup de violences et beaucoup de choses associées à ce désordre. Mais le désordre s’inscrit dans un ordre social, c’est comme une parenthèse, comme un droit ritualisé : le carnaval revient chaque année, l’espace et le temps sont ritualisés, réservés pour cette fête. L’autre élément qui fait que c’est un rituel, c’est la forme de la participation, ce qu’on va faire et ce qu’on va dire, comment on va défiler, les musiques que l’on va jouer, le déguisement et le masque que l’on va porter, ce qui touche aussi à la provocation, à l’agressivité…
Au Brésil, dans le bloc afro Ilê Aiyê, des concours vont sélectionner des sambas pour chanter pendant le défilé, des concours vont élire la « Déesse d’ébène » qui est la déesse afro du carnaval. Juchée sur une plateforme, elle sera la personne qui danse et qu’on regarde. Tout ça, ce sont des choses qui sont ritualisées, dans le sens où ça revient chaque année, et qui demandent une préparation particulière, des apprentissages, pour les pas de danse, la musique, les rôles que l’on joue. On retrouve ça en France, quand des gens apprennent par exemple les batucadas qu’ils joueront lors d’un carnaval. Le masque contribue beaucoup au rite. Il a une fonction symbolique et contribue à se mettre hors de soi et de la vie ordinaire dans le carnaval, avec tout un contexte qui y contribue, y compris, à Bahia, l’alcool et les drogues... Ces éléments-là font partie de la mise hors de soi, alors qu’ils seraient prohibés et auraient un tout autre sens s’ils advenaient dans la vie ordinaire. La transformation des corps, des mouvements, des gestes, tout ce qu’on s’autorise à exhiber à ce moment-là, est possible parce que le contexte est rituel. Il y a un espace, un temps, un contexte qui permet un rôle, qui lui-même est un rôle rituel. Ce qui n’empêche pas que dans un carnaval, il peut y avoir du spectacle. J’utilise parfois l’expression de spectacle rituel, parce que certains blocs de carnaval ont besoin d’être regardés, ils existent parce qu’on les regarde.
Nos sociétés modernes semblent éloignées des sociétés où des fêtes rituelles permettaient à une communauté de se régénérer, de marquer le passage d’une année à l’autre, dans le cycle du temps. Quel est le lien aujourd’hui entre le carnaval et la communauté ? Un carnaval contribue-t-il à définir une communauté ? Auprès de qui ? Ceux qui défilent dans un groupe du carnaval, ceux qui s’y identifient, ceux qui assistent au carnaval ?
Dans le carnaval il y a des moments où l’individuel rejoint le collectif, où tout d’un coup, quelque chose se met à exister. Ce quelque chose, c’est un sentiment de communauté, d’être dans un collectif. C'est le principe de la communauté rituelle. Si le rite est réussi, une communauté rituelle se met à exister. Cela peut être un moment de catharsis, d’identité, de rédemption, un moment plein d’élans, d’affects.
Chez les ethnologues, on considère souvent qu’il y a trois phases dans le rituel : le préliminaire, le liminaire et le post-liminaire. Le préliminaire, c’est la séparation de son identité ordinaire, par des lavages et tout un tas de gestes qui marquent la rupture très nette entre la vie ordinaire et le moment rituel où l’on va rentrer. Le liminaire, c’est le moment de la formation de la communauté rituelle, de l’agglomération, de la réunion, du regroupement. Et le post-liminaire, c’est le moment où l’on revient dans la vie ordinaire, en ayant été transformé par le rituel. Il faut qu’il y ait ces trois moments, et que la séparation soit marquée.
Au Brésil, quand vient le mercredi des cendres, que le carnaval est terminé, il y a toujours des gens qui ne veulent pas terminer et continuent la fête, mais par cette attitude ils rappellent que la norme est de clore la fête le jour des cendres.
Le carnaval est-il aussi le moyen pour une communauté de dire son identité ?
À Bahia, quand les blocs que j’ai étudiés se mettent à dire « nous sommes les Africains à Bahia », ma réaction d’anthropologue ayant vécu longtemps en Afrique, est de me dire qu'ils ne sont pas Africains ! Ils arrivent néanmoins à croire eux-mêmes et à faire croire autour d'eux qu’ils sont Africains à Bahia. Les chansons de samba sont assorties d’emprunts au culte du candomblé. Pour faire des gestes qui rappellent l’Afrique, pour réintroduire le culte afro-brésilien dans ce moment-là, il y a des tenues, des manières de s’habiller qui font africain. Ils créent un imaginaire qui va faire exister cette communauté rituelle pendant le moment du carnaval.
Dans mon livre je détaille tous ces rituels qui sont pratiqués, de mini-rituels très détaillés à l'intérieur du grand rituel carnavalesque : les lavages, les cérémonies pour ouvrir le chemin, les gestuelles spécifiques dans le défilé, etc. Les gens eux-mêmes vont s’appeler ou être désignés les Africains à Bahia. Il y a donc une communauté rituelle qui réussit à exister.
Le nom Ilê Aiyê signifie en yoruba maison (Ilê) et le monde physique, matériel (Aiyê). Les membres du groupe le traduisent « mundo negro », le « monde noir ». Ils créent ainsi un monde afro. Ils réussissent finalement à produire une utopie concrète, ils mettent en scène et font exister dans le carnaval quelque chose qui n’existe pas mais qui se met à exister et qu’ils appellent l'Afrique. Évidemment ce n’est pas l’Afrique comme territoire, c’est quelque chose d’autre. C’est une utopie qui est réalisée pendant cinq jours. Tout cela ne veut pas dire que tous les gens autour du carnaval font partie de cette communauté. Des gens peuvent en être spectateurs, et trouver incroyable de voir ainsi un groupe africain traditionnel. Tout le carnaval ne fait pas une communauté. Je dirais la même chose du rite dans le carnaval, toute la fête carnavalesque, dans tous ses détails, n’est pas un rite.
Une fois que le carnaval est fini, la communauté rituelle n’existe plus. Le carnaval produit-il malgré tout des effets dans la durée ?
Si j’en reste à la monographie très riche réalisée à Bahia, dans les groupes appelés afros ou africains, et dans le groupe Ilê Aiyê qui est le premier et le plus important, ce qui s’est passé durant et autour du carnaval se répercute dans toute la vie des gens, ça reste et ça s'incarne dans les subjectivités, dans le sentiment accru d'être fier, dans la fierté d’être Noir. Pendant qu’ils défilent, ils sont admirés par tout le monde. C’est pour ça que le rituel peut être qualifié de spectacle rituel. Il intervient dans un contexte de relations raciales particulièrement inégales, de racisme idéologique, structurel, ancré, qui semble absolument sans solution, qui s’exprime par exemple par des manières péjoratives de désigner les Noirs ou un paternalisme écrasant, source de sujétion, d'humiliation pour les personnes racisées.
Au moment du carnaval, tout change : ils deviennent « l’élite noire », ils se tiennent tous très haut, ils dansent très bien, tout le monde les admire, leur ensemble musical est toujours très performant, tout le monde l’admire aussi. Tout devient merveilleux, c’est le principe du carnaval. Il ne faut surtout pas que ça ressemble à la vie réelle. Ça, c’est quelque chose qui reste pour eux. Par exemple, ils gardent chez eux les tenues du carnaval, ils en font des tissus par exemple pour les sofas, pour les couettes, c’est un tissu qui reste dans la maison. J’étais impressionné de voir des gens qui chez eux étaient encore dans la reproduction de leur communauté rituelle. Cela n’était plus le cas quand ils allaient travailler, mais il y avait quelque chose comme ça qui restait imprégné dans leur vie quotidienne.
La force de ce groupe-là, c’est aussi d'avoir créé un calendrier : les gens se retrouvent pratiquement toute l’année, du mois de septembre jusqu’au mois de mars, jusqu’au carnaval. Il y a des fêtes pratiquement tous les samedis soirs, qu’on appelle les fêtes de répétition du carnaval. Il y a aussi tout un tas de commémorations qui sont faites pour célébrer des héros de l’histoire afro-brésilienne. Ils se retrouvent et entretiennent ce sentiment, pas forcément d'être une communauté soudée, comme elle peut apparaître dans les spectacles rituels, mais d'être dans un quartier où l’on entretient des relations de solidarité, où il y a une sorte de familiarité. Ce n’est pas vrai pour d’autres blocs de carnaval, qui sont plutôt des blocs où on va écouter de la musique endiablée, se déguiser, mais ni mettre une signification particulière à tout ce qu’on fait, ni s’identifier forcément à une communauté.
Ceux qui investissent ce carnaval sont-ils ceux qui ont des bonnes raisons de le faire ? Faut-il notamment être malmené dans la vie sociale pour vouloir occuper cet espace rituel ?
Victor Turner, l'anthropologue qui a travaillé sur les rituels, parlait du « pouvoir rituel des faibles » pour dire que ce sont les faibles socialement qui se trouvent dans cet espace de chamboule-tout, où tout se renverse.
En réalité je pense que c’est plus compliqué que ça, car les très faibles sont trop faibles pour s’organiser, pour avoir un peu d’argent pour s’acheter les costumes et tout ce qu’il faut pour le rituel carnavalesque. Mais l’idée de pouvoir rituel des faibles est intéressante, parce qu’il y a l’idée d’un espace-temps rituel en dehors de la vie ordinaire, et dans lequel on peut se venger en quelque sorte, créer une autre image de soi. Rejeter les blancs par exemple, ce qu’a fait le groupe afro sur lequel j’ai travaillé, qui a décidé qu’il n’y aurait pas de blancs dans leur carnaval. Ils ont été longtemps traités de racistes.
Maintenant la critique est moins frontale, on leur dit « vous avez un défilé absolument magnifique, c’est la tradition africaine, mais pourquoi refuser les blancs ? ». La non-mixité qu’ils ont mise en place, à la manière de certains autres blocs qui ne prennent que des femmes ou que des hommes, est une condition de réussite, car l’imaginaire qu’ils fabriquent, le monde imaginaire qu’ils inventent, ne pourrait fonctionner avec la présence de blancs, même très sympathiques. Ça ne serait plus le même spectacle, ça ne serait plus la même chose. Donc il faut qu’ils le fassent.
Une des conclusions de l’étude que nous avons menée sur le Défilé de la Biennale de la danse de Lyon, est que pour un certain nombre de participants, qui viennent de quartiers ou de communes qui n’ont jamais été considérées comme des lieux de culture, qui ont été plutôt des territoires dénigrés, comme Saint-Étienne ou les communes de l’Est lyonnais, défiler permet de réparer une identité blessée, maltraitée. Ils vont être très valorisés en défilant au cœur de Lyon.
Oui, c’est exactement la conclusion à laquelle j’arrive dans un dernier travail sur Ilê Aiyê. Pour les 50 ans du groupe, je suis retourné au Brésil pour écrire un papier sur leur histoire, de 1974 à 2024. Il se termine exactement sur ce point de la réparation.
À Lyon, il y a sans doute beaucoup à réparer. Dès lors qu’existe un accord sur le fait que le carnaval ou le défilé est un espace rituel, qu’on peut y exprimer des choses qui ne sont pas celles du quotidien, alors les groupes qui sont dans la marginalisation, ou dans l'humiliation, l'exploitation, la soumission, peuvent y trouver un espace où ils vont être vus et peuvent se donner une image identitaire, une image d’eux-mêmes qui va être applaudie, admirée. À ce moment-là, il y a un phénomène de réparation. Ils vont montrer quelque chose qui change le regard porté sur eux-mêmes. Produire une autre image de soi peut faire partie des enjeux du déguisement de carnaval.
Pour revenir à cette histoire du bloc afro qui ne veut pas de Blancs, leur spectacle serait raté s’il intégrait des Blancs, y compris s’il mettait en scène l’amour réciproque entre Blancs et non-Blancs, car c’est précisément cette réparation symbolique qui est importante et qu’ils obtiennent par eux-mêmes, par le spectacle rituel.
Dans le cas de ce carnaval de Bahia, est-il important que ces groupes afros se produisent devant un public qui n’est pas uniquement afrodescendant ?
Oui, c’est très important. Ils sont apparemment dans l'entre soi mais sans y être. Ils sont en train de montrer l'Afrique à Bahia tout en se convainquant eux-mêmes, plus ou moins, qu’ils représentent et rendent une espèce d’hommage permanent à la matrice africaine. Ce terme, intéressant, n'existait pas au début du groupe dans les années soixante-dix. Sur le plan symbolique, ils ont déjà réussi à obtenir réparation, d’une certaine façon, même si on est loin du compte sur le plan social, économique ou politique, vu les siècles d’esclavage et de domination raciale.
Ces groupes afrodescendants, en exprimant dans le carnaval qu’ils ont une histoire différente des Blancs, qu’ils ont été les enfants d’esclaves, trouvent-ils ainsi une place dans la société brésilienne, plutôt que d'être dans le « à côté » ?
En tout cas, cela leur a permis d’exprimer leur culture et leur identité tout en les recréant, et cela a donné lieu à une certaine traduction politique. La dimension politique a été dès le début très présente au carnaval de Bahia. Dès les premiers défilés par exemple, les gens brandissaient des panneaux contre le racisme. Au Brésil, le mouvement noir, qui a toujours été assez faible sur le plan politique, a été redynamisé par ces groupes culturels. Il a obtenu des résultats politiques. En 1988, le racisme a été reconnu dans la nouvelle Constitution brésilienne. Les quilombolas, ces descendants d’esclaves en fuite se sont organisés pour obtenir des titres de propriété foncière sur les terres occupées par leurs ancêtres. Leur revendication pour récupérer les terres de Quilombo a donné lieu, après des décennies de luttes, à une loi qui a reconnu des propriétés collectives aux communautés marronnes. Ce sujet a été porté par le groupe Ilê Aiyê lui-même.
Autre résultat, la mise en place depuis les années 2000 par les universités brésiliennes de quotas pour les étudiants noirs, ce qui n’est pas allé sans polémiques pour savoir qui est Noir et qui ne l’est pas. Dès qu’on passe d’une identification raciale issue d’un racisme à l’identité de couleur de la peau, apparaissent des phénomènes un peu ridicules autour de la question d’être plus ou moins noir, brun, etc. Les Brésiliens s’amusent beaucoup avec toutes les variantes de la couleur de la peau. Il n'empêche qu’avec cette politique des quotas, l’université en est venue à mieux refléter la société. Et le nouveau gouvernement de Lula a annoncé début 2023 des quotas pour les emplois dans la fonction publique et la création d’un ministère de l’égalité raciale, une première.
Il s’est passé un peu la même chose en Guadeloupe, avec deux groupes culturels, Akiyo et de Voukoum, qui se sont dits dans l’anti-carnaval, ce dernier étudié par Flore Pavy. Pour eux, défiler ce n'était pas pour faire la fête, mais une manière d’exprimer leur culture africaine, leur ancestralité, leur identité. Ces mouvements-là, et notamment Akiyo, ont joué un rôle important dans ce qui s’est appelé mouvman kiltirel en Guadeloupe, mouvement qui s’est formé en parallèle aux groupes culturels brésiliens, dans les années 1980-90, et qui a ensuite joué un rôle dans les contestations politiques et sociales de 2009-2010.
Comment les autorités locales soutiennent-elles, et surtout perçoivent-elles le carnaval, qui, va mettre la ville dans le désordre pendant plusieurs jours ?
La municipalité de Salvador et l'État de Bahia peuvent apporter des aides aux groupes, s'ils le demandent, mais c’est surtout les cotisations qui vont vivre les groupes. Le groupe Ilê Aiyê compte 3 000 membres. De façon générale les autorités craignent le carnaval. Leur problème, c’est le peuple.
À Bahia, le jeudi soir, le maire ou la mairesse de la ville remet symboliquement les clés de la ville à un gros bonhomme très risible, considéré comme le roi du carnaval, un type énorme déguisé comme un pantin. À ce moment-là, c’est dit : “ça y est, il a les clés de la ville, la rue est au peuple”. Pendant cinq jours, il n’y a plus de maire ! Pour les autorités municipales, il y a toujours une crainte, celle du désordre extrême, voire celle du renversement, un très vieux thème. Dans son livre Le carnaval de Romans. De la Chandeleur au Mercredi des cendres 1579-1580, Emmanuel Le Roy Ladurie souligne qu’il y a toujours la crainte du carnaval séditieux, où les gens jouent des rôles de renversement d’un ordre, en couronnant le roi d’un groupe de carnaval... Le rituel carnavalesque est sans doute de plus en plus difficile à faire passer dans nos sociétés très contrôlées, très policées. Dès lors que l’on dit “la rue est au peuple”, que ce soit pour une heure ou pour plusieurs jours, la ville s’ouvre à la licence carnavalesque. A Bahia, le carnaval existe, il est impossible de l'empêcher. Il ne peut pas ne pas exister. Cela dépasse les choix d’une municipalité.
Justement, comment se passe ce carnaval, concrètement ?
Sur toute la ville de Salvador, sur les cinq jours du carnaval, 1,5 à 2 millions de personnes vont descendre dans les rues. Il y a trois lieux de défilé principaux, sur une dizaine de kilomètres. Quand les groupes défilent, ils sont parfois derrière d’énormes camions qui transportent des sonos hyper puissantes. Parfois les camions sont surmontés d’une plateforme où des groupes chantent, animent. Derrière, selon les groupes, on trouve des ensembles de percussions, qui rassemblent entre une vingtaine et 150 personnes. Et encore derrière, les membres du groupe défilent, chantent et dansent. Tous ces gens-là sont à l'intérieur de cordes, qui avancent en même temps que le groupe, pour délimiter ceux qui en font partie et les autres.
Derrière ces cordes, une multitude de gens suivent et regardent, ils n’ont pas de déguisement. Cela m’a fait souvent penser à des manifestations, ces gens qui accompagnent le bloc qu’ils préfèrent, sans en être membres. Au total, il doit y avoir une quarantaine de blocs afro, avec chaque fois 2 à 3 000 personnes à l’intérieur des cordes, dans les défilés proprement dits. Le nombre des gens qui les accompagnent n’est pas vraiment connu mais il est énorme. Il y a aussi tous les autres blocs, les « trios » qui sont ces camions avec d’énormes sonos et un rythme très différent, et là les gens sautent, suent, dansent n’importe comment, c’est très endiablé, très délirant, mais ils ne jouent pas de rôle particulier, ils ne mettent rien de spécial en scène, ils sont là pour s'éclater, en général avec beaucoup d’alcool et diverses drogues. Cela ajoute des dizaines de milliers de personnes.
En de rares endroits, on trouve comme à Rio des gens installés sur des tribunes qui regardent passer. En général, quand on va au carnaval sans faire partie d’un bloc, on met short, t-shirt et tennis, et rien dans les poches, pas d’argent, pour ne pas se faire voler. C’est une ambiance très spéciale. Il y a énormément de violence, des règlements de compte, même des gens qui se font tuer dans le cadre du carnaval, car on n’y voit rien. A chaque bilan de carnaval, on compte les morts.
Pour revenir à la France, comment interprétez-vous en tant qu’anthropologue le phénomène du blackface, quand, lors de la Nuit des Noirs, un des moments forts du carnaval de Dunkerque, des participants se griment le visage en noir, suscitant la critique d’associations antiracistes ?
J’ai été à Dunkerque, et on m’a demandé de réagir à ce qu’il s'était passé. J’ai écrit un texte pour la revue en ligne AOC. Quand des Blancs se déguisent et se peignent le visage en noir, il faut comprendre qu’on est dans le cadre d’un carnaval. Ce qu’on peut regretter, c’est que le carnaval ne soit pas investi par d’autres, c’est que les Noirs eux-mêmes n’investissent pas le carnaval, pour jouer quelque chose qu’ils jouent par exemple en Guyane avec le défilé des nèg’ marrons, qui critiquent ainsi l’esclavage et les dominations post-esclavagistes. Ce sont des personnes noires qui se déguisent en Noirs et se peignent en noir. Dans le même carnaval on trouve des gens déguisés en Blancs, avec le visage peint en blanc. Dans les carnavals, il existe depuis très longtemps des personnages qu’on pourrait considérer comme des expressions d’un racisme, le Juif, le Maure, la Tsigane, la sorcière, etc. Cela devrait-il être prohibé ? Faudrait-il interdire que les hommes se déguisent en femmes par exemple ? Dans les carnavals brésiliens, on voit des hommes très machos qui se déguisent en femmes pour ridiculiser la féminité mais celle-ci les fascine, à moins qu’ils se moquent de leur propre fascination. Ils mettent en scène d’énormes seins et d’énormes fesses. Dans le carnaval ils rencontrent des travestis, et alors il y a une totale confusion des genres, de l’inversion des genres aussi. Il serait malaisé de qualifier ce qui est de l’ordre de la manifestation raciste dans un espace comme celui-ci, qui justifierait une interdiction. Si on interdit, cela signifie qu’on n’est pas dans un rituel, mais dans la vie de tous les jours. Interdire enlèverait à la société, et notamment aux groupes minoritaires, marginalisés, indésirables, la possibilité d'exister différemment dans l’espace rituel.
Je reconnais que c’est une question peu évidente, notamment pour les politiques publiques. Mon point de vue est qu’il ne faut pas supprimer l’espace rituel au nom de sujets sensibles, parce que tous les sujets sont sensibles. J’ai étudié des petits carnavals en Colombie, où les défilés étaient beaucoup plus réduits, ils rassemblaient des groupes de 30, 40, 100 personnes qui montaient sur de minuscules chars qu’ils fabriquaient eux-mêmes, et là tous les sujets étaient bons, dans la moquerie, la raillerie, la rigolade, on se moquait un peu de tout. C’est le principe, quand on va au carnaval, on n’en ressort pas indemne. C’est ce qu'on a appelé les carnavals sales, car dans le carnaval populaire, on s’envoie de la farine, des oranges, ou des tomates pourries. En France, les choses sont tellement policées, contrôlées, soumises à mille contraintes, que l’espace rituel est de plus en plus réduit voire impossible.
L’étude menée sur le Défilé de la Biennale de la danse n’a pas su raccrocher la question « raciale » ou de couleur de peau aux questions sociales et de genre, alors même qu’on observait que les femmes des classes moyennes blanches s’inscrivent surtout par elles-mêmes, alors que les personnes racisées sont, en proportion, plus souvent un public des quartiers en politique de la ville, captif, amené au Défilé par les structures associatives, ou encore que les participantes des ateliers couture, non visibles durant le Défilé, sont en majorité des femmes racisées.
Je suis assez libéral, voire libertaire de ce point de vue là : si on veut un carnaval, il faut jouer vraiment le jeu du carnaval, il faut pouvoir faire et dire ce qu’on veut et pouvoir parler d’Afrique, de Maghreb, de racisme, d’être Noir, d’être Blanc... A-t-on les moyens en France de faire exister des espaces rituels comme des carnavals où des sujets de ce genre-là peuvent s'exprimer ? J’en doute.
Le carnaval de Nice, par exemple, est très éloigné de cette fonction rituelle du carnaval. Celui de Dunkerque, avec sa tradition locale des pêcheurs a en revanche quelque chose qui peut lui permettre d’avoir cette dimension populaire. En ce qui concerne le Défilé de Lyon, peut-être vaudrait-il le coup de demander aux participants qui viennent des quartiers populaires, ce qu'ils feraient s'ils étaient tous seuls à imaginer leur propre carnaval. Ne pas les inviter à participer à une initiative, leur dire d’avoir leur propre initiative.
Est-il plus compliqué aujourd’hui qu’hier de faire une fête carnavalesque en France, en raison des peurs et des contraintes de sécurité (pandémie, attentats…) ? Je pose la question parce que le Défilé de la Biennale de Lyon a été impacté par ces phénomènes.
Bien sûr, le climat sécuritaire se renforce, nous sommes dans un climat de peur, envahis par la peur « globalitaire », comme le disait Paul Virilio. Alors qu’on associe la terreur à des régimes totalitaires, où les États gouvernent par la terreur, nous sommes sans le savoir dans un régime de peurs multiples et incessantes qui produit le même effet que la terreur. Le climat général, médiatique, politique, mais aussi moral, intellectuel est saturé de la permanence des dangers, que ce soit la fin du monde, les crises sanitaires, ou le terrorisme. Face à tous ces dangers, la sécurité se renforce et devient plus visible. Et la visibilité de la sécurité a pour effet que la peur se développe, s'installe, prend la forme d’une terreur. Ce n’est plus la peur telle qu’on la connaissait sous une forme individuelle, c’est une emprise sécuritaire totale, une emprise totale de la peur.
Pour une mairie, cela peut s’ajouter encore à la crainte d’organiser un carnaval, alors même qu’elle le souhaiterait parce qu’elle veut développer de la sociabilité et de la fête dans sa ville. Nous sommes bourrés de contradictions. Georges Balandier a pu dire que tout ordre a besoin de désordre, et même que l’ordre naît du désordre. L'anthropologie s’intéresse beaucoup à ce rapport entre les ordres sociaux et les désordres rituels ou politiques. C’est quelque chose qui est permanent pour comprendre les sociétés, ce rapport avec le désordre. Mais cet énoncé très simple du point de vue des sciences sociales, devient risqué et hasardeux du point de vue politique.
Le carnaval permet-il d’exorciser ou d’apprivoiser nos peurs ?
Dans le petit livre La peur des autres, essai sur l’indésirabilité, je conclus sur la possibilité de résoudre les peurs à travers des formes de ritualisation. Au moment du pic de la pandémie de Covid, j’avais écrit “Vivre avec les épouvantails”, les épouvantails désignant tous les personnages imaginaires qu’on invente pour ridiculiser la peur. Mikhaïl Bakhtine, un historien qui fait référence sur les carnavals au Moyen Âge, expliquait qu’entre le 13ème et le 15ème siècle, c’est un des principes du carnaval : les fêtes populaires ridiculisaient les peurs et les puissants qui inspiraient la peur au peuple. Le peuple inventait des épouvantails qui allaient être moqués pendant les carnavals. D’où la formule de Bakhtine, « et le rire a vaincu la peur ». C’est une manière d’imaginer une solution aux peurs, à travers des pantomimes, des rituels, des personnages.
J’ai observé aussi, au Brésil et en Colombie, des personnages dont le rôle est de prévenir des dangers et de faire peur, mais d’être aussi des compagnons, qui nous accompagnent et qu’on aime bien. Certaines orishas, des entités surnaturelles considérées comme des divinités par les afro-brésiliens, ou des esprits de la forêt, les visiones, dans le Pacifique colombien, sont des personnages qui, par certains aspects, peuvent faire peur aux enfants et aux adultes, et à propos desquels existent de nombreux récits, contes, histoires qui se transmettent jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent devenir des personnages de carnaval.
En Colombie, d’anciens esprits de la forêt, inventés pour faire attention et ne pas s’y perdre, bien connus des gens car c'était comme ça qu'on gérait la peur et les dangers au sein des espaces naturels (forêts, rivières, mangroves), sont devenus en ville des personnages de carnaval qui portent des messages de protection de la forêt et de critique du capitalisme agro-industriel prédateur.

Article
Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.

Interview de Michel Agier
anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et directeur d’études à l’EHESS.

Article
En 2010, les sociologues Cédric Polère et Catherine Foret tentait de dresser un premier constat des démarches menées en ce sens, avec le Défilé comme exemple concret de projet fédérateur par-delà des inégalités persistantes et des incompréhensions profondes.

Article
Qui ne se rappelle de l'ouverture du défilé de la Biennale de 1998 ? Des êtres anachroniques et sans frontières ont surgit d'un ailleurs de nos rêves pour nous embarquer dans le mouvement de la fête.

Interview de Fred Bendongué
Chorégraphe

Interview de Philippe Delpy
Ancien membre du comité de pilotage du Défilé de la Biennale de la danse

Article
Les enjeux de la politique d’action culturelle qui s'est affirmée, au croisement de la crise du travail social et de ladite « crise urbaine », depuis le début des années 1990 dans les banlieues populaires, sont divers et complexes.

Interview de Dominique Hervieu
Ancienne directrice de la Biennale de la danse et du Défilé

Interview de Mourad Merzouki
Danseur-chorégraphe - compagnie Käfig

Interview de Margot Carrière
Chorégraphe
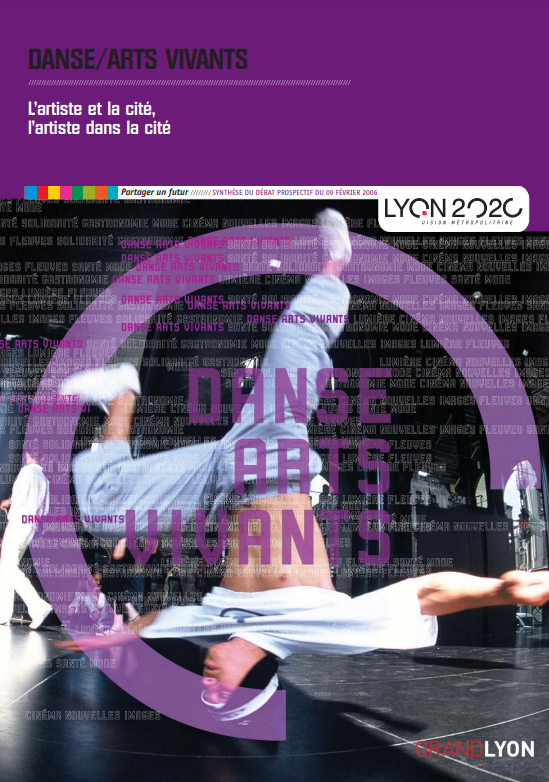
Étude
Aujourd’hui, la priorité est-elle à la découverte et à la promotion des talents « locaux » ou à l’accueil des représentants de la scène artistique internationale ? Synthèse du débat prospective du 9 février 2006.

Texte de Catherine FORET
Histoire du danseur Pierre Deloche.

Article
Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

Interview de Lionel Arnaud
Professeur en sociologie à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et directeur adjoint du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP)

Interview de Claudia Palazzolo
Maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 et auteure

Depuis leurs origines, la prospective de la Métropole de Lyon et le Défilé ont une histoire commune, liée à la naissance d’un nouveau sentiment d’appartenance au territoire grand-lyonnais

Au niveau culturel et artistique, quel rôle a joué le Défilé dans la reconnaissance de pratiques émergentes ?

Article
Dans cet article, retour sur une union de circonstance où chacun a su trouver son compte, sans avoir à trahir ses valeurs et ses missions, dans l’intérêt d’une renouvellement culturel et artistique qui allait marquer les années 90 et plus encore…

Article
Les arts de la rue se sont imposés au cours des 25 dernières années. Ils ont certes une filiation avec le spectacle vivant, mais développent aussi des problématiques originales.
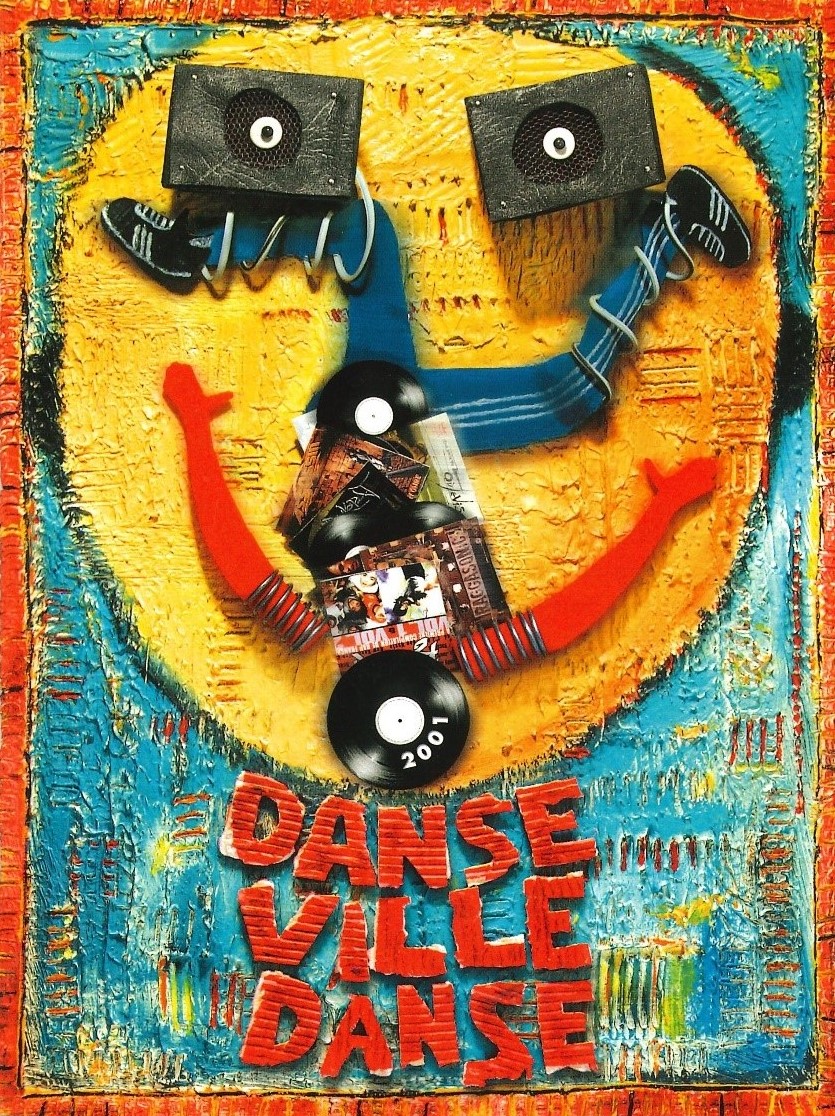
Article
La break dance a été réinventée par des jeunes qui se sont d'abord identifiés à ce que le mouvement hip-hop représentait. Ils ont progressivement pris place dans l'espace public de leur quartier, puis du centre-ville, pour se défier et s'entraîner à dessiner sur le béton armé avec l'énergie toute particulière de ceux qui s'engouffrent dans une brèche de possibles.

Étude
Une fête, une parade, un carnaval, un rituel, un emblème, un creuset, un bonheur, un défi, une histoire, une énergie ?... Retrouvez sur cette page toutes les étapes de nos réflexions sur le Défilé de la Biennale de la danse de Lyon, un évènement hors catégories !