[Infographie] Outils numériques et conditions de travail : un progrès, vraiment ?

Article
Cinq archétypes de travailleurs d’aujourd’hui, de leur environnement matériel jusqu’au coût environnemental de leur modèle.
< Retour au sommaire du dossier

Article
Depuis plus d’une décennie, « l’ubérisation » est une transformation majeure du travail. Dérivée de la célèbre entreprise américaine Uber, elle se caractérise par la transformation d’un secteur d’activité du fait de l’arrivée de plateformes de mise en relation entre clients et prestataires, qui s’appuient sur le « crowdsourcing », c’est-à-dire la « sous-traitance par la foule ».
Les nouvelles technologies numériques ont permis l’essor de cette économie de plateforme, dans le domaine du transport VTC (Uber, Beats, etc.), de la livraison de repas et de courses (Uber Eats, Deliveroo, Stuart, etc.), mais aussi dans celui de l’accès aux soins (Doctolib), du tourisme (Airbnb) ou encore de l’artisanat (Mon artisan).
Dans cet article, nous proposons de nous intéresser à une des activités liées à cette économie de plateforme la plus visible dans l’espace public : celle des coursiers à vélo. Exercé via de grandes plateformes, le métier a donné lieu à beaucoup de controverses juridiques et médiatiques depuis son arrivée en France en 2011, notamment à propos de sa précarité et de l’incohérence entre statut d’indépendant et rapports de subordination (autrement dit du salariat déguisé). Ces conditions de travail ont fait l’objet de nombreuses luttes, et des modèles alternatifs ont été créés, comme celui de la coopérative.
Pour saisir les lieux dans lesquels se déploie ce travail et les liens qu’il construit, nous avons rencontré Chernor, réfugié sierra-léonais qui espère poursuivre ses études d’informaticien en France, et qui exerce en tant que coursier depuis cinq ans. Nous sommes allés à sa rencontre avec de nombreux présupposés en tête : les coursiers seraient des travailleurs des non-lieux, privés de collectif de travail par la mise en concurrence, ayant des contacts très réduits avec les restaurateurs et les clients, isolés notamment par la médiation du smartphone et la mise à distance des corps dus à la pandémie de Covid-19.
Chernor nous a dépeint une situation plus complexe, qui invite à nuancer ces idées. Nous verrons que les relations entre coursiers sont ambivalentes, balançant entre solidarité, exploitation et concurrence, dans un milieu marqué à la fois par une relative homogénéité et de multiples fragmentations sociales. Le rapport aux lieux du travail révèle quant à lui les nombreuses compétences invisibles dont font preuve les coursiers. Nous décrivons également les liens inattendus que Chernor noue avec les clients et les restaurateurs, bien au-delà de la relation d’évaluation perpétuelle. Les paroles de Chernor sur son travail sont mises en lien avec sa trajectoire sociale, afin de saisir de manière fine son rapport au travail de coursier.
Dans l’exploration de tous ces sujets, nous tentons de mêler l’histoire individuelle et collective, le parcours spécifique de Chernor étant mis en perspective avec un apport théorique, qui s’appuie sur la lecture de plusieurs études sociologiques (quantitatives et qualitatives) émises par la recherche académique.
Pour parler du travail de Chernor, il faut s’attarder sur son parcours personnel, car comme le décrivent plusieurs sociologues, migration, livraison, et économie de plateforme semblent très liées. En effet, le monde des coursiers de plateformes a subi de profondes transformations quant aux caractéristiques de sa main-d’œuvre. Au cours de ses premières années d’implantation en France, cette activité précaire était principalement exercée par des étudiants et des personnes cumulant plusieurs emplois, et très rarement à plein temps (Jan, 2018).
Majoritairement blanche, motivée par la promesse de liberté et le caractère sportif de la livraison, partageant souvent « une forme d’identité de groupe autour de la culture du vélo » (Jan, 2018), cette main-d’œuvre a progressivement laissée place à une autre plus précaire, dans laquelle on retrouve beaucoup de travailleurs étrangers sans titre de séjour et autorisation de travail, autrement dit « sans-papiers » (Gomes, 2022), qui exercent cette activité à plein temps.
En cause, la détérioration des rémunérations (passage de la tarification horaire à la tarification à la course ou kilométrique, baisse des tarifications) et son corollaire, celle des conditions de travail (augmentation de la mise en concurrence, accélération des cadences, incitation aux comportements à risque, temps d’attente plus nombreux non rémunérés, etc.). Ces évolutions s’inscrivent dans la stratégie économique des plateformes. Pour s’implanter et transformer les modes de consommation, elles se sont appuyées sur la promesse d’une livraison très rapide, et ont dû constituer rapidement une flotte de coursiers suffisante, séduite par les promesses de rémunérations avantageuses.
À mesure que la clientèle se fidélise et que la main-d’œuvre disponible augmente, « les prix peuvent augmenter pour les consommateurs, mais celui du travail se réduit » (Gomes, 2022). Cette activité aux faibles barrières à l’entrée a donc été investie comme travail de subsistance par beaucoup de travailleurs immigrés ou issus de l’immigration, racisés, « confrontés à des discriminations sur le marché du travail salarié ou sans autorisation de travail » (Aunis et Stevens, 2021).
Une étude dirigée par Laëtitia Dablanc en 2021 à Paris indique que parmi les 400 coursiers interrogés, 90 % n’avaient pas la nationalité française, et 70 % exerçaient seulement cette activité, sans cumul d’emploi ou d’études en parallèle. Un constat qui n’est guère surprenant, dans la mesure où les travailleurs immigrés sont surreprésentés dans les secteurs d’activité les plus pénibles, qui peinent à recruter en France (« métiers en tension »).
Chernor, lui, fait partie de la « deuxième génération » de coursiers. Il a dû fuir la Sierra Leone il y a plus de sept ans, et atteint les portes de l’Europe par les côtes italiennes en 2016. Il est accueilli en Italie par une famille qui l’accompagne dans ses démarches administratives, puis parvient à obtenir une carte d’identité, et s’inscrit à l’université. Mais le racisme ambiant devient trop menaçant pour lui. Il décide alors de partir rapidement vers la France (en 2018), via un passeur qui le déposera à Lyon, ville dont il ne savait rien avant d’y arriver, et dans laquelle il est installé depuis. S’il ne bénéficie pour l’instant d’aucune aide ici, il espère y gagner en respect et en perspectives.
Comment es-tu arrivé à Lyon ?
Avec une voiture parce que quand je voulais quitter l’Italie, il y a les gens qui conduisent les camions et les petits taxis, je paye 250 euros, pour faire Italie-France. […] Normalement, je peux prendre le train avec mes pièces d’identité, mais je ne sais pas tu vois… donc j’ai fait le passage illégalement, parce que j’étais vraiment pressé.
La France, c’est ta destination finale ou tu vises un autre pays ?
Hum… Moi j’aime bien France, parce qu’en Italie pour un black c’est tellement difficile. En Italie, tous les noirs sont des réfugiés ou des pauvres qui n’ont rien. Mais la première fois que j’arrive en France, ici à Lyon, j’ai vu un black qui conduit une Ferrari. C’était la première fois que je voyais ça. J’ai aussi vu l’équipe de France [de football] […] si tu vois les pays en Europe, la France elle a beaucoup de noirs qui la représentent. […]
Tu as l’impression qu’en France tu aurais peut-être plus d’avenir qu’en Italie ?
J’ai quitté l’Italie parce que là-bas j’allais à l’université pour être informaticien, sauf que je me fatigue avec des racistes parce qu’il y a toujours des histoires avec l’Islam. Il y avait des hommes blancs qui me posaient tout le temps des questions racistes là-bas, tout ça me fatigue quoi… J’ai dit à l’université beaucoup de fois qu’il y a beaucoup de racisme contre moi, mais il n’y a rien qui change. Je vois que personne ne va me comprendre, oui j’ai une bonne vie là-bas, j’ai les aides, mais il n’y a pas de respect parce que je suis black. C’est pour ça j’ai préféré quitter l’Italie, il n’y a pas une bonne vie, il n’y a pas de respect pour moi, si je finis d’étudier là-bas, pour trouver un boulot c’est… (rires)
Arrivé à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu, Chernor est livré à lui-même. Il ne connaît pas le français, mais parle anglais, peul, italien, soussou, maninka, et se met à la recherche d’interlocuteurs potentiels. Il entend alors parler de l’amphi Z, un squat ouvert à l’initiative de réfugiés et d’étudiants, où il sera hébergé quelque temps.
Quand je descends à Part-Dieu, il y a des Nigériens que je rencontre parce que si tu es un immigrant, surtout d’un pays anglophone, tu cherches les gens qui parlent [des langues que tu connais], c’est comme les diamants pour toi quoi, comme des choses de valeurs. Quand je vois les Nigériens, je leur demande, “Je viens d’arriver, je ne sais pas comment je vais faire”, et ils me disent “Il y a un grand bâtiment, il s’appelle amphi Z à Cusset”, donc ils me ramènent là-bas, on me donne une chambre, mais… (rires) les bagarres et tout, donc, le squat (soupir)… […] Donc j’ai commencé à trouver des choses pour travailler comme ça, pour avoir ma vie privée quoi.
Alors qu’il cherche le moyen de subvenir à ses besoins, il découvre la livraison par le bouche-à-oreille, et travaille pour Stuart en 2018, via le compte d’un autre coursier.
Au début où j’ai commencé à faire les livraisons, ce n’est pas des “professionnelles” que j’ai faites. […] Le compte est à son nom, donc tout l’argent de mon travail va direct à lui, il se paye 100 euros, ou 130 euros la semaine, et il me donne le reste. […] Sauf qu’à ce moment-là je n’ai pas eu le choix. Depuis que je vis en France, je n’ai pas d’aides, je dois prendre une maison, je dois manger.
Ce qu’a vécu Chernor se retrouve largement dans la littérature scientifique. En effet, la précarisation du travail a entraîné des pratiques d’exploitation entre coursiers, comme la location de compte à des travailleurs « sans-papiers » (ou méconnaissant leurs droits, comme dans le cas de Chernor). Ne pouvant ouvrir leur propre activité, ils payent l’accès à des comptes contre une partie de leur chiffre d’affaires. Et parfois, lorsque la cagnotte du compte se remplit, le propriétaire le clôt et spolie la rémunération des travailleurs-locataires. Ces pratiques de travail informelles sont illégales et renforcent encore la précarité, mais sont pourtant très répandues.
Les plateformes entretiennent une relation ambiguë vis-à-vis de ce phénomène. D’un côté, la demande croissante et la très faible marge des livraisons dans leur modèle économique (qui pousse à rogner la rémunération des livreurs, tout en accélérant les cadences) induisent de fait le recours à cette main-d’œuvre dépourvue d’autre choix. De l’autre, face aux pressions de l’État quant à cette situation, elles mènent une politique répressive plutôt que de régularisation de ces travailleurs. L’entreprise Uber Eats notamment s’est illustrée en 2020 par la suspension de nombreux comptes soupçonnés d’être sous-loués, ce qui a donné lieu à d’importantes mobilisations de coursiers « sans-papiers ».
Alors qu’il est parvenu à louer un logement individuel à un particulier, Chernor se fait escroquer par le propriétaire du compte sur lequel il fait les livraisons. Voyant ses difficultés financières, c’est un autre coursier qui lui explique ses droits : sa carte d’identité italienne lui permet d’ouvrir un statut d’autoentrepreneur et de travailler légalement pour les plateformes de livraison.
Au début, je travaillais avec le compte de quelqu’un, mais après il m’a volé 900 balles. Je devais payer le loyer à ce moment-là, quand il m’a volé mes 900 euros, je ne savais pas comment faire. […] Je suis vraiment stressé parce que je ne sais pas quoi faire avec les lois et tout, mon appartement je payais 720 euros par mois… Il y a un livreur maghrébin qui vient me dire “Qu’est-ce qu’il se passe ?”, donc je lui explique, il me demandait “Mais tu n’as pas des pièces d’identité européennes ?”. J’en ai, mais c’est les italiennes. Après, il me dit “Bah tu peux faire le Kbis” […] Alors j’ai ouvert un compte bancaire ici, après ça j’ai commencé à faire les Uber Eats, et à présent je fais Deliveroo.
On comprend que le monde des coursiers à vélo est traversé de pratiques d’exploitation, mais aussi de solidarité. D’ailleurs, le temps que Chernor ouvre son statut d’autoentrepreneur, il sera aidé par un ami du pays, lui aussi réfugié en France, qui lui permettra de travailler sur son compte. Le film de Nader Samir Ayache, La Guerre des centimes, met bien en exergue ces relations entre livreurs marquées par la concurrence autant que par l’entraide. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que malgré sa précarité, le statut d’indépendant et le fort turnover, le milieu des coursiers a porté de nombreuses luttes collectives, et que plusieurs syndicats se sont montés en France.
Chernor travaille à son propre compte via des plateformes de livraison, presque quotidiennement, environ sept heures par jour. Il a choisi d’organiser ses horaires de travail autour des pics de la demande : en général de 11 h à 14 h, puis de 18 h à 22 h. Lorsqu’il fait un shift (créneau), Chernor se connecte sur l’application et attend les commandes. Son activité s’organise autour de différentes séquences : attendre les propositions de courses (avec lieu de livraison et rémunération), les accepter ou refuser, aller chercher la commande au restaurant (y patienter parfois longtemps), puis livrer la commande. Seule cette dernière séquence est rémunérée.
Tu te connectes en ligne. Quand tu es connecté, les courses arrivent. Donc chaque course, il y en a elles sont payées trois euros, quatre euros, il y en a deux euros. Parfois, il y a double commande aussi. Tu as une notification, avec la livraison, combien elle est payée, et c’est toi qui décides si tu acceptes ou pas. […] Quand tu acceptes, tu peux annuler si tu veux, par exemple on annule quand on va chercher les commandes au resto et qu’en fait il y a trop d’attente. C’est toi qui décides. C’est autoentrepreneur, c’est indépendant. Mais si tu récupères les commandes, tu dois aller livrer. C’est les deux choses que tu dois faire, tu dois respecter les gens quand tu vas livrer les commandes, quand tu vas chercher les commandes, tu dois respecter les gens qui travaillent dans un resto.
L’essentiel du temps de travail de Chernor se déroule dans l’espace public, les rues qu’il arpente à toute vitesse, les places sur lesquelles il passe ses temps d’attente. Avec l’expérience, il a progressivement adapté ses espaces de travail, son matériel et sa conduite. Il a notamment choisi de réduire son périmètre à Villeurbanne et aux 3e, 6e et 7e arrondissements qui sont à la fois très plats et proches de chez lui, et a opté pour un vélo électrique. Comme la livraison est la seule séquence rémunérée, elle porte un enjeu fort d’optimisation pour les coursiers. Plusieurs études ont montré les pratiques accidentogènes que cette mise sous pression temporelle entraîne (encouragée par les plateformes, qui proposent par exemple des primes à la rapidité). Chernor, lui, a fait le choix de la prudence : il dit respecter les feux rouges et les limitations de vitesse. Cet arbitrage vise à éviter « tout problème pendant les livraisons ».
Et comment as-tu choisi ton vélo actuel ?
Au début, j’ai commencé avec le scooter. Mais, j’avais grossi, parce que je n’avais pas d’exercice. Donc après je l’ai vendu, j’ai commencé avec le vélo, mais maintenant je roule avec mon vélo électrique. […] Mais Croix-Rousse, ou Rillieux-la-Pape, c’est les fous qui vont là-bas. Parce que moi, si c’est les montagnes je ne veux jamais y aller. Mais, quand je roulais avec le scooter, j’allais à Rillieux, dans les Monts d’Or, à Tassin. Je suis déjà allé jusqu’à Francheville.
Les temps d’attente improductifs sont aussi investis de différentes tactiques pour obtenir une course plus rapidement (rester proches de restaurants très demandés/être toujours en mouvement/rechercher une bonne couverture réseaux, etc.). Les chercheuses Émilie Aunis et Hélène Stevens (2021) ont bien montré la diversité de ces tactiques, qui se construisent entre expérience et croyance, car le fonctionnement des algorithmes qui attribuent les commandes reste relativement opaque pour les coursiers. Chernor nous parle par exemple de « zones blanches », qu’il interprète comme la conséquence de plaintes du voisinage. Il gère ses temps d’attente en croisant des logiques d’optimisation (accroître ses chances de recevoir une commande en ayant une bonne couverture réseau, réduire ses temps de trajet par un emplacement central), de recherche de confort (notamment se tenir au chaud), et de réappropriation de son temps (rentrer chez lui, faire d’autres activités). Ces stratégies expliquent en partie les rassemblements de coursiers que l’on observe dans l’espace public, autour d’un banc, à proximité d’un restaurant.
Et si tu as des temps d’attente, tu fais quoi, tu vas où ?
Il y a Part-Dieu [dans le centre commercial] parce que là-bas c’est chaud. Dehors c’est froid. Ou Charpennes, donc moi, c’est ces deux côtés-là où je vais. Parce que je travaille sur Lyon 6, Villeurbanne, Lyon 3, Lyon 7. Si c’est l’été, je suis dehors, parce que dehors c’est beau. Et si je suis fatigué, je peux aller chez moi. […] À 14 h, je suis chez moi parce que j’aime bien rester quand même pour faire les choses, regarder la télé, ou faire des recherches sur les sites.
On voit d’ailleurs des endroits où attendent beaucoup de livreurs, comme ce banc sur la place des Charpennes.
À Charpennes, devant la banque LCL ou devant le McDo là-bas oui. Devant la banque LCL il y a du réseau. Parce qu’il y a des zones blanches aussi avec Uber Eats, si tu es dans une zone blanche jusqu’à demain, tu ne vas pas sonner. Des zones blanches parce que peut-être qu’il y a des voisins qui se sont plaints, “Il y a les livreurs qui sont là qui viennent faire du bruit”, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de bruit avec les livreurs, ils ne parlent pas doucement, ils crient. On a des problèmes avec ça.
Les plateformes de livraisons ne fournissent pas d’autres espaces aux livreurs. De plus, elles n’ont que peu, voire pas de bureaux, dans les villes où s’exercent leurs activités, les coursiers n’ayant que des contacts dématérialisés avec les plateformes. Chernor a la chance d’avoir son propre appartement dans lequel il mange et prend ses temps de repos, de choisir ses horaires de travail pour réduire ses temps d’attente (nous y reviendrons), et de connaître certains restaurateurs qui lui autorisent l’accès à leurs commodités. Néanmoins, sa situation n’est pas représentative de celle de tous les coursiers : certains travaillent plus de 10 h par jour, et vivent dans des squats ou autres logements où l’accès à l’hygiène et au repos peut être très contraint.
Plusieurs initiatives visent alors à adapter la ville à ces usages professionnels. Des « maisons des coursiers » ont notamment vu le jour à Paris et à Bordeaux. Soutenues par les pouvoirs publics, elles offrent un espace de repos protégé des intempéries, l’accès à l’eau et aux commodités, ainsi qu’un soutien juridique et administratif aux coursiers précaires. Sur un autre registre, Guillaume Lebon (2019) invitait à repenser les bancs publics pour satisfaire aux besoins de ses nouveaux usagers : prise électrique pour recharger son smartphone et son vélo, points d’eau, attaches pour les vélos, etc.
Le métier de coursier repose sur de nombreuses compétences et stratégies invisibles de l’extérieur, construites individuellement par l’expérience, et collectivement dans les échanges. Les temps d’attente sur les points de rassemblement sont propices aux sociabilités professionnelles : les coursiers partagent entre eux leurs expériences avec les clients, les restaurants, leur compréhension du fonctionnement des plateformes, et des démarches administratives (déclaration du chiffre d’affaires, demande du droit d’asile, etc.).
Bien que ces sociabilités puissent être des espaces propices à la construction de ces collectifs, elles « sont précaires et fluctuantes du fait du fort taux de rotation des travailleurs [et] fragilisées par la concurrence inhérente à leur statut de micro-entrepreneur qui crée des tensions entre eux et limite les formes d’entraide » (Aunis et Stevens, 2021). L’indépendance et la précarité des travailleurs sont des obstacles de taille à la construction d’un collectif de travail, qui élabore et partage des règles de métier, et se soutient dans l’activité professionnelle.
Qu’il les croise dans les rues ou attende avec eux sur les places, Chernor décrit des liens faibles avec les autres coursiers, des discussions tournées vers le travail, et de nombreuses pratiques d’entraide. Attaché à la séparation entre sphère privée et sphère professionnelle, il dit aussi avoir pris de la distance avec le milieu de la livraison.
On se croise dans les restaurants ou sur le vélo. Par exemple, si toi tu es livreur, moi je suis livreur, on ne se connaît pas, on se croise, on parle juste comme ça, “Hey ça va, ça sonne pas les restaurants, ça va prendre le temps ? Tu es là depuis quand ?”, “Je suis là depuis 5/10 minutes, donc il faut que tu annules hein, parce que toi tu viens d’arriver”. […] J’ai beaucoup de collègues livreurs, ils connaissent mon nom, mais je ne connais pas le leur. Donc je ne sais pas si c’est un ami, parce que, plusieurs fois notre communication c’est savoir si ça sonne, comment ça passe […] C’est pas “Oh, tu vas bien ?” Non non non. J’ai des amis pour ça.
Vous parlez du travail ?
C’est ça, mais ça, ce n’est pas des amis quoi. On parle sauf de ça, mais on n’a pas de “Ah demain tu fais quoi ?” Non non, on n’en a pas. Il y en a ils ont ça, mais moi j’aime, comment dirais-je… Si je prends les deux trois jours-là que je ne travaille pas, je ne veux pas être avec des gens pour parler du travail, je veux parler d’autres choses.
Chernor souligne aussi à plusieurs reprises la relative homogénéité sociale qui domine le monde la livraison. Comme nous l’avons déjà rapporté, la recherche a montré qu’une très grande proportion des coursiers est étrangère voire « sans-papiers », majoritairement d’Afrique du Nord et d’Afrique Sub-saharienne. Le monde des coursiers est néanmoins traversé de multiples fragmentations : durant les temps d’attente, on peut observer des segmentations spatiales qui s’appuient sur des proximités culturelles (formation de groupes autour d’une même nationalité, et/ou d’une même langue), des différences de statuts (obtention ou non de la nationalité, etc.), et de rapport au travail (être étudiant, actif, avoir d’autres ressources, etc.) (Aunis et Stevens, 2021.) Pour Chernor, qui cherche activement à reprendre ses études d’informaticien, ce relatif « entre-soi » ne permet pas de « s’intégrer », ce qu’il entend comme le fait de côtoyer des Français, et d’apprendre leur langue et leur culture.
Quand je suis avec des livreurs, on parle anglais. Il y a les livreurs qui sont là [en France] depuis 6 ou 7 ans, s’ils ont des rendez-vous c’est moi qui vais appeler pour faire les traductions ou pour arranger les choses comme ça. […] Tu ne fais pas la livraison pour t’intégrer, pour moi c’est un peu impossible. Parce que plusieurs fois, les personnes qui font les livreurs si c’est des Guinéens ils parlent soussou, ils ne parlent pas français, pour moi, s’intégrer dans un pays, c’est apprendre sa culture, comment il fait sa vie… Si je suis avec des Nigériens, on parle anglais, si je suis avec les Guinéens, on parle soussou, maninka, ou si je suis avec les Libériens, on parle anglais. Pour moi, ça c’est pas l’intégration.
Chernor a eu l’opportunité de fréquenter d’autres milieux sociaux et culturels grâce à la rencontre de la compagnie Waninga, lorsqu’il était logé à l’amphi Z. Cette compagnie lyonnaise de théâtre est composée de mineurs non accompagnés (MNA) et de jeunes adultes en demande de titre de séjour et d’asile, ainsi que d’une psychologue, un comédien, une comédienne et une metteuse en scène chercheuse. C’est par ce biais qu’il a pu apprendre le français, et rencontrer des personnes au-delà du milieu des coursiers.
Si on est en France, on doit apprendre, c’est pour ça que j’ai commencé à faire du théâtre pour rencontrer des amis et faire d’autres choses comme ça entre les livraisons. Parce que depuis que j’ai commencé les livraisons, je sais que ça, ça ne sert à rien sauf pour avoir de l’argent vite, pour faire d’autres choses, mais ce n’est pas de l’intégration ou des choses comme ça. [Quand j’étais au squat], il y a une association qui arrive là-bas et ils nous demandent si des personnes sont intéressées pour faire du théâtre. Depuis que j’ai essayé, j’aime bien et je continue, c’est comme ça que j’ai commencé à rencontrer des Français, Françaises, pour m’intégrer bien !
Les coursiers entretiennent le plus souvent des liens très réduits avec les restaurateurs et les clients. Travailleurs des seuils, leurs contacts sont furtifs, d’autant plus depuis l’émergence de la fonctionnalité « déposer la commande sur le palier », qui a permis de supprimer les contacts entre clients et coursiers durant la pandémie. La barrière de la langue et les cadences soutenues jouent négativement sur la construction de relations entre ces deux bouts de la chaîne de livraison. Les coursiers sont également pris dans un processus de double évaluation, par les livreurs et les restaurateurs. Les retours négatifs recueillis directement par les plateformes peuvent entraîner des sanctions (suspension de compte, moins de sollicitations pour les commandes, etc.).
Le spectre de la mauvaise évaluation contraint les coursiers à se montrer irréprochables. Chernor rapporte quelques expériences difficiles avec les clients (manque de respect, sur-sollicitation, et mêmes avances sexuelles), et explique avoir « adapté sa mentalité » pour faire face à ces cas de figure.
Parfois, les clients ne te respectent pas, aussi les restos. […] J’ai perdu un vélo un jour : la dame me dit de monter la commande et que y’a pas d’ascenseur, je vais livrer la commande, je descends et… [bruit de bouche agacé] le vélo il y a plus. Il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de stress donc c’est pour ça que j’ai changé ma mentalité quoi. […] Parfois, il y a les clients qui sont méchants, les clients qui sont racistes. Plusieurs fois, j’ai rencontré les clients racistes, mais dans ma tête ça ne change rien parce que, tu ne vas pas me dire quelque chose qui va casser toutes mes journées. Les mots, c’est que les mots quoi. C’est toi qui vas déterminer ce que tu vas faire avec. […] Parce que parfois, si, surtout si ça sonne [qu’il y a beaucoup de commandes], y’a des livreurs qui sont tellement pressés pour aller livrer. Quand ils arrivent, que le client dit « C’est au 5e étage », et des fois il appelle trois fois, ça ne répond pas, donc après il est énervé. Même si le client descend et qu’il parle mal, ou les clients qui disent « Moi j’ai payé pour monter », ça ça casse les livreurs quoi. « J’ai pris ta commande depuis combien de kilomètres, j’arrive jusqu’a chez toi, je dois monter encore ? » Donc le client appelle Uber, et tu perds ton compte. […] Un jour, je vais livrer une commande, mais c’est une dame toute nue qui m’ouvre. Elle me dit « Vous posez la commande dans mon salon », je dis ok. Ouais, après quand je suis dans le salon, elle ferme la porte. Je lui dis « Ok je vais fermer mon vélo parce que mon vélo il n’est pas tranquille encore » [frappe dans les mains pour signifier qu’il part], et quand je suis sorti, j’appelle Uber direct et je dis « Voilà ce qu’il s’est passé, donc si la cliente vous appelle et dit autre chose ce n’est pas vrai.
Chernor est aussi amené à travailler avec des restaurants d’un genre particulier : des dark kitchens, qui proposent un service uniquement accessible via les plateformes de livraison, et n’ont pas d’espace de réception. Plus que des locaux commerciaux déjà bien identifiés par les pouvoirs publics, Chernor décrit des appartements que des particuliers ont transformés en restaurants, un phénomène accéléré par la période Covid.
Y’a beaucoup de restos comme ça, y’a des restos c’est dans un appartement, mais ils connectent avec Deliveroo et avec Uber, surtout à Villeurbanne. Y’en a un à côté-là, et ben c’est un resto africain, mais c’est dans un appartement quoi. Tu en as plein, même si c’est dans un studio tu peux ouvrir ton compte sur Uber ou Deliveroo. […] Quand tu vas là-bas, tu ne vois pas le restaurant, peut-être qu’ils habitent au troisième étage, tu dois appeler et c’est eux qui viennent te chercher. Parfois Uber, Deliveroo, ils ne savent même pas, mais nous les livreurs on sait.
Loin des clichés, Chernor entretient aussi des liens originaux avec les clients et les restaurateurs. Sa maîtrise du français et son caractère sociable lui permettent de nouer de bonnes relations, et par là même de gagner beaucoup de pourboires. Grâce à ces revenus supplémentaires, il peut choisir ses horaires de travail, et s’accorder quelques vacances. Alors qu’un coursier qui travaille dix heures par jour gagnerait entre 50 et 80 euros (selon les témoignages recueillis dans différents reportages), Chernor parvient à gagner parfois bien plus en moins d’heures. Il critique à demi-mots les coursiers qui travaillent sans cesse, interprétant cet investissement comme un choix, et non une nécessité, sans penser les ressources qu’il a et qui ne sont pas forcément partagées par tous (maîtrise du français, sociabilité, travail à son compte, rapport transitionnel au travail, etc.).
Je commence les livraisons à 11 h, mais à 14 h, je suis chez moi parce que j’aime bien rester chez moi pour faire les choses, regarder la télé, ou faire des recherches sur les sites. Je recommence à 18 ou 19 h, jusqu’à 22 h encore. Même s’il y a beaucoup de commandes, à 22 h je suis chez moi. Mais il y a des gens qui commencent à 8 heures du matin, jusqu’à 4 heures du matin.
Comment ça se fait ?
Ils travaillent tout le temps : “Ça c’est mon travail, donc si ça continue de sonner, je suis dehors ”. Je ne sais pas si tu comprends. Là on dit workaholic, tellement addict au travail. Déjà, tu vois parce qu’il y a l’argent dedans, ouais, mais moi non, je ne veux pas.
Tu trouves l’équilibre, parce que tu gagnes combien sur une journée avec tes horaires ?
Moi, le truc qui m’aide, c’est que chaque jour j’ai beaucoup de pourboires. Parce que les clients me connaissent, ils sont gentils avec moi, parfois je peux faire 100 euros avec moins de travail […] Parfois, quand je vais livrer c’est “Comment tu vas, ça va bien ?” On parle, parle, parle, donc, quand je pars ils me donnent 30 euros, 20 euros comme ça.
Les pourboires qu’il obtient dépendent directement des relations qu’il noue avec les clients. Chernor semble sensible à leur état émotionnel, et est très volontaire pour engager la discussion. Plusieurs fois, il a suspendu son temps de travail en se déconnectant de l’application, pour leur offrir une oreille attentive. Il souligne que sa situation de réfugié est un bon miroir dégrossissant pour les problèmes des autres.
Beaucoup de gens que j’ai livrés maintenant je suis ami avec eux, parce que moi quand je livre je demande “Tu vas bien ? Ça va ? Qu’est-ce qu’il se passe ? […] et la personne que je vais livrer, depuis le matin il a son problème, mais il n’y a pas personne qui parle avec lui. Ouais, parfois je fais comme psychologue (rires). J’ai une bonne relation avec les restos et les clients. C’est pour ça quand je vais chercher une commande, si je suis déjà allé dans ce restaurant-là, plusieurs fois les gens qui travaillent là-bas ils me connaissent.
Tu as l’impression qu’il y a des gens isolés parmi tes clients ?
Ouais, plein. Un jour, je vais livrer une commande à une fille, elle a 22 ou 23 ans, elle a des problèmes avec son copain tu vois, donc je vais livrer chez elle, tout son visage il est… [il mime une mine décomposée], “Je dis qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vas bien ?” Elle me dit, “Non, je ne suis pas bien”, j’ai dit, “Tu veux parler ?”. Donc j’ai déconnecté [de la plateforme de livraison]. J’ai dit “On peut parler si tu veux”. On a discuté de beaucoup de choses. […] C’est pour ça je travaille avec deux numéros, je ne travaille pas avec mon numéro personnel sinon les clients m’appellent encore pour parler. […] Moi je ne mets pas mon problème devant mon visage. Parce que si tu mets ton problème devant toi, chaque jour où tu vas te réveiller tu vas le voir. Donc plusieurs fois j’encourage les clients et je leur dis que je suis un immigré ici, dans un autre pays, donc même si tu as des problèmes, ça va peut-être changer quoi. Si tu veux savoir les problèmes dans le monde, parle avec un migrant. […] Donc parfois quand je parle avec les gens ils voient que “Lui c’est un migrant, mais il a le temps pour les amusements comme ça là”. Donc ça va changer beaucoup [leur manière de voir les choses]. Même parfois c’est pour ça que je fais les livraisons, parce que je parle avec les gens. Il y a des gens qui se moquent de ça, ce n’est pas pour tout le monde l’émotion.
Dans la pièce de théâtre À bout de pédale, écrite par la compagnie dont fait partie Chernor et interprétée par lui, sur la base de son expérience de coursier. Dans cette performance qui met en scène le quotidien des livreurs (répétition des gestes, nécessité de tenir la cadence, etc.), il rapporte notamment des rencontres avec des personnes très isolées. À l’écouter, on se dit même qu’il peut être le dernier rempart avant la solitude : certains clients paraissent plus attendre le coursier que la commande qu’il délivre.
À travers ces paroles, on comprend que ce parti-pris de discuter beaucoup avec les clients est très important pour Chernor, qui ne s’épanouit pas dans le travail de coursier. D’une part, c’est une stratégie vectrice de revenus supplémentaires qui lui permettent de se réapproprier une partie de son temps pour faire ce qui lui plaît, et de passer les journées de manière plus agréable. D’autre part, nouer ces relations permet de mettre un peu de lui dans le travail, de le faire à sa manière, ce qui renvoie à un processus de subjectivation au travail.
Moi je fais les livraisons pour payer mon loyer, mais dans ma tête je sais que ça, ce n’est pas mon boulot. Je n’aime pas faire les livraisons. Donc je trouve un peu d’amusement quand je parle avec les gens. Ça m’a aidé et ça a aidé les clients aussi. [...] Moi parfois je prends deux semaines de vacances. Pour profiter de ma vie. […] Parce que, en anglais on dit “All works and no play make Jack a dull boy”. Ça veut dire, si tu travailles tout le temps, tout le temps, tu n’as pas de temps pour jouer, tu vas devenir fou quoi.
Comme la plupart des coursiers, il entretient un rapport instrumental au travail : la livraison est un moyen de subvenir à ses besoins. Discuter avec les clients ou faire du sport sont des stratégies compensatoires qui lui permettent de mieux supporter la situation.
Quand je fais une livraison, il y a une motive derrière. J’ai fait avec vélo pour faire de l’exercice, parce que la salle de sport, c’est trop cher.
Malgré les conditions de travail difficiles qu’il nous a décrites (exposition aux intempéries, dureté physique, gestion des clients difficiles, évaluation perpétuelle, précarité, etc.), Chernor s’est montré peu critique envers son travail lors de notre entretien. Bien sûr, ce qu’il nous donne à voir ne permet pas d’apprécier tout ce qu’il ressent, et comme il nous l’a déjà confié : il ne met pas ses problèmes « devant son visage ». Il nous paraît cependant intéressant d’analyser cette apparente acceptation à l’aune des usages de l’activité : il envisage la livraison comme quelque chose de temporaire, et construit largement sa vie en dehors. Ce point est capital, car comme l’avait déjà identifié le doctorant en sociologie Arthur Jan à propos des jeunes étudiants coursiers, « La possibilité de tirer des profits symboliques [...] reste liée à l’absence de projection à long terme dans cette activité. Elle ne constitue en rien un horizon professionnel dans lequel ils se projettent, et n’est pas au cœur de leur identité sociale, mais correspond à une nécessité de financement ponctuelle dans une trajectoire dont leur position sociale ou leur cursus scolaire leur laisse à croire qu’elle sera ascendante » (2018).
Grâce à ses ressources sociales et sa motivation, Chernor espère bien pouvoir obtenir le droit de s’inscrire à l’université, et de poursuivre ses études en informatique. Il fait les livraisons « en attendant ». Mais cela fait déjà cinq ans, ce qui est sûrement plus long que ce qu’il espérait.
Je ne vais pas dire c’est un bon travail, mais c’est une chose que tu fais pour une certaine période. [...] Moi je voudrais être étudiant, la livraison c’est comme une page de mon livre. Ce n’est pas une chose que tu fais toute ta vie. Donc je voudrais tourner la page.
Dans de nombreuses trajectoires sociales, si le métier est envisagé de manière temporaire, il peut risquer de se transformer en activité pérenne, car il n’offre ni de perspective d’évolution, ni d’intégration. Aujourd’hui, à la suite de la crise sanitaire qui a marqué les années 2020-21, des études semblent même indiquer un retour à la livraison pour des catégories socioprofessionnelles qui s’en étaient éloignées. Les étudiants notamment, dont la précarité s’est renforcée durant la pandémie, réinvestissent cette activité : selon l’étude dirigée par Laëtitia Dablanc en région parisienne, ils étaient 9 % des livreurs en 2020, contre 18 % en 2021. 61 % d’entre eux déclaraient s’être tournés vers cette activité du fait de la crise. Une nouvelle évolution de la sociologie des coursiers que Chernor constate aussi dans la rue :
Beaucoup de clients sont devenus livreurs maintenant. Parce qu’il y a les gens qui commencent durant le Covid-19, juste pour sortir de chez eux. Donc quand ils sortent ils voient qu’ils gagnent de l’argent. [...] C’est pour ça, avant le Covid, c’est beaucoup les blacks et les Maghrébins qui font les livraisons. Mais après il y a eu les Français. »
© Ionuţ Dulămiţă. Les trois illustrations utilisées dans cet article ont été réalisées dans le cadre du projet Gig work, soutenu par l’université de Manchester, dans lequel collaborent des chercheurs en sciences humaines (Cosmin Popan et Nathanael Sheehan), des coursiers exerçant pour les plateformes de mise en relation, et des artistes. Mené dans les villes de Manchester (Angleterre), Lyon (France) et Cluj (Roumanie), ce projet de recherche collaborative retranscrit le quotidien des livreurs en mêlant extrait sonore d’entretien, illustration d’artistes, et cartographie dynamique.

Article
Cinq archétypes de travailleurs d’aujourd’hui, de leur environnement matériel jusqu’au coût environnemental de leur modèle.

Interview de Anca Boboc
Sociologue du travail et des organisations, spécialiste des usages du numériques en entreprise

Article
Depuis plusieurs années, de nouvelles manières de travailler et d’habiter émergent. On observe, entre autres, un intérêt pour les lieux partagés, dont le « coliving » fait partie.

Article
Si nous n’y prêtons pas toujours attention, la logistique se révèle indispensable pour la pérennité de nos modes de vie contemporains.

Article
Dans cet article, nous proposons de nous intéresser au métier de coursier opérant pour les plateformes de livraisons rapides, sous l’angle des lieux et des liens du travail.

Article
Réinventer la proximité : Comment les technologies redéfinissent le rapport entre les individus et les lieux de travail.

Étude
Enquête auprès des salariés et entreprises de la Métropole de Lyon entre avril et juin 2020
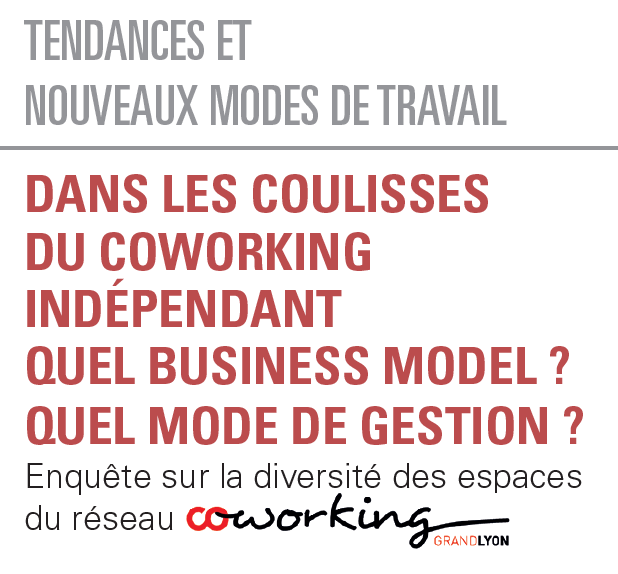
Étude
Quel business model ? Quel mode de gestion ?

Étude
60 tendances pour questionner les exigences de l'organisation et le besoin d'harmonie au travail.
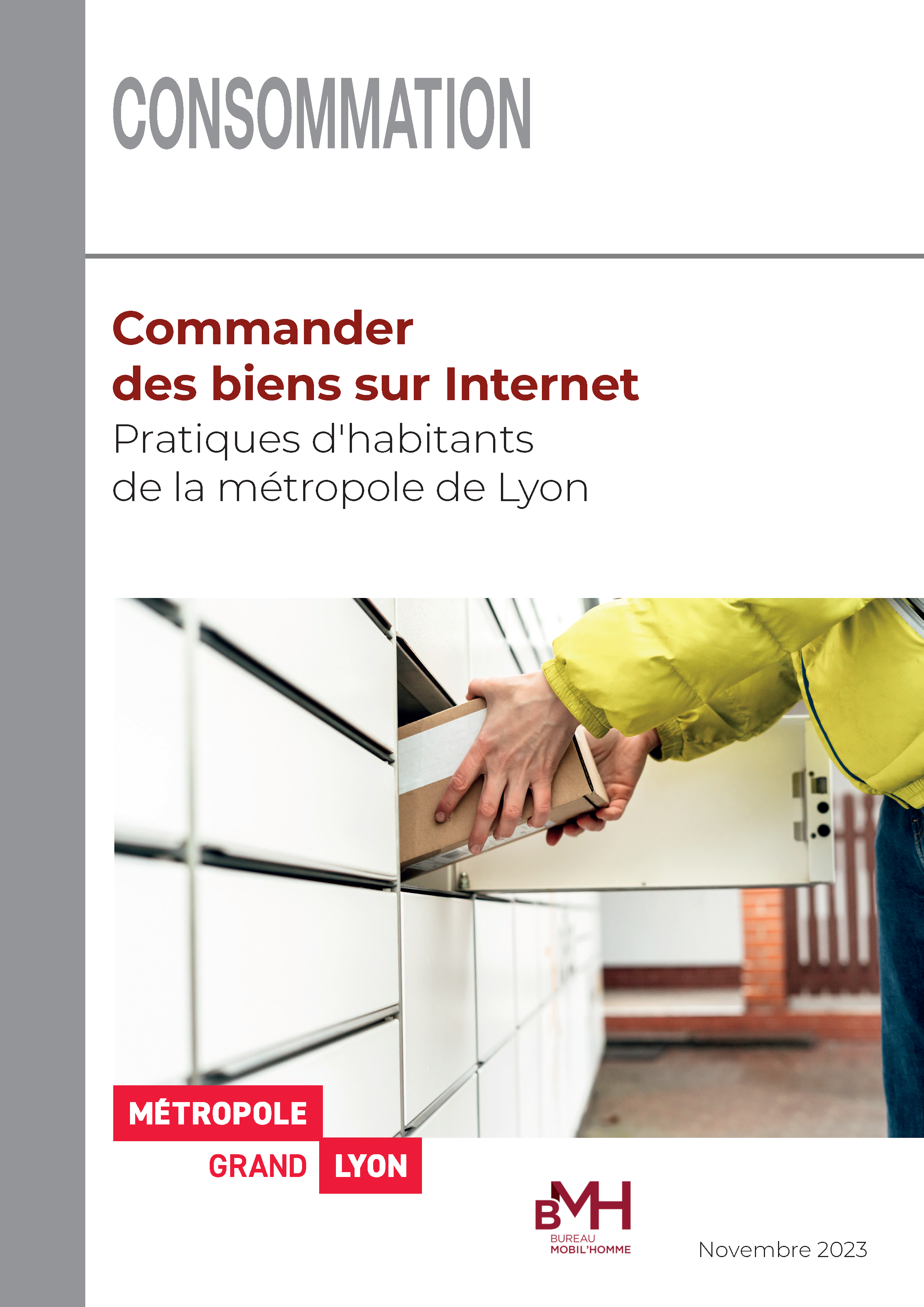
Étude
Pourquoi acheter en ligne ? Quelles préférences entre se faire livrer à domicile, en point-relai ou en drive ? Une douzaine d’habitants témoignent.

Étude
Comment les commerces de proximité s’adaptent à la vente en ligne ? Cette étude donne la parole à une dizaine de commerçants indépendants du territoire.

Étude
Quels sont les profils-types de consommateur ? Qu’achètent-ils en priorité et comment se font-ils livrer ? Cette étude fait le point.

Étude
Qu’est-ce que la logistique urbaine et comment s’organise-t-elle ? Cette revue de la littérature fait le point sur le dernier maillon d’une longue chaîne d’approvisionnement.

Interview de Laetitia Dablanc
urbaniste et enseigne à l’Université Gustave Eiffel
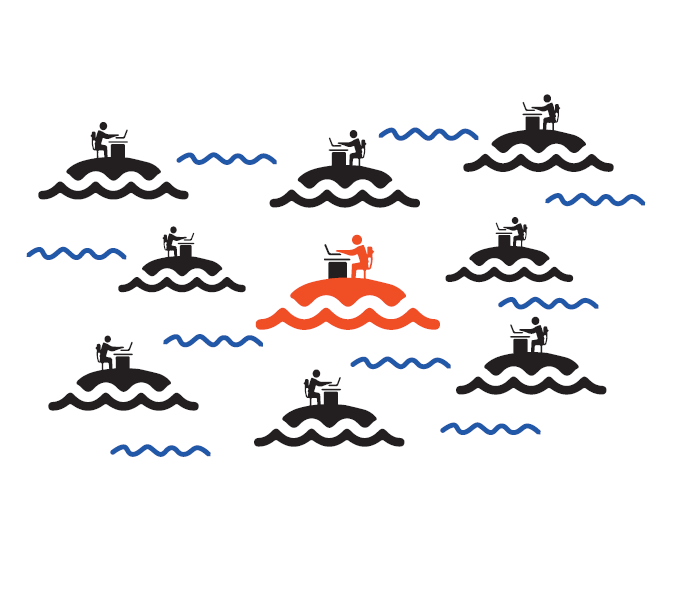
Quelles tendances et questionnements dans les avenirs du travail ?
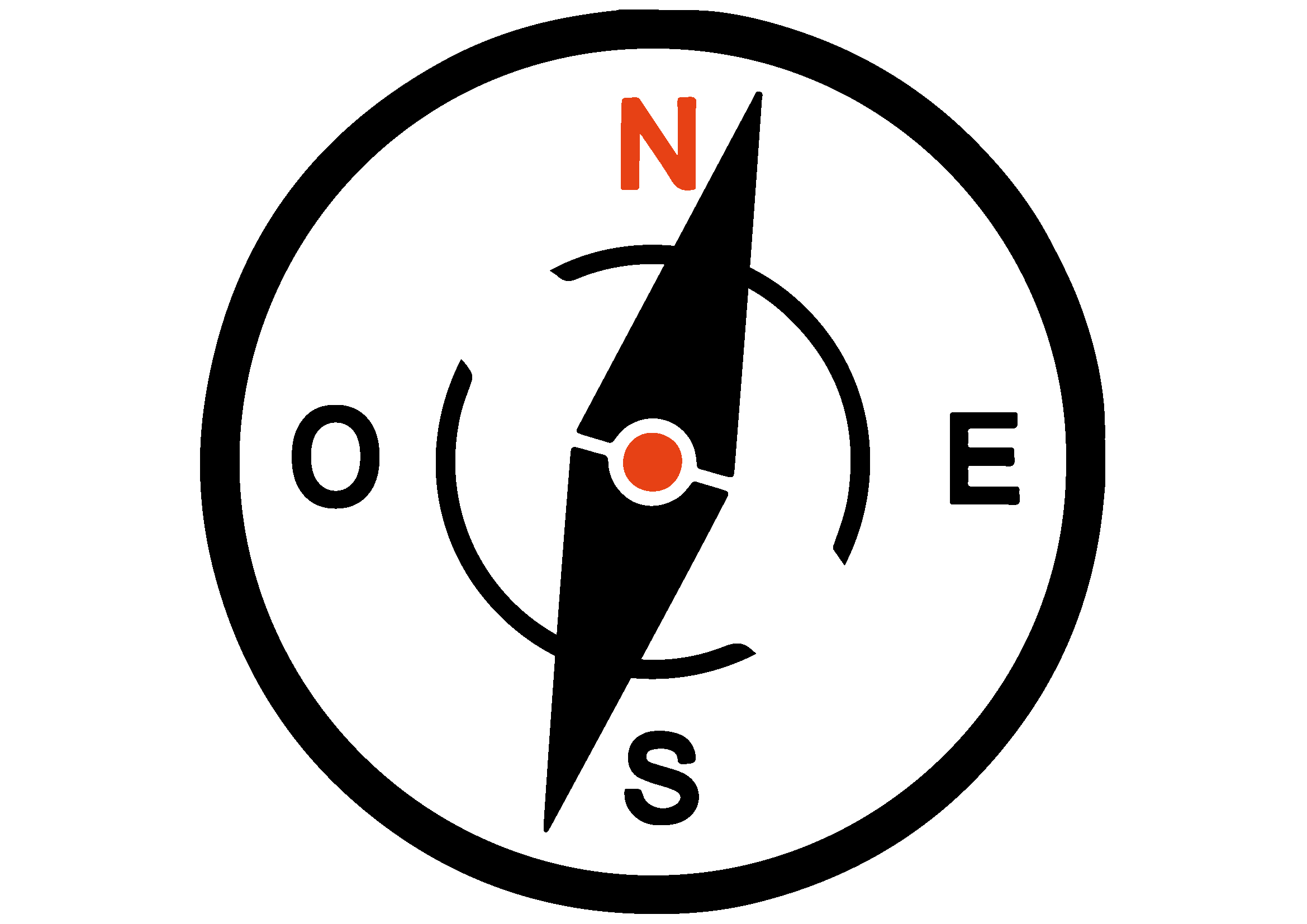
Étude
Entre dynamiques de fragmentation et prise en compte de nouvelles aspirations sociétales, le monde du travail à la recherche de nouveaux repères.
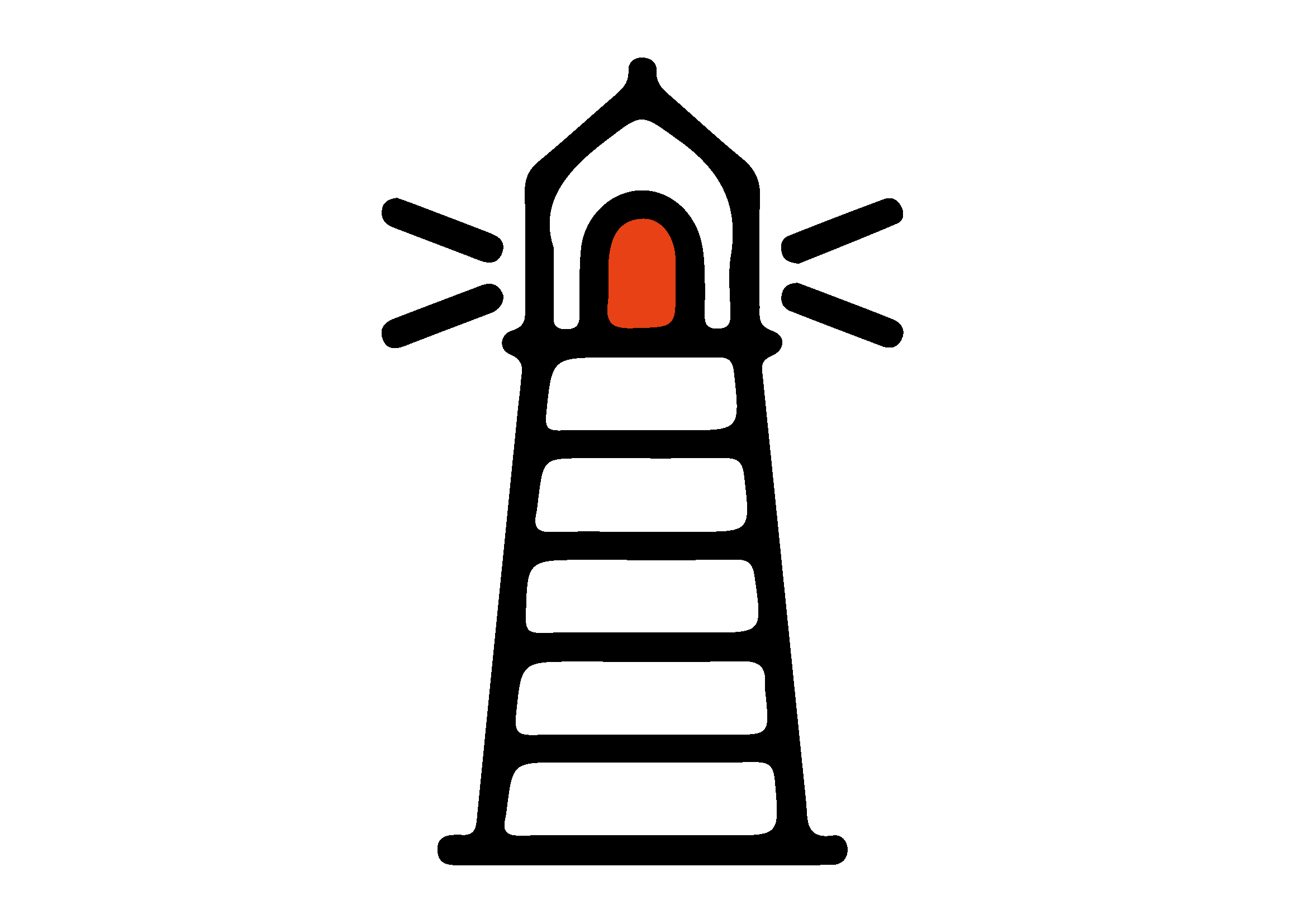
Étude
Plus de sens pour une meilleure performance, plus d'autonomie pour une meilleure organisation.

Étude
Des usages numériques toujours plus présents et indispensables au travail, mais aussi aliénants et nocifs pour la santé à long terme... Un regard de plus en plus exigeant posé sur la digitalisation du travail.