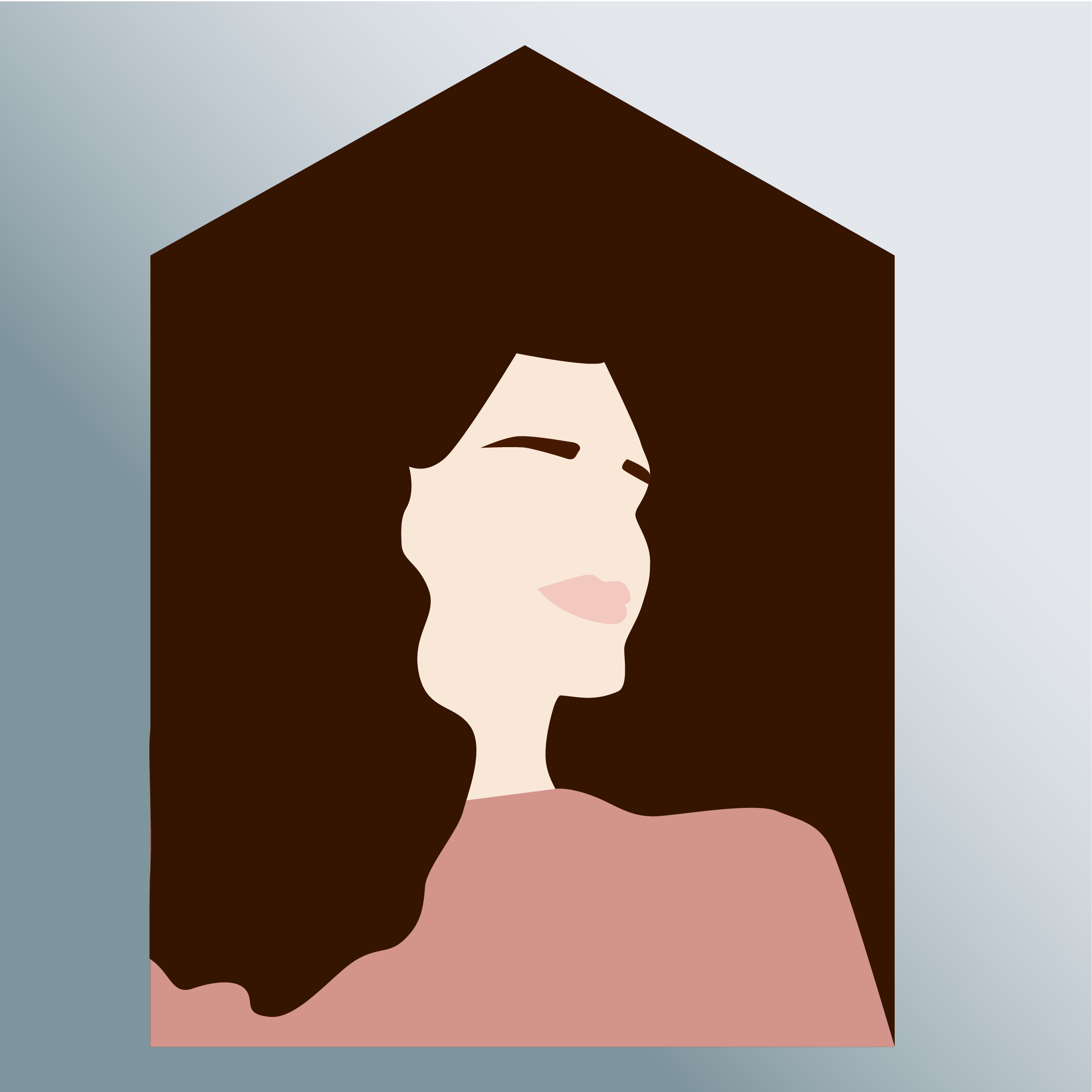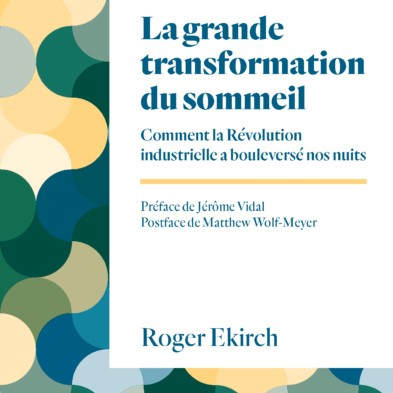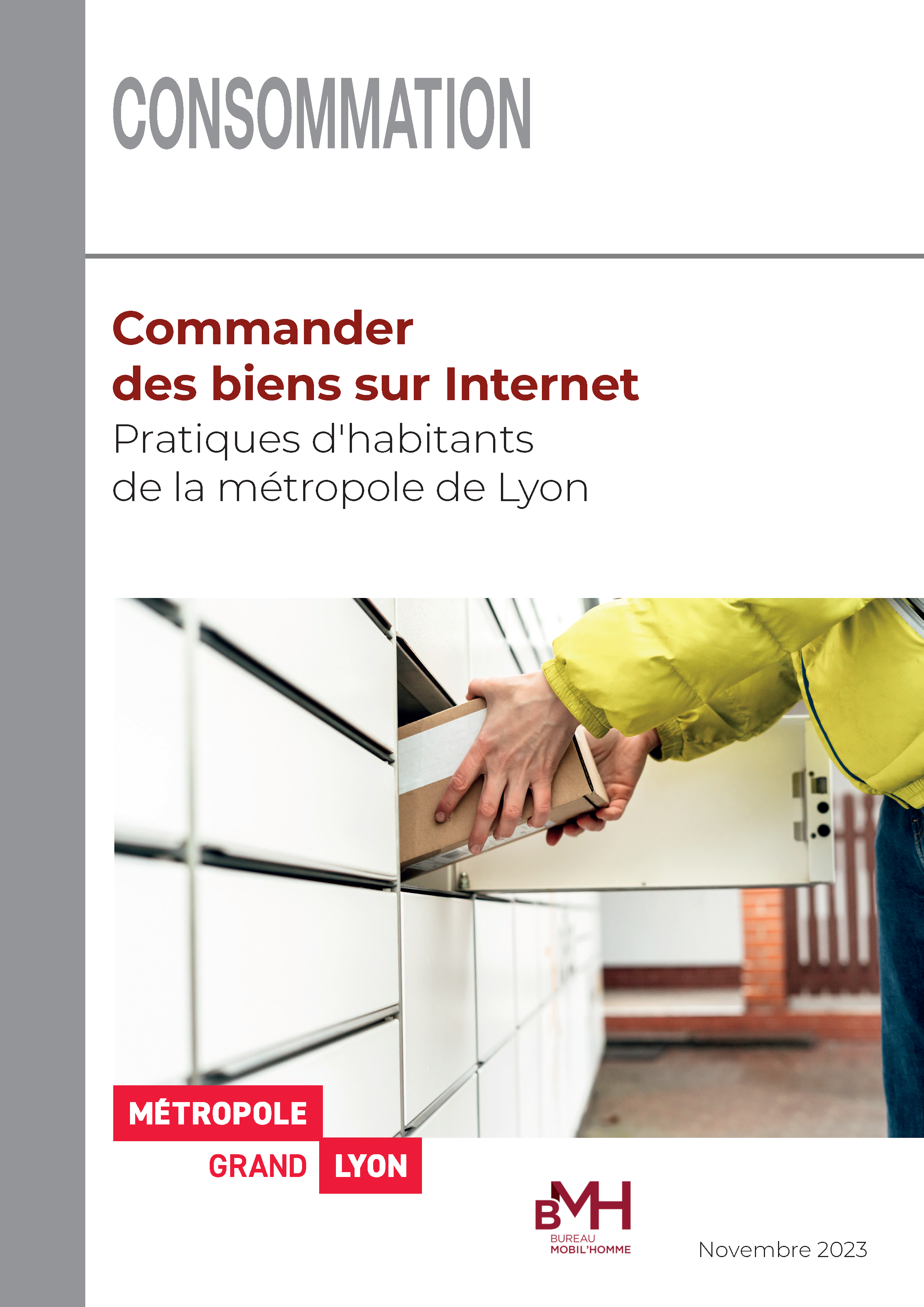C’est un gros travail, quand même, qui a été mené par le mouvement d’habitat participatif, avec une implication sur le juridique qui a été très forte. Le ministère ne maîtrisait pas forcément très bien, au départ, les problématiques, et était en demande, je dirais, de l’ingénierie des groupes et des collectifs.
J’avais participé aux consultations préalables à la loi Alur, c’est du temps de Cécile Duflot bien entendu, mais il y avait, il me semble, une vraie écoute et l’envie d’essayer de développer un certain nombre de choses. Il y a encore des points de blocage, en matière de financement en particulier, mais cela a le mérite, de mon point de vue, de faire exister le sujet sur la scène nationale.
Maintenant, comme vous le dites, l’habitat participatif évoque des choses aux gens, quels qu’ils soient. Quand j’ai commencé ma thèse, personne ne savait de quoi je parlais. Là, quand je dis que j’ai travaillé sur ce sujet, on me répond « Ah oui, je connais quelqu’un qui… ». Il y a eu une forme de démocratisation qui s’est opérée dans les esprits d’une manière générale. Cela a permis de donner de la légitimité à quelque chose qui était encore parfois vu de manière un peu caricaturale. Cela a eu le mérite de motiver des partenaires un peu frileux, notamment les bailleurs sociaux qui se sont sentis plus sécurisés, mieux outillés.
Les premiers retours d’expérience, ont contribué à ce rapprochement. Quand vous avez un organisme qui dit « Dans telle ville, il y a un organisme HLM qui s’est engagé dans tel projet, le collectif a été formidable et tout s’est bien passé », pour les collègues dans la salle, vous allez peut-être lever un frein primaire chez certains, qui vont se dire que « C’est possible, d’autres ont essuyé les plâtres avant nous, on peut y aller, il y a une loi ». C’est l’aboutissement d’un travail très intense du côté du mouvement et une écoute du côté du ministère à ce moment-là, avec l’envie de débloquer des choses.