Le travail social et médico-social à l'heure du numérique

Étude
Cette synthèse explore l’impact du numérique sur le travail social et médico-social auprès des services publics locaux.
Interview de Johann Rony et Olivier Carbonnel

<< Je suis persuadé que le numérique est aujourd'hui un territoire supplémentaire à aller investir pour faire de la prévention spécialisée, et qui relève complétement du champ de compétence [des éducateurs]. >>.
Johann Rony et Olivier Carbonnel travaillent tous les deux à l’Institut Régional Jean Bergeret (IRJB), une structure spécialisée dans la prévention des conduites à risque et la promotion de la santé. Le premier est assistant de service social. Le second est psychologue et informaticien. Il s’est intéressé à la question de la souffrance au travail, et à l’impact des systèmes d'information sur l’organisation individuelle au travail. Il intervient en temps partagé auprès de différents instituts de formation, pour les accompagner dans la transformation des pratiques formatives en lien avec le numérique. Il est aussi président d’une agence pédagogique coopérative, PIXAGO qui regroupe quatre coopérateurs (l’ESSSE, l’ARHM, Don BOSCO et l’ARAFDES) et qui a pour vocation d'accompagner la transformation de leurs processus formatifs.
L’Institut (ex Centre Jean Bergeret) intervient depuis 1982 sur la question de la prévention des conduites à risque de manière générale, et plus spécifiquement jusqu’à présent autour des conduites suicidaires, des conduites addictives, des conduites sexuelles... Depuis 2015 ont été rajoutées la radicalisation conduisant à la violence, et la prévention de ses risques.
L’Institut a créé le Dispositif d’Appui pour la Prévention à La Radicalisation (DAPR) suite à un appel d'offre, en lien avec la préfecture du Rhône. Ce dispositif, financé par le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, et en partie moindre par l’ARS et la PJJ, est dédié à l'accompagnement et au soutien des familles dont les enfants sont signalés au titre de la prévention de la radicalisation. Il vise à accompagner ces jeunes en termes de prévention, pour arriver à comprendre comment ils sont rentrés dans ce processus, et les amener à déconstruire ou en tout cas donner des pistes pour que cet engagement puisse se transformer. L’Institut réalise aussi des actions de formation et d’appui aux professionnels qui sont confrontés à ces situations.
L’entretien a été réalisé dans le cadre d’une enquête menée pour la Métropole de Lyon sur l’impact du numérique dans le travail social et médico-social. Il a été motivé pour la raison suivante : l’Institut Bergeret accompagne des jeunes à l’usage d’internet et des réseaux sociaux dans le cadre de la prévention des risques liés à la radicalisation. Alors que les enjeux éducatifs et de prévention liés à l’utilisation de ces outils par les jeunes sont importants, il semblait intéressant de connaître le point de vue de professionnels sur ces enjeux et sur les méthodes utilisables.
Pouvez-vous me parler du dispositif d'appui pour la prévention des risques liés à la radicalisation (DAPR), hébergé par votre Institut ?
JR : Depuis 2015 nous avons accompagné environ 70-80 familles autour de cette thématique. Et très vite s’est posée la question du numérique dans l’engagement radical. Avec l'idée que finalement, ce qu'on appelle radicalisation n’aurait jamais pu arriver à un autre moment : cette question est liée au contexte numérique et aux bouleversements que cela entraine au niveau culturel, puisqu’on assiste à une forme de scission, difficile à qualifier, disons culturelle, entre jeunes et adultes.
OC : Oui, c’est l’hypothèse que nous formulions dès le lancement du dispositif : le contexte sociétal dans lequel nous étions ne pouvait pas être dé-corrélé du numérique, en tout cas du point de vue de nos actions. Engager des actions de prévention sans tenir compte de ce nouvel environnement numérique, notamment au regard de la radicalisation, exigeait que nous intégrions la problématique numérique. Cette question s’est donc posée sous deux facettes : celle de l'usage du numérique de la part des jeunes dans les processus de radicalisation, et la place qu'accordent les professionnels à la connaissance de ces environnements-là, pour accompagner leur public, c’est-à-dire les jeunes.
Comment avez-vous constaté ce lien entre internet et la radicalisation des jeunes ?
OC : Nous sommes partis de deux constats de terrain assez basiques : le premier est que les prises de contact, les prises d'information de la part des jeunes étaient quasi majoritairement liées au numérique et à leur usage des réseaux sociaux. Nous aurions pu nous dire qu’on ne s'en occupe pas, mais dès lors cela revenait à fermer la voie au questionnement sur la manière dont ils avancent et se transforment avec le numérique. Cela nous semblait totalement absurde et surtout inadapté. C'est une des raisons pour lesquelles il fallait que l'on développe cette expertise et que l’on se donne les moyens d'aller au-delà de ce que nous connaissions nous-mêmes des pratiques du numérique. Deuxième constat, nous nous disions que si le numérique est un des outils qui environne ces processus de radicalisation, nous nous devions alors, en tant que professionnels et vis-à-vis des autres professionnels qui nous consultent, de mettre en œuvre de nouvelles manières de travailler, de nous inscrire nous-mêmes dans des processus de transformation de nos pratiques, en lien avec le numérique, et que nous en fassions profiter également les professionnels pour les accompagner. Typiquement, quand nous intervenons en formation en appui auprès des éducateurs de prévention spécialisée, nous passons un temps à travailler avec eux sur la nécessité de faire un pas de côté dans leur pratique sur la question du numérique, tant du point de vue de leurs usagers, que du point de vue de leur propre pratique.
Ce que vous dites, c'est que de nouveaux fonctionnements se sont installés chez les usagers et qu’il faut que les professionnels en tiennent compte.
OC : En tout cas, c’est un écosystème qui vient bousculer nos habitudes de travail, notre habitus. Un écosystème qui fait qu'à un moment donné, soit nous pouvons camper sur nos positions en tant qu’intervenant social en disant : non, de toute façon c'est sans le numérique, et c’est comme ça que doit se faire notre action. Soit nous nous interrogeons sur la nécessité de regarder comment les jeunes s'en emparent, et comment ils le traitent dans leur rapport à la radicalisation. Parce que typiquement aujourd'hui ils reçoivent 80, 90, 100, 150 SMS ou messages par jour, une fois qu'ils sont inscrits sur WhatsApp, pour leur indiquer comment ils doivent se comporter.
JR : C'est un usage commun chez ces jeunes-là, et on ne peut pas faire l'économie, dans le cadre de ce dispositif, de se poser la question : qu'est-ce qu'on intègre et comment on l'intègre dans notre pratique, et qu'est-ce que ça va provoquer ? Et d'inviter tout le monde à se poser cette question.
OC : D'autant plus, que derrière ces pratiques vous avez aussi la question de la place des uns et des autres, puisque la place du sachant, de celui qui sait, de celui qui accompagne, de celui qui guide — et la question du guide se pose dans la prévention de la radicalisation —, est totalement bousculée. Pour accéder à de l’information et pouvoir monter en compétence avec ce nouveau terrain de jeu, les ressources sont disponibles sur Internet. Cette profusion d'informations sous toutes ses formes, qu'elles viennent des médias d'information, des médias de désinformation, de plateformes collaboratives ou d’expressions, bref, le panel ordinaire de l'ensemble des typologies des réseaux sociaux, nous interroge sur ce que l'on peut, nous, professionnels via nos institutions, représenter pour ces jeunes. Et là aussi, ne pas penser la question du numérique dans le rapport des jeunes à la connaissance nous ferait passer à côté de la compréhension de ce mécanisme.
Vous avez évoqué l’usage du SMS : dans le cadre de vos formations, préconisez-vous aux professionnels de revoir leurs pratiques pour s’adapter aux usages, donc par exemple de communiquer avec leurs usagers par ce biais ?
OC : Nous essayons toujours de réintégrer la question des usages dans une vision un peu plus large. Nous ne sommes pas dans la fonctionnalité, à se dire, il y a besoin d’un SMS donc on met du SMS. On intègre le fait qu’effectivement il y a cette dimension, conjointement à d’autres, par exemple pouvoir rester en lien 24/24H avec eux, pouvoir leur offrir des espaces d'échanges qui soient partagés parce qu'on a aussi des activités de groupes avec eux. Résultat : on a décidé de mettre en place un réseau social privé qui nous donne la « maitrise » de bout en bout de l'organisation même des données et de leur diffusion. Nous avons un panel de fonctionnalités, avec des applications smartphones, des applications Android, et à partir de là, nous développons l'ensemble du contexte de ce réseau social privé, pour pouvoir offrir à nos jeunes un mode de communication, exactement comme ils le font sur Facebook, sauf qu'ils le font sur nos outils, ce qui nous permet de les adapter à notre action. On n’est pas dépendant d'une contrainte extérieure.
Et nous avons fait exactement la même chose pour les professionnels. On s'est dit : est-ce qu'on reste dans une logique habituelle de blogging, de type « WordPress », pour pousser de l'information régulière, plus ou moins structurée, ou est-ce qu'on rentre dans une logique de transformation des pratiques de nos professionnels en leur offrant un espace de formation en ligne ? Dès le départ, le choix a été fait de structurer nos contenus, tout ce qu'on produisait, dans une logique de plateforme, d'apprentissage en ligne. On a donc fait le choix de développer une plateforme LMS[1] de l’ensemble de nos contenus, en vue de l'offrir à nos professionnels.
[1] Une plateforme de « Learning Management System » gère de la formation en ligne ou un parcours pédagogique.
Les jeunes vont-ils utiliser ce réseau social privé parce qu'ils n'ont pas le choix, ou parce que la plateforme est attractive ?
JR : Nous expérimentons cet outil sur la base d’une réflexion que l'on mène depuis 3 ans, et plus spécifiquement dans le cadre d'une action portée par notre dispositif : le séjour de rupture. Le premier a eu lieu en 2016. Nous partons en Grèce pendant trois semaines rejoindre une association humanitaire pour aller travailler avec des jeunes suivis par le DAPR. Dans ce cadre, nous avons mis en place ce réseau social. Le prochain séjour va être l’occasion de le lancer, nous verrons dans quelle mesure les jeunes y adhéreront. L'enjeu est aussi d'amorcer quelque chose. Il n’y a aucune obligation à venir pour les jeunes, et aucune obligation à venir sur ce réseau social. L'enjeu est bien que les jeunes trouvent un intérêt à y aller. A l’occasion de ce séjour, ils n’auront pas leur propre téléphone portable, par contre ils auront un portable dédié uniquement à ce réseau social qu'ils pourront utiliser à longueur de journée pour partager ce qu'ils sont en train de vivre. Pour rentrer dans un fonctionnement qu'ils ont habituellement, mais sous un regard différent, le nôtre.
OC : Permettant aussi à ceux qui restent et qui n'ont pas pu partir d'échanger et d'amorcer une dynamique que l’on retrouve habituellement sur ce type de réseau. C'est un essai pour nous aussi. Il faut voir ce que cela donne, comment ça prend.
Avez-vous l'impression que les jeunes que vous accompagnez ne sont pas capables de vérifier la véracité de l'information qu’ils reçoivent ? Essayez-vous de former leur jugement ?
OC : La question du « croire » est le deuxième volet que j’allais aborder, vous déroulez ici la logique de nos formations. Qu'est-ce que croire ? Cette question se pose aussi bien pour les jeunes que pour nous professionnels.
JR : Et pour les parents d'ailleurs. La question se pose aux trois niveaux.
OC : La question du numérique vient bousculer cette question du croire, du côté de l'information/de la désinformation, du côté de la question de l'instantanéité, et du côté de la capacité à l'oubli ou en tout cas de la « sédimentation » de l'information. On travaille avec ces jeunes et nos professionnels sur cette question du croire. Quand on le fait avec les jeunes, on pourrait dire qu'on se balade aussi avec eux : on se met au même niveau qu'eux, pour mieux cerner « où ils sont ». On ne se refuse rien concernant les pratiques numériques, pour être clair. On va aussi avec eux sur des sites prosélytes, mais pour introduire chez eux du doute, du questionnement, de la critique...
Est-ce le jeune qui vous guide ?
JR : Oui, je leur demande de me montrer où ils s'informent, sur quel site, etc. Nous regardons ensemble ces sites-là, les vidéos prosélytes, y compris celles de l'Etat Islamique. A partir de là, on regarde le rapport qui construit la croyance à ces vidéos-là. En les emmenant un peu à réfléchir, à travailler le libre arbitre, et à trouver d'autres sources d'information pour arriver à croiser les regards.
Les jeunes acceptent-t-ils de vous montrer ces sites ?
JR : Oui, ils sont assez demandeurs parce qu'ils se sentent très isolés dans cet engagement radical. Du moment qu’on s'y intéresse, ils sont plutôt partants pour qu'on y aille ensemble. Sachant que quand ils viennent ici, on ne leur dit pas : « ce que tu fais, c'est n'importe quoi » ! S'ils y sont, c'est qu'ils y ont trouvé la meilleure réponse qu'ils estimaient pouvoir trouver pour eux. L'enjeu, c'est vraiment de dire : « tu nous montres où tu en es, on va réfléchir ensemble pour essayer de construire quelque chose ensemble à partir de là ».
Quand un jeune vous montre une vidéo par exemple, qu’allez-vous faire ?
JR : En fait cela dépendra de ce qui est montré, et du degré du lien de confiance qui s’est établi avec le jeune… Il est déjà arrivé de lui demander, à partir d’une vidéo, ce qu'il en comprend exactement, et d'amener un peu de questionnement et de discours contradictoire disant : « de mon point de vue…», « peut être que je me trompe, mais... », « moi ce que je comprends... », etc. On essaye de croiser les regards et de co-construire une idée différente, mais que le jeune peut s’approprier de lui-même. L’idée est d’arriver à instiller un peu de doute, et de développer chez lui une autre compréhension des choses qui l’entourent et du monde qu’il pense appréhender. Certaines fois, ce n'est pas du tout de l'information. L'autre jour une jeune fille me montrait ce que l’on appelle un nasheed (chant) islamique, qui appelait au jihad. Il n'y avait alors pas forcément à recouper avec autre chose. Par contre, j’ai travaillé sur comment elle comprenait cette vidéo, qu'est-ce qui est en jeu derrière, quelle technique a pu être utilisée pour la monter, etc. Pour d’autres médias, on pourra croiser leur source d’information avec d'autres sources, on ira se renseigner ensemble là-dessus, on les aidera un peu à chercher, pour qu’ils voient comment on se renseigne différemment. On peut aussi vouloir arriver à comprendre finalement d'où vient cette vidéo, qui a pu la poster, quel était l’intérêt de la personne à la poster, etc. Ce travail peut donc se faire à différents niveaux.
Votre travail ne porte donc pas forcément sur la véracité de l'information mais peut chercher à faire toucher du doigt au jeune pourquoi un contenu le touche ou le fascine ?
JR : C’est ça, nous travaillons principalement sur ce que provoque la vidéo. Pour moi, au cœur du travail, c'est finalement comprendre en quoi cela vient parler à des jeunes, parce que, encore une fois, s'ils sont allés là-dedans, c'est qu'il y a des choses qui ont répondu à un certain nombre de leurs attentes ou de leurs inquiétudes. On peut aussi réfléchir à la manière dont se construit un rapport à l'information à partir de l’émotion qu’elle provoque chez le jeune.
OC : Je crois qu'on focalise beaucoup sur la question de la vidéo, parce que c'est une thématique qui est en lien avec l'image. Cela vient vraiment toucher la question des pratiques du jeune. Quand est-ce que je m'inscris sur un réseau social, quand est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que j'ai conscience qu'en faisant ça, je prends des risques supplémentaires parce que potentiellement je vais m'exposer à l'accroche d'autres personnes... On a une jeune de 13 ans qui est restée toute seule un été, parce que sa mère a décidé de partir en vacances sans elle. Cette jeune a fait des allers retours avec Telegram, en installant puis en quittant l’application. Que fait-on de ça ? Ce qui importe, pour moi qui suis plus avec les parents qu’avec les jeunes, c'est surtout que notre discours et notre manière d'appréhender ce qui se vit n'est pas en décalage avec ce qu’ils vivent à l’extérieur, en tout cas au moment où ils sont en lien avec nous. C'est un élément important de crédibilité dans l'approche, dans l'accroche, dans la continuité.
Avez-vous le sentiment que les professionnels sont en décalage avec leur public justement à cause de ces pratiques numériques qui prennent une place grandissante ?
OC : Je parle uniquement de la question de la prévention de la radicalisation, et je ne me prononcerais pas à la place d’autres professionnels intervenant sur d’autres dispositifs. Ce qui est sûr, c'est que systématiquement, dans tous les groupes de professionnels que nous accompagnons, si nous avons 3 à 4 % de professionnels qui sont acteurs dans leur pratiques professionnels du numérique, et intègrent le numérique comme un outil leur permettant de transformer quelque chose chez les jeunes, c'est le bout du monde.
JR : C’est le grand maximum.
OC : Et encore, je pense être optimiste. Je ne dis pas que chacun d'entre eux ne fait pas un usage du numérique. Ils l'utilisent sans doute mieux que moi, dans le cadre de la préparation de leurs voyages, ou pour acheter les dernières fringues à la mode parce que le ou les sites choisis correspondent à leurs usages. Mais nous interrogeons les professionnels : dans vos pratiques professionnelles, comment avez-vous intégré cette dimension ?
Que font les 3 ou 4 % de professionnels qui utilisent ces outils numériques avec leur public ? Ont-ils des pratiques d’accompagnement un peu similaires aux vôtres, à l’Institut Bergeret ?
OC : Encore une fois, c'est plutôt des impressions de terrain, des témoignages, lorsque notamment nous étions en formation. Ces pratiques sont principalement liées au transfert d'une pratique personnelle vers une pratique professionnelle : j'utilisais Facebook dans ma vie privée, donc je ne vais pas m'interdire de le faire dans ma vie professionnelle. J’utilisais Instagram, donc je ne vais pas m'en priver. On est là dans une forme d'appropriation d'usage.
Avez-vous l'impression que cela se fait en dehors du cadre et des consignes posés par l’institution du travailleur social ?
OC : Cela a été constaté de tout temps, le législateur est toujours en retard d'un temps. C’est la « pression de la rue » qui va imposer au législateur de légiférer, de la même manière au niveau de l'institution, c'est le changement des pratiques des professionnels qui à un moment donné va bousculer l'institution. Il est clair qu'aujourd'hui avec le numérique, dans la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des institutions, et je parle des institutions les plus diverses que nous rencontrons, les professionnels utilisateurs du numérique sont souvent en dehors des clous de leur institution.
JR : Y compris ici, à un moment. L’institution a mis du temps à bouger aussi.
OC : Oui, l’institution ferme les yeux, en se disant : j'ai affaire à des professionnels, ils savent ce qu'ils font, mais je ne veux pas savoir. Peut-être est-ce trop perturbant, ou source d’enjeux institutionnels trop complexes ?
On trouve souvent dans le champ social l'idée que la bonne relation à l’usager est la relation directe, en face à face, c'est presque un dogme. Et davantage sans doute dans la jeune génération, des travailleurs sociaux n’ont pas cette perception, ils n'envisagent pas l'écran comme un « écran à la relation ». Il existe donc des perceptions différentes...
OC : Ces représentations-là, les jeunes viennent les bousculer. Et si nous ne sommes pas capables de les bousculer, nous restons dans le « dogme contre dogme », et la radicalité pour le coup se poursuit. On ne peut pas se permettre sur un sujet qui remet autant en question les dogmes, de rester imperméable à cette question du numérique. En tant que professionnels, oui effectivement, cela bouge nos représentations. Dans mes propos introductifs en formation, quand nous travaillons ces questions-là, je dis : c'est quand même la première fois depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans, que les ressources informatiques mises à notre disposition par notre institution sont 10, 15, 20, 100 fois inférieures que celles dont vous pouvez disposer à titre personnel. Il y a un gros changement en terme d’organisation personnelle et du travail dans ces moments totalement fractalisés où l’on peut faire du travail à la maison. Il est illusoire d'imaginer interdire Facebook dans un environnement social où la question de la pratique et du lien, ou qui relève d'une prise de contact, peut se faire aussi par ces moyens-là. Vous voyez là à quel point cela vient tout bousculer ! Et les directions des systèmes d'informations, les responsables des systèmes informatiques, les directions générales ont une exigence forte de sécurisation des données et sur la confidentialité. Tout ça n'est pas aujourd’hui résolu au niveau institutionnel.
Donc ce partage est déjà un moyen de pouvoir parler de contenus, et d'avoir une certaine prise...
JR : Oui. C'est sûr qu'il y aura toujours des espaces intimes qu’ils ne partageront pas pleinement, mais c'est le propre de l’adolescence d’avoir des secrets, il faut aussi leur laisser quelques latitudes. Avant c'était dans la rue, où il y avait des choses qu’on ne voyait pas, et je crois qu'il faut aussi l'accepter. En tout cas, ils seront plus en capacité de venir partager certaines choses, là où ils se poseront des questions, là où ils auront une inquiétude. En disant par exemple : « là, j'ai rencontré telle personne, là j'ai eu accès à tel contenu, il y a une question que je me pose ». « Bon, on va en parler! ».
Le mot contrôler est-il d’ailleurs le bon mot ?
OC : Non. C’est décloisonner. Je vais vous donner un exemple. Un groupe de parents va dire : j'ai besoin de contrôler mon jeune, donc j'ai installé un espion sur son téléphone portable à son insu. Et alors ? La belle affaire. Il y a des parents qui le font. Qu’en faites-vous ? Qu’est-ce que cela permet de transformer, de vous, de la relation à votre jeune, de comment vous abordez les choses, si ce n'est de renforcer effectivement le contrôle et le cloisonnement.
JR : Et la suspicion, et le manque de confiance qui va avec, etc., etc.
Pourquoi un jeune accepte-il de parler avec vous de ses pratiques sur les réseaux sociaux ?
JR : Il en parle parce qu'on s’intéresse à lui, à ses pratiques, au sens de « curiosité et envie de s’identifier ». Et c'est un espace auquel aucun, ou peu d'adultes de son entourage s'intéressent. La semaine dernière, une jeune fille m’expliquait que sa mère avait découvert, parce qu'elle avait fouillé dans son portable, qu'elle était allée voire une vidéo d'un islamologue un peu douteux. Du coup sa mère l'a confisqué et a interdit l'usage de ce réseau social. Il n'y a alors pas eu de dialogue par rapport à ce qu’elle cherchait, à ce qui l’intéressait dans cette vidéo ! Sa seule réponse a été « je te l’interdis ! » Mais la jeune y est retournée avec le mobile des copines. Alors que rien que de pouvoir en parler, et de dire : « mais c'était quoi ce contenu, pourquoi il t'a plu ? », c'est déjà proposer un espace où on s’intéresse à leur usage, et les jeunes sont plutôt partants de pouvoir partager ce qu'ils expérimentent sur ces réseaux.
Au lieu de poser des barrières qui seront contournées et vont empêcher le dialogue, vous préconisez d’échanger sur leurs pratiques numériques, c’est cela ?
JR : Oui, et je crois qu'à travers cette posture, l'adulte peut reprendre sa place d'accompagnant, de celui qui va permettre qu’un rapport se forge à ces espaces-là, un rapport qu'on pourrait appeler sécurisé, en tout cas où les jeunes ont conscience de ce qui peut se jouer. On peut avoir l'impression que l'adulte est éjecté de ces espaces, parce qu’il n'a aucune compétence et qu'il se sent dépassé. Alors qu'en fait il a une réelle légitimité à accompagner l'usage.
Dans le champ religieux, on se rend compte que le numérique est aussi un nouveau canal de transmission de « modes de vie », ce qui pose la question de l’offre.
JR : Ce qu'on a observé sur le terrain par rapport à la radicalisation, c'est que parmi ceux qui rentrent là-dedans, les jeunes qui sont issus de culture musulmane sont minoritaires. Finalement la radicalisation ne s’est pas faite par rapport à une transmission culturelle, mais bien par rapport à une offre, une offre qu'il y avait sur le Net, d'appartenance, de sens, d'identité, d'idéalité, etc.
OC : Votre machine à laver est en panne, vous allez regarder sur Internet s'il y a un tutoriel qui peut vous aider à la réparer. Les études du Crédoc sont intéressantes là-dessus, elles montrent l'évolution des pratiques. Ce qui est valable pour nous l’est aussi pour les jeunes. Que ce soit pertinent en termes d'apprentissage ? C'est toute la bataille de ceux qui sont responsables des apprentissages, les parents en premier chef, l'Education Nationale, les instituts de formation, etc. On voit bien comment le numérique bouscule ce qui touche aux apprentissages. Mais il n’empêche que la manière de construire une représentation ou une connaissance évolue vers une logique de réseau social d’apprentissage dématérialisé, dans la plus forte assertion du terme. Cela modifie tout et donne lieu à des constructions absolument hallucinantes. Par exemple nous présentions un reportage, dont on ne pouvait pas remettre en doute la probité journalistique, qui témoignait de la violence qui était faite aux femmes à Raqqa, en Syrie. La journaliste avait décidé de partir avec un voile, une caméra cachée pour montrer comment ça se passait. Elle était interpellée par un homme policier qui lui disait de remettre correctement son voile, alors qu'elle n'aurait jamais dû, selon la loi, être interpellée par cet homme qui n'a pas à lui adresser la parole. Nous montrons le reportage à une jeune femme qui revendique l’idée d'une égalité entre les hommes et les femmes à Raqqa. Le reportage étant en arabe, il est donc forcément traduit. Cette jeune femme remet en question la traduction, alors qu’elle ne parle pas un mot d'arabe ! Elle est obligée d’aller plus loin pour ne pas affronter une réalité contrariante. On est sur ce double mouvement permanent : « il y a une offre, je prends, elle ne me plait pas ou plus, j'en prends une autre et je la construis différemment ». C’est un bricolage !
Au-delà d’éduquer les jeunes aux médias, faudrait-il alors construire des offres alternatives ?
OC : On est partagé là-dessus. Dès l'instant où ne nous sommes pas présents avec eux, les jeunes vont sur une autre offre. Mais la question de l'offre est celle du rapport à l'autre, pas seulement avec le numérique. Là où il y a une offre, et on le voit bien sur le terrain, le jeune va y aller en privilégiant un espace où il est accueilli, choyé, considéré, ce qui va lui donner une valeur. Que dire si nous, au sens large, nous ne sommes pas capables de le faire ?!
Donc l'offre qui fait défaut peut être une offre de considération, de reconnaissance ?
JR : En effet le numérique est l'outil qui permet d’accéder à l'offre, et la question n'est pas tant celle d’un manque d'offre, mais plus celle d’un manque d'offre accessible sur le numérique, en tout cas concernant cette thématique de la radicalisation. Clairement, il y a un manque d'offres accessibles autour d'autres projets de société, d'autres idéalités, d'autres façons d'être en lien, d'autres connaissances, etc. L'offre la plus accessible là-dessus, et je pense que c’est encore le cas aujourd'hui encore, elle est autour de l’islam radical.
OC : Face à cela, les institutions ont investi cette question sous une forme un peu particulière, qui est celle du contre-discours. Qui tombe à côté de la plaque, parce que précisément on n’adresse pas la question de l'offre, on n'aborde que la question du discours. Dans notre travail de prévention, nous sommes convaincus que le contre-discours passe à côté du fond du problème.
Quelles formes prend le contre discours ?
JR : C’est par exemple tout ce qui vient démonter ce que donne à voir l'Etat Islamique dans sa communication.
OC : Dans cette optique, il s’agit d’être très présent, d’inonder les réseaux sociaux de contre-discours, ce qu'a tenté de faire le gouvernement dans ses campagnes. Ils occupent le terrain. Mais quel terrain ?
Par rapport au public que vous accompagnez, voyez-vous des changements dans l’adhésion aux théories du complot ?
JR : L’adhésion aux théories complotistes peut être aussi présente chez les professionnels. Il y a peu, un professionnel m'a dit concernant le projet HAARP, qui est une théorie du complot assez développée sur le Net : « mais qu'est-ce qui nous garantit que ça n’existe pas ce truc là en fait ? »
Avez-vous des outils pour travailler là-dessus ?
JR : J'avoue qu'on est un peu dépassés. Mais aujourd’hui, ça se travaille dès l’école primaire. Il y a des super initiatives avec les élèves à l'école autour de questions du type : « si je dis que la maitresse dans le bureau d'à côté est sur l'ordinateur, est-ce que je le sais ou est-ce que je le crois ? » Cela permet de travailler le rapport entre croire et savoir. Il me semble que l'Education Nationale s'empare de ces questions-là. Autre exemple : nous avions fait intervenir Rudy Reichstadt qui a énormément travaillé sur ces questions de complotisme et qui a créé un observatoire là-dessus (Conspiracy Watch). Dans ce cadre, ils avaient monté de toute pièce une fausse théorie du complot, en disant que le sida avait été inventé par les États-Unis dans leur lutte contre Cuba. Ils l’ont diffusé sur le Net pour voir comment ça allait prendre, et l'ont retiré très rapidement. Très vite derrière, ils ont rediffusé une vidéo expliquant comment ils avaient monté cette fausse théorie. L’idée était de voir comment ce genre de théorie se propage. Aujourd’hui ils font le tour des lycées et des collèges pour, dans un premier temps, exposer cette fausse théorie. Ils font réagir les élèves, certains disent « ouf c'est bizarre », d’autres « j'en étais sûr, je le savais, je l'avais entendu ! ». Quand ils diffusent dans un deuxième temps le reportage qui explique comment ils ont monté cette théorie, les élèves se sentent un peu bêtes d’y avoir cru. L'après-midi ils travaillent avec les jeunes sur la manière dont on arrive facilement à créer une théorie du complot, pour que les jeunes voient aussi le processus... A travers ces théories complotistes, on parle bien de croyance. L'autre jour, une jeune fille suivie par le DAPR nous a montré une vidéo du président Macron dans laquelle ce dernier parle de sa spiritualité. C'était très intéressant : d'un coup quand il dit qu'il est spirituel, il se relève. La vidéo montre que cela prouve qu'il est habité par un djinn, par les esprits… Comment faire de la contre-information là-dessus ! D’autant que la contre-information peut avoir l’effet inverse de celui escompté, et venir renforcer la croyance. Il faut alors faire différemment en allant travailler sur la construction de la croyance : « pourquoi quand il te dit ça, tu le crois ? » Une autre piste serait de produire une offre d’idéalité autre.
Vous pensez à d'autres idéalités qui ne sont pas forcément du côté religieux ? Du côté des projets de quartiers par exemple ?
JR : Tout à fait. Parce que je pense que ce que la radicalisation vient nous dire, c'est qu'un certain nombre de personnes ne peuvent plus se tourner vers les institutions ; que, dans l'imaginaire collectif, les institutions ne sont plus repérées comme pouvant apporter des réponses aux problématiques des habitants sur un territoire donné. La question pour les institutions est donc : comment faire pour réinvestir cette fonction qu'elles occupaient originellement ?
Je reviens aux travailleurs sociaux. Ce qui leur manque aujourd’hui, est-ce des consignes de leurs institutions pour investir les outils numériques ?
OC : On est là dans une interrogation systémique, avec la question de la pratique du changement. Peut-être au bout du compte changer nécessiterait une crise du cadre qui serait trop violente, alors on préfère résister. Nous avons constaté que les professionnels sont, en fonction des tranches d'âge, des parcours, diversement intéressés, bousculés dans leur représentation et dans leurs normes..
JR : Il y a un double mouvement : il y a une vraie nécessité des institutions à bouger, y compris en termes de moyens, parce qu'on rencontre beaucoup d'éducateurs, dans des institutions, qui ont un portable professionnel mais qui n'ont pas d’accès à internet ; de fait, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Ou leur système d'information a tellement de filtres qu’ils ne peuvent aller nulle part sur internet avec leurs jeunes. Il y a quelque chose vraiment à penser pour que les institutions bougent. Il y a aussi, je pense quelque chose à accompagner du côté des professionnels pour accepter l'idée de faire un pas de côté supplémentaire dans la façon de travailler aujourd'hui dans l’accompagnement social. Et pour explorer des univers et des espaces qui jusque-là étaient, dans l’imaginaire collectif, dédiés à l'intime.
OC : Cette « extimité » dont il est question, le travailleur social ne sait pas quoi en faire...
On peut échanger sur les réseaux sociaux, puis se rencontrer, puis échanger à nouveau sur les réseaux sociaux, ce qui traduit un mixage entre vie matérielle et vie numérique dans la vie sociale. Faudrait-il en tirer les conclusions dans le travail social ?
OC : On parlait des éducateurs de prévention tout à l'heure, moi je suis persuadé que le numérique est aujourd'hui un territoire supplémentaire à aller investir pour faire de la prévention spécialisée, et qui relève complétement de leur champ de compétence. Ce serait un vrai bouleversement des pratiques professionnelles et cela pose énormément de questions, à laquelle il faut s'atteler : des questions éthiques, des questions déontologiques, des questions pratiques, etc.
A un éducateur qui dit : on n'a pas à être « ami » d’un jeune sur Facebook, alors que ce jeune qu’il accompagne le lui propose, que dites-vous ?
JR : C'est peut-être plus compliqué que ça, sachant que l’ « amitié » sur Facebook a énormément bouleversé la notion d'amitié. Si par exemple le professionnel a un compte professionnel, il peut tout à fait être « ami » depuis ce compte professionnel avec le jeune. La question c'est à partir de quel compte et de quel espace on parle, il me semble.
OC : Facebook est venu effectivement bouleverser la question de la place, et vous trimballez votre profil Facebook aussi bien au boulot que dehors, et vous parlez d'ailleurs sur Facebook de boulot aussi. Donc oui, cette mixité des profils dans les environnements sociaux est nécessaire. Ce qui ne va d'ailleurs pas être sans problème quand on sait que Facebook vient de racheter une société d'authentification forte, qui assure que derrière un nom, il y a un numéro de permis de conduire, une carte d’identité, et que vous êtes bien la personne que vous revendiquez être. Ça ne va pas être sans conséquences.
JR : En attendant certains jeunes peuvent avoir jusqu’à 3-4 comptes différents, et ils savent très bien jongler en fonction des espaces. Je ne vois pas pourquoi, nous en tant que professionnels, on ne serait pas en capacité aussi de faire ce jeu-là et cette séparation-là.
Que faire quand, sur les réseaux sociaux, un professionnel apprend par hasard des informations contradictoires sur un usager, je pense par exemple au mineur isolé qui ne l’est pas ?
OC : Il n'y a pas de séparation, ce qui est sur Facebook est dans le réel. Déjà vous n’avez pas cette information par hasard, ce n'est pas vrai. Et puisqu’elle existe, il faut bien sûr pouvoir s'en saisir, et la travailler avec le prisme qui est celui de son cadre : si on est dans le juridique, juridiquement, si on est dans le social, avec le prisme social, etc.
JR : De mon point de vue de travailleur social, cela m'interroge : pourquoi ce jeune qui est mineur isolé fait-il passer l’information sur les réseaux qu'il ne l'est pas ? L’enjeu est aussi de travailler avec ces jeunes-là sur ce qu'on met sur ces espaces, parce que ce sont des espaces qui sont publics.
Il faut croire que cette information n'était pas destinée au travailleur social...
OC : Oui mais ça fait partie de son environnement. Ce n’est pas pire qu’une professionnelle qui était en arrêt maladie et qui était en réalité en vacances en Australie ; elle a posté une photo d'elle en surf, et s'est faite attraper par son employeur... Les espaces ne sont pas si cloisonnés que ça.
D’après l’enquête, les outils numériques sont peu pensés par les professionnels sous l'angle de la capacitation. A votre avis, comment faire en sorte qu’ils renforcent des capacités des usagers, ou servent à construire du lien ?
JR : Il me semble qu’il y a une prise de conscience au niveau sociétal... Il y a un moment où l’on a été dans une forme de lutte ou de résistance contre le numérique et ses conséquences. Aujourd’hui on est plutôt dans un changement de perspective, on se pose la question de comment on peut l'utiliser, on en fait quelque chose, une force, on développe les capacités des personnes à travers ça.
Et concrètement on a du mal.
JR : C'est aussi les conséquences de toutes ces années où on a été en résistance par rapport à ça, il faut du temps.
OC : Je crois que c'est vraiment une des questions fondamentales de l’intervention sociale : comment s'emparer de ces outils pour en faire quelque chose qui relève de son champ, de ses valeurs ? Peut-on, comme ce fut le cas par le passé, mettre à distance un mouvement qui ne se produit pas sur des décennies, mais qui se passe à un rythme de changement tous les 6 mois ? Avant, il était question de prendre la bonne distance, d'être très loin, d'avoir une grande distance à l’usager, c'était très important. Maintenant on assiste au phénomène inverse qui est d'avoir une très grande proximité. Où est la « bonne » distance ? N’est-ce pas cette question du lien qui est interrogée aussi à travers le numérique ?
Dans la protection de l’enfance, il est souvent question de l’impact du numérique sur les visites médiatisées : le cadre posé par le juge peut être chamboulé avec les outils de visio-conférence... Que faudrait-il faire ?
OC : Il va falloir aller vite, il y a une urgence.
JR : On a déjà été confronté à une situation un peu similaire : on suivait une jeune qui était placée en MECS (Maison d’Enfance à Caractère Social) avec un droit de visite qui s’exerçait en visite médiatisée. Sa mère lui envoyait plein de textos, elle communiquait avec elle par SMS, par les réseaux, entre chaque rencontre, ce qui venait remettre en question le principe-même de visite médiatisée.
OC : Ce que vous évoquez là, c'est typiquement ce que disait un éducateur alors que nous étions en formation : « vous vous rendez compte, moi j'ai besoin d'animer mon quartier avec les jeunes, alors j'ai eu une super idée : une activité « sortie en quad » ! Je suis allé voir un premier jeune, j'ai monté les escaliers, parce que c'est le seul moment où je pouvais toquer à la porte, attraper le jeune, parce que de toute façon aujourd'hui entre le moment où ils sortent du bahut, ils prennent le bus et le moment où ils rentrent chez eux, c'est compliqué. Donc je monte les trois escaliers, je lui propose, il me répond : « ouais pourquoi pas ! » Donc l’éducateur pense que ça va peut-être fonctionner, il va voir un autre jeune pour faire dynamique autour de ce projet. Il descend les quatre étages, il change d'allée, il frappe à la porte d’un autre jeune, qui lui ouvre et lui dit : ta ballade en quad ça m’intéresse pas ! Et l’éducateur nous dit, je fais comment avec ça ? L'institution elle ne me permet pas d'avoir Facebook, dans mes pratiques je ne sais pas comment me positionner. » C’est pour ça que votre sujet d'étude est extrêmement intéressant.
Parmi les initiatives pionnières d’accompagnement éducatif sur internet et les réseaux sociaux, j'ai entendu parler des Promeneurs du Net : qu’en pensez-vous ?
OC : Leur approche par l’expérimentation et l'implication est vraiment quelque chose qui fait sens, je crois qu’ils ont vraiment compris aussi cette démarche-là, qu’il est urgent de ne pas être simplement dans du catalogue, mais de faire bouger, de faire des pas de côté. Et le seul moyen de le faire, c'est plonger, s’immerger. La question du numérique pose aussi la question du manque d’investissements au sens large. La Région indique par exemple avoir plusieurs milliers de postes de développeurs informatiques et de techniciens informatiques à pourvoir, mais n’arrive pas à former ! Je m'inquiète beaucoup sur le parent pauvre qu’est le travail social : comment va-t-il faire pour se doter d’outils, de moyens pour pouvoir suivre ? Parce que c'est déjà par définition des secteurs qui ne sont pas très attractifs pour ce type de compétences. Et légitimement, le travailleur social, va dire : « moi je n’ai pas forcément envie d'être inféodé à un réseau social comme Facebook dans lequel la question de la sécurité de mes données, la question de la possession de mes données, etc., rien ne m'est garanti ». Et je le comprends.
Beaucoup de questions se posent en effet, dans le secteur social, sur la protection et la sécurisation des données personnelles des usagers.
OC : Vous voyez ce qui est mis en place par le secteur médical avec la messagerie sécurisée de type MSSanté pour sécuriser les échanges de mails entre professionnels. Comme c'est compliqué à mettre en œuvre, les moyens qu'il a fallu mettre en place ! 10 ans de travail et des millions investis pour développer une messagerie sécurisée, qui garantit que l’ensemble des informations échangées entre professionnels ne puisse se faire qu'au travers d’une architecture sécurisée. Je vois mal le secteur social s’engager dans cette logique…

Étude
Cette synthèse explore l’impact du numérique sur le travail social et médico-social auprès des services publics locaux.

Étude
Avec la question de la solidarité, on est au cœur du processus de construction de la Métropole.

Étude
Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant

Texte d'Anouk JORDAN
Les violences avec le public témoignent de la difficulté d’exercer le métier de travailleur social dans les organisations concrètes du travail que sont les collectivités territoriales.

Interview de Joël de Rosnay
Scientifique, prospectiviste, conférencier et écrivain
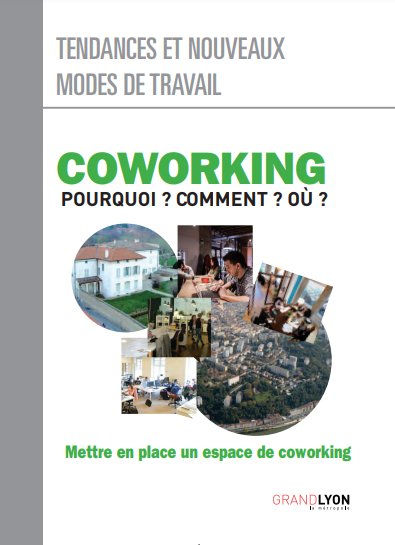
Étude
Ce guide a pour objectif de répondre aux questionnements des communes souhaitant ouvrir des espaces de coworking, et ce à toutes les étapes du processus.

Interview de Patrice Obert
Responsable de la délégation générale à l’éthique à la RATP

Interview de Mathilde Philipp-Gay
Maître de conférences en droit à l’Université Jean Moulin - Lyon 3

Étude
Orchestrer la Ville Intelligente (8)