Intelligence artificielle (2/3) : ses conséquences dans le monde réel

Article
Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?
Interview de Joël de Rosnay

Complexité, diversité et mélange des parcours, des cultures, révolution numérique : ce champ de réflexion est parcouru depuis un demi-siècle par Joël de Rosnay.
Ce savant de renommée internationale creuse le sillon d’une pensée prospective qui associe particulièrement biologie et informatique, sans jamais perdre de vue les dynamiques d’évolutions sociétales et sociales.
Depuis le management d’un groupe jusqu’aux structures de nos sociétés plurielles, cet humaniste militant nous éclaire sur ces possibles qui donnent envie de sourire en bâtissant l’avenir.
Avec la publication en 1975 de votre ouvrage « Le Macroscope », vous avez été un pionnier de l’analyse systémique, qui a nourri votre réflexion sur le management de la complexité. Cette complexité, à partir de quand peut-on la diagnostiquer objectivement, à partir de quelle échelle ou de quel seuil d’interaction ?
Avant tout, une précision : la complexité n’est pas la complication. La complication est un ensemble d’éléments que l’on ne peut pas relier entre eux et qu’il est très difficile de déchiffrer, de décrypter et de rationaliser. Par contre, la complexité a une logique interne, des interactions entre les éléments que l’approche systémique permet de traiter globalement.
Avec l’irruption du numérique, d’abord avec l’informatique appelée jadis la télématique et maintenant l’écosystème numérique, la complexité est parmi nous tous les jours, dans l’économie, la vie publique, nos loisirs, la vie de famille ou la vie professionnelle. Cette complexité est liée à l’intrication des interactions entre des éléments qui constituent un système complexe. Et ce qui constitue la complexité, ce qui rend absolument fascinant son développement et qui permet d’essayer de la traiter, ce sont les interactions dynamiques entre les éléments de ce système complexe, qui font émerger des propriétés nouvelles.
La complexité a toujours existé, avec le langage, les mots, la grammaire, et les relations entre les mots et l’informatique, qui a amplifié ces interactions. Aujourd’hui, dans l’écosystème numérique, la complexité est donc encore plus grande, mais on a les moyens systémiques de la résoudre.
Concrètement, comment peut-on en faire un outil de pilotage d’une organisation ?
L’outil idéal de pilotage d’une organisation de la complexité, c’est la simulation sur ordinateur. L’ordinateur peut être un laboratoire sociétal qui permet de simuler des interactions complexes dans l’entreprise. Grâce à la simulation, on peut jouer, si je peux employer ce terme : « Si je faisais cela, que se passerait-il ? » La simulation permet donc de préconiser de nouvelles fonctionnalités, de les tester, de voir les résultats éventuels, positifs ou négatifs pour l’entreprise.
Et au sein d’une équipe, peut-on imaginer que le langage, avec sa capacité à nous projeter, et le dialogue, permettent de reprendre les fondamentaux de cette simulation ?
Oui, absolument, à partir de ce que l’on appelle les « jeux de rôle », qui peuvent d’ailleurs être aidés par l’informatique en donnant à chaque personne leur profil et leur personnalité. Il y a d’ailleurs des séances de management en entreprise qui utilisent ces jeux de simulation, où quelqu’un prend la place du patron, celle d’un salarié, d’un directeur des ressources humaines. La simulation des interactions humaines peut donc aider, grâce à la complexification dans l’entreprise, à mieux gérer les organisations.
Revenons sur l’opposition que vous faites entre complication et complexité : au sujet des collectivités décentralisées, on parle très souvent du « mille-feuille territorial » comme d’un facteur de complication. Mais est-ce que la complexité de ces différents échelons de gouvernance peut, notamment, permettre de réagir face aux déséquilibres locaux et d’articuler avec une intelligence sociale les politiques publiques qui sont, en soi, un système complexe ?
Oui, à condition de provoquer les interactions. Il faut les créer pour voir où ces dernières se renforcent ou sont au contraire négatives. C’est grâce à la dynamique des interactions que la complexité peut nous aider à mieux comprendre comment manager des systèmes complexes territoriaux ou d’entreprises.
Il faut donc créer la dynamique des interactions grâce à laquelle on voit émerger de la complexité, du nouveau, de l’innovation sociétale et psychologique.
Justement, dans les interactions entre les différents niveaux de l’État, entre les différents acteurs de l’action publique, il peut y avoir des dimensions politiques, par exemple, qui peuvent prendre une dimension conflictuelle, et freiner, ou au contraire dynamiser cette dialectique. Au sein des organisations concernées, il peut y avoir beaucoup de variables à prendre en compte de la part des acteurs, tels que les agents du service public. Comment cette organisation peut alors être en mesure de les rassurer, de fixer des repères clairs, tout en les invitant à élargir leur champ de perception des différentes interactions ?
Vous avez parlé de politique : dans les rapports de politique, il y a des rapports de force, et il faut créer des rapports de flux. Comme je le disais, il y a une grande différence entre la complication et la complexité, comme entre les rapports de force et les rapports de flux. Les rapports de force sont conflictuels et peuvent se traduire par une escalade : tantôt l’un prend le dessus, tantôt c’est l’autre. Dans les rapports de flux, c’est un échange permanent d’informations, de biens matériels, de biens financiers.
Il faut donc promouvoir les rapports de flux plutôt que les rapports de force, sur le plan territorial, dans les relations entre les gens, dans la création des interactions. Un rapport de flux, c’est la confiance mutuelle dans l’information qui est échangée et la confiance dans son interlocuteur. Et ces rapports de flux créent un rapport d’échange, de solidarité et, si j’ose dire, de renvoi d’ascenseur : « Je fais quelque chose, je te donne en retour un renvoi, une récompense sous forme d’une information complémentaire ».
L’un des points importants de la méthode que vous défendez, c’est la notion de « catalyse » dans le management, et donc de mise en relation des différentes compétences, des différents parcours. Comment peut-on respecter ces différentes compétences, ces micro-objectifs internes que chacun se donne, et en même temps ne pas diluer les objectifs globaux ?
Il faut afficher les objectifs globaux pour que, dans la réunion de travail où chacun partage, ce soit la confiance qui règne. La compétence des gens dans tel ou tel sujet doit être reconnue par les autres. C’est la reconnaissance des compétences, la confiance et le partage des objectifs par des méthodes mises en commun qui permettent d’atteindre ces objectifs et de respecter l’apport de chacun.
C’est ce que je fais dans les séminaires de travail : j’ai une grande pratique de cela, que j’ai développée depuis des années, avec l’analyse systémique : afficher les objectifs clairement, faire du mind mapping, respecter les compétences pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice.
J’ai une vision pratique, puisque je suis un praticien de l’approche systémique dans la création collective. Je pense que la création collective est une des choses les plus importantes que l’on peut faire dans l’entreprise et dans la vie de chacun. Créer collectivement rappelle cette phrase d’Albert Camus : « Créer, c’est vivre deux fois ». On vit sa création, et la création continue dans l’entreprise et au-delà de vous-mêmes, de ce que vous avez fait.
Je pense donc que la mise en commun des compétences, la mise en réseau des savoirs, la catalyse les interactions dynamiques entre les gens, font émerger des innovations. C’est la clé du succès du travail en commun, de la créativité commune.
Cette créativité a justement besoin de décalages, de nouvelles passerelles entre des parcours et de compétences diverses. C’est donc très important, selon vous, pour qu’une équipe fonctionne, qu’elle réunisse des profils différents, notamment au niveau générationnel ?
Oui, absolument. À la Cité des Sciences et de l’Industrie, j’ai fait des quantités d’expériences dans le transfert des savoirs entre les anciennes et les nouvelles générations. Les nouvelles générations peuvent apporter aux plus anciennes les technologies nouvelles, les technologies de relais, les technologies de réseaux, et les générations plus anciennes peuvent apporter la contextualisation politique, économique, voire spirituelle, de manière à ce que les gens puissent se situer dans un but commun. Je suis donc pour la cogénération, le capital commun échangé entre les générations montantes et les seniors.
Je crois qu’il faut faire l’expérience de mise en relation des seniors et des juniors. Je dis souvent aux grands patrons d’entreprises qui me demandent : « Comment pouvons-nous faire pour changer ? Parce que ce que vous dites, Monsieur de Rosnay, c’est très bien, mais des gens de cinquante ou soixante ans, ils ne se sentent pas en situation de… ». Je leur dis : « Prenez des stagiaires de vingt ou vingt-cinq ans, vous allez voir : ces jeunes vont catalyser les idées des gens, faire des expériences, évaluer les résultats des expériences en commun, et c’est comme cela que ça marche. ».
On parle de plus en plus de prospective, du fait d’enjeux de long terme beaucoup plus présents dans le débat public. Cette démarche prospective, intellectuelle, a vocation à viser un futur dit « souhaitable ». Cela croise une demande croissante de la part de la population d’être associée aux décisions politiques, de faire de la prospective un terrain d’échanges démocratiques. Selon vous, de quelle prospective a-t-on besoin au niveau des territoires pour à la fois responsabiliser l’institution centrale et partager la décision avec les usagers, les habitants, les bénéficiaires ?
La prospective la plus importante au niveau des territoires, pour que les gens se sentent impliqués, c’est une prospective qui touche la santé, l’éducation, l’environnement, l’alimentation et l’énergie. Ces cinq éléments-là sont à mettre en avant dans une prospective territoriale et citoyenne pour que les gens se sentent impliqués.
Dans cette dynamique, quelle place peut-on accorder aux outils numériques ? On parle d’e-démocratie, et en même temps, on a l’impression que les réseaux sociaux, tout cet environnement numérique, ont créé des formes d’anomies, de replis sur soi. Comment peut-on donc à la fois utiliser les facilités données par ces outils, et en même temps revenir à un débat public qui permet la rencontre ?
C’est souvent ce que l’on a dit : « L’ordinateur va entraîner un repli sur soi, les gens vont être devant leur écran et ne se parleront plus, ils seront constamment sur les ordinateurs ». C’est bien le contraire de ce qui se passe, lorsque l’on sait utiliser l’ordinateur comme réseau de communication, et quand les réseaux sociaux sont bien utilisés. Il s’agit d’outils de mise en commun des savoirs et de partage des connaissances, et je crois qu’il faut le voir sous cet angle positif.
On n’est donc pas dans la crainte de l’écran qui isole, on est plutôt dans une vision positive. Quand je dis « on », ce sont toutes celles et tous ceux qui font de la prospective comme moi sur ce sujet. On est dans une vision positive de « l’ordinateur qui rapproche », pour une dynamique de réseau qui fait émerger de la nouveauté. Et cela passe évidemment par l’informatique et le numérique.
Et comment contourner alors cette espèce de « divination algorithmique » qui amène chacun, a priori, à se nourrir avec ce qui fait déjà partie de ses convictions, de manière à être dans cet échange où l’on peut se mettre à la place de l’autre, où l’on peut regarder le monde avec un autre point de vue ?
Les gens font des recherches sur Google et croient y trouver quelque chose de nouveau, mais beaucoup d’entre eux le font pour renforcer leurs propres connaissances. C’est la vision un peu nombriliste du serpent qui se mord la queue. Pour éviter cela, il faut toujours créer, en même temps que l’accès à l’information, des moyens d’évaluation des effets de l’accès à l’information. C’est ce que je fais avec mes élèves, les consultants dans les entreprises auprès desquelles j’agis : je crée les conditions d’accès à l’information, je leur apprends comment mieux s’informer. Qu’ils soient patrons ou salariés, les gens connaissent mal les outils extraordinaires d’information dont on dispose aujourd’hui.
J’apprends donc d’abord aux gens à bien s’informer, à savoir stocker des informations pour les réutiliser. Et deuxièmement, je leur apprends à évaluer l’impact de cette information sur leur gestion de l’entreprise, sur leur action.
Concernant cette idée de prospective partagée, pour ne pas dire de « prospective citoyenne » : pour que l’on ne soit pas dans la démagogie, on a besoin d’une mise de fonds de la part d’experts, en tout cas de scientifiques. Cette période de pandémie a permis de les voir prendre un rôle plus important dans la gouvernance de crise. Pensez-vous qu’il nous restera, après cette période, une aspiration à leur accorder un nouveau rôle pour avoir une certaine fiabilité dans les informations, intégrer des enjeux de long terme, à partir de risques évalués avec justesse ? On a beaucoup été confrontés à la question des fake news, par exemple.
Oui, mais méfiez-vous des scientifiques, si j’ose dire, même si je suis un scientifique. Qu’ils ne ressassent pas leurs cours d’une manière analytique. Le scientifique doit pouvoir développer un discours systémique, qui voit au-dessus de sa discipline, qu’il soit physicien, chimiste ou sociologue.
Je vous dis donc « Méfiez-vous des scientifiques ». Oui, il faut les utiliser. Oui, la rationalité scientifique est importante dans un moment de fake news, pour montrer qu’il y a des réalités sur lesquelles on peut s’appuyer. Et la science démontre qu’il y a des méthodes de rationalité qui ont été expérimentées depuis des millénaires et que ça marche. Oui à cette méthode, attention au scientifique qui refait son cours.
Et lorsque le scientifique intervient, comme on a pu le voir sur des questions d’ordre politique, où il est question de choix de la part de l’exécutif, conserve-t-il son autorité de savant, ou doit-on le considérer comme un citoyen ? Doit-on objectiver aussi là d’où il parle pour éviter le mythe du philosophe roi ?
C’est un citoyen savant. Un savant est un sachant et un citoyen est quelqu’un à même d’essayer de comprendre. Un citoyen sachant est une forme de savant, et le scientifique doit avoir cette place-là, cette position et pas une autre. Il ne doit pas être celui qui sait tout et qui va toujours imposer son savoir.
Par contre, les scientifiques qui savent se hausser au-dessus de leur discipline pour avoir une vision large, œcuménique de la science en général et de son application pour la politique et la société, ça oui, je suis d’accord. C’est ce que j’essaye de faire en tant que scientifique, mais je ne peux pas l’imposer à tout le monde.
D’un côté, on a ces sachants et, de l’autre, des citoyens qui ont une connaissance empirique de la société. Cette expérience est aussi influencée par leurs valeurs, leur parcours, des choses aussi inconscientes. Cela m’amène à penser à votre démarche de création d’AgoraVox, que vous appeliez le premier média « pronétaire ». Dans ce contexte, entre ces pronétaires, et ces sachants, ces producteurs traditionnels de discours qui font autorité, jusqu’où peut-on imaginer pousser le parallèle avec la lutte des classes ? Jusqu’où le conflit pourrait aller ?
Il n’y a pas de conflit. Il faut pousser ces gens-là parce que, en parallèle des sachants, les pronétaires, les gens qui savent moins, ont de l’intuition, de l’expérience, de l’émotion. Des gens qui ne sont pas des spécialistes sont des gens qui peuvent apporter énormément au débat citoyen. Ils sont capables de voir des choses avec leurs expériences familiale et professionnelle. Et il faut les écouter, il ne faut pas écouter que les spécialistes, que les sachants et que les scientifiques.
Comme je vous l’ai dit, je me méfie beaucoup de ceux qui veulent imposer leur savoir en disant : « On a la solution parce que l’on a appris comment faire ». C’est vrai que la méthode scientifique est essentielle, mais elle est parfois mal appliquée par les scientifiques eux-mêmes.
Vous nous emmenez vers une idée du débat public qui se déroulerait, comme on dit, « en bonne intelligence ». Pourtant, on a l’impression que justement, notamment à travers les réseaux sociaux, on vit dans une société beaucoup plus conflictuelle. N’y aurait-il pas des outils culturels, une nouvelle culture du vivre ensemble qui associerait le numérique, qui devraient voir le jour pour que l’on arrive à se projeter jusqu’à l’objectif que vous indiquez ?
On est en train d’évoluer doucement vers cela. Vous avez employé un terme que j’aime beaucoup : « en bonne intelligence ». J’ajouterais : « en sages ». On utilise moins ce terme parce qu’on le connaît moins : « un sage ». Qu’est-ce qu’un sage ? La sagesse, qu’est-ce que c’est par rapport à l’intelligence ? La sagesse, c’est la multidimensionnalité, la capacité d’un ou d’une sage de relier les choses entre elles d’une manière multidimensionnelle, à des niveaux différents.
Être en bonne intelligence les uns avec les autres, c’est donc appliquer cette sagesse, la mulitidimensionnalité, pour mieux se comprendre et aller plus loin ensemble. Les éléments sont là, il faut les connaître, beaucoup d’entre nous les avons décrits, comme Edgar Morin dans ses livres. Tout ce que l’on a fait dans le Groupe des Dix, dont vous avez certainement entendu parler, a laissé ses traces, a fait des petits, de Jacques Attali à Jacques Delors. Des livres ont été écrits à la suite des travaux du Groupe des Dix. Il y a donc des possibilités, des voies : en bonne intelligence, cela veut dire aussi en bonne sagesse.
Mais dans un contexte médiatique où de grandes questions de société sont traitées à un rythme sidérant, sur des plateaux télé par exemple, où chaque argument est présenté en une minute trente, ce sage, quelle est son arme majeure contre ce que seraient aujourd’hui ces sophistes modernes, disons en tout cas des gens qui raccourciraient les questions, qui simplifieraient les réponses ?
D’abord, la modestie par rapport à tous ces experts que l’on voit sur tous les plateaux de télévision, l’intuition, la valorisation de ce que disent les autres. J’ai beaucoup travaillé aux États-Unis, où l’on valorise toujours ce que l’autre a dit. Cela renforce le travail de groupe, le respect de ce que l’autre personne a dit, cela crée une cohésion et une confiance.
Plutôt que des experts qui ne parlent que d’eux et qui n’écoutent pas les autres, que l’on voit défiler sur les plateaux télé, je pense que le sage est modeste. Il est sage et montre que sa modestie, finalement, permet d’aller plus loin en écoutant les autres et en les respectant. Le sage écoute et respecte.
Pour permettre l’émergence de cette culture commune qui nous permettrait d’utiliser à bon escient ces outils de communication, peut-on imaginer l’émergence de nouveaux médias qui, justement, seraient dédiés à ces objectifs, qui n’auraient peut-être pas les mêmes enjeux de rentabilité et qui seraient plus dans une démarche, si vous me passez l’expression, de « service public de la connaissance » ?
Oui, on peut l’imaginer, ce serait une magnifique chose d’avoir un service public de la connaissance, de nouveaux médias. Mais je crois aussi que l’on peut tous ensemble chercher à faire évoluer les réseaux sociaux. Ils sont un outil extraordinaire de partage, de mise en commun, mais qui, malheureusement, ont dévié à cause de l’anonymité vers la haine, vers les fake news.
Je pense qu’il faut reconstruire, repenser les réseaux sociaux dans l’optique positive que vous venez de dire. Plutôt qu’un service public, les citoyennes et les citoyens, de proche en proche, bottom up, comme diraient les Anglo-saxons, du bas vers le haut, pourraient reconstruire des réseaux sociaux positifs apportant à chacun de l’information, de l’intelligence et de la sagesse, plutôt que de la dénégation, des fake news, du déni et de la haine.
Ce monde numérique baigné par les réseaux sociaux est aussi un monde dans lequel on a, heureusement, constaté l’affirmation de certaines minorités qui ont pu agir pour leurs droits, mais en même temps un certain fractionnement des collectifs. Comment peut-on, concrètement, concilier cela avec l’émergence de nouvelles scènes communes de dialogue ?
Vous savez, la biologie et l’évolution de la vie sur la terre montrent que la diversité est créatrice d’évolutions. L’une des clés de l’évolution, c’est la diversité. S’il n’y avait pas eu de diversité, il n’y aurait pas eu d’évolution. Dans les réseaux sociaux, il y a donc de la diversité parfois positive, parfois négative, mais c’est cette diversité qui permet l’évolution. Et qu’aujourd’hui il y ait des personnes comme moi qui vous parlent, qui essayent de faire en sorte que les réseaux sociaux évoluent vers quelque chose de plus constructif pour l’humanité et la société, montre qu’il y a une évolution, qu’il y a une voie possible et un espoir en train de se forger.
Pensez-vous, au niveau territorial, que la dynamique de métropolisation qui met en commun de plus en plus de territoires et en même temps des territoires de plus en plus urbanisés, crée un écosystème favorable à l’émergence de ce que vous décrivez ?
Alors, ça, c’est le grand problème de la ville, de la métropole du futur. La ville doit être un catalyseur de l’émergence de l’intelligence des humains. On parle d’un terme que je n’aime pas du tout : la smart city, la ville intelligente. Il n’y a pas de ville intelligente : elle n’est intelligente que dans la mesure où elle catalyse l’intelligence de celles et ceux qui l’habitent.
La ville est à la fois un support, et la conséquence de l’organisme vivant que sont les centaines de milliers ou les millions de gens qui y habitent. Cet « organisme vivant », c’est nous, les 10 000, 100 000 habitants d’une ville, le million, les 10 millions. La ville est donc un organisme vivant collectif que nous devons de nouveau concevoir pour catalyser les intelligences personnelles et la créativité collective. C’est l’enjeu des villes de demain.
Là, nous parlons à une échelle macro des collectifs humains. Si l’on revient à une échelle plus petite, comme les équipes de travail que l’on a évoquée au début par exemple, pensez-vous que la tendance générale qui associe, au sein d’un même projet d’entreprise ou au sein même des services publics, des titulaires, des salariés traditionnels et des indépendants, est un type de diversité générateur d’une capacité à innover ?
Oui, salariés plus indépendants, et j’ajouterais des indépendants jeunes, des millenials, c’est-à-dire des jeunes qui sont constamment mobiles, en recherche de leur métier : ils font une chose et en font une autre, simultanément. Ces jeunes, avec leur smartphone — c’est un laboratoire et un bureau à lui tout seul — peuvent beaucoup apprendre dans l’entreprise sur la diversité des relations, des parcours. Et je pense que c’est dans cette diversité des parcours que se construiront peu à peu, même sur le plan territorial, les métiers du futur et la capacité de gestion de la complexité des entreprises et même des villes et territoires de demain.
Cela nous amène à la notion de précarité : on a une vision qui se focalise sur la stabilité des emplois comme norme, et qui postule que la mobilité est dangereuse, on a toujours dit cela. Mais ces millenials, ces freelancers, qui travaillent sans être dans un bureau, mobiles constamment, mobiles dans les idées, dans le travail, souffrent en fait actuellement surtout de la précarité des nouveaux entrants dans un champ professionnel. À l’avenir, leur statut d’électron libre, leur mobilité, leur diversité, leur volonté de non stabilisation, d’être constamment en recherche de quelque chose qui les motive, qui leur donne envie de continuer, les rendra indispensables dans l’écosystème numérique et les réseaux. C’est cela qui est en train de changer.
Il n’y a plus de travail fixe dans des endroits fixes, le travail devient mobile, le temps se modifie, le temps de travail est désynchronisé. Les deux mots-clés sont : désynchronisation et délocalisation. Qu’est-ce que le travail, s’il devient désynchronisé et délocalisé ? Alors que jusqu’à présent, on est payé pour être dans un bureau de telle heure à telle heure, là vous travaillez sans être à un endroit fixe. Comment contrôler ? Comment savoir qu’effectivement, les gens sont utiles à l’entreprise ou à la plateforme, comme l’on dit, ou à l’organisme qui les emploie ? Le nouvel enjeu, c’est la mobilité, la désynchronisation du temps, la délocalisation des lieux.
Cela croise aussi, au niveau de la complexité interne de ces personnes, l’affirmation des identités que j’évoquais tout à l’heure, leur métissage, la créolisation des cultures. Chaque individu du troisième millénaire est doté d’un habitus de plus en plus complexe. A-t-on besoin, pour recréer des passerelles, des espaces de dialogue entre des gens qui intègrent en eux-mêmes tellement de différences, d’un travail sur soi ? On peut être aujourd’hui le descendant, à la fois du colon et du colonisé et là, cela paraît très difficile de dialoguer avec l’extérieur, on est plus sur un cheminement personnel, presque de l’ordre de l’individuation.
En continuant sur la ligne positive que j’avais évoquée tout à l’heure en parlant des slashers, je dirais que l’on a besoin, à terme, d’une recréation spirituelle interne pour aller plus loin ensemble, parce que si l’on veut aller plus loin ensemble, il faut avoir quelque chose à échanger, et ce n’est pas que de l’information.
Ce seront de plus en plus des valeurs, des émotions qui vont devenir importantes, et même plus importantes que l’information. L’information, on y a accès, on va sur Google : on a une information, on sait plein de trucs tout de suite, quelqu’un qui ne sait pas quelque chose, qui a oublié une date, il va chercher sur le web. On a une mémoire collective prodigieuse, avec des avantages et des inconvénients, mais elle est là. L’important que l’on doit partager n’est donc pas de l’information : pour chacun d’entre nous, ce sont des valeurs communes, spirituelles, morales. Ces valeurs-là seront l’outil de partage essentiel de confiance et de respect des gens entre eux.
Et si l’on refait un parallèle entre ces questionnements sociaux et la biologie, si l’on utilise l’épigénétique comme une métaphore de ces identités complexes, est-ce que l’on va, justement par ces dialogues, cette construction commune d’une forme de sagesse, vers un renforcement du libre arbitre de chacun ?
Je suis allé carrément dans cette direction à la fin de mon livre La symphonie du vivant, avec ce que j’appelle l’épimémétique, un « mème » est l’équivalent d’un gène sociétal, un mème est un gène transmis par la culture, l’information, les tweets. La mémétique, c’est le renforcement des mèmes dans la société, un tweet aujourd’hui est un mème, #MeToo est un mème. Ces mèmes vont se renforcer de plus en plus dans la société de demain et nous aider à nous construire collectivement.
On a donc besoin, à la fois de beaucoup mieux comprendre la sociologie de la diversité pour, en même temps, permettre à chacun de l’objectiver, d’objectiver son parcours, sa spécificité, de manière à s’émanciper des déterminismes sociaux.
Écrivez cette phrase que vous venez de me dire et gardez-la précieusement.
D’accord, c’est promis. Ce qui marque en découvrant votre parcours et votre pensée, c’est une forme de joie du savoir, pour ne pas dire de gai savoir.
Oui, c’est vrai, de gai savoir, de joli savoir, de joie d’échanger surtout !
Oui, et donc quelque chose de jubilatoire que vous transmettez. Alors que pour les plus jeunes générations, on peut avoir l’impression que l’on est face à un ciel sombre, orageux, avec un futur qui nous semble plein d’inquiétudes et de menaces qui sont bien réelles aussi, quelle serait la clé de cet optimisme ?
J’ai une vision positive du monde, pas une vision optimiste. J’essaye de montrer que chacun d’entre nous peut avoir une vision positive pour mieux construire son futur avec les autres.
Donc la clef, c’est de découvrir dans le futur l’énergie, la communication, l’éducation, les loisirs, tout ce qu’il y a de positif et l’échanger avec les autres, de manière à construire ensemble positivement des choses. C’est dans la construction positive que l’on crée en commun, on n’a pas envie de créer en commun si l’on crée des « saloperies », des choses dangereuses. Dans la création collective, on cherche du positif qui permet d’aller plus loin ensemble, dans un futur qui n’est pas subi, mais choisi, c’est assez différent.
Par rapport aux outils numériques dont on a parlé, peut-être que pour se retrouver les uns avec les autres, se reconnecter paradoxalement, on doit aussi réapprendre à se débrancher ?
Oui, c’est vrai, on doit réapprendre à se débrancher. J’avais fait un livre qui s’appelle Branchez-vous ! il y a quelques années, sur l’ordinateur moderne à la maison, le PC. Avec ma femme on avait écrit ce livre, mais aujourd’hui j’écrirais Débranchez-vous !, pour apprendre aux gens à se déconnecter, penser vraiment au fond des choses. Ne pas gagner du temps, parce que l’on ne peut pas gagner du temps, mais investir du temps pour créer un temps potentiel qui peut nous servir à d’autres choses.
Dans la description de la symbiotique que vous faites sur le long terme, de rapprochement entre ces technologies et la biologie humaine, comment peut-on se débrancher ? De quoi se débranche-t-on vraiment d’ailleurs ? Parce que le débranchement que l’on évoque là ne consiste pas à appuyer sur le bouton off d’une machine.
Cela sera pire, si j’ose dire, lorsque nous serons branchés symbiotiquement avec l’écosystème numérique comme des gens le proposent, comme Elon Musk avec sa neuralink. Je pense, c’est inéluctable, que l’on va vers une connexion directe du cerveau vers l’écosystème numérique. D’abord, la parole va jouer un rôle considérable, beaucoup plus qu’aujourd’hui : on va parler aux machines, mais directement de notre cerveau en communiquant avec elles. Dans vingt ans, trente ans, peut-être dans cinq ans, mais on y va, c’est sûr.
La grande question va donc être de savoir se débrancher quand on est branché mentalement. On sait déjà le faire lorsque l’on veut se débrancher de gens avec lesquels on est mentalement connectés, soit des gens de la famille, soit d’un amour que l’on a eu et que l’on a perdu. On va essayer d’oublier tous ces souvenirs, on essaye de se débrancher. Et là il va falloir apprendre à se débrancher lorsque l’on sera connecté mentalement avec l’écosystème numérique. J’essaye d’y réfléchir parce que je pense que c’est inéluctable, on va le faire dans les vingt ou trente prochaines années. Mais se débrancher mentalement sera très dur, comme se débrancher mentalement de gens qu’on aime.
On flirte avec la notion de résilience dans ce que vous dites. Avec des individus qui, en eux-mêmes, sont apaisés, dans l’approche de Boris Cyrulnik, et en même temps dans une société qui est capable de développer sa capacité d’adaptation face au risque.
Vous avez raison de les employer, les mots « résilience » et « sagesse » sont les mots-clés pour pouvoir envisager le futur. Je reprends cette phrase de Camus : « Créer c’est vivre deux fois ». En étant résiliant et sage, on peut créer sa vie et aider les autres à créer la leur.
A notamment publié :

Article
Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article
Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.
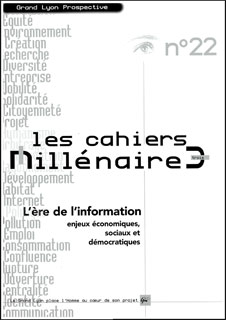
Étude
L'enjeu est de comprendre que si l'ère de l'information dans laquelle nous entrons est une donnée, forte, incontournable, qui s'impose à tous, ce sont bien les acteurs de la société qui inventent les usages.

Interview de Johann Rony et Olivier Carbonnel
Assistants de service social et psychologue
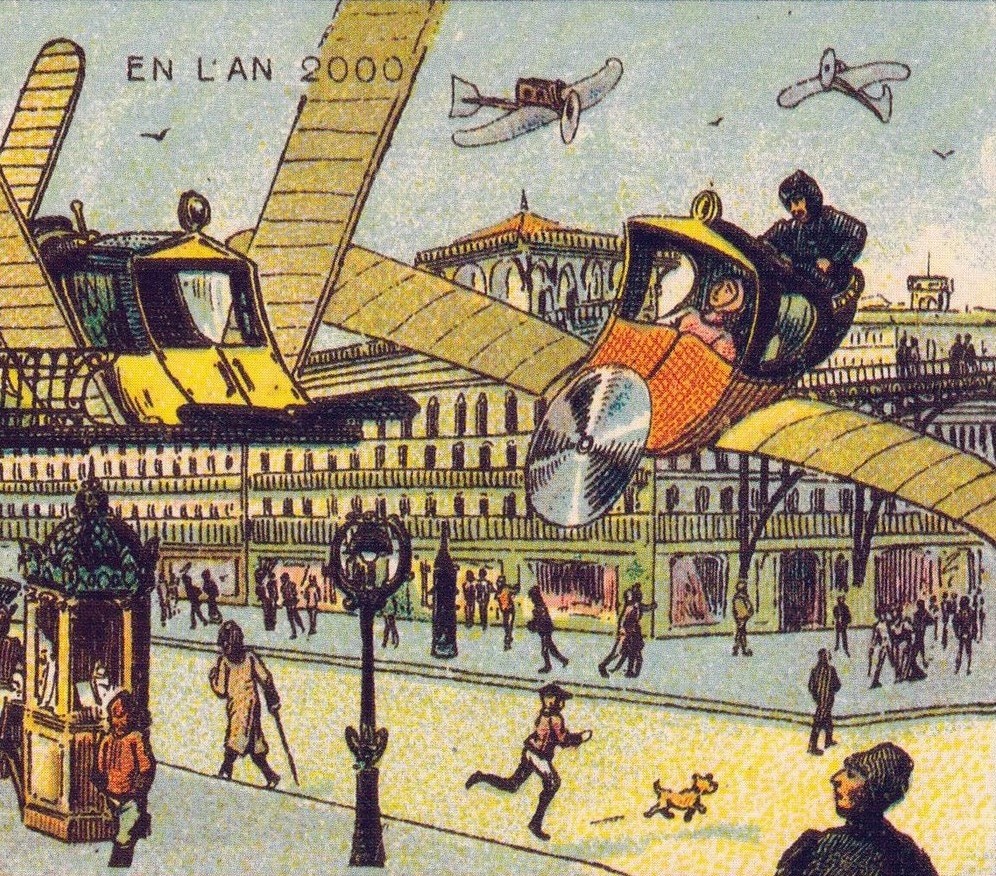
Article
Cet article propose dix « bascules » sur l’impact du numérique sur la ville, en comparant ce qui était perçu par le passé et la façon dont le numérique a effectivement transformé la ville.

Texte de Daniel KAPLAN
Les villes ont l’opportunité d'offrir de nouveaux agencements entre gouvernance, services, « communs » et pratiques collaboratives.

Étude
Des usages numériques toujours plus présents et indispensables au travail, mais aussi aliénants et nocifs pour la santé à long terme... Un regard de plus en plus exigeant posé sur la digitalisation du travail.

Étude
60 tendances pour questionner les exigences de l'organisation et le besoin d'harmonie au travail.
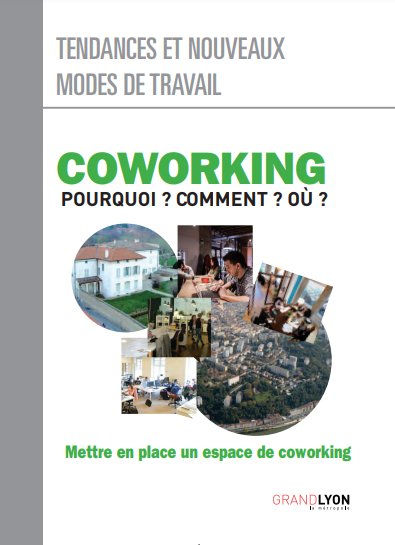
Étude
Ce guide a pour objectif de répondre aux questionnements des communes souhaitant ouvrir des espaces de coworking, et ce à toutes les étapes du processus.