Veille M3 / Quand les écrans s’illuminent, la ville s’éteint

Article
Si toute notre vie sociale tient dans un smartphone, à quoi bon profiter de sorties nocturnes ?


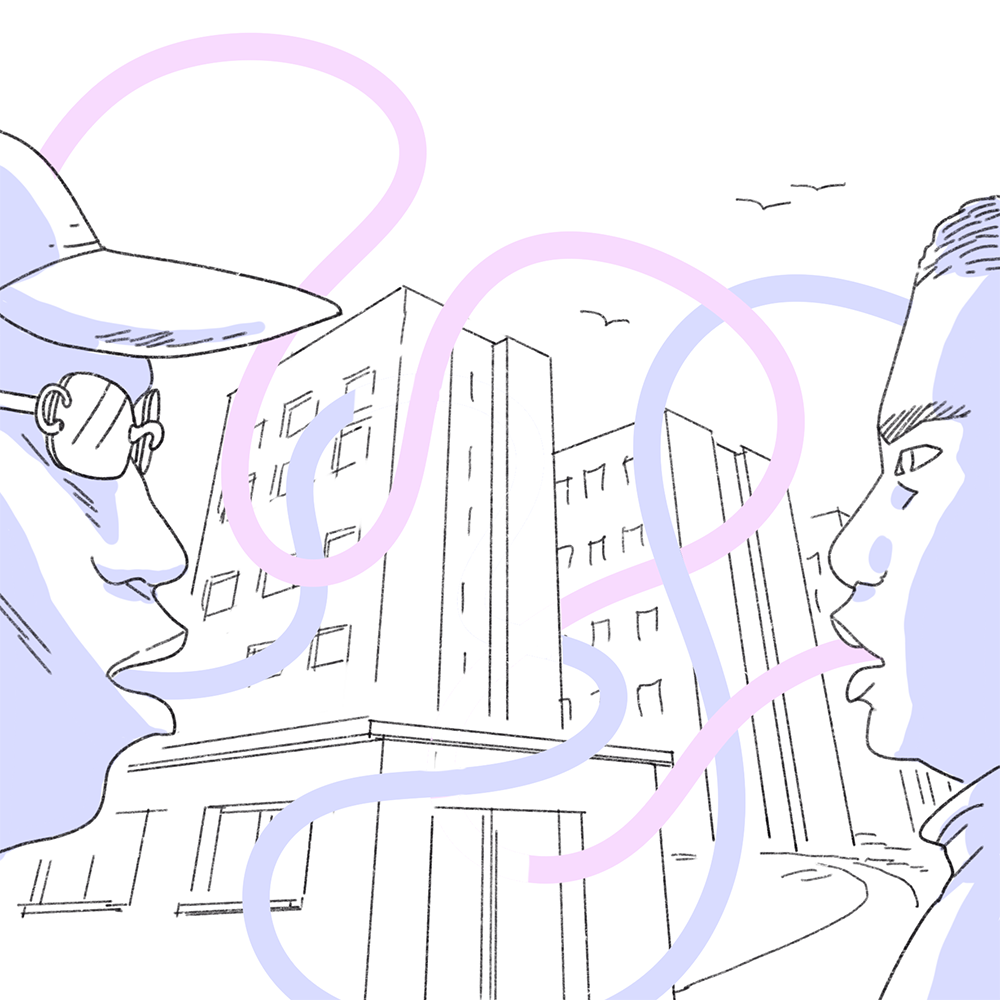
Article
Tag(s) :
« Leur attitude, langage verbal, une certitude : le style lyonnais c’est de la balle » (Pass Pass - Style Lyonnais - 1999)
L'arrivée en France du hip hop et du rap se fait par plusieurs canaux. Dès 1984, l’émission de télé « H.I.P H.O.P » est diffusée sur TF1 à une heure de grande écoute, et fait découvrir les éléments de cette culture au public français. Tout au long de l'émission, l’animateur Sydney réalise des pas de breakdance, en rappant sur fond de graffitis en guise de décor.
Toute une jeunesse se retrouve dans des lieux undergrounds pour organiser à leur tour les premières blocks parties françaises, inspirées de celles organisées notamment dans le Bronx. Une petite communauté de pratiquants, mêlant des jeunes de différents milieux sociaux et quartiers tentent de structurer cette culture, au-delà d’un effet de mode.
À Lyon, l’arrivée du hip hop coïncide avec un contexte de bouillonnement associatif, militant et culturel lié à la Marche pour l'Égalité et contre le Racisme. En 1983, aux Minguettes de Vénissieux, il y a déjà des danseurs hip hop et c’est la musique rap notamment qui accompagne ces événements. De cette effervescence émergent par exemple les précurseurs du collectif de danse Traction Avant, accompagnés par certaines institutions, ainsi que certains crews de graffiti, comme les TWA.
En parallèle, sur les pentes de la Croix-Rousse, le premier club dédié au Hip hop voit le jour, le Cool K, ouvert par un des premiers groupes de rap lyonnais, MCM90. Un de leurs morceaux apparaît sur Rapattitude, compilation emblématique de ce premier âge. Malgré des débuts prometteurs, avec DNC et le DJ Dee Rock, le rap reste à Lyon une pratique très confidentielle. Dans des quartiers populaires, des acteurs épars se connectent progressivement de manière affinitaire, voyagent pour digger des vinyles, des vêtements et des connaissances qu’ils importent à Lyon et dans ses environs.
À la fin des années 90, une dynamique porte un certain nombre de nouveaux crews dans la métropole lyonnaise. Bougnoul Smala, le collectif de beatmakers Gang du Lyonnais, les rappeurs Monsieur Zou ou Kesto, la rappeuse La gonz Viv, le fanzine Version 69 ou encore les groupe La Medina et Pass Pass tentent de se faire connaître à plus large échelle, malgré le retard pris sur les deux pôles du rap français, Paris et Marseille. De nombreuses mixtapes sont produites, et deux figures majeures, véritables porte-parole du rap lyonnais, mettent alors en lumière l’agglomération sur la scène nationale : Casus Belli et IPM.
Alors qu’IPM collabore avec Ärsenik, duo mythique du rap de l’époque, et créent le label La Lyonnaise des Flows, Casus Belli, avec son album Lyon, va connaître ses premiers succès commerciaux, faisant de l’identité et de l’argot lyonnais sa signature.
Ces projets ont connu un succès d’estime, mais les retombées restent modestes : Casus Belli exerce en parallèle son activité de professeur d’EPS malgré sa signature sur un label parisien influent, et IPM se séparent en 2005. Ainsi, le hip hop s’implante dans la métropole de Lyon dès les premiers pas de cette culture en France, mais la reconnaissance discrète de ses principaux acteurs à l’échelle nationale amène rapidement les activistes du mouvement lyonnais à penser que leur ville est maudite.
« Je vis pour mes srabs et mes srabs vivent pour moi » (Bougnoul Smala - 1999)
Dans le Lyon des années 90/2000, le hip hop reste une culture d’outsiders, en majorité issus des quartiers populaires. À cette époque, la découverte de la culture hip hop passe par une transmission entre initiés, associations et structures publiques de proximités. Thibault Akplogan, militant passionné du mouvement et organisateur d’événements, en témoigne :
«Fin des années 90 dans mon quartier, on voit déjà les grands qui rappent, mais c’est vers 2000 que j’ai rencontré Lucien Sezes et son groupe IPM. Leur album Galerie des Glaces et le morceau Mortel Poison ont déjà beaucoup tourné à l’époque, mais avant de le rencontrer, j’en ai pas connaissance. J’ai 16 ans et on fait un chantier jeune dans mon quartier. Y’a quelqu’un du centre social de la Ferrandière qui vient nous voir et nous dit : “Vous savez pourquoi vous bétonnez ce mur ? On va faire un festival et on va graffer dessus ce week-end". C’est la première année du Festival Espèces Urbaines organisé avec le centre social, les gars d’IPM mais aussi Bruno Abouzi (animateur), et Christophe, de la mairie. Plus tard, on a fait des ateliers d’écriture grâce à Lucien. Il a vraiment fait de la transmission, il nous a aidé à nous placer en tant qu'humains, il a été un modèle positif et pertinent pour nous. »
Grâce au bouche-à-oreille, T. Akplogan approfondi sa connaissance du rap lyonnais, expérimente des formes de socialisations et des modalités d’organisation collective dans son quartier, en rejoignant l’association Espèces Urbaines d’une part, et d’autre part avec son crew :
« À la même époque, je me suis retrouvé à être un peu manager d’un groupe de potes de mon quartier, Ravage. Je me disais manager, mais c’était avant de connaître le métier. On faisait partie d’un crew en fait. On essayait de faire ce qu’on pouvait, des conseils, des soutiens, on cotisait pour faire des t-shirts, on organisait des clips en allant rassembler des gens. On a tous creusé le rap ensemble, trouvé des premières parties, échangé avec d’autres artistes locaux, il y a eu toute une émulation. »
Le renforcement des liens entre pairs permet aussi d’aller à la rencontre de l’autre et ne signifie pas un repli. Ce renforcement des solidarités de proximité s’accompagne souvent d’échanges, de découvertes et de reconnaissance des autres territoires de la métropole.
« Pour moi, Lyon c’est typiquement une ville underground, les gens s’organisent dans l’ombre. Il y a toujours eu des gens qui font, qui ne sont pas reconnus pour, mais qui font. Il y avait des mini-studios partout dans les quartiers. Nous on faisait des missions pour aller dans tout Lyon, à Vénissieux, à Saint-Genis, à Saint-Fons. Il y avait vraiment une très forte identification par quartier. Chacun avait un peu sa petite star, les gens étaient très dans le local. Sans Internet, ça passait beaucoup par le bouche-à-oreille. Quand tu bougeais dans un autre quartier, tu faisais écouter la cassette ou “le skeud” de ton artiste du quartier. »
Ces crews et associations tentent par ce moyen de se donner le pouvoir d’agir dans une optique d’autonomie culturelle vis-à-vis de certaines institutions dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Si les liens avec les lieux associatifs et les MJC sont pourtant forts, les acteurs eux-mêmes tiennent à ces fonctionnements « alternatifs » :
« L'informel, c'est aussi l'expérimental, ça te permet d'exister de manière complète, d'exprimer des choses fines. Là où le formel va toujours te demander de passer par son prisme pour exister, alors que ça devient finalement plus dur d'exister tel quel. On n’est pas désorganisés, mais on a une autre manière de s’organiser, en créant nos propres référents. À cette époque, on se dit que les gens passent leur temps à essayer de devenir “formel”, et que du coup ils se coupent de la réalité de “l'informel”. On se retrouve avec des gens qui ont les moyens mais qui ne sont pas liés entre eux, et des gens qui font des choses mais qui ne sont pas liés aux moyens. Ça j'ai l'impression que ça agit beaucoup dans le rap lyonnais, peut-être même plus que dans le rap parisien. »
C’est d’ailleurs à la suite d’une prise de conscience de certaines inégalités dans la mise en place de l’action pour la jeunesse dans son quartier que T. Akplogan et ses proches décident d’organiser des événements par eux-mêmes :
« À la suite des émeutes de 2005, des subventions pour la jeunesse sont mises en place. On se rend compte que dans notre quartier, les subventions vont au club de basket, dont le président est aussi le directeur du bailleur social qui gère les immeubles où on habite. On a eu l’impression que l’argent qui devait aller pour les jeunes ne nous revenait pas vraiment. On s’est sentis utilisés et c’est là qu'on a voulu faire nos propres trucs, plus en lien avec les gens. Quelque chose de plus accessible. »
Forte de sa dimension underground, la production musicale et culturelle du hip hop à Lyon a permis de tisser des réseaux, d’autonomiser des individus et des structures. Cette proximité au sein de la culture hip hop, et le caractère encore marginal de cette musique, contribuent ainsi au renforcement d’un sentiment d’appartenances à la fois culturelle et territoriale d’une certaine jeunesse des quartiers populaires lyonnais.
« Jonage, Meyzieu, Décines, Rillieux
Pélos de la zone, délits majeurs et circuits périlleux »
«Peu importe pour quel secteur on opère,
C’est pour le courage de nos mères et la force de nos pères ».
(K’naï - 69 la Trik)
Le début des années 2000 voit le gangsta rap s'imposer dans la rue et sur les ondes. La thématique sécuritaire, en vogue dans les médias, et une certaine méconnaissance de cette culture, renforcent alors l’amalgame entre certains de ses codes et la banalisation de comportements délictuels.
De nombreux collectifs de rap lyonnais des années 2000 se démarquent alors du rap français « à l’ancienne », plus social, et embrassent cette tendance issue du rap américain. Cette nouvelle esthétique, particulièrement inspirée du cinéma, met en scène certains modes de vie et activités de l’économie parallèle. Il s’agit d’un rap qualifié de hardcore, où les paroles crues semblent faire l’éloge de l’argent facile, de l’utilisation des armes et/ou de la vente de drogue. La violence ressentie par les auditeurs non-initiés tient alors autant aux textes et aux beats plus électroniques qu’aux clips montrant des jeunes en bandes.
Des crews lyonnais, tels que 800 Industrie à Saint-Priest, 140 Gang à Rillieux-la-Pape ou le rappeur Sang Pleur du collectif D.Tenu, s’inscrivent dans ce style, au même titre que des artistes tels que Booba, LIM ou encore la Mafia K’1 Fry, pour ne citer qu’eux.
« Dans les années 2000, le rap en France c’était très sombre et encore plus à Lyon. Comme personne ne gagnait vraiment d’argent avec sa musique, c’était très lié à la rue, à la frustration aussi, et donc à la non-réussite. Y’a ce vrai truc de la ghettoïsation qu’on connaît. À partir du moment où tu vas t'identifier à une zone, tu vas te retrouver justement en concurrence avec les autres zones. Ça existe partout dans le monde, les gangs aux États-Unis c’est pareil, ils ont juste des armes en plus. C’est juste le truc de réunir des pauvres au même endroit qui finissent par se taper dessus. »
Dans le clip 69 La Trik, le rappeur K’naï se réapproprie au contraire les panneaux d’entrée des villes de la périphérie lyonnaise, et accentue dans son texte des traits de caractères « crapuleux » associés à chacun de ces quartiers. En filigrane de ce clip, chaque banlieue lyonnaise est représentée et mise en valeur, invitant les habitants à être fiers de la singularité de leur territoire.
À travers cette mise en récit des légendes urbaines locales, ce rap diffuse des mythologies et des références à même de produire un imaginaire propre à ces territoires. Mais ces textes ne sont-ils pas une manière de jouer avec les catégories auxquelles sont assignés leurs auteurs ?
« Tous les marqueurs étaient très clairs. On voyait qu’une musique comme le rap avait le même traitement que nous. Le rap, en centre-ville, on l’accueillait pas trop, c’était un truc étranger. Dans notre quartier, on nous mettait la tête dedans. Tous les rappeurs lyonnais disaient "On nous boycotte". Le plus dur c’est de se sentir boycotté dans sa propre ville. Quand on partait en ville, on était en bande et on voyait que quand on croisait les gens, ils étaient pas bien. On rentrait dans un bar, les gens n'étaient pas bien du tout, n'importe où ou tu rentrais en fait, les gens n’étaient pas bien. »
Comme l’explique le sociologue Erving Goffman, on « garde la face » lorsqu’ on a la possibilité de se présenter et de se définir devant l’autre. À l’inverse, lorsque l’autre nous définit sans que l’on ne puisse mot dire, on est alors stigmatisé. Le renversement de stigmate s’opère lorsque des individus se réapproprient les étiquettes qu’on leur impose, pour sortir des contraintes que l’autre exerce, et ainsi obtenir plus de liberté dans l'interaction.
Au-delà des considérations esthétiques, ce rap hardcore permet à une jeunesse issue de l’immigration et mise au ban de la réussite sociale de scander avec rage et en musique leurs volontés d’enrichissement, et leurs ancrages territoriaux. Ils transforment en musique les représentations auxquelles on les assigne, et construisent ainsi des représentations qui leur appartiennent.
Dans le clip Mecs de Villeurbanne de Ravage feat. Balir, tous les codes du rap hardcore sont présents à l’écran. Pourtant, comme nous le confie T. Akplogan, la réalisation de ce clip a permis concrètement la réunification de quartiers et d’individus jusque-là en conflits ouverts. Si l’esthétique du clip peut paraître violente pour l’auditeur non averti, il a autant contribué à un renforcement des liens entre des groupes de pairs isolés qu’au développement d’une fierté territoriale.
« Quand on a fait le clip Mecs de Villeurbanne, qui a bien tourné au final, des gens m’en parlent encore, on a pu rassembler des quartiers qui étaient en guerre. Nous, on connaissait les gens qui étaient en guerre, on savait pourquoi, on assistait du coup à des scènes de bagarres impressionnantes, et on a pu rassembler ces quartiers-là pour ce clip qui justement était unificateur. »
La prise en compte du rap comme vecteur d’appartenance et de socialisation a alors conduit des acteurs comme T. Akplogan à chercher à ouvrir cette musique à l’ensemble des Lyonnais.
« La majorité des concerts que je faisais avant dans ma jeunesse, des concerts de rap locaux, c'était avec 90 ou 95% d'hommes. Il y avait des open mics où ça partait en baston, j'ai déjà vu des armes sorties. Maintenant ça paraît impensable. Plus tard, quand j'ai voulu organiser des événements, c'était justement avec la volonté de rassembler les gens dans un autre cadre. On savait que le rap ne devait pas être juste une musique où on allait se rassembler entre gars de quartiers, c’était juste un truc humain en fait. Et une de mes grandes fiertés, c'est justement qu'on a toujours réussi à avoir plein de gens différents à nos concerts, venant de tous horizons. »
« Je me souviens à cette époque on était tous grillés, maintenant ils font toc-toc comme le pompier et son calendrier »
(Anton Serra feat. Lucio Bukowski - Les lions sont solitaires - 2014)
Assez tôt dans les années 2000, de nouvelles scènes indépendantes viennent disputer l’hégémonie du hardcore et élargir l’offre artistique du rap.
Dès 2003 à Lyon, le rap alternatif des Gourmets tisse des liens avec un univers électro et décalé. D’une autre manière, dans toute la région, des groupes comme le Chaos Clan, Dialekt, La Moza, La Cinquième Kolonne ou encore La Microfaune se revendiquent de sonorités à l’ancienne qu’ils réinventent.
Vers 2010, une nouvelle vague de rappeurs mêlent ces tendances alternatives et se saisissent des nouvelles techniques de productions, tant dans leurs musiques que dans leurs clips. Ils investissent massivement la plateforme YouTube et le réseau social Facebook, qui leur offrent des moyens de diffusion gratuits sur des canaux de plus en plus populaires. Le rap mainstream, porté par les majors et la radio nationale Skyrock, n’occupe plus seul les devants de la scène.
Des rappeurs déjà célèbres, tels qu’Oxmo Puccino, commencent à ouvrir leur esthétique pour toucher un public de plus en plus large. Des jeunes rappeurs connaissent un essor rapide, tel que Nekfeu et le collectif L’Entourage, ou encore Vald. T.Akplogan nous renseigne sur l’ouverture culturelle que représente cette période.
« C’était en même temps que l’avènement de Nekfeu, du groupe 1995, des Rap Contenders etc. vers 2012. J’ai vu beaucoup de trentenaires venir me voir et me dire “Ça fait 10 ans que j’avais coupé avec le rap parce que je me sentais plus légitime à travers les années, ça me concernait plus. Cette nouvelle génération, ça m’a remis dedans, ”. Cette époque vers 2012, c’est un tournant, il y un vrai truc social qui se joue. Ça a construit quelque chose d’assez sain dans l’ouverture. »
À Lyon, le collectif L’Animalerie connaît une ascension rapide et engrange des millions de vues en quelques mois grâce à leurs freestyles sur Internet. Autour du beatmaker Oster Lapwass, le collectif rassemble des rappeurs de banlieues et du centre-ville, de l’ancienne et de la nouvelle génération, et représente Lyon dans ce courant naissant. Ce collectif montre sur la toile de nombreuses vidéos qui mettent en scène la ville et présentent des spécificités culturelles à la fois ancrées dans la tradition, et ouvertes sur des formats contemporains.
L’écriture d’Anton Serra, membre du collectif, met ainsi à l’honneur dans le son Là Où un ancien parler lyonnais et décrit l’identité actuelle de la ville : « Ici c’est Lyon là où, ça pavarle en Javanavais tu compravend walavou, si t’es pava lyonnavais, t’as du mal avoue ! Là où les jeunes disent cher au lieu de trop, et pélo au lieu de type, et tamien au lieu de shit, là où on t’met la trick ! Là où on te la fait à l’envers sans verlan, c’est comme quand ton équipe de foot débarque à Gerland »
Le centre-ville aussi joue son rôle. Dans le sillage de Dj Duke, qui accompagne sur scène le groupe Assassin, de nouveaux crews organisent des événements (Panthers, Quartz Prod), qui regroupent acteurs locaux et figures du mouvement. Les émissions de radio Break Ya Neck, L’Antichambre, Art’ère ou Le Gros Tas De Zik, donnent une visibilité à la musique rap sur les ondes locales. Des concerts et open mics permettent à des collectifs indépendants naissants de se produire sur scène (La Mégafaune, Némésis Musique, DTL, Monde Collectif, etc.). De manière plus visible, l’Original Festival existant depuis 2004 gagne en ampleur, rendant ainsi visible cette effervescence via des événements à l’image du Street Day, qui rassemble plusieurs milliers de spectateurs sur la Place des Terreaux en 2010.
Vers 2014, le rap bascule définitivement vers le grand public. L’arrivée des plateformes de streaming lui offre de nouvelles perspectives, et l’importation de la trap music puis de la drill changent considérablement les beats et les flows, solidifiant les ponts préexistants avec l’électro. Enfin, l’arrivée de nouveaux outils de créations, notamment l’auto-tune, floute la limite entre rap et chant. Désenclavé, le rap passe du statut de culture underground à celui de tête de gondole de la culture pop.
À Lyon, ces trois phénomènes commencent à changer le statut de la scène locale. Cartographier cette propagation du rap à travers la métropole lyonnaise serait une entreprise pour le moins complexe, tant le nombre de nouveaux rappeurs et de nouveaux styles évolue chaque jour. Certaines figures sortent pourtant du lot et représentent la ville de Lyon, hors de ses murs, sur la toile et dans des festivals de premier plan.
Jorrdee, Lala &ce, les collectifs RTT Clan et LyonZon, ou encore Chilla et So La Lune (qui viennent de Lyon sans forcément s’en revendiquer) acquièrent des renommées à l’échelle nationale. Les beatmakers Phazz et King Doudou collaborent avec des artistes internationaux de renom, le rappeur de la Guillotière Tedax Max collabore avec Nike, et est invité à jouer un morceau sur la chaîne YouTube « Colors », à l’audience mondiale et à la programmation exigeante. Le rap lyonnais sort des quartiers, et crée autant de passerelles avec la variété qu’avec des artistes et des marques en vogue, intégrant progressivement le spectre de la culture « légitime ».
On retrouve désormais le rap dans des festivals grand public jusqu’alors réservés à d’autres styles musicaux. Ainsi, la rappeuse Lala &Ce, originaire de Bron, obtient par exemple une carte blanche au festival Nuits Sonores, alors que le beatmaker Phazz joue sur scène aux côtés du rappeur Orelsan dans les plus grands festivals internationaux. Désormais, la métropole lyonnaise met à l’honneur le rap dans des lieux d’envergure et ouvre pour la première fois les portes du Stade de Gerland à une programmation entièrement dédiée à ce genre musical lors du Festival Inversion en 2022.
Sur scène, aux côtés du chanteur Stromae ou des Black Eyed Peas, les 40 000 spectateurs du festival ont pu apprécier la performance de deux Lyonnais au succès inégalé jusque-là : Sasso et L’Allemand. Représentants les quartiers populaires du 3è arrondissement et des Minguettes à Vénissieux, ils montrent comment l’intégration du rap à la pop culture n'empêche pas de valoriser les racines populaires de cette musique. S’inspirant de codes du rap hardcore, ils le transforment en une pop urbaine et y intègrent des tonalités festives et entraînantes, accessibles au grand public. Ils incarnent un courant majeur du rap à l’heure des réseaux sociaux, comptabilisant des dizaines de millions de vues sur leur clip tout en restant fidèles à leurs quartiers d’origine. Dans cette lignée, des rappeurs de banlieues lyonnaises comme La F, Zeguerre ou encore Menace Santana, paraissent bien partis pour faire briller Lyon sur la carte du rap hexagonal.
Par ailleurs, à la suite de la disparition de DJ Duke en 2020 des soirées Duke heritage sont organisées. Celle du 20 janvier 2023 a réuni dans une salle comble des figures du rap lyonnais, français et international, telles que Yanbra, Dj Dee Nasty, Souffrance, Rockin’ Squat, Napoleon da legend, et témoignait de la reconnaissance d’un patrimoine rap lyonnais au-delà de la seule métropole.
C’est pour comprendre en quoi cette musique participe plus que jamais de la transmission et de la socialisation des jeunes habitants de la métropole que nous avons interviewé Malix, rappeur des Minguettes âgé de 16 ans.
« Maintenant les jeunes ils chantent encore plus fort que les Choristes » (L’Allemand – Minguettes)
Mehdi, alias Malix, découvre le rap dès son plus jeune âge dans son premier cercle de socialisation : la famille.
« Mes parents écoutaient IAM, NTM, Sexion d'Assaut… Enfin, beaucoup de rap ! Quand j’avais neuf ans, avec mes cousins, pour rigoler des fois on se mettait dans une pièce et de 13 heures à 20 heures, on mettait des instrus sur le portable, on écrivait des textes sur le papier et on enregistrait entre guillemets des albums ! Je sais pas comment on faisait en vrai ! En une journée on faisait peut-être 10 sons ! »
Aujourd'hui le rap a acquis une légitimité culturelle telle qu’il s’est fait une place jusque dans les écoles :
« La première fois où je me suis exposé, à assumer que je faisais du rap et à le montrer à mes potes, ça devait être en 5ème ! Je m’en rappelle, on était en cours de musique et le prof faisait un atelier dans lequel on devait écrire un son. Personne ne savait que je rappais. Tous les autres rigolaient en groupe, mais moi j'étais resté seul au fond, dans ma bulle en train d'écrire ! Après je m'en souviens, j'étais passé au tableau, je l’avais fait et ils étaient tous choqués ! Il y avait une prof qui m’avait pris à part elle m'avait dit “Je te crois pas, c'est pas toi qui l'a écrit !”. Elle me disait ça, ça m'avait marqué. Parce que quand on me dit ça en fait, je me rends compte que s'ils ne me pensent pas capables de faire ça. C’est que justement j’ai réussi à les épater. »
Pour Malix et pour beaucoup de jeunes de sa génération, il reste néanmoins important de gagner sa légitimité dans son premier cercle. Si l’objectif est de diffuser sa musique au plus grand nombre, le premier échelon du rap reste le quartier.
« Dans mon quartier à Lénine-Corcières, il y a toujours eu des clips. Plein de clips, plein de rappeurs qui venaient ! Ou même des fois genre de ma fenêtre je regardais, il y avait une voiture en bas avec plein de grands, ils mettaient du son à fond, ils rappaient. Je me suis toujours dit ça : il faut d’abord se faire valider par sa famille, son entourage. Ensuite par ses amis, ensuite par son quartier, ensuite par la plus grande ville ! Enfin on monte les échelles ! Et le jour où justement les plus grands m'ont dit “Bah viens rapper avec nous”, là j'ai senti que j'avais passé un cap. »
La reconnaissance des pairs et le bouche-à-oreille sont toujours les moteurs d’une transmission et d’un apprentissage efficaces. Ainsi, sa rencontre avec des « grands de son quartier » lui permet d’accéder à des studios, et certains proches l’aident à intégrer le dispositif d’accompagnement artistique de la salle de concert Bizarre, à Vénissieux. Il y suit un cycle d’ateliers d’écriture avec le rappeur et beatmaker Raistlin, découvre de nouvelles techniques et sort ses premiers clips, notamment Eren Jäger. La référence à ce manga témoigne de la capacité du rap à s’inspirer de toutes les cultures, à détourner les codes, et à retourner les stigmates pour en tirer de la force.
« Eren Jäger, c’est le personnage principal dans le manga SNK, L’Attaque des Titans. Il y a 2000 ans, des titans sont venus attaquer son village et ils ont tout détruit. Eren s'est promis un truc, d'exterminer tous les titans, de se venger ! Et quelques saisons plus tard, on le voit justement revenir en mode énervé pour de vrai, pour se venger. Et moi aussi j’ai envie de me venger, enfin de prendre ma revanche sur la vie tout court. Financièrement on n’a pas toujours été bien et y'a pleins de trucs comme ça. Se venger, ça serait peut-être réussir dans le rap. Ça, ça peut apporter plein de choses ! De la fierté aux miens, être bien. »
Comme par le passé, sur le modèle des samples qui mélangeaient influences et héritages, le rap se nourrit donc de références variées, procède par identifications et emprunts. Mais jamais hors-sol, il permet toujours de mettre en lumière des réalités de territoires invisibilisés et en marge.
« Le rap c'est aussi ça hein ! Dire ce qu'on voit, ce qu'on vit, les bonnes choses du quartier, les mauvaises… Je suis obligé de parler de ce qui se passe même s'il y a de la violence, etc. Ça fait partie du jeu. Je peux autant te parler d'un truc bon que d'un truc mauvais. Je dois parler de tout, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Et du coup je parle de ce que je vois, ce que je vis, du quotidien de mon quartier. »
Pour cette génération, l’idée d’une malédiction du rap lyonnais reste à l’esprit, mais l’espoir en l’avenir n’en est pas affecté. Et si le rap reste une passion, il peut également être envisagé comme un travail sérieux, qui demande de l’apprentissage, de la persévérance et de l’application.
« Un jour, Lyon ça va bien monter aussi ! Et puis nous à Vénissieux, on a L'Allemand. Franchement il représente bien la ville. En tant que Vénissian, je peux être fier de lui. En plus, il n’y a pas longtemps, il a sorti un projet en commun avec Sasso, et franchement je suis fier d’eux. Là actuellement, je ne me vois pas comme un rappeur. Je vois plutôt le rap comme un entraînement. J'écris pleins de textes, je fais des clips pour voir ce que ça fait, mais c'est un entraînement. Là où je pense que je prendrai le rap au sérieux pour de vrai, c'est après le Bac. Si je fais un album, je veux être focus sur le truc ! S’il faut faire huit séminaires, je le ferai ! Je veux vraiment le travailler, je veux vraiment être dans le truc si je sors un album. »
Pour Malix comme pour bien d'autres, cette musique accompagne des étapes de vie autant individuelles que collectives.
« Déjà, le rap ça me permet de découvrir d'autres personnes. Et je sais que moi par exemple, j'arrivais pas trop à parler, à me confier. Et du coup souvent je rappais pour dire ce que je pensais, pour dire ce que j'avais sur le cœur. Ça m'a aidé à communiquer. Ça aide beaucoup, même pour la confiance en soi. Avant j'avais pas vraiment confiance en moi, mais grâce au rap, je peux dire que j'ai pris confiance ! Franchement le rap ça m'a beaucoup aidé. »
Lorsque nous l’avons rencontré, Malix allait participer à son premier concert, dans le cadre du dispositif d’accompagnement artistique qu’il avait intégré. À ses côtés sur scène, un rappeur de 35 ans originaire de Vaulx-en-Velin, un ami d’enfance des Minguettes, un jeune du 8è arrondissement en apprentissage pour travailler dans la mode, un rappeur de Givors ayant déjà plusieurs scènes à son actif, ainsi qu’un producteur/rappeur/chanteur de Marcy-l’Étoile de presque 30 ans. Tous se retrouvent alors réunis autour de références musicales et culturelles communes, de manière de danser ensemble sur scène et d’interpréter collectivement des œuvres qu’ils ont créées individuellement.
Si le rap est devenu aujourd’hui un carrefour au cœur de la vie culturelle, il n’en reste donc pas moins un accélérateur puissant de socialisation. Valorisant les ancrages territoriaux et sociaux, il continue à permettre la rencontre de l’autre, de la métropole et ses habitants jusqu’à l’ensemble des afficionados d’un genre musical aux contours de plus en plus flous, car de plus en plus étendus.
À Lyon depuis plus de 30 ans, le rap et la métropole se structurent en parallèle, reflétant une identité collective encore en construction. Des Grand-Lyonnais de tous âges s'habillent, parlent et agissent avec des codes et des références liés à des clips, des textes et des punchlines. À l’échelle locale comme sur la toile, le rap participe ainsi aux appartenances territoriales d’hier et d'aujourd'hui : la vie des Grand-Lyonnais nourrit le rap, et le rap nourrit la vie des Grand-Lyonnais.
Apprécié désormais au-delà du seul cadre des initiés, cette musique conserve sa dimension ésotérique, dans laquelle les spécificités vernaculaires occupent une place de choix, renforçant la complicité avec le premier cercle, les proches, celles et ceux qui savent, mais sans exclure les plus curieux qui chercheront à décrypter les références à un environnement qui leur reste étranger.
Autant aux abords du lycée Saint-Just du 5è arrondissement de Lyon que du lycée Jacques Brel des Minguettes, sur les quais du Rhône et de la Saône, dans les oreilles des skateurs de la place Louis Pradel, sur les terrains de basket et de football, et même dans les magasins chics de la Presqu’île, le rap de Lyon a vocation à résonner toujours plus au-delà de ses frontières initiales. Globalement, le rap n’est donc plus à considérer comme le témoignage d’une forme d’enclavement.
Aujourd’hui, cette musique est devenue un socle large vers lequel convergent d’autres styles et références populaires, et son développement local s’avère indispensable aux ambitions de rayonnement culturel d’un territoire, en France comme ailleurs. Loin de toute malédiction, le rap du Grand Lyon n’a donc peut-être seulement pas fini de grandir, attendant plus ou moins tranquillement son heure, pour alors mieux rugir…

Article
Si toute notre vie sociale tient dans un smartphone, à quoi bon profiter de sorties nocturnes ?

Interview de Pierre Vidal-Naquet
Sociologue et chercheur au CERPE, associé au Centre Max Weber

Article
Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.

Article
Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

Interview de Lionel Arnaud
Professeur en sociologie à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et directeur adjoint du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP)

Interview de Claudia Palazzolo
Maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 et auteure

Interview de Michel Agier
anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et directeur d’études à l’EHESS.

Article
Comment incarner les « modes de vie » dans des situations du quotidien ? Cette fiche propose des éléments de définition, de tendance, de benchmark et liste des enjeux sur les liens entre modes de vie et façons d’habiter un territoire.

Interview de Frédérique Jacob
Maitresse de conférences en géographie à l'Université de Lille