Loi et éthique, un duo utile pour interpréter et faire évoluer le droit

Interview de Jean-Pierre Rosenczveig
Ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny
Interview de Pierre Vidal-Naquet

Pierre Vidal-Naquet est sociologue et chercheur au Centre d’Étude et de Recherches pour la Petite Enfance (CERPE), associé au Centre Max Weber, Lyon. Ses travaux portent sur la sociologie des risques, de la santé, du handicap et du travail social.
Il a joué un rôle clé dans la mise en place et l’animation des « ateliers éthique », expérimentés sur le territoire Vénissieux–Saint-Fons et que la Métropole de Lyon prévoit désormais d’étendre à d’autres territoires, en lien avec les objectifs du nouveau Projet métropolitain des solidarités (prévention de l’usure professionnelle, développement du pouvoir d’agir des agents et de l’attractivité des métiers…).
Dans cet entretien, Pierre Vidal-Naquet montre comment les repères que donnaient traditionnellement les politiques publiques à l’accompagnement social se sont brouillés depuis les années 70.
À rebours d’une approche descendante de l’éthique, il souligne l’importance de doter les organisations du travail d’espaces de régulation permettant de mutualiser l’inconfort que suscitent les situations d’accompagnement et la recherche des compromis acceptables.
On voit de plus en plus d’établissements du secteur social et médico-social se doter de « comités éthiques ». Sur le territoire de Vénissieux – Saint-Fons, la Métropole de Lyon a mis en place des « ateliers éthique » pour les agents des Maison de la Métropole de Lyon (MDML). Peut-on y voir la montée d’une « demande sociale d’éthique » ?
On observe effectivement une tendance en ce sens depuis le début des années 80. Dans le champ de la médecine d’abord, avec la création du Conseil Consultatif National d’Éthique en 1983, chargé d’identifier et de clarifier les questions éthiques posées par les avancées de la science et par les nouvelles demandes sociales liées à la procréation ou à la fin de vie par exemple. Les hôpitaux se sont dotés ensuite de comités éthiques en soutien aux équipes médicales.
Enfin, en ce qui concerne le travail social, la Haute Autorité de Santé a produit une recommandation en 2011, incitant les établissements sociaux et médico-sociaux à se doter à leur tour de comités éthiques. Donc, oui, il y a une demande sociale d’instances chargées d’instruire les dilemmes éthiques qui se posent dans notre société et en particulier dans le travail social et médico-social.
Cela dit, tous les comités ne fonctionnent pas sur le même modèle. Certains d’entre eux privilégient une approche descendante. C’est le cas dès lors que ces instances « disent l’éthique », comme on dirait le droit. Il faudrait consacrer une recherche spécifique à cette question pour l’affirmer sans risque de se tromper, mais j’ai l’impression que beaucoup de comités sont appréhendés comme cela. Personnellement, j’ai été plusieurs fois sollicité pour intervenir selon cette vision de l’éthique.
Il y a une seconde approche, plutôt ascendante, que nous avons tenté de développer avec mes collègues du collectif Métis, dans l’animation des ateliers éthique de Vénissieux–Saint-Fons. Nous sommes partis des situations de travail concrètes des agents, non pas pour y introduire de l’éthique ou pour la renforcer, mais au contraire, pour examiner quelles étaient les pratiques morales à l’œuvre dans des situations bien souvent dilemmatiques et complexes.
Dans le travail social et médico-social en effet, il n’y a pratiquement jamais de solution idéale. Les travailleurs sociaux le savent bien. Ils sont souvent amenés à emprunter la voie du « moindre mal », du « compromis », de la « moins mauvaise solution ». Ce faisant, ils s’éloignent plus ou moins de l’idéal, des grands principes, parfois même, du droit. Dans chaque situation, de nombreux paramètres — sociaux, économiques, humains etc. — sont, en effet, à intégrer pour prendre des décisions. Toute la question étant alors de savoir ce qui est acceptable ou ce qui ne l’est pas. C’est la raison pour laquelle il nous semble important qu’il y ait des instances où l’acceptabilité puisse être réfléchie, discutée.
Les ateliers éthiques seraient donc des instances de discussion et d’accompagnement des pratiques, plutôt que d’énonciation et de prescription de l’éthique ?
Oui, c’est l’une des raisons pour lesquelles, nous avons choisi de ne pas mettre de « s » à « éthique » dans « ateliers éthique » : pour souligner que ce ne sont pas des ateliers qui ont vocation à produire de nouvelles normes, des « bonnes pratiques » qui fonctionneraient dans toutes les situations. Leur intérêt, c’est plutôt de fonctionner comme des espaces de régulation. Cela dit, ce genre de régulation pourrait très bien emprunter d’autres voies que celle des ateliers.
L’éthique se glisse dans le quotidien du travail social et d’une certaine manière, il ne devrait pas y avoir besoin d’espaces dédiés pour en parler. Mais dans la vie réelle, il n’y a souvent pas de temps pour considérer les situations avec recul, il faut faire vite, prendre des décisions…
Il y a une ambiguïté sur la nature de la réponse à apporter aux dilemmes éthiques auxquels sont exposés les travailleurs sociaux : dans un cas, on est sur une demande de prescription, dans l’autre, sur une demande d’espaces de régulation. Mais il y a malgré tout une demande. Est-ce que cela veut dire que le travail social et médico-social d’aujourd’hui est davantage confronté à des dilemmes éthiques que par le passé ?
Je ne le pense pas. En revanche, il me semble qu’au cours du XXe siècle, ces dilemmes ont changé de nature et de modes de traitement. Pour le dire en quelques mots, les travailleurs sociaux sont de plus en plus amenés aujourd’hui à mobiliser leur éthique personnelle pour résoudre certains dilemmes, faute de pouvoir s’adosser à la morale de l’État Providence.
Cette morale sociale, qui émerge à la fin du XIXe siècle, tend à s’opposer à la morale compassionnelle de l’Église. Selon cette dernière, l’assistance dépendait essentiellement de la subjectivité du donateur, de la « générosité capricieuse des philanthropes », « de l’arbitraire des commissions administratives » et abaissait ainsi la dignité du bénéficiaire, selon Édouard Grinda, l’un des promoteurs des assurances sociales.
La morale de la société assurantielle qui est portée par la IIIe République est tout autre. Elle vise la justice sociale et l’égalisation des conditions, ceci grâce à la mutualisation des risques et à une redistribution des droits à ceux qui — parce qu’ils ont contribué à quelque titre que ce soit — peuvent entrer dans la catégorie des ayants droit. Ce faisant, les bénéficiaires ne dépendent plus de la subjectivité des donateurs. Ils ont des droits. Certes, les plus démunis sont encore assistés, mais l’objectif de l’État social est malgré tout d’en finir avec l’assistance grâce à la généralisation des droits sociaux.
Après la Seconde Guerre mondiale, un tel projet semble réalisable grâce au travail et au plein emploi. Dans ce contexte, l’activité des travailleurs sociaux consiste à aider les bénéficiaires à accéder à leurs droits et à s’assurer que ceux-ci entrent bien dans la catégorie des ayants droit. Dans ce contexte, les dilemmes éthiques proviennent en grande partie de l’inadéquation entre les droits sociaux et les situations vécues. Sauf exception, les travailleurs sociaux n’ont pas à mobiliser leur éthique personnelle pour tenter de résoudre les dilemmes.
La société assurantielle, telle qu’elle s’est édifiée au cours du XXe siècle, est fortement ébranlée à partir des années 70. Depuis la fin des années 80, il y a même un retour vers une logique assistancielle avec un certain nombre de dispositifs comme le RMI, la CMU qui — au départ au moins — ne s’inscrivaient pas dans une logique catégorielle ou contractuelle. Cela alimente la critique de l’assistanat, et ce d’autant plus qu’on fait reposer le financement de ces dispositifs sur l’impôt, pour ne pas alourdir le coût du travail par les cotisations sociales…
Ce qui vient ébranler la société assurantielle, c’est la conjonction d’un ensemble de tendances : la crise économique et de l’emploi, la désinstitutionnalisation de la famille, qui bat en brèche l’idée selon laquelle on pourrait sécuriser chacun en ouvrant des droits au travailleur, chef de famille, la crise climatique qui amplifie les flux migratoires… Tout cela joue. Mais, en tant que sociologue, ce que je trouve encore plus inédit, c’est la très forte accentuation des phénomènes d’individualisation et de différenciation sociales auxquels on assiste depuis les années 70 du siècle dernier.
Cette « individualisation du social », c’est l’aspiration à s’affirmer comme individu libre et autonome ?
L’individualisation du social est un phénomène ancien : Norbert Elias le fait remonter au Moyen Âge. Mais, à partir du dernier quart du XXe siècle, les avancées technologiques (révolution des transports, révolution numérique, progrès de la médecine…) font qu’on a des moyens comme jamais de faire advenir cette société d’individus, qui cadre bien avec la société néo-libérale. Cela va de pair avec un changement de paradigme au niveau des droits humains : on ne va plus simplement décréter que « les gens sont libres ». La liberté devient pratiquement une obligation.
La liberté individuelle est désormais placée très très haut dans la hiérarchie des normes. À tous les niveaux : dans la famille, au travail, en termes de genre, et même dans les politiques sociales, avec la philosophie de l’empowerment, qui enjoint à soutenir et promouvoir les capacités de l’individu, à les développer, les responsabiliser…
Comment cette individualisation du social transforme-t-elle le travail social et médico-social ?
Le travail social a un rôle de régulation, dans une société où ce qui jusque-là « tenait ensemble » — le travail, la famille, les syndicats, les partis politiques — joue de moins en moins ce rôle. Il intègre progressivement les droits humains, avec une tension permanente entre d’une part le travail de protection et d’attribution des droits, qui vise à réduire les inégalités, à améliorer les conditions de vie des gens et d’autre part l’attention qui est portée au consentement, à l’adhésion, à la participation, aux projets individuels, professionnels, de formation, résidentiels des usagers, etc.
De nouveaux dilemmes se font jour. Il ne s’agit plus seulement de faire accéder les usagers à leurs droits. Il s’agit aussi de les soutenir dans leurs propres projets, y compris lorsque les personnes semblent aller à l’encontre de leurs intérêts, que ce soit à court, moyen ou long terme. L’approche catégorielle devient ici insuffisante puisque, en raison de leurs projets, les usagers d’une même catégorie peuvent ne pas bénéficier des mêmes droits ni du même traitement. La perspective de l’équité tend à se substituer à celle de l’égalité.
Est-ce que c’est plus difficile qu’avant ? Je dirais non, c’est différent. Il y a toujours eu des problèmes, des difficultés. Mais il me semble quand même que le cadrage dans lequel étaient les travailleurs sociaux pendant la période des 30 glorieuses était un peu plus fort qu’aujourd’hui. Les balises morales ne sont plus cadrées par les institutions, et deviennent de plus en plus une affaire privée. Elles relèvent de l’éthique personnelle de chacun.
Est-ce que la sociologie peut être une ressource pour le travail social et médico-social, face à ce manque de cadre ?
En sociologie, traditionnellement, on cherche les régularités, les récurrences… Aujourd’hui, on a beaucoup de mal à les trouver en raison de l’effacement des catégories, ou du moins de leur flexibilité. Il convient néanmoins d’agir malgré la complexité du réel. On a alors besoin, comme le dit le pragmatiste Hans Vaihinger, de « faire comme si », mais ajoute-t-il « Il faut toujours bien garder à l’esprit qu’on est dans le “comme si” », jamais dans la “réalité vraie” ». Selon cette épistémologie, la sociologie n’a pas pour but de dévoiler la vérité, mais plutôt de poser des hypothèses et d’avancer avec prudence. D’où encore, la nécessité d’échanger, de débattre, de discuter.
Les ateliers éthique qu’on a animés à Vénissieux s’inscrivent un peu dans cette philosophie pragmatiste. Ce sont des espaces de régulation, qui doivent soutenir la pratique « prudentielle » des travailleurs sociaux et médico-sociaux qui peuvent proposer certaines solutions pour répondre à certains dilemmes, mais sans en faire une vérité pouvant convenir à n’importe quelle situation.
C’est essentiel qu’il y ait dans les organisations des espaces comme cela. Je me demande quand même si pour instruire les questions complexes que pose aujourd’hui le travail social et médico-social, il ne faut pas aussi remonter plus haut dans les organisations du travail. Les « situations de travail impossibles » auxquelles doivent faire face les professionnels de terrain renvoient aussi aux injonctions contradictoires des politiques sociales…
Oui, le principe d’inconditionnalité, qui s’est développé depuis une dizaine ou une quinzaine d’années, en est un bon exemple. La norme d’inconditionnalité, c’est l’idée que le besoin suffit à ouvrir un droit à l’aide, sans autre condition préalable. D’un côté, on a ce mouvement d’inconditionnalité, et d’un autre, on a le développement des politiques d’accompagnement qui sont fondées sur la responsabilisation, la réciprocité contractuelle… C’est assez paradoxal, et ça donne des situations difficilement gérables.
Dans le champ de la santé mentale, par exemple, on a longtemps pensé qu’il fallait d’abord soigner les gens pour les rendre « insérables » dans la cité. Depuis une dizaine d’années, un autre paradigme émerge, comme par exemple le programme Un chez soi d’abord : selon ce programme, l’attribution d’un logement est un préalable à partir duquel le bénéficiaire, sous réserve d’être accompagné, peut s’engager dans le soin. Le principe de l’inconditionnalité est ici appliqué au logement. Bien entendu, en pratique, cela donne souvent des situations délicates.
À Lyon, le dispositif Un chez soi d’abord héberge une centaine de personnes. L’équipe passe pas mal de temps à gérer les problèmes comme les conflits de voisinage par exemple. Il ne faut pas s’en étonner. Cela est inhérent à leur travail, car si les personnes n’ont pas de problèmes de santé mentale suffisamment sévères, elles ne sont pas admises dans le dispositif.
Si elles en ont, il y a beaucoup de chances que leur présence perturbe l’environnement, car elles peuvent faire du bruit, ne gèrent pas toujours leur logement selon les normes en vigueur, éventuellement ne payent pas leur loyer… Ce qui peut poser des questions extrêmement difficiles à l’équipe : est-ce qu’il faut rénover les appartements tous les ans, même s’il y a toutes les chances qu’ils soient très vite détériorés à nouveau ? Est-ce qu’il faut éduquer les personnes qui sont dans le dispositif pour qu’ils deviennent de « bons » voisins ? Quel compromis trouve-t-on entre le respect de la liberté individuelle des personnes, leur responsabilisation, leur protection ?
Est-ce que les comités éthiques peuvent devenir un instrument pour que les directions pensent avec les professionnels les tensions du travail social et médico-social ?
Je n’ai pas de réponse définitive à cette question, mais j’ai accompagné le comité éthique d’un Ehpad. Il était à la fois composé de membres de la direction et de professionnels de terrain. À un moment donné, ce comité a été interpellé par la situation d’un résident : un homme, assez âgé, un prêtre, faisait en permanence des fausses routes, au risque de s’étouffer.
Le médecin lui avait proposé la solution d’une alimentation entérale — par le nez — mais il l’avait refusé, et comme de surcroît, c’était quelqu’un de très bon vivant, il recevait des amis qui lui amenaient tout un tas de bonnes choses à manger — du saucisson, des huîtres… Il détestait le « mixé ». Résultat : le personnel devait l’emmener régulièrement en catastrophe à l’hôpital, au bord de l’asphyxie. Le comité éthique disait : c’est déjà difficile de recruter, on ne peut pas faire vivre ça au personnel, ils n’en peuvent plus, il y en a qui vont dans les toilettes pour pleurer, et puis, le problème c’est qu’ils se focalisent sur cette personne, au détriment des autres usagers, etc. Et donc je leur ai dit : « Votre problème, c’est qu’il y a plusieurs régimes d’intervention qui se croisent dans l’Ehpad ».
Il y a le régime biomédical : les médecins savent ce qu’il faut faire — l’alimentation entérale, le mixé… — bref, on a la réponse bénéfices-risques côté médical. Il y a le régime des libertés individuelles : aujourd’hui, on est dans un contexte où on ne peut pas imposer à qui que ce soit telle ou telle thérapeutique. Il y a le régime de la justice sociale, c’est-à-dire qu’effectivement dans un Ehpad, on n’accompagne pas une seule personne, mais on gère le collectif des résidents ce qui pose la question des ressources — ici les ressources humaines — qui doivent être réparties de façon équitable entre les résidents.
Enfin, depuis le début des années 2000, il y a la prise en compte des risques psychosociaux : l’établissement a la responsabilité de se préoccuper de la santé au travail du personnel. Il doit prendre en compte les traumatismes pouvant être vécus par le personnel, dans les situations que je viens de décrire. Ces quatre régimes sont incommensurables entre eux, c’est-à-dire qu’on ne peut pas privilégier l’un au détriment des autres. Il n’y a pas de bonne solution. Voilà le genre de dilemme qui ne saurait être cadré de façon claire par de grands principes éthiques et qui méritent d’être mis sur la table pour être mutualisés, discutés.
Est-ce qu’on pourrait imaginer d’autres dispositifs pour accompagner le management dans la régulation de ces quatre régimes ?
Ce serait intéressant d’organiser des ateliers éthiques dédiés aux responsables. On peut penser que c’est en prenant conscience de la profondeur des dilemmes du quotidien, que chacun s’équipe véritablement d’une capacité d’écoute du travail des autres.
À la Métropole de Lyon, on a proposé de tels ateliers, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. Je sais que cela se fait dans d’autres structures. Un de mes collègues travaille actuellement avec un groupe de directeurs de MJC. C’est très intéressant. Peut-être n’avons-nous pas suffisamment insisté pour développer ce genre d’instances en direction des responsables.
Les ateliers de Vénissieux–Saint-Fons étaient suivis par un comité de pilotage. Peut-être aurions-nous pu proposer d’en faire une instance éthique, mais on était avant tout préoccupés par la bonne marche des ateliers éthique avec les agents.
Vous avez été confrontés aux dilemmes de votre propre activité ?
Exactement ! Il n’y a pas que dans les Ehpad qu’il y a plusieurs régimes qui se croisent : notre activité de sociologues aussi est traversée par des dilemmes. Bricoler, tâtonner, c’est une gymnastique à laquelle chacun est contraint : professionnels de terrain, décideurs, sociologues… C’est pour cela que les comités éthiques qui prétendent « dire le bien » se retrouvent dans des impasses. En matière d’éthique, personne ne peut jamais prétendre avoir le dernier mot !

Interview de Jean-Pierre Rosenczveig
Ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny

Étude
Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant

Interview de Nawel Bab-Hamed
Chargée d'études sociologiques, culture & modes de vie à l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise (UrbaLyon)

Article
La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
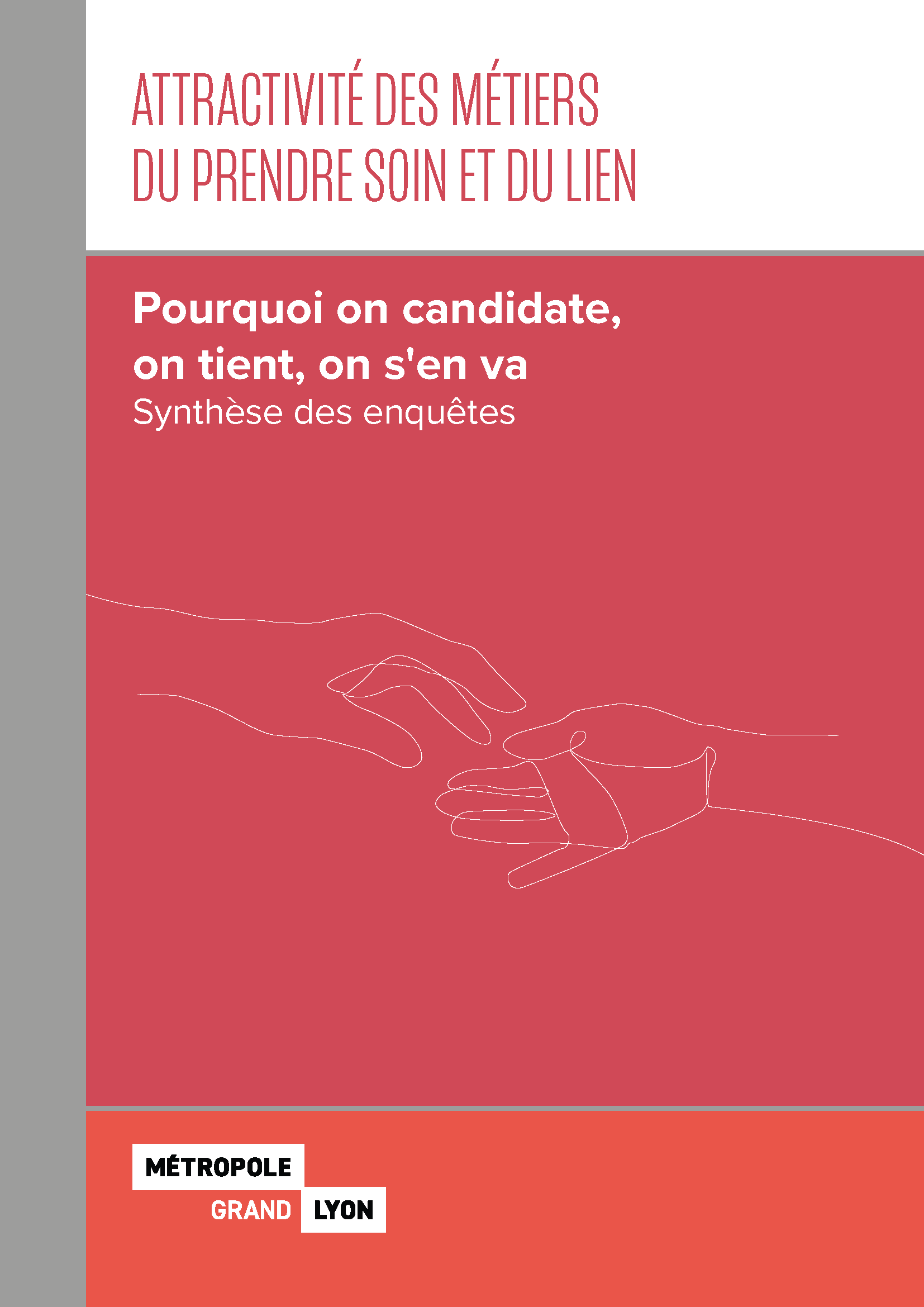
Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.
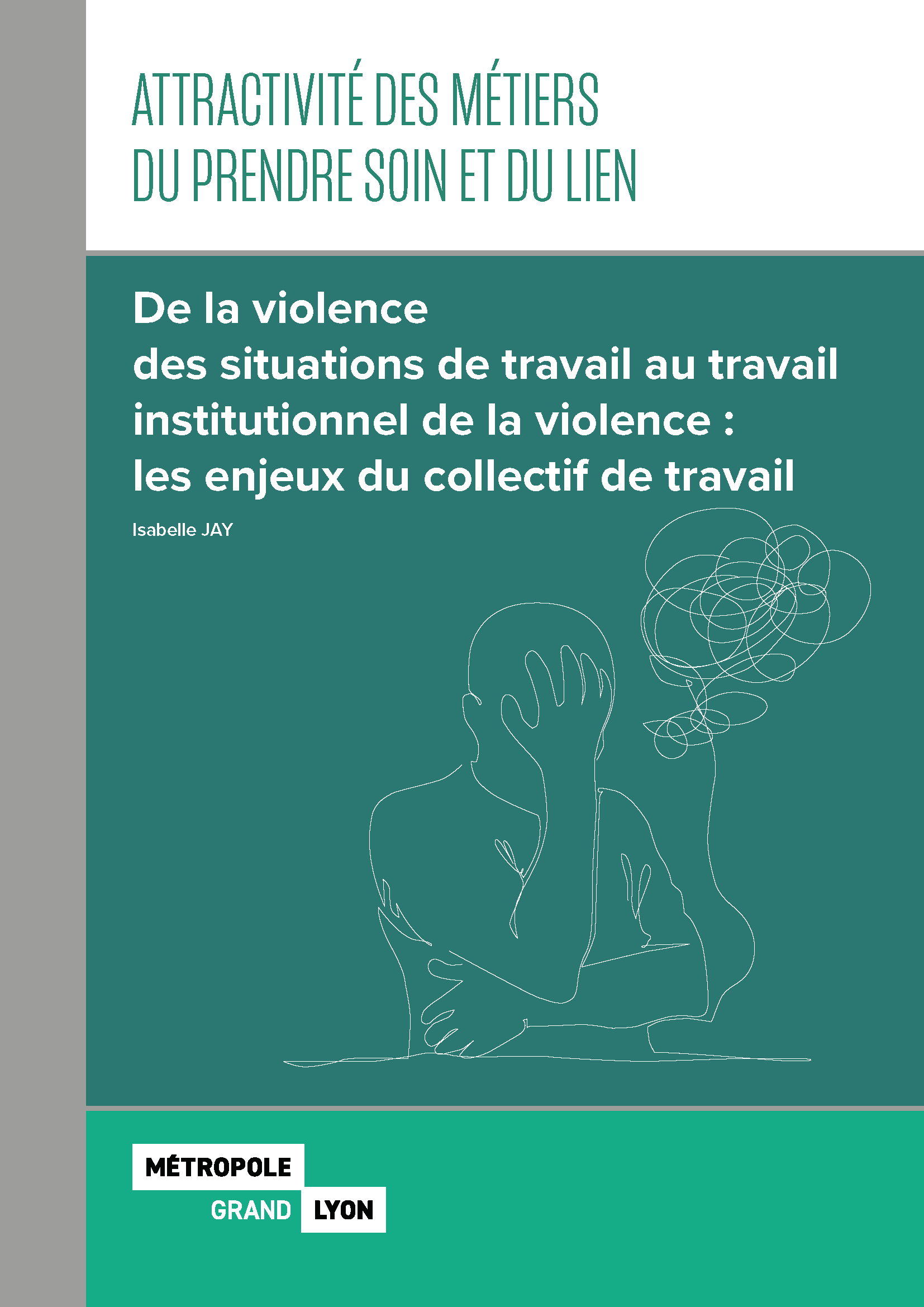
Étude
Lorsque les contraintes ne permettent plus aux professionnels de surmonter les aléas, quelle place donnée à l’autonomie et au collectif de travail pour affronter les difficultés ?

Article
Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?
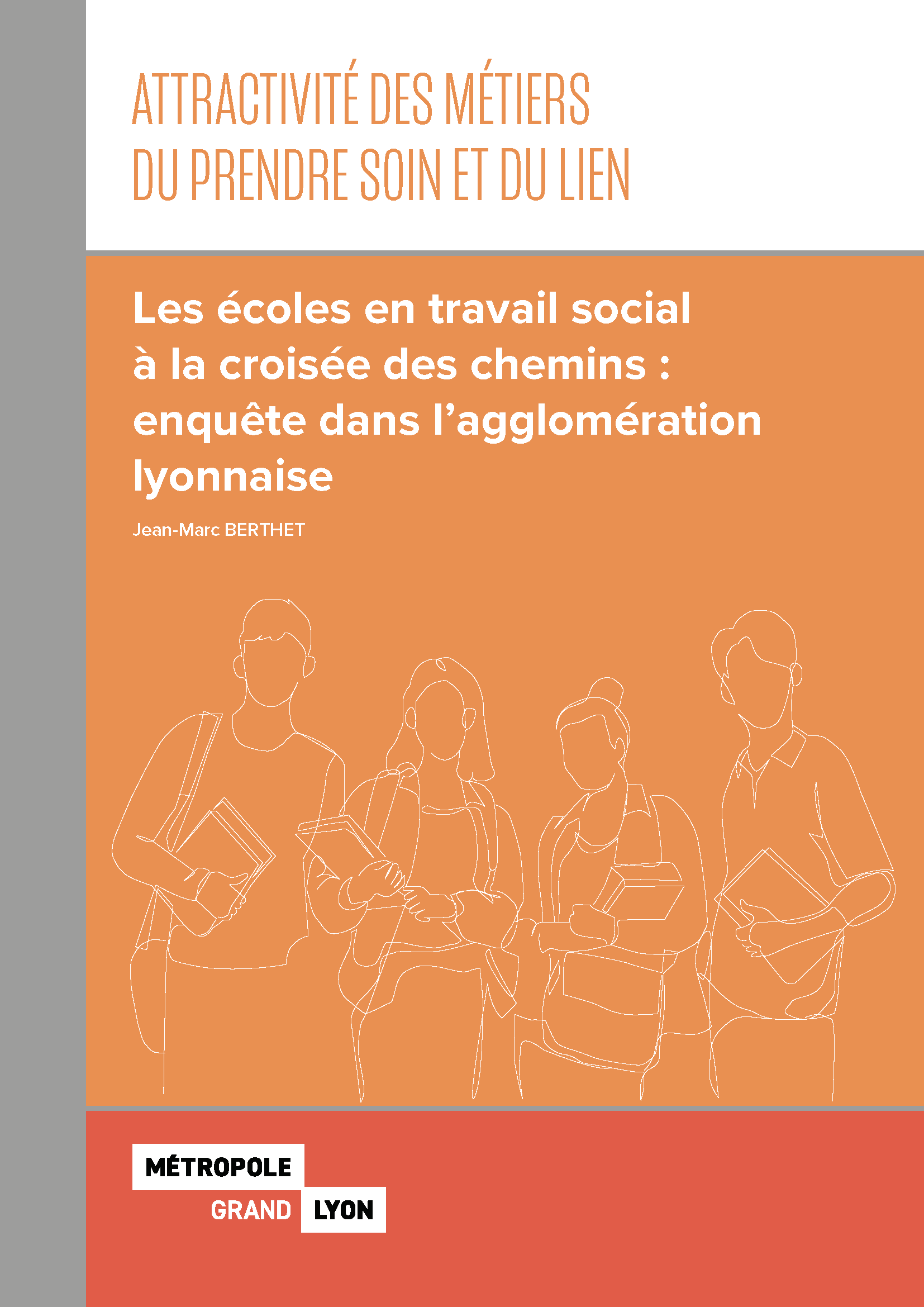
Étude
Les travailleurs sociaux diplômés ne sont plus au centre du paysage dans la mesure où de nombreuses autres personnes exercent des métiers dans le social sans forcément être titulaires d'un des diplômes.