Isabelle Baraud-Serfaty : « L’espace public est potentiellement l’espace le plus résilient dans la ville »

Interview de Isabelle Baraud-Serfaty
Fondatrice d'Ibicity
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Patrick Penot
Après de longs mois d’arrêt, le secteur des arts vivants tente de redémarrer, malgré la tourmente d’une deuxième vague de pandémie.
Patrick Penot, infatigable animateur culturel de la région lyonnaise, décrypte une situation où chaque jour, la tragédie suit son cours.
Pour débuter cet échange, pouvez-vous s’il vous plaît nous faire un point sur la situation actuelle, en ce début d’automne ?
Depuis la fin du confinement, nombre de dossiers n’ont toujours pas trouvé de solution. La situation de la Culture en général, et du spectacle vivant en particulier, est toujours aussi précaire et laisse tout le secteur dans une incertitude inconfortable et anxiogène.
Tout cela provoque des multitudes de débats un peu stériles, où s’affrontent les volontaristes de tout poil qui trépignent et veulent reprendre l’activité à tout prix, le plus tôt possible, et ceux qui tentent de convaincre de la nécessité de profiter du ralentissement général pour « inventer le monde d’après ». En vérité, peu de choses changent, car c’est le virus qui a le dernier mot ! Chacun espère donc simplement reprendre son activité, et retrouver son public, comme avant. Mais plus le temps passe et plus celui-ci sera dur à convaincre de retrouver les salles de spectacles.
Je doute, pour ma part, que la reprise sans crainte - donc sans mesures sanitaires de protection - puisse avoir lieu avant le printemps 2021, tant l'épidémie est encore présente dans de nombreux pays. Ça fragiliserait encore plus tous les projets internationaux : sur les 20 spectacles prévus pour l’édition prochaine du festival Sens interdits, neuf créations sont pour l’instant à l’arrêt faute de répétitions possibles au Chili, au Brésil ou en Russie…
Quelles conséquences peut-on envisager, et de quelle façon peuvent-elles être amorties ?
À court terme, c’est carrément un tsunami, dont on ne mesure pas encore toutes les dimensions. Le premier effet de la crise actuelle, c’est un report systématique des engagements pris par les programmateurs. Les premières victimes sont les artistes et les techniciens. C’est d’une violence inouïe pour le monde de l’intermittence. On ne se rend pas compte à quel point ce secteur est totalement à l’arrêt.
Concernant Sens interdits, qui est une biennale, la dernière édition avait eu lieu en octobre dernier. En 2020, nous n’avons pas de festival, nous n’aurions pas dû être touchés. On l’a pourtant été, parce que pour vivre entre deux éditions, nous organisons des tournées de spectacles que nous estimons n’avoir pas été assez vus lors de ces évènements.
Concrètement, on lançait à la mi-mars la tournée d’un spectacle burkinabé, Les Sans, qui avait déjà été joué une quinzaine de fois en aval et en amont du festival. On avait mis sur pied une tournée de 21 dates dans la Drôme, en Ardèche, et dans la métropole. Dès le lendemain de la première, le 13 mars, c’était terminé. Il a fallu les « exfiltrer » avant que les lignes aériennes et les frontières ne soient fermées. On s’est retrouvé avec des frais à payer, mais pas de spectacle. L’État a demandé à tous les Centres Dramatiques Nationaux de respecter les contrats, mêmes si les représentations étaient annulées, ce qui nous a permis de payer les artistes.
Ça, c’était la situation du début de crise. Mais petit à petit, on a vu que les dates de reprise d’activité reculaient, que les festivals estivaux tombaient les uns après les autres. Très logiquement, les théâtres ont modifié leur programmation 2020/21 pour intégrer des spectacles annulés du printemps dernier. Ainsi la Biennale Bime, portée par le Centre National de Création Musicale Grame, est morte le 13 mars, jour même de son inauguration, mais plus de la moitié de sa programmation a pu être reportée tout au long de la saison 2020/2021. Partout sont annoncés les reports d’une bonne partie des spectacles annulés depuis mars sur l’automne 2020 et le printemps 2021. Pour y parvenir, il a donc fallu décaler à l’automne 2021 les spectacles initialement prévus à la rentrée 2020 !
Hélas, le sinistre jeu des chaises musicales s’aggrave chaque jour. La deuxième vague, tellement redoutée, est en train de perturber violemment l’ensemble de l’activité du spectacle vivant, en limitant les jauges, en imposant des contraintes peu séduisantes pour un public rendu anxieux, en annulant nombre de festivals et de tournées, et en interdisant les déplacements internationaux.
L’incertitude est partout, et nombreux sont les professionnels qui n’osent plus croire à une activité normale avant septembre 2021. Bien sûr, nul n’est en mesure d’évaluer les dégâts dans une profession aussi durement éprouvée, mais chacun a conscience que les victimes risquent d’être nombreuses, surtout du côté des jeunes fraîchement sortis des Conservatoires et des Écoles d’art.
La situation est très liée à la globalisation, elle-même au cœur des problématiques du changement climatique. À l'avenir, un spectacle vivant « durable » devra-t-il consentir à certains sacrifices, notamment au niveau des déplacements ?
Prenons l’exemple du Centre national chorégraphique de Créteil, dirigé par Mourad Merzouki : les tournées internationales représentent les trois quarts de son activité de diffusion, or les voyages internationaux ne sont plus possibles depuis mars. Donc les danseurs ne dansent pas, le CCN n’a pas de recettes, et à l‘étranger il n’y a ni indemnisation ni report pour les spectacles annulés.
Pour Sens interdits, je vois bien que prononcer le mot « international », dans un monde où les frontières sont fermées et où les compagnies aériennes sont menacées de faillite, c’est presque insulter l’avenir. On commence à nous dire qu’il y a d’autres priorités que de faire venir des artistes étrangers. Je crois pourtant que le spectacle vivant ne peut pas se développer sainement dans une France et une Europe repliées sur elles-mêmes et refusant la rencontre. La respiration, l’air du large et la nécessaire confrontation à des esthétiques, des cultures, des savoir-faire et des langues différentes sont des éléments essentiels à la construction des esprits.
Mais il est évident que l’on devra modifier des habitudes et des comportements. J’ai connu des collègues qui se gardaient bien de dire qu’ils allaient inviter untel ou untel, parce qu’ils voulaient être les seuls et surtout les premiers à inviter un artiste. Celui-ci repartait donc immédiatement après deux représentations. C’est de l’orgueil mal placé, mais c’est surtout un coût écologique absurde et une frustration pour l’artiste.
Quand on découvre un artiste, ce qui est intéressant, c’est de vendre l’idée d’une tournée en amont ou en aval des dates lyonnaises. Ainsi, lors de la dernière édition, deux spectacles mexicains, un polonais et un burkinabé ont tourné en France et en Europe pour une cinquantaine de représentations. Avec ces tournées, leur notoriété a progressé comme leur chance d’être invités ultérieurement. Je crois qu’il ne faut pas se contenter du simple accueil d’un spectacle international, mais qu’il faut optimiser la présence des troupes en les envoyant dans les conservatoires, les lycées, les compagnies pour des rencontres, des ateliers, des master-classes... Avec l’espoir, à terme, de coproductions et d’échanges.
Dans ce contexte, quelle est la situation des plus jeunes, les nouveaux-entrants de la sphère artistique ?
Pour celles et ceux qui sortaient des écoles, qui viennent de créer leurs compagnies, qui avaient des projets pour lesquels il fallait d’abord être vus, encouragés, aidés, confortés, pour ceux-là, rendez-vous dans 2 ans, quand les autres seront passés. Ils viennent d’être diplômés, ils sont les futurs professionnels, acteurs, metteurs en scène, cinéastes. Tous ces gens arrivent sur un champ de ruines où l’immobilité sera la règle. Et que se passe-t-il pour ceux qui vont tenter de rentrer à l’Ensatt ? Une génération est en train d’être perdue, qu’on le veuille ou non.
Qu’est-ce qui va sortir de tout ça ? Certainement des choses extrêmement inventives. Mais il y a un principe de base, c’est que le spectacle vivant n’est vivant que s’il réunit des artistes et un public. Et ce n’est pas avec la vidéo qu’on va le faire. D’accord, on a pu, pendant le confinement, attendre et meubler des heures d’inactivités avec la diffusion de vidéos, mais que se passe-t-il dans un théâtre sous contraintes, avec distanciation et masques pour le public ? Les chiffres obtenus récemment des deux plus gros théâtres de la Métropole de Lyon situent approximativement le retour du public à 60% de fréquentation habituelle. Qu’en sera-t-il demain si les contraintes sont encore renforcées ?
Qu’en est-il alors de la situation des intermittents ?
Le principe d’une année blanche a été acté. Les intermittents du spectacle sont donc protégés jusqu’en août 2021, à la différence des précaires du bâtiment, de l’artisanat ou de l’agriculture, pour lesquels aucun programme de soutien n’est prévu. Cette disparité de traitement concerne également les travailleurs du secteur culturel qui, faute d’activités suffisantes et régulières, n’ont pas encore le statut d’intermittent. Cela risque d’être une source de tensions sociales, car comment peut-on rembourser un prêt ou payer un loyer alors qu’il n’y pas de salaire ?
Il y a toujours des gens pour dire qu’après tout, la crise va permettre de « changer l’eau de l’aquarium », et d’éliminer les « canards boiteux ». C’est une approche tout à fait inacceptable, car en dehors de la France, qui est le seul pays au monde à avoir mis en œuvre un plan de soutien aux artistes et aux techniciens du spectacle, la précarité est la règle, pour toutes les compagnies, structures et individus du monde entier travaillant dans le champs culturel. À part de timides reprises sous-conditions sanitaires, tout est à l’arrêt : répétitions, créations, diffusion locales et internationales… Or, nous sommes tous si interdépendants qu’une production avortée au Chili impactera forcément l’économie des théâtres et des festivals européens qui devaient l’accueillir, et limitera le recours aux intermittents. Bref, l’ensemble de la chaîne économique sera touchée.
On décrit de plus en plus dans le monde du travail un phénomène de professionnalisation hybride, à cheval sur différents métiers, dans différents secteurs. Est-ce que la précarisation en cours de certains artistes ou techniciens pourrait mener à ce type de restructuration, avec une scène artistique beaucoup plus protéiforme en matière de statuts ?
Oui, je le crois. Être intermittent, c’est bénéficier d’un statut administratif de gestion salariale. Ce n’est pas un métier. Il y a peut-être en France une facilité trop grande à s’autoproclamer acteur ou metteur en scène. « Je n’ai pas fait de conservatoire, ni d’école, mais je suis metteur en scène, je constitue un groupe, je crée une compagnie. » Rien n’empêche de le faire. Il suffit d’être reconnu par trois lieux d’accueil, petits ou grands, et au bout d’un moment, on a suffisamment d’heures, et on devient intermittent.
Il peut y avoir un coup de génie, mais la plupart du temps se sont des choses relativement médiocres. Ces projets nécessitent un regard extérieur précis, qui leur donne des conseils, corrige et élève leurs exigences. Devenir acteur, ça nécessite une formation de trois ans, et ce n’est pas parce que l’on a le diplôme que l’on est encore un bon acteur. Il y a une part de don, mais il y a surtout beaucoup de travail.
Je crois qu’on a perdu depuis très longtemps l’idée très noble d’un théâtre amateur respectable et reconnu. Je pense au parcours de Jean-Pierre Miquel, qui a dirigé la Comédie-Française mais qui est venu du théâtre amateur universitaire, qui était une grande tradition. Il n’y avait pas de honte à l’époque à ne pas être professionnel mais à être un bon « artisan » amateur du théâtre. Ça existait, il y avait tout un réseau.
Plein de gens de toutes conditions et de tous âges se réunissent et fondent un groupe théâtral. De temps en temps, ils louent ou se font prêter un lieu de représentation, et voilà. Ils sont payés au chapeau par exemple, et ça leur permet d’acheter des costumes pour un prochain spectacle à monter. Ça reste du travail amateur, mais ce sont des amateurs éclairés. Il existe tout un maillage de MJC et d’autres structures qui pourraient encadrer et soutenir plus fortement ces pratiques-là, et pas forcément avec beaucoup d’argent. Je pense que s’il y avait un développement intelligent de cette pratique amateur, on aurait moins d’engorgement dans le monde professionnel.
Par ailleurs, de plus en plus de projets intègrent dans un spectacle professionnel des témoins et/ou des acteurs de certaines situations sociales (ouvriers victimes de plans sociaux, migrants et demandeurs d’asiles…) formés ou non dans le cadre de pratiques amateurs, comme dans le spectacle Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu, du Groupe Nimis, que nous avions invité en 2015. Cela ne tient pas de l’utopie : il peut y avoir un dialogue très riche entre ces deux réalités, qui nourrit le théâtre actuel et lui évite de se considérer comme un ghetto assiégé, seul porteur de la vérité du monde.
Se dirige-t-on vers une restructuration globale et durable d’un écosystème des festivals particulièrement riche en France, avec une réduction du nombre d’évènements ?
Je ne pense pas. Il va y avoir forcément un appel d’air dans le tissu associatif, qui est extrêmement foisonnant en France, et qui permet, par du bénévolat et, très souvent, par des pratiques amateurs à l’origine, de créer un festival, puis de le développer et ensuite d’attirer des professionnels.
Dans de petits villages, sous prétexte d’une fête locale, un festival naît et accueille des artistes de théâtre de rue, des conteurs, des musiciens... Ces projets arrivent du territoire, du terrain et se professionnalisent petit à petit. Cette dynamique s’est développée lors des dernières décennies, dans le sillage de la Fête de la Musique, qui était une forme d’incitation. Le terreau existe, la demande est là, et elle est forte. Ces activités qui nécessitent le rapprochement entre un projet et un public, ça se passe sur un territoire, et les collectivités locales sont déterminantes à ce niveau, parce que cette animation répond à un besoin.
On connaît d’autres modèles, je pense à la lettre qu’avait publiée Matthias Langhoff. Il parle comme un ancien de l’Allemagne de l’Est, où l’organisation de la culture était étatique. Il y a cette tradition en Europe, de l’Allemagne jusqu’à la Russie. Les théâtres y sont des théâtres de troupe. On est dans la troupe, ou on n’est pas artiste. Il n’y a pas d’intermittents chez eux. On défend un théâtre qui ne circule pas, il est dans la ville. La troupe intègre ceux qui sortent des conservatoires, et qui, comme à l’Ena, sont choisis en fonction de leur rang de sortie. Les plus prestigieux sont dans la capitale, et les autres en province. On ne bouge plus, il y a de l’argent pour des créations, et on n’a pas une approche de rentabilité mais d’une culture de service public.
Il n’y a qu’en France et en Belgique, où existe un système assez proche de notre intermittence, où quand un metteur en scène décide de créer un spectacle, il fait son casting en allant chercher librement dans une offre extrêmement large les acteurs nécessaires. Il n’a pas une troupe à son service. Il recrute les acteurs pour la durée des répétitions et un nombre précis de représentations. À l’issue du contrat, chaque acteur est libre de s’engager sur un autre projet. Pour reprendre le spectacle un an après, le metteur en scène doit soit faire un nouveau casting, soit attendre que tous les acteurs de la création soient libres pour un nouveau contrat.
Matthias Langhoff pense à une structure dans laquelle le metteur en scène a tout pouvoir sur les acteurs de la troupe. Certes, il bénéficie d’un outil formidable, mais nous ne sommes pas du tout dans ce modèle-là en France, puisque la Comédie-Française est le seul théâtre de troupe. L'organisation territoriale du théâtre repose sur des centres de création (les CDN), des centres de diffusion (les Scènes nationales), ainsi que sur des festivals souvent adossés aux CDN, et tout cela doit s’interpénétrer dans un ensemble cohérent.
Les dispositifs mis en place par l’État ont été abondamment commentés, mais dans les faits, les collectivités ne sont-elles pas en première ligne pour résoudre l’équation d’une « résilience » des arts vivants ?
Sans aucun doute. 75 % des financements qui impulsent ou soutiennent la culture proviennent des collectivités locales. L’État est proportionnellement en recul, mais il reste l'indispensable garant d’une Culture de service public, notamment au moyen de l’attribution de labels. Qu’est-ce qu’un label ? Depuis trois ans, une loi fixe les règles communes que l’État impose à tout établissement labélisé de création ou de diffusion artistique (de toutes disciplines : théâtre, musique, danse, cirque, théâtre de rue…) en charge d’une mission publique. Sont ainsi recensées les conditions de recrutement des directions, la durée des mandats, le respect de la parité, de la diversité, le partage de l’outil, le travail de formation, de transmission… Il s’agit au fond d’un cahier des charges et d’un cadre déontologique. Les collectivités locales qui gèrent ou cofinancent des théâtres et des structures sans labels nationaux (théâtres de villes, musée locaux etc.) s’inspirent largement de ces règles, mais exercent leur responsabilité avec indépendance.
Pour trouver le juste équilibre au sein de ce système, le rôle des collectivités est essentiel. Je suis Président du conseil d’administration du Centre national chorégraphique de Créteil, que j’évoquais tout à l’heure. Trois tutelles sont présentes : l’État, la mairie de Créteil et le département de Seine-et-Marne. La commune, qui met à disposition des locaux et cofinance de façon importante l’établissement, est très attentive à l’animation de son territoire et au rayonnement national et international que lui assure le CCN. C’est elle qui donne vraiment l’impulsion. L’État veille à ce que tous les CCN de France proposent un même niveau d’exigence, alors que les demandes de la Ville de Créteil sont motivées par le souci qu’elle a de son territoire : « Qu’est-ce que vous faites avec les jeunes du petit conservatoire à rayonnement régional ? Qu’est-ce que vous faites dans tel et tel quartier ? Nous vous donnons des subsides pour faire un festival qui doit permettre l’intégration, la découverte, etc. » Les tutelles locales sont très préoccupées par ce qui se passe chez elles, évidemment.
Parfois, les tutelles décident de ne plus participer aux conseils d’administration, mais plutôt à des comités de suivi. Si elles s’entendent bien, ça donne quelque chose de très efficace, et ça oblige l’État à être beaucoup plus précis. C’est la force du territoire qui doit l’emporter, j’en suis persuadé.
Face à la crise, de nouvelles formes de solidarités émergent-elles au sein des sphères culturelles ?
Oui, on est tous très isolés, mais en même temps on ne s’est jamais autant parlé. Au printemps, il y a eu par exemple l’organisation d’une visio-conférence par l’Office National de Diffusion Artistique (Onda), association financée par le Ministère de la Culture, qui facilite la circulation des spectacles, parce que le grand défaut en danse, en musique, et particulièrement en théâtre, ce n’est pas le manque de créations, mais leur diffusion qui est trop faible.
D’après les chiffres 2018 du ministère, la moyenne du nombre de représentations pour une création théâtrale est de 3,5 et de 2,2 pour la chorégraphie. Cela signifie que de nombreux spectacles ne tourneront jamais. L’Onda a donc organisé cette réunion vidéo à la mi-avril pour évoquer la situation de huit projets de tournées de spectacles internationaux.
Nous étions concernés par un projet chilien que l’on m’a demandé de présenter. Il y a eu cent inscrits à cette réunion. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’apporter une aide à l’organisation de tournées dans un monde bloqué, et que l’on a besoin de partager les idées et de mutualiser. On s’est retrouvés avec des gens de Varsovie, de Belgique, d’Espagne, d’Italie. Ça a permis d’avancer énormément, même si chacun sait que ce travail risque de rester virtuel. Nous avons présenté le projet d’une grosse tournée, d’une troupe chilienne mapuche, qui devrait tourner en octobre et novembre 2021. Mais qui sait où en sera le monde en 2021 ? Alors on espère, et on continue d’inventer l’avenir. C’est en train de s’élargir, de s’organiser, même si c’est encore timide.
Le monde de « l'Après » mobilise dès aujourd'hui de nombreuses réflexions. Que peut-on attendre des artistes, et plus spécialement du théâtre, pour nourrir les débats à venir ?
Le théâtre a toujours existé, partout. C’est déjà le débat en puissance. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment il prend forme, dans quel but. On a un exemple très concret que certains Lyonnais ont pu suivre, dont je viens de parler.
En 2010, dans la Cordillère des Andes, je vais voir ce que l’on me présente comme un spectacle mapuche, un peuple indigène premier habitant d’un vaste territoire à cheval sur le Chili et l’Argentine. Et là, je découvre une jeune femme qui met en scène huit actrices amateurs. Elles sont très impressionnées, mais elles sont aussi impressionnantes. Elles sont là pour témoigner de l’existence d’une culture, de la fierté d’une langue, et des injustices auxquelles elles ont été confrontées. C’est très maladroit, mais c’est la première fois visiblement que ce peuple utilise le théâtre pour défendre sa culture. Ça m’intéresse et je les fais venir. Ceux qui les ont vues - c’était au TNG, à Vaise - me croisent dans la rue et me demandent encore « Comment vont les Mapuches ? ». C’était inoubliable ! C’était un spectacle très maladroit, mais ça frappait juste. Ces formes-là sont indispensables à découvrir.
Cette femme, Paula González Seguel, a maintenant presque 40 ans, et pendant 10 ans, elle a fait évoluer son théâtre, le KIMVN Teatro. Elle a réuni des ethnologues, des psychanalystes, des photographes, des vidéastes, des romanciers, et elle est devenue l’épicentre de la défense des droits des peuples premiers du Mexique jusqu’à la Terre de Feu. Son projet théâtral était largement dépassé, pour devenir social et politique.
Au fond, le théâtre est très politique. C’est ce que j’ai voulu dire d’ailleurs en créant Sens interdits, pour revenir à ce qu’a dû être cet art à sa création.
De quoi parle-t-on ? Un type vivant qui parle aux autres. Dès la préhistoire, on peut s’amuser à imaginer qu’il y en a un qui monte sur un rocher, dans la grotte et qui se met à dire « Demain, nous irons chasser, nous prendrons telle arme, etc. ». Ça, c’est un politique.
Si par contre, le lendemain, il y a en a un autre qui monte sur le rocher et qui dit « Vous vous rappelez hier, quand on a attrapé la girafe, et comment pendant ce temps-là, il se passait des choses graves de l’autre côté... », ça c’est un poète, et c’est du théâtre.
Il y aura toujours besoin d’être ensemble pour entendre quelqu’un de vivant qui pose une des réalités du monde sur le plateau. Et on la regarde, et on en débat, ou pas, en tout cas on repart avec des questions. Ça a toujours existé, et ça continuera. Il ne peut pas en être autrement.
Finalement, qu'est-ce qui nous manque, selon vous, lorsque l'on n'a plus accès aux arts vivants ?
C’est comme regarder une pièce en vidéo, même si la captation a été formidable. On fait ça dans son salon, avec une bière, un café ou un thé. On est face à des artistes, il y a une belle performance, on apprécie, on est bien, mais on est seul. Quand on est dans une salle, on ressent l’émotion globale, l’approbation ou la désapprobation des autres.
Si un spectacle a remporté l’adhésion, ou au contraire a provoqué quelque chose de très polémique, vous allez remarquer qu’au moment où tout le monde sort, les gens restent dans le hall et discutent. Sur le perron, dans la rue, ils continuent à discuter. Si le spectacle a été lourd, ou inquiétant, tout le monde part dans une espèce de silence. S’il est réussi, tout le monde se parle, a envie d’échanger, de comprendre ce qu’a ressenti l’autre.
Dans tous les cas, ça ne se vit pas impunément. Ne pas pouvoir vibrer ensemble, ça nous laisse un grand vide...
En attendant son retour, ne perdez pas de vue l’actualité du festival Sens Interdits !
Pour poursuivre vos lectures, retrouver ICI l’ensemble des articles #Covid-19

Interview de Isabelle Baraud-Serfaty
Fondatrice d'Ibicity

Interview de Emmanuelle Santelli
Sociologue

Interview de Patrick Penot
Directeur du festival Sens Interdits

Texte d'auteur
Face à la crise, Luc Gwiazdzinski appelle à une intelligence des temps et des mobilités.

Interview de Manon Loisel et Nicolas Rio
Consultants, Chercheurs et Maîtres de conférences en Science Politique

Étude
Cette synthèse des articles publiés pendant le confinement s'intéresse aux tendances émergentes et aux sujets mis à l’agenda des institutions publiques avec la crise du Covid-19.

Interview de Benjamin Lemoine et Edoardo Ferlazzo
Sociologue, socio-économiste

Interview de François de Jouvenel
Directeur de Futuribles

Interview de Jean-Michel Besnier
Philosophe

Interview de Marie-Caroline Missir, du réseau Canopé
Directrice générale du réseau Canopé
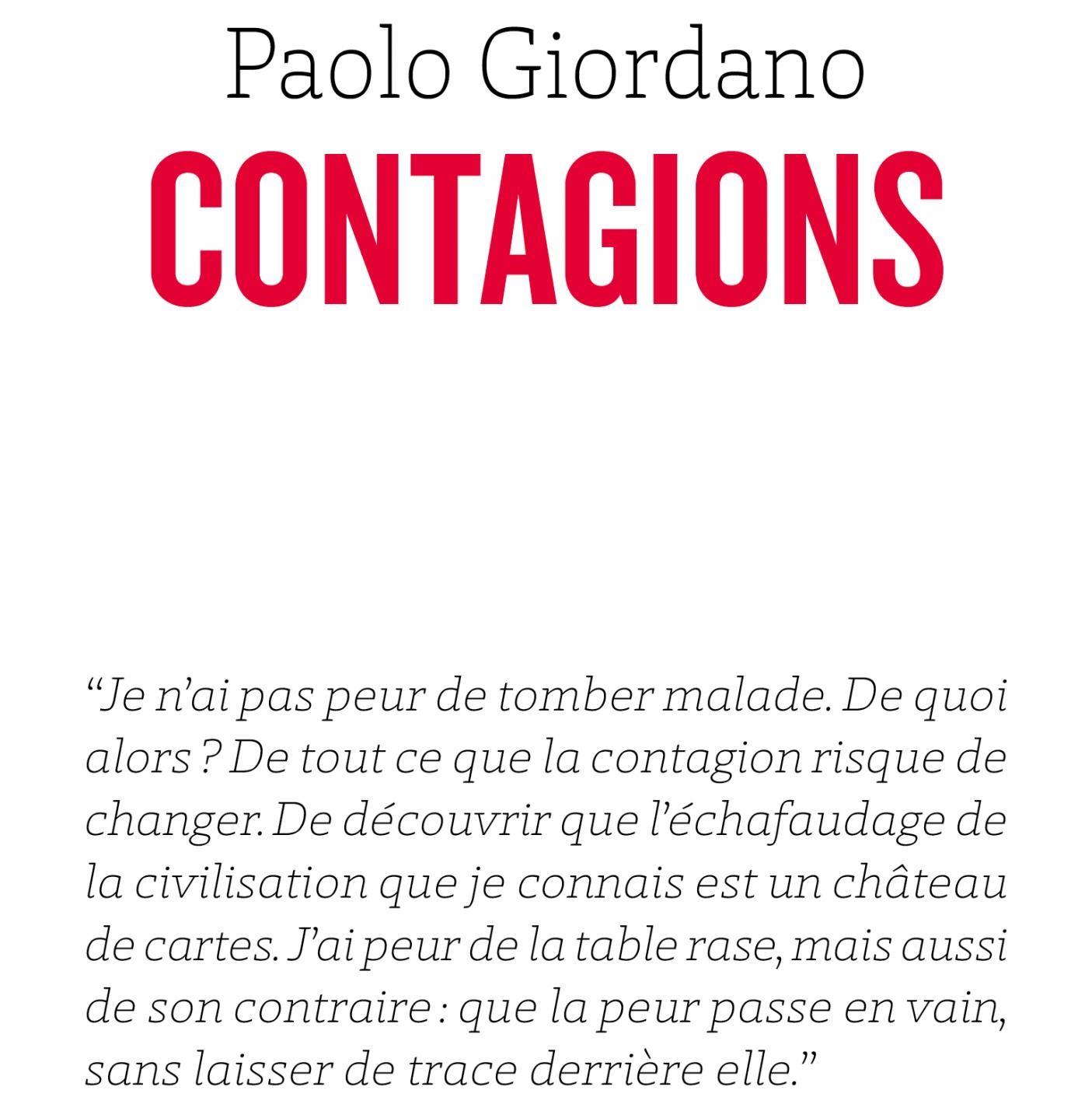
Article
Une réflexion simple mais profonde pour appréhender avec distance la crise actuelle et ce qu’elle dit de nous.

Article
Quelles sont les ressources mises à disposition des décideurs par l’Organisation mondiale de la Santé ?

La santé mentale est partout. Entre présentation d’impasses actuelles et évocation de pistes prometteuses, ce dossier vous propose un verre que vous pourrez juger à moitié vide ou à moitié plein.

Interview de Pascal Blanchard
Vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé, aux politiques des solidarités, du grand âge et du handicap.
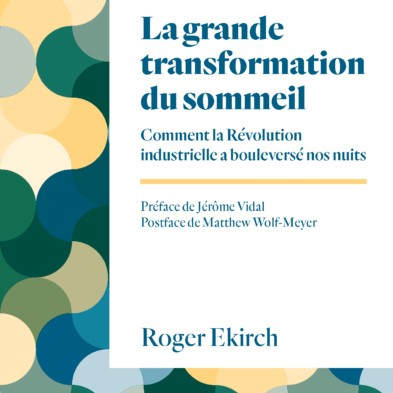
Article
Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?

Interview de Nina Sahraoui
post-doctorante au sein de l’équipe « Genre, Travail, Mobilités » du Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris

Article
Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Article
L’éco-anxiété : pathologie mentale ou réaction normale face à une majorité dans le déni ?

Article
À quelles ressources avons-nous renoncé en stigmatisant les comportements de celles et ceux qui défient notre idéal d’équilibre et de raison ?