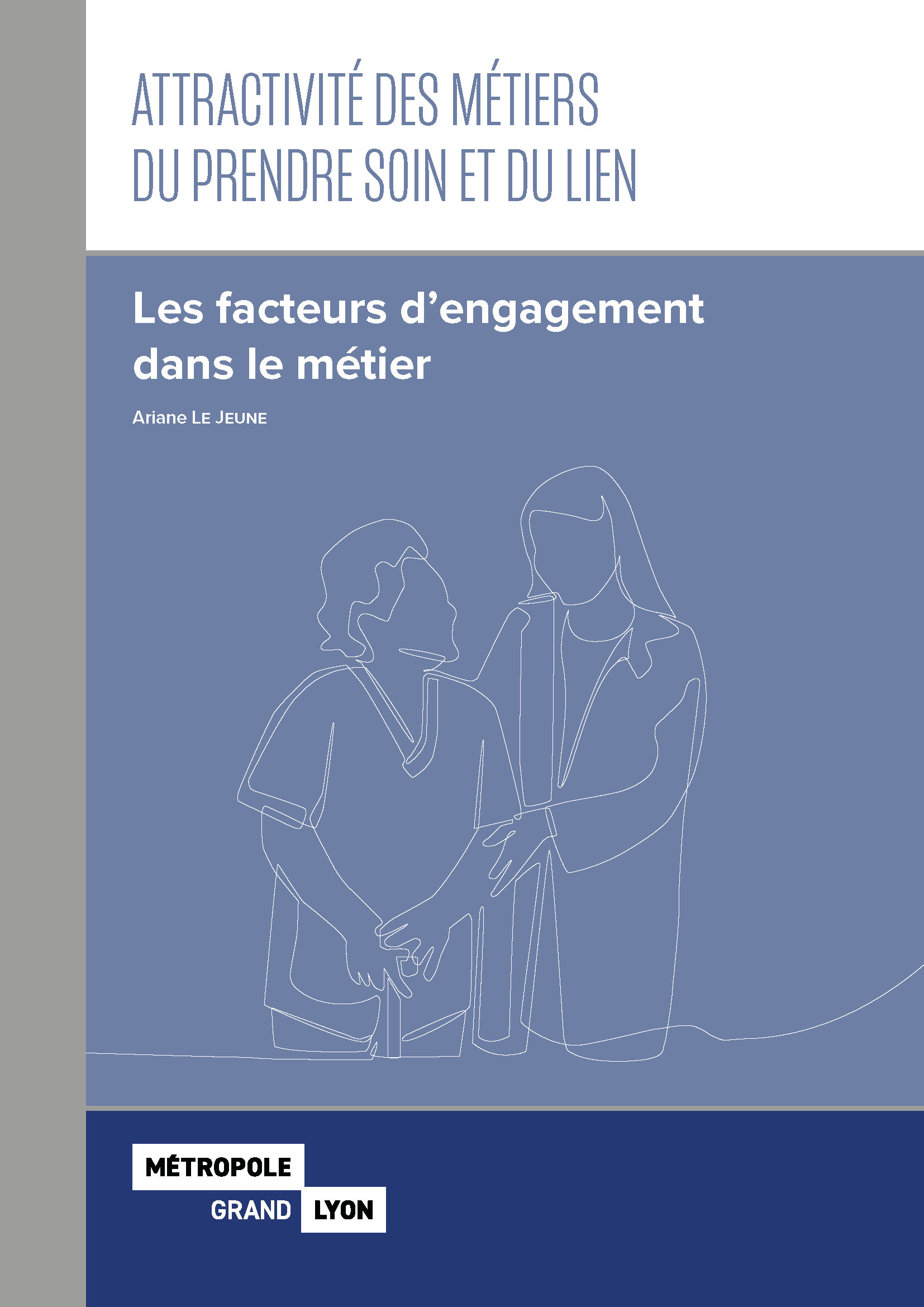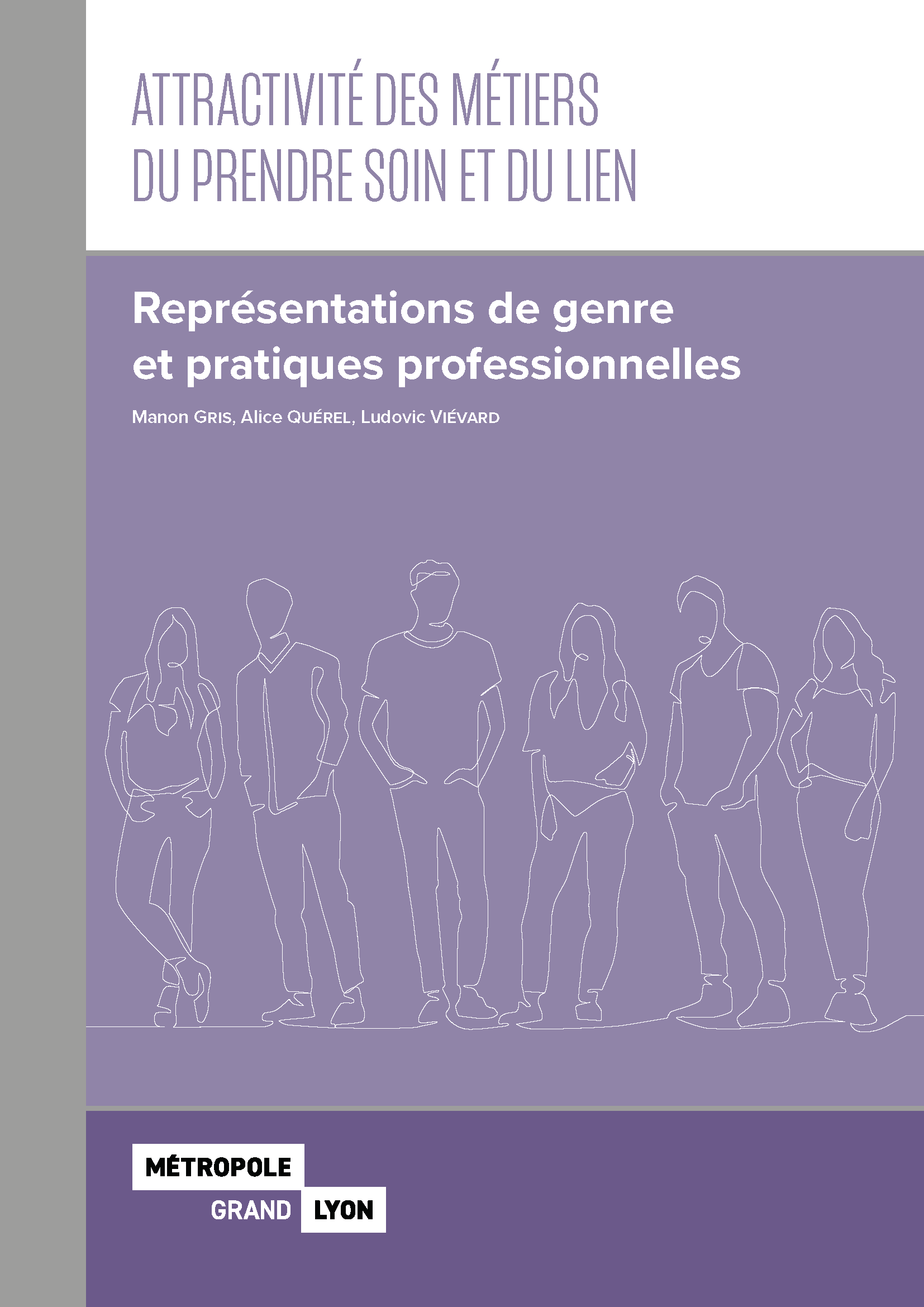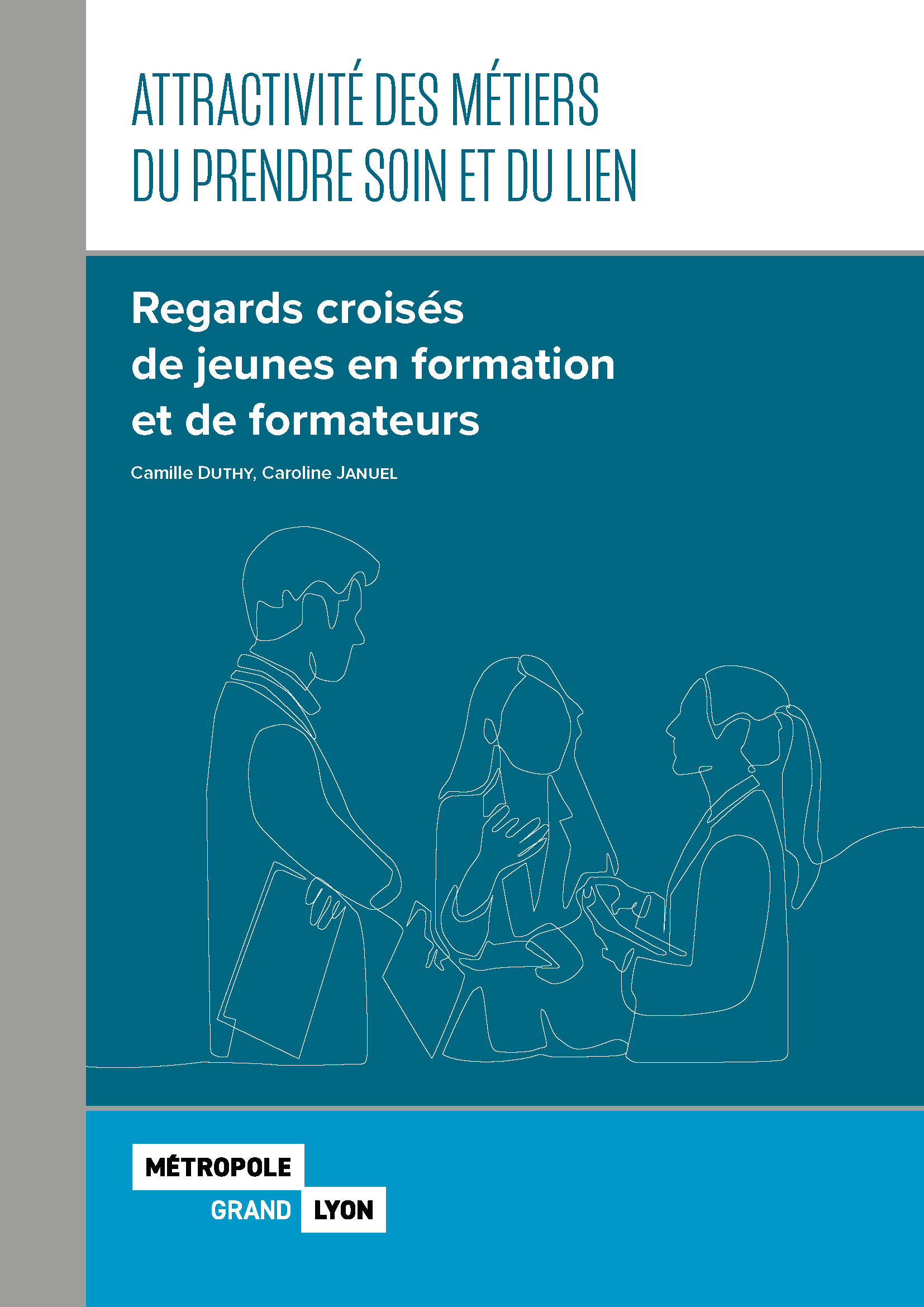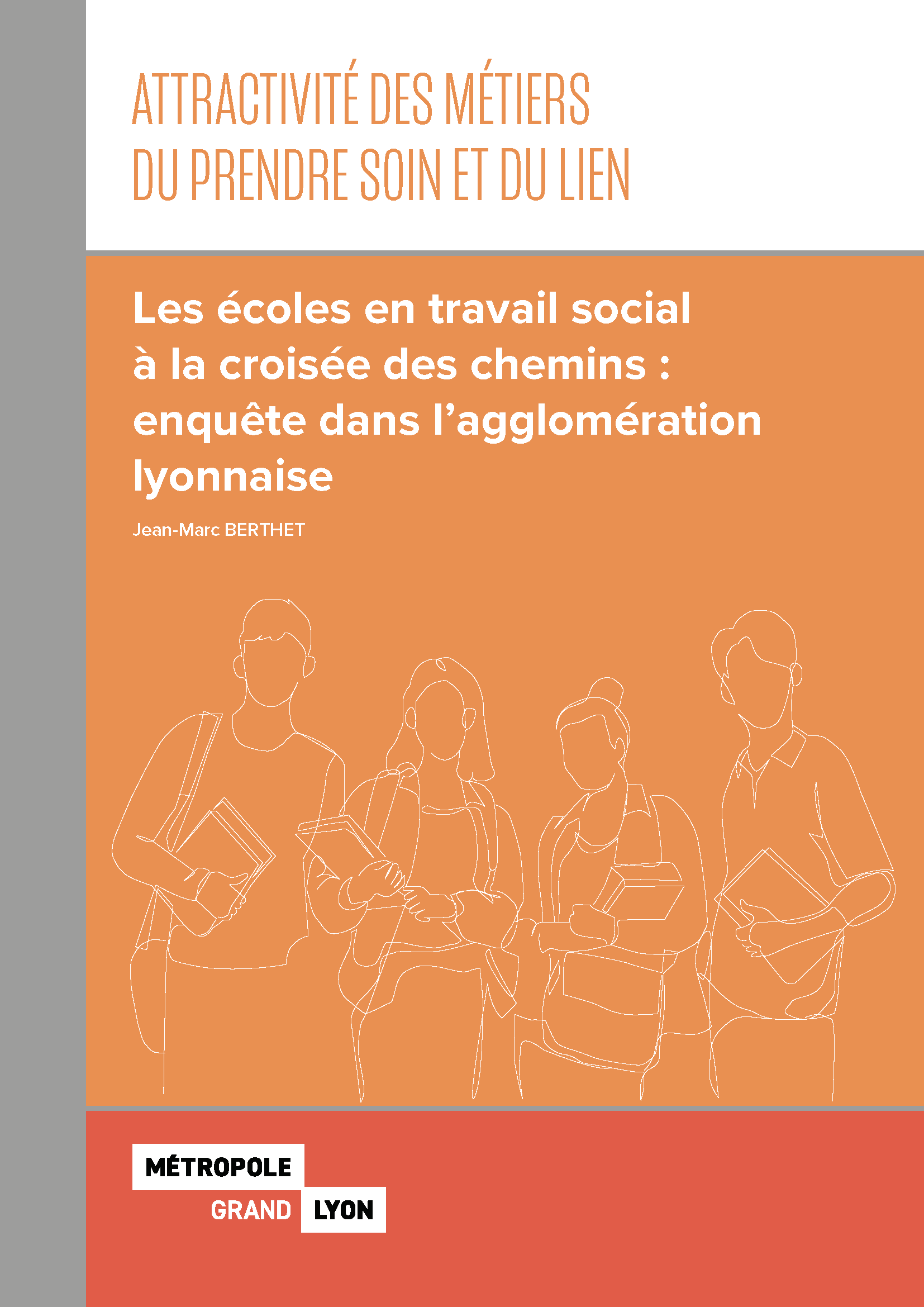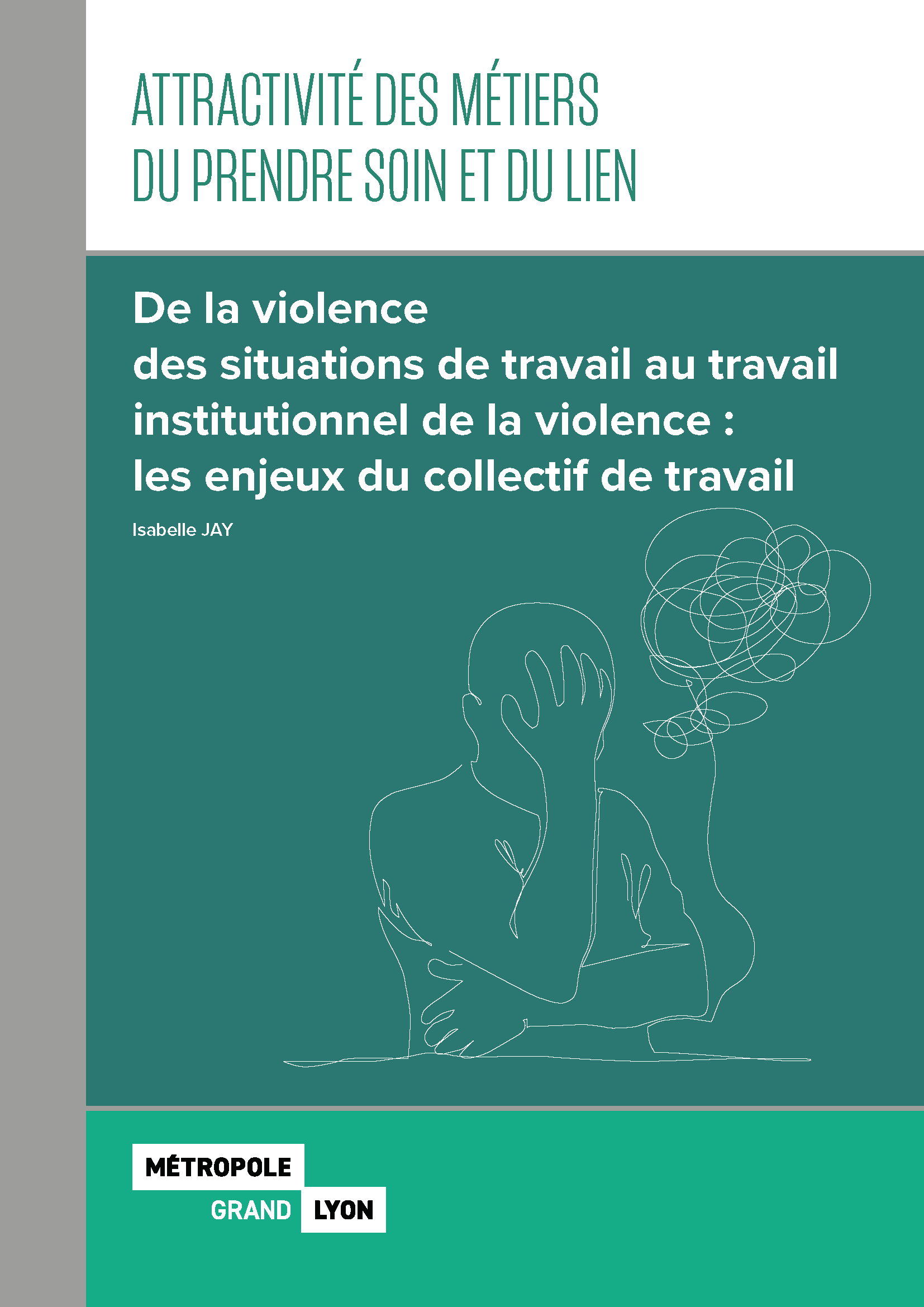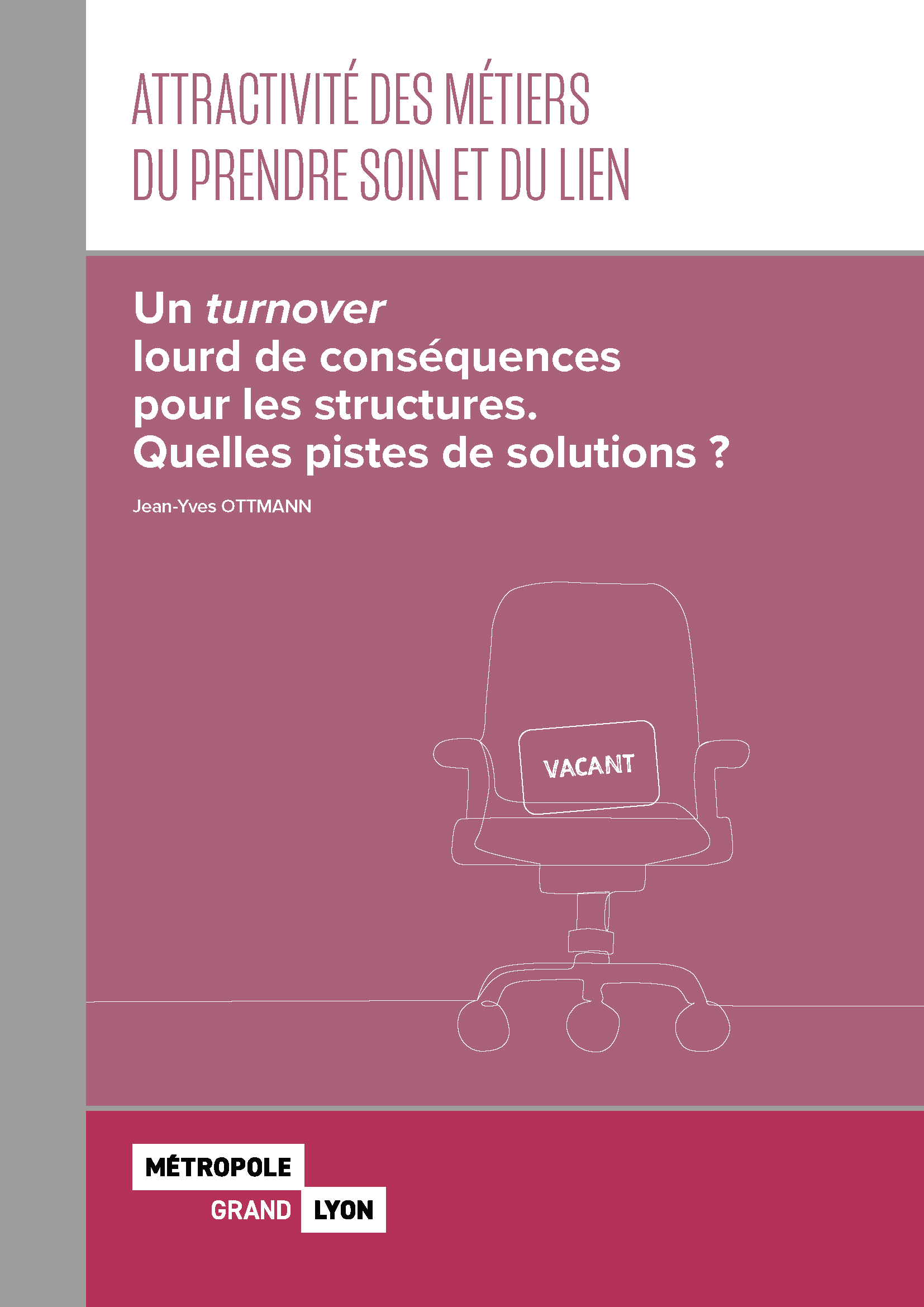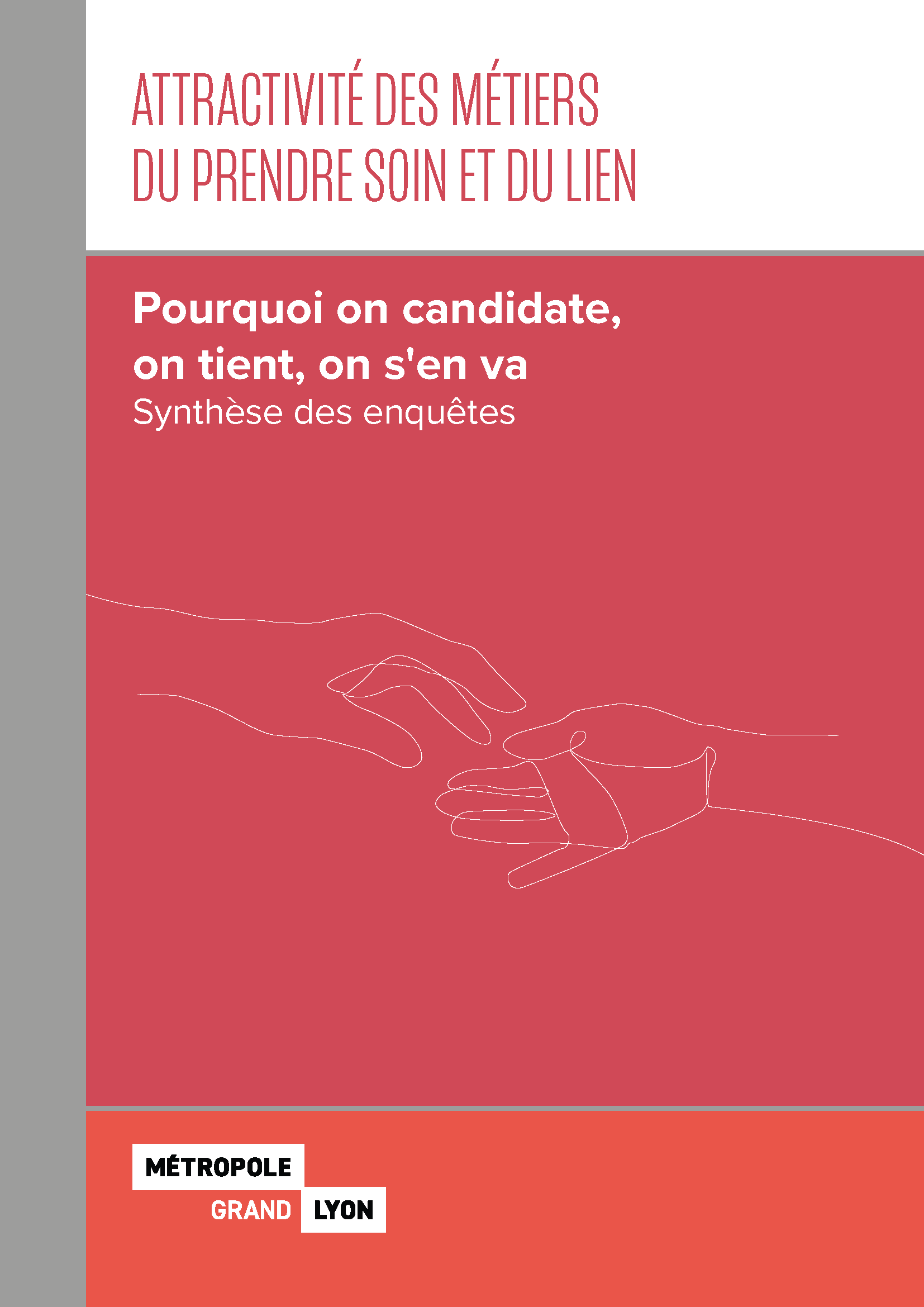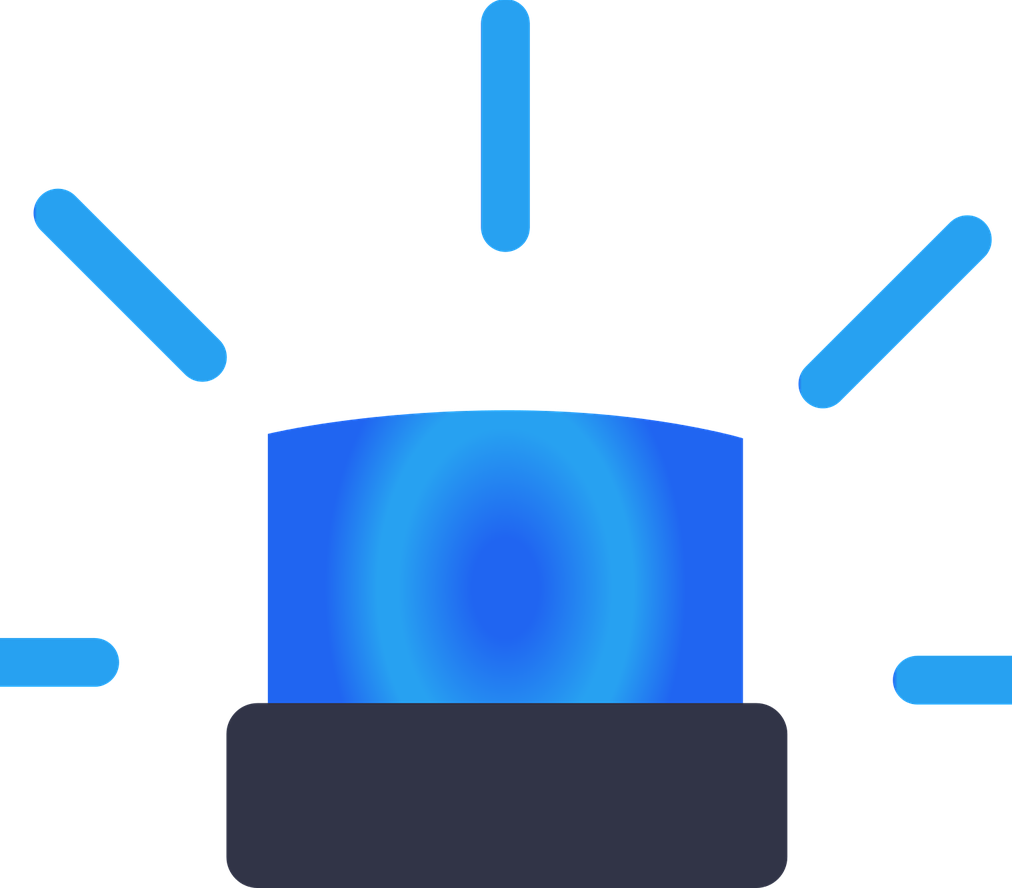Il y a plusieurs processus qui se croisent et qui produisent cumulativement cette segmentation du marché du travail. D’une part, le système patriarcal instaure une binarité public/privé et associe des normes dites masculines à la sphère publique et des normes considérées comme féminines à la sphère privée – produit une dévalorisation du travail de care, notamment à travers des représentations genrées qui en font un travail peu qualifié et par conséquent sous-rémunéré. Les notions de qualification et de compétences sont genrées, puisque c'est l'association des activités du soin au travail domestique, majoritairement effectué par les femmes, qui engendre une forme de stigmate, et l’idée d'une faible qualification. Alors qu'en réalité, le quotidien des personnes soignantes requiert de nombreuses compétences, avec notamment beaucoup de travail émotionnel et relationnel. C’est un travail difficile, mais ces compétences sont peu visibles, peu valorisées.
L'autre processus qui vient s’ajouter, c'est que cela engendre un faible niveau de rémunération, une forte précarité de l'emploi dans ce secteur, ce qui rend donc ces emplois peu désirables. En conséquence, ce sont les personnes qui ont le moins le choix, le moins d'options sur le marché du travail, qui vont être amenées à exercer ces emplois, c’est-à-dire les femmes racisées. Les femmes migrantes non européennes ont peu d'options sur le marché du travail, parfois parce qu'elles n’ont pas de formation ou de diplôme préalable, mais aussi souvent parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus dans les pays européens – c’est ce que j’ai constaté en Espagne, en France, et au Royaume-Uni. Elles ne peuvent donc pas trouver d’emploi dans leur branche, et le secteur du care représente une des seules options qui s'ouvrent à elles.
A cela s'ajoute parfois des représentations culturalistes, avec une présumée prédisposition des femmes migrantes aux métiers du care, du fait de représentations stéréotypées des employeurs ou des intermédiaires sur les sociétés d'origine. Il apparaît dans les entretiens que parfois les femmes elles-mêmes mobilisent ces stéréotypes de manière stratégique, dans le contexte d’un entretien d'embauche par exemple, pour avoir des chances d'obtenir un emploi. Mais de manière générale, ce qui ressort très clairement de mon enquête, c'est que ce secteur du care s'impose dans la plupart des cas comme une des seules options possibles, et non un réel choix. Il y a donc une forme structurelle et racialisée de segmentation du marché du travail, à partir du moment où ce sont les seuls emplois qui sont accessibles à ces personnes-là, et que par ailleurs d'autres personnes, blanches et européennes, se « déchargent » de ce type de travail. Il en résulte une forme d’assignation au care, pour des travailleurs et travailleuses racisées.
Cette structuration genrée et racialisée du secteur maintient par ailleurs une certaine dévalorisation de ces métiers, puisqu’une sorte de cercle vicieux se met en place : les structures patriarcales qui dévalorisent le care d’une part, le racisme sur le marché du travail d’autre part, produisent une segmentation et une précarité qui nourrissent en retour les représentations stéréotypées qu'on a autour du care comme un travail peu qualifié.