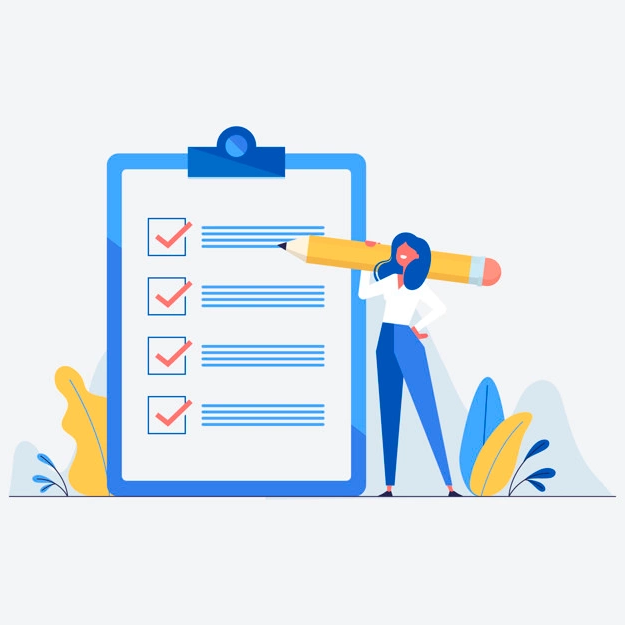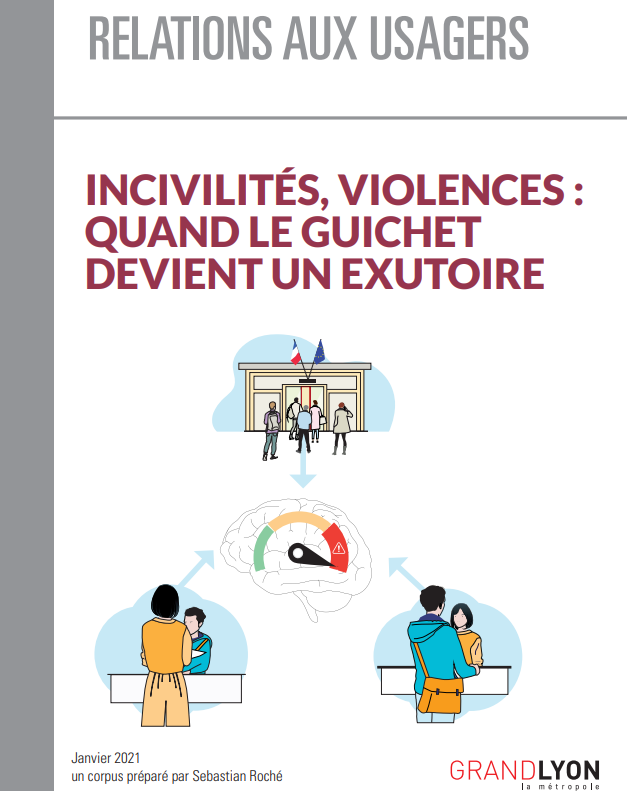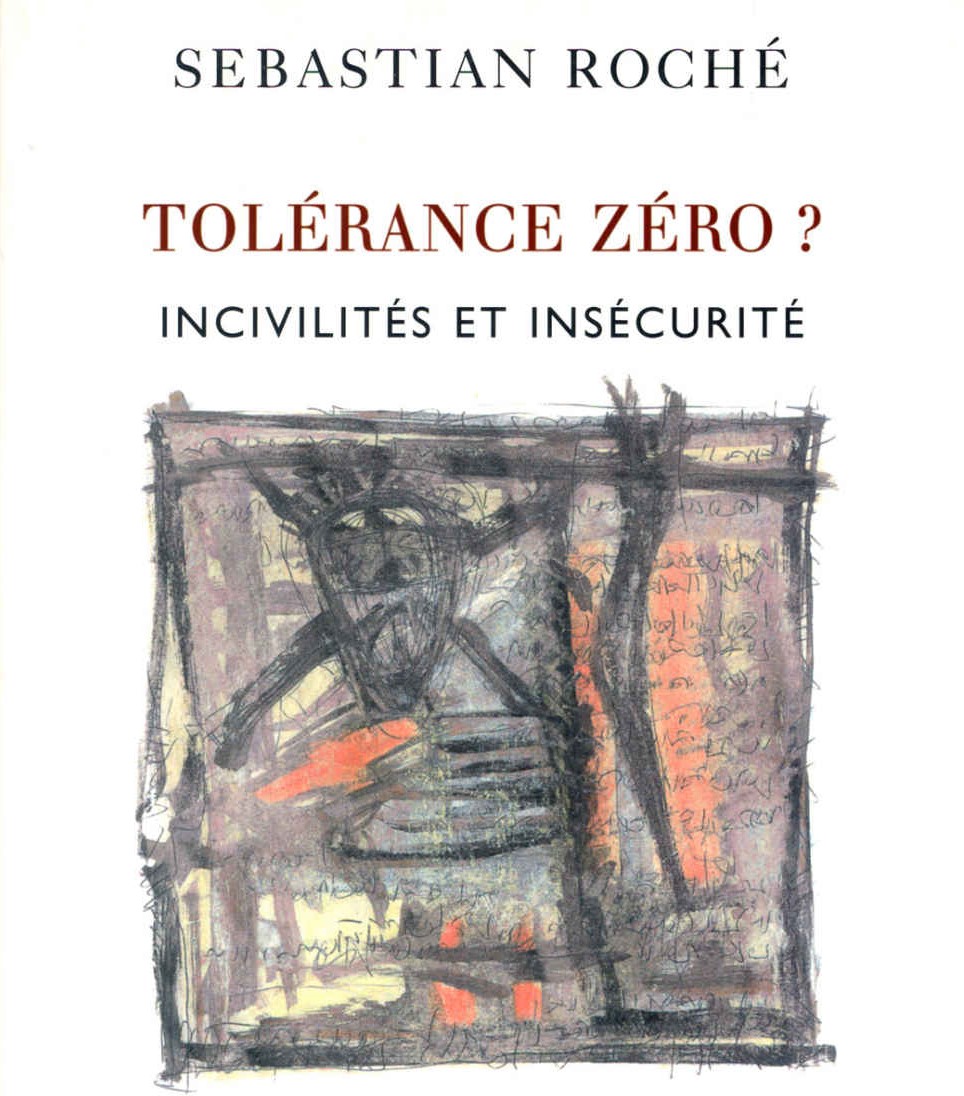Téléchargez ICI le PDF de l’ensemble des textes de ce dossier, et retrouvez ICI notre sommaire en ligne.
Régulièrement la violence resurgit comme enjeu de société ou comme préoccupation chez les professionnels dans le cadre de leurs relations à leurs usagers, qu’il s’agisse du corps médical, social ou même policier. À la fin des années 80, je découvrais au cours d’entretiens à Grenoble ce que j’allais plus tard nommer, à l’aide d’un terme à l’époque tombé en désuétude, « incivilités ». J’y consacrais plusieurs articles et ouvrages pour tenter de les comprendre et les mesurer. Ces frictions entre les habitants, les usagers ou les élèves à propos de comportements quotidiens (salissures, agressivité verbale notamment) ont attiré l’attention, dix ans plus tard, des pouvoirs publics au point que la garde des Sceaux Élisabeth Guigou déclara en 1998 : « Il faut donc, sur chaque site, que soit engagée une concertation entre maire, préfet et procureur pour le traitement des incivilités ». Après vingt ans d’oubli, le terme refait surface, de nouveau : l’actuel garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti organise une réunion à Dijon début septembre 2020, dans la foulée des déclarations du Premier ministre, qui analyse les incivilités comme le résultat d’un défaut de punition, et d’un ministre de l’Intérieur qui croit voir la société française retourner à l’état sauvage. Pourtant, on ne saurait réduire le questionnement aux prises de paroles des ministres : la question de l’agressivité dans les relations humaines était déjà revenue dans les esprits comme si elle répondait à une logique de cycle. Avant même ces déclarations des responsables nationaux, et pour la première fois depuis 15 ans, j’ai été invité dans plusieurs villes pour proposer des analyses et discuter des réponses possibles. Dans le même temps, la direction de la prospective du Grand Lyon s’interroge sur les interactions avec le public, qualifiées parfois de violentes par des agents de différents services de la Métropole.
Comment comprendre ce retour des incivilités, comment le situer dans un portrait plus général de l’ensemble des violences ? Illustrent-elles un renversement des normes et des valeurs jusque dans le quotidien le plus banal ? Comment situer les tensions entre les usagers et les agents des services publics parmi celles qui existent dans les relations interpersonnelles, que ce soit entre citoyens, dans les familles, ou dans les institutions ? Y a-t-il une aggravation des différentes formes de violences, des plus dures, – telles que les atteintes à l’intégrité physique, le terrorisme du fait de groupes armés ou les homicides ordinaires – aux plus molles que sont les incivilités ? Ou, inversement, n’y aurait-il pas plutôt une transformation de la sensibilité à l’égard de la violence et ce que cette notion recouvre ? Plus de sensibilité signifierait plutôt un corps social et des professionnels en alerte, plus attentifs aux signaux faibles de la violence. La notion de violence, par sa plasticité, cache sous son ombre une grande diversité d’enjeux. Ses manifestations se transforment. La violence sociale et politique peut prendre des formes extrêmes et visibles alors que d’autres, comme le harcèlement, longtemps toléré, sera mis à l’index. Toutes évoluent à leur rythme, rendant complexe une lecture simpliste, souvent morale, d’une réalité plutôt multiforme.
La violence : une notion de plus en plus extensible
Ce qui me frappe, en regardant rétrospectivement les évolutions des sociétés européennes, et de la France, c’est tout d’abord une extension de l’usage de la notion de violence. La qualification de « violence » tend à s’élargir avec le temps, traduisant un phénomène de sensibilité croissante à son égard. Pour le dire simplement, elle est de moins en moins acceptée et les justifications qu’on peut vouloir lui apporter échouent de plus en plus à convaincre. Ceci constitue une transformation majeure des mentalités, auxquelles il est difficile pour les responsables politiques et administratifs de ne pas répondre. Entre le début des années quatre-vingt et aujourd’hui, on n’a cessé de trouver plus de violences au fur et à mesure qu’on les recherchait. Ainsi, comme je l’indiquais plus haut, les incivilités sont devenues des objets de politiques publiques, non seulement par les ministères de l’Intérieur et de la Justice, mais aussi des municipalités et encore de diverses entreprises : il n’est plus possible de ne pas y répondre, quelle que soit la matérialité des faits.
Le livre de la psychiatre Marie-France Hirigoyen sur le harcèlement au travail, publié en 1998, a fait l’effet d’une bombe, bien au-delà de toute anticipation. Son intitulé, Le harcèlement moral : La violence perverse au quotidien, ne trompe pas : selon elle, « des mots, des regards, des sous-entendus » sont des violences. L’histoire récente des violences faites aux femmes se confond avec celle de la manière dont elles sont considérées et jugées par la société tout entière. En 1976, la militante féministe et auteure Benoîte Groult s’indigne des violences subies par les femmes depuis l'Antiquité jusqu’à nos jours : « On a essayé de maintenir les femmes dans un état d’infériorité, de demi- humanité ». Avec le mouvement #MeToo, qui débute en 2017 avec l’affaire Weinstein, la contestation radicale du fait d’user de sa position de pouvoir pour obtenir la soumission sexuelle prend de l’ampleur. Le scandale de l’affaire Strauss-Kahn au Sofitel à New York en 2011 avait déjà mis au grand jour les pratiques sexuelles de certains hommes de pouvoir. Ce sont des basculements majeurs dont on notera qu’ils se produisent presque quarante ans après les dénonciations de Benoîte Groult, dévoilant la temporalité lente de l’évolution des sensibilités sociales. En quelques dizaines d’années, la question de la violence dans le couple est devenue un enjeu public, et non plus une question privée. Les évolutions se sont faites de manière incrémentale, assorties des premières enquêtes sociologiques (et notamment en 2000 l’enquête dite ENVEFF - Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France) et les mobilisations associatives dès les années quatre-vingt. Toutes les formes d’agression deviennent plus difficiles à dissimuler, et cela affecte même les institutions aussi puissantes que les États et les églises. Ainsi en va-t-il pour celle de Rome, qui avait couvert les agressions sexuelles contre des mineurs, et dont le caractère systématique a été révélé au public à différentes occasions mais en particulier lors des révélations en 2002 des journalistes du Boston Globe. Les révélations concernent d’abord le diocèse de Boston, puis ensuite, à l’échelle des États-Unis, les mécanismes secrets de dissimulation des crimes par l’Église. Leur enquête a donné lieu à un film, Spotlight. En 2018, le pape parle « d’abominations » et promet qu’il « ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits ». À Lyon, en 2020, Bernard Preynat, ancien curé du diocèse de Lyon, est condamné à de la prison ferme pour agressions sexuelles sur mineurs.
Les violences des institutions, religieuses ou civiles, sont davantage rejetées
Parallèlement, les violences policières sont de moins en moins tolérées, comme l’a montré le mouvement mondial de sympathie et de protestation suite à l’homicide de George Floyd, un Noir, par un policier blanc, qui lui écrase le cou et l’étouffe. Jamais un mouvement de protestation n’a eu une telle ampleur aux États-Unis et n’a résonné à cette échelle en dehors. Dans la foulée, en France, on enregistre la plus importante mobilisation sur cette thématique début juin 2020 avec près de 20 000 participants massés devant le tribunal de Paris à l’appel de « Justice pour Adama », une situation inédite jusqu’alors. Les 120 à 200 exécutions extra-judiciaires de manifestants sympathisants du FLN par les policiers dans les rues de Paris réalisées sous les ordres du préfet de police Maurice Papon le 17 octobre 1961 semblent aujourd’hui difficilement envisageables, tout comme le « processus systématique » de sa falsification étayé par les historiens britanniques Jim House et Neil MacMaster. L’ordre du même Papon de « dispersez énergiquement », qui s’est traduit par le décès de neuf manifestants communistes au métro Charonne au cours de la seule journée du 8 février 1962, déclencherait aujourd’hui, fussent les victimes des opposants politiques participants à une manifestation non-déclarée, une crise politique majeure, j’imagine. Par contraste, le décès et les trente mutilations causées par la police lors du mouvement des Gilets jaunes ont été documentés par des journalistes indépendants, comme David Dufresne, relayés sur les médias sociaux, puis par la presse généraliste, et ont créé une onde de choc. Une telle indignation collective est nouvelle. Ni l’autorité de l’église, ni celle de l’État ne légitime la violence de ses agents et ne justifie plus ni la couverture, ni l’absence de sanction dont ils bénéficiaient jusque-là. Au moment où la violence est plus rejetée que jamais, son usage ne renforce plus le pouvoir qui l’utilise : je pense que nous sommes entrés dans une telle configuration. La philosophe Hannah Arendt l’avait théorisé en distinguant le pouvoir (comme fin) de la violence (comme moyen) : « La violence ne peut jamais être la source du pouvoir », écrivait-elle en 1972. Le pouvoir, fusse-t-il de nature républicaine ou divine, protège de plus en plus mal les puissants qui infligent une douleur à leurs ouailles ou leurs sujets. Le déclin de la violence est ici indissociable de la « révolution des droits » qui s’est produite au cours de la seconde partie du vingtième siècle pour les minorités raciales, les femmes, les enfants, les homosexuels, les personnes avec un handicap, les animaux. C’est l’aboutissement d’une tendance finalement assez récente qui a commencé avec l’abolition de l’esclavage et des privilèges féodaux. La condamnation morale de la violence intentionnelle progresse dans notre société, mais probablement pas de manière uniforme. On a vu l’extension de la notion de violence, et il est un fait que les sociétés occidentales sont de plus en plus sensibles aux dommages faits au corps ou à la dignité. Pourtant, cette aversion dépend toujours de l’identité des victimes. Les violences n’attirent pas la même réprobation selon qu’il s’agisse des victimes du terrorisme (suivant qu’elles sont occidentales ou non), des morts (suivant qu’il s’agisse de « migrants » à nos frontières ou non), de la souffrance au travail (suivant le statut des personnels).
La violence politique et sociale en perte de vitesse
Concernant la violence politique et sociale, ses justifications morales apparaissent aujourd’hui très affaiblies, sans qu’on puisse dire qu’elles soient complètement anéanties. On se reportera au texte de Michel Wieviorka qui fait un panorama des tendances générales de la violence politique et sociale en France sur un demi-siècle. Il observe les mutations d’une société traversée par l’irruption de la violence - parfois sous une forme extrême, celle de l’action politique armée. On est frappé par l’affaissement des justifications de la violence par les intellectuels, et dans la population générale. Rares sont aujourd’hui les visions optimistes de la violence, et, de ce fait, rares sont les intellectuels qui théorisent la nécessité de la violence, qui défendent le terrorisme ou les criminels de droit commun. En effet, ces justifications morales ont été largement défaites, notamment par l’expérience des révolutions – par définition violentes – qui n’ont pas aboli la violence. Comme l’écrit le philosophe Michaël Floessel, « Le paradigme de la (bonne) violence révolutionnaire s’est effondré quand il est apparu clairement que celle-ci était loin de mener à la constitution d’une société qui n’aurait plus à faire usage de la force ». La justification de la violence repose sur des justifications d’ordre moral, et celles-ci ne sont jamais totalement absentes. Les violences sont plus acceptées lorsque la pauvreté, ou l’affirmation d’identités conflictuelles les déclenchent. Ces deux facteurs sont toujours associés aux confrontations, que ce soit en Inde, en Amérique Latine, ou en Irlande du Nord. On a aussi vu en France, avec les émeutes de 2005 ou les protestations de Gilets jaunes qui se considèrent comme déclassés, et enfin avec les attentats au nom de l’Islam, que les injustices ressenties et la pauvreté créent des fractures dans lesquelles ces justifications de la violence sont susceptibles de se développer.
Y a-t-il une bonne violence ?
On observe que la violence se justifie si l’idée est partagée par les acteurs qu’elle est le seul moyen dont ils disposent pour réaliser « quelque chose de bon », c’est-à-dire obtenir la justice et la vérité. Les débats actuels sur l’usage de la violence d’État portent d’ailleurs exactement sur ce point. Lorsque le président de la République tente de faire penser que la violence policière est a priori légitime par ce qu’elle émane de l’État, lorsqu’il d’affirme
« Ne parlez pas de répressions ou de violences policières, ces mots sont inacceptables dans un État de droit », il est moqué. Et pour cause : c’est précisément dans ces régimes qu’on les nomme et donc qu’on les combat le plus efficacement au nom des droits humains. Lorsqu’e un ministre de l’Intérieur défend que l’ordre est nécessaire au point de rendre la violence « bonne », il n’a pas pris la mesure de la transformation des sensibilités et de la révolution des droits. Plus largement, les groupes qui peuvent s’engager dans l’action violente au nom de causes comme l’environnement ou la vie animale cherchent à convaincre avec un argumentaire similaire à celui d’un chef de la police : la violence est nécessaire pour rétablir l’ordre naturel, l’ordre des choses, l’ordre moral. Ils détruisent un champ d’OGM, s’introduisent dans les abattoirs pour montrer la souffrance des bêtes sans défense et la cruauté des hommes, détruisent la vitrine d’un boucher. Pourtant, rares sont aujourd’hui les grands mouvements politiques dans lesquels de nombreux militants sont convaincus de son efficacité. Cela n’exclut pas qu’ils s’y trouvent parfois entraînés comme pour des Gilets jaunes : se sentir victimes de violences policières et humiliés a provoqué chez eux une perte de sens, et une adhésion corrélative à la valorisation de la violence. Ce dernier point a été bien documenté par Yara Mahfud et Jaïs Adam-Troian. Même les conflits du travail n’ont plus la vigueur qu’on leur a connus il n’y a pas si longtemps. Dans une Lorraine en voie de désindustrialisation, on a vu en 1979 des affrontements d’une intensité remarquable lorsque les sidérurgistes attaquèrent le commissariat de Longwy, répliquèrent à la police avec des cocktails Molotov, des boulons et billes d’acier tandis d’autres furent tentés (mais dissuadés par leurs camarades) d’utiliser leurs fusils contre les policiers. Il en fut de même lorsque les paysans bretons firent le coup de poing, ou que les viticulteurs abattirent un CRS au fusil de chasse à Montredon en 1976. Même les guerres sont moins virulentes et moins dévastatrices de vies, une réalité qui au regard de notre information -toujours plus exhaustive- n’est pas facile à accepter spontanément. On pourra se reporter au travail du géopoliticien Frédéric Encel qui vient de publier Les 100 mots de la guerre pour s’en assurer. Ou encore à la fresque historique de longue durée du psychologue américain Steven Pinker et à son livre La Part d'ange en nous (The better angels of our nature) publié en anglais en 2011 et traduit en français en 2017 qui confirme la force et le caractère ininterrompu du processus de pacification des mœurs.
La réforme de l’État et la violence au guichet
La violence dans les relations sociales peut difficilement être pensée à l’écart de l’organisation de ces relations par l’État, et ce d’autant plus qu’on s’intéresse aux propres services administratifs centraux et locaux. En effet, par le pouvoir qu’il impose, en particulier sous la forme du droit, l’État peut tout aussi bien modérer que produire de la violence. L’État n’est, dans ce dernier cas, plus perçu par les usagers comme ce qui modère la violence ressentie, mais comme un instrument qui la génère. Il faudrait bien sûr mieux différencier les formes locales de l’État (les collectivités locales) des formes nationales (les administrations centrales) que je ne le fais ici. Il y a un accord large des contributeurs pour dire que, si elles se produisent au cours d’une relation au guichet ou de suivi individuel, les violences sont loin de se résumer à une question de personnalité ou de profil individuel des usagers ou ne sont pas le fait de comportements individuels déviants des agents. Elles ont au contraire une histoire et se produisent dans un contexte plus large, celui de la réorganisation de l’État, de ses services, de ses activités commerciales. Elles peuvent aussi se situer dans une relation entre un gouvernement local ou national et des gouvernés ou ayant droits, c’est à dire un rapport asymétrique du fort au faible. Ces situations où le faible ressent une injustice et ne voit pas d’issue sont de nature à engendrer des tensions. Et se sont souvent les agents publics qui se sentent pris entre les exigences organisationnelles et les attentes des usagers.
Pour conclure, je voudrais faire quatre observations. Premièrement, quelle que soit la visibilité des actes de violence, la pacification des mœurs comprise comme l’apaisement des relations sociales restent tendanciellement vraie. Ainsi, les homicides ordinaires déclinent en tendance de manière continue, nonobstant de « mauvaises » années, indiquant que la population dans son ensemble adhère à ce rejet de la violence et a intériorisé cette norme de rejet. Deuxième observation, il y a un paradoxe à ce que la violence définie par la souffrance qu’elle cause aux individus soit devenue de plus en plus intolérable, mais que, dans le même temps, elle soit de moins en moins identifiable du fait de l’extension de sa définition. Telle est pourtant la situation actuelle. Troisièmement, dans ce contexte de sensibilité croissante, l’extension de l’usage de la notion de violence place les responsables politiques dans l’obligation d’y répondre lorsqu’elle est dénoncée. Enfin, la quatrième observation est que, en dépit des tendances lourdes à la pacification des mœurs, se manifestent actuellement des contre-tendances qui tiennent à l’activation de clivages entre groupes sociaux, à la concentration de la pauvreté ou encore à la réforme de l’État et des administrations publiques au contact du public. Elle crée un stress et des tensions décrites comme nouvelles par les spécialistes et professionnels des domaines concernés, les sociologues des guichets de l’État, comme nous allons le voir.
Il existe donc un cadre macrosocial dans lequel se pose aujourd’hui la question des tensions interpersonnelles, et j’ai essayé d’en rendre compte dans cet avant-propos. La question de la violence est, on l’a compris, tout à la fois celle de la sensibilité à son égard et des formes concrètes qu’elle prend. Lorsque la violence se manifeste dans la rue ou au guichet, il est indispensable de chercher à l’analyser et à la déchiffrer : on ne sait pas répondre à un problème qu’on ne comprend pas. La compréhension de l’évolution de la sensibilité ne doit pas empêcher l’analyse des causes de ses formes actuelles. C’est l’objet du corpus de textes qui est rassemblé ici.
Des tendances de fond et des possibilités d’action
Ce dossier présente plus particulièrement des clés de lecture concernant les tensions au travail, en particulier dans les organisations qui reçoivent du public, qu’elles soient commerciales ou non, culturelles ou sociales, et dans lesquelles les personnels sont en première ligne, au contact des usagers ou clients. Pour concevoir ce dossier, dont la focale principale est la violence ressentie au travail, j’ai sollicité une diversité de regards, à la fois de professionnels, mais également d’universitaires. Ils appuient leurs diagnostics sur des analyses de situations de travail précises et des évolutions générales de la violence, mais encore sur la manière dont les politiques publiques mises en œuvre changent les interactions entre le public et les agents. L’idée principale qui se dégage de leurs analyses est que la violence a diverses origines identifiables dans le fonctionnement de la société, et notamment l’exclusion économique, les politiques adoptées par les organisations publiques, mais aussi le mode d’organisation des petits groupes que sont les collectifs de travail. Enfin, ils nous montrent qu’il existe des pratiques, qui, à défaut d’être des solutions, améliorent nettement les situations.