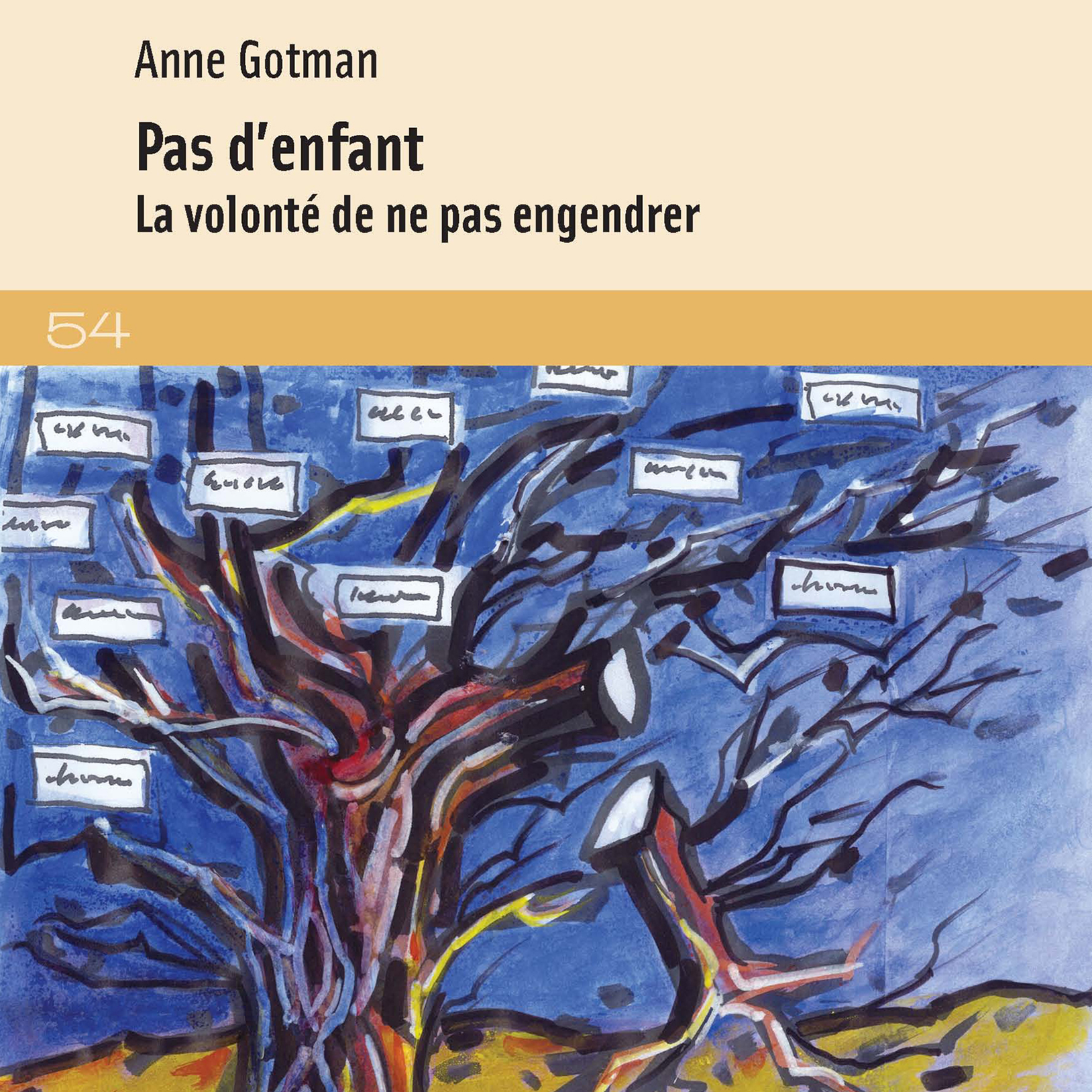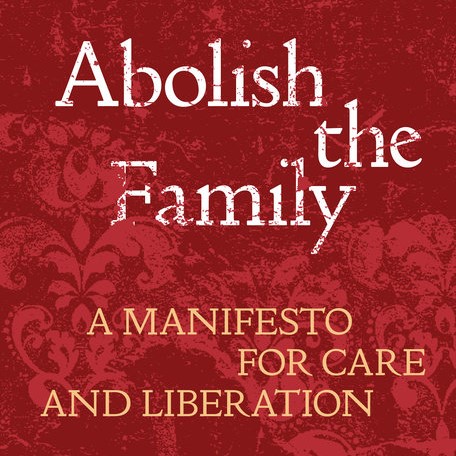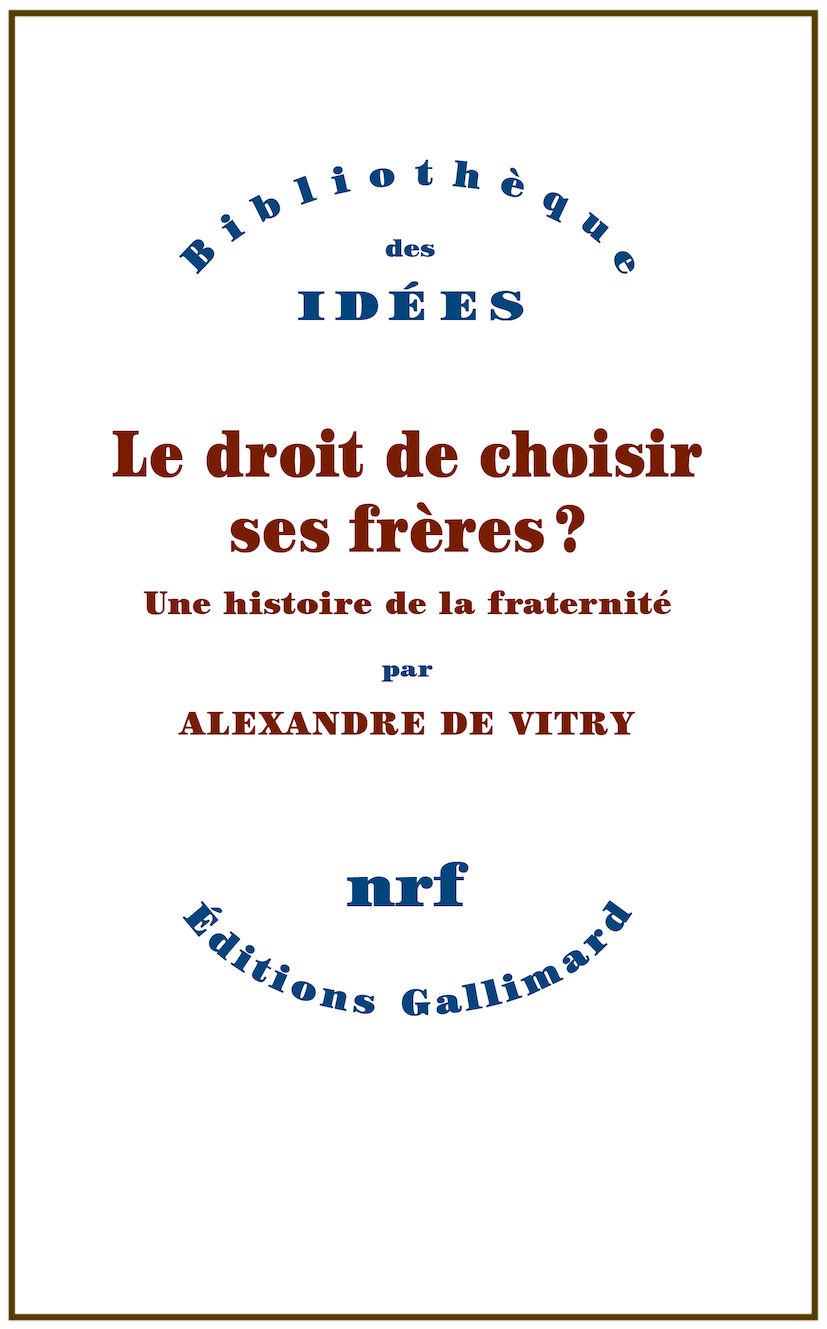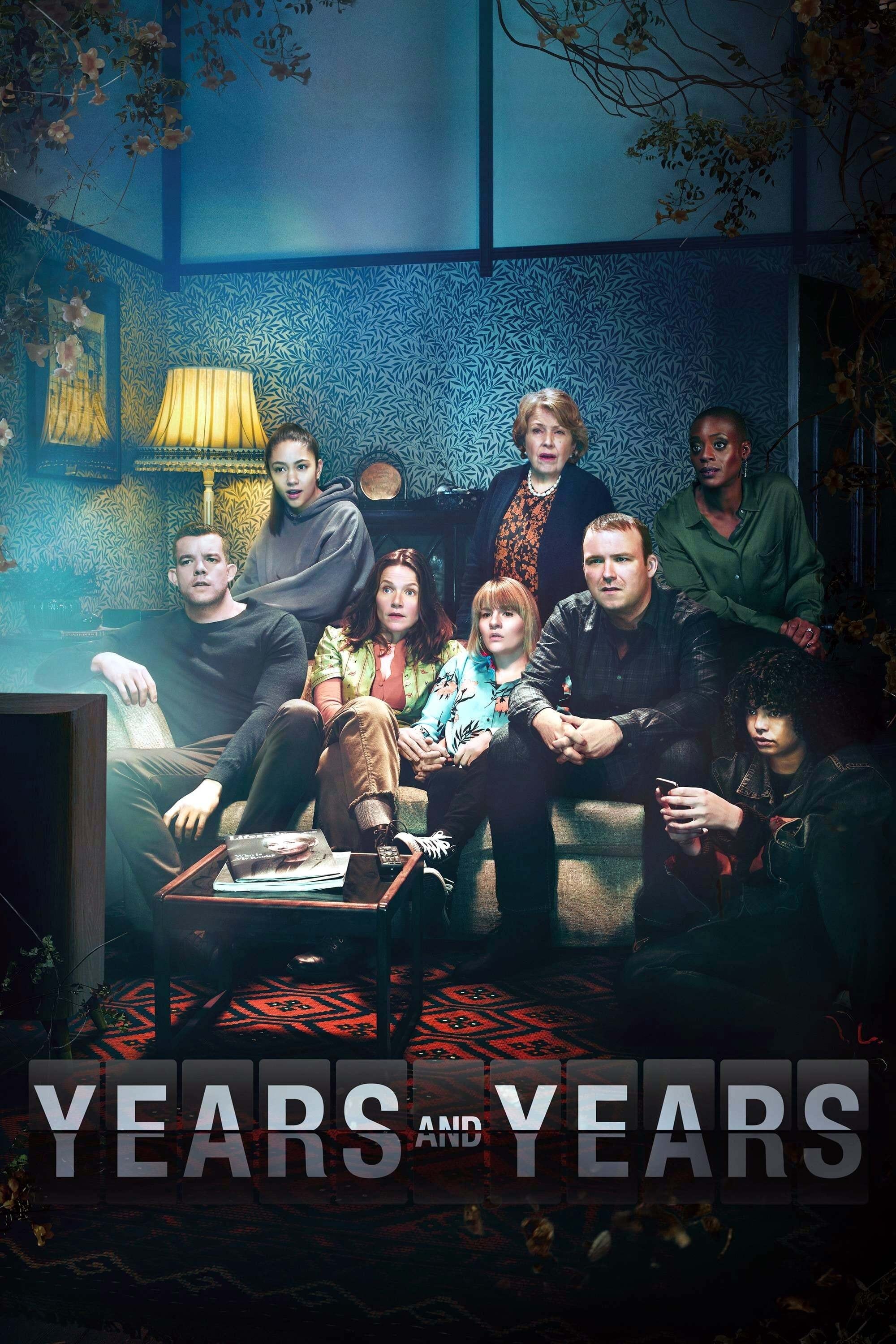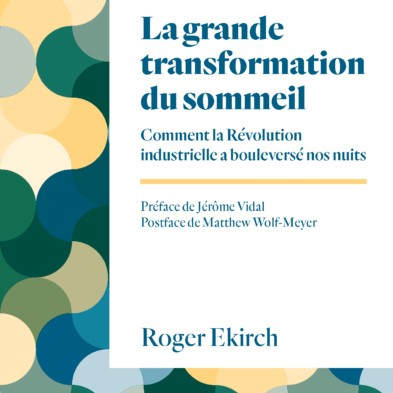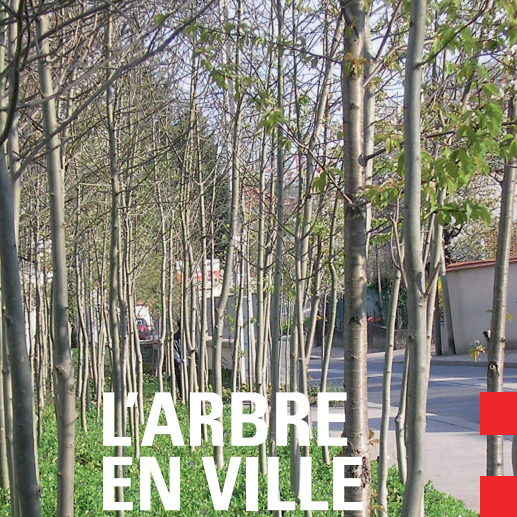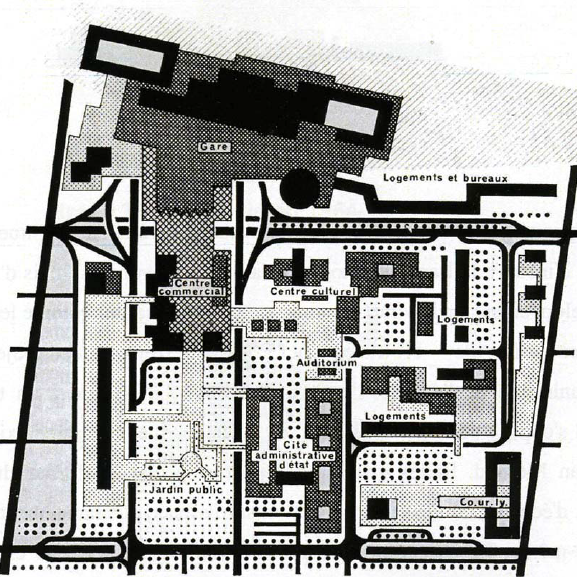Socialement accepté ? Il semble qu’il y ait encore du chemin à parcourir d’après les mouvements en faveur des « sans-enfant » dénonçant les pressions infligées aux personnes dans cette situation. À l’heure où le pluralisme familial gagne du terrain et où « la dissociation entre conjugalité et parentalité est posée comme une évidence », les propos désobligeants, les questions intrusives et les jugements hâtifs restent monnaie courante. Ils conduisent les « sans-enfant » à expliquer leur choix, le justifier, ruser (« Peut-être plus tard »), prendre une identité de substitution (« Je ne peux pas en avoir »), voire à retourner la question (« Et vous, pourquoi en avez-vous ? »).
Pourquoi tant d’incompréhension, en particulier à l’égard des femmes ? Malgré les avancées féministes, la norme de l’accomplissement individuel prédomine encore : sans enfant, une femme ne serait pas totalement accomplie. Plus généralement, être parent rendrait heureux. La sociologue Anne Gotman ne manque pas d’interroger cette norme implicite. D’une part, il est possible de s’épanouir ailleurs que dans la maternité/paternité. D’autre part, les enquêtes d’opinion comme les études empiriques montrent, contrairement aux attentes, que les parents ne sont pas plus heureux que les non-parents. D’après le sociologue Thomas Hansen, l’illusion viendrait de la confusion entre bonheur et sens de la vie : « La parentalité peut être une piètre stratégie pour trouver le bonheur, mais un excellent moyen de trouver un sens à sa vie ».
Les sans-enfant ? Combien sont-ils ?
D’après l’enquête française FECOND (2010-2013) réalisée par l’Inserm et l’Ined, la part de non-parents volontaires reste très minoritaire en France, avec seulement 6,3 % des hommes et 4,3 % des femmes de 15 à 49 ans déclarant aux débuts des années 2010 ne pas avoir d’enfants, ni en vouloir. Mais chiffrer l’infécondité volontaire déclarée ne reflète pas la réalité des parcours qui fluctuent, entre infécondité volontaire déclarée et pas déclarée.
Selon les études, en majorité anglo-saxonnes, ceux qui formulent précocement leur volonté de ne pas avoir d’enfant sont rares. Ces early articulators sont majoritairement des femmes. Quand la société parle d’absence d’instinct maternel, celles exprimant dès leur plus jeune âge ne pas vouloir d’enfant répondent simplement qu’elles n’en ont jamais eu envie. Les postponers, celles et ceux qui reportent le projet, reconsidèrent la question à l’aune des circonstances, puis finalement n’en ont pas, sont beaucoup plus nombreux. Enfin, il y a aussi beaucoup d’incertains qui répondent « ne pas savoir ». Certains sans-enfant, en majorité des hommes, témoignent que pour eux, la question n’a jamais été centrale.
La difficulté à déterminer le poids numérique des sans-enfant n’a pas empêché des études sociologiques et démographiques de se pencher sur leurs caractéristiques. Et là encore, oubliez les présupposés. Les sans-enfant sont-ils plus nombreux chez les populations prospères et diplômées ? En France, l’infécondité définitive est certes plus élevée chez les femmes diplômées, mais elle est au contraire plus fréquente chez les hommes en bas de l’échelle sociale, pour les célibataires. Pour les personnes en couple, le diplôme n’est pas significatif, d’après les études de Charlotte Debest, Magali Mazuy et l’équipe de l’enquête FECOND. En réalité, l’influence du diplôme et de la catégorie sociale est de moins en moins prégnant, et l’absence d’enfant semble s’étendre actuellement à tous les profils.
Qu’en est-il du parcours familial ? Une enfance douloureuse ou des rapports conflictuels avec ses parents expliquent-ils le choix de ne pas faire d’enfant ? Cela peut être le cas bien sûr, mais les caractéristiques le plus significatives des sans-enfant seraient un départ tardif de chez les parents et une mise en couple également tardive. Et encore, le fait de prendre son temps n’explique pas à lui-seul le choix des sans-enfant !
Liberté, liberté chérie
« Le choix de ne pas avoir d’enfant, comme le fait de se retrouver sans enfant sans l’avoir vraiment décidé, ne peuvent se réduire à des motivations univoques et simples. Parmi elles, il semble toutefois que la liberté tient une grande place », écrit la sociologue. Il s’agit même du principal avantage de la vie sans enfant d’après les concernés. Une liberté synonyme de vivre comme on l’entend (freedom) et de s’affranchir des liens politiques et communautaires (liberty). Lorsqu’ils doivent expliquer leurs choix, les sans-enfant mettent en avant aussi bien des raisons anecdotiques (ex. être libre de ses horaires) que fondamentales (ex. refuser de se conformer à « l’obligation sociale »).
Pour beaucoup, vie conjugale et vie parentale sont inconciliables. Le couple est prioritaire. Ne pas avoir d’enfant le protégerait et permettrait plus de cohésion entre les partenaires, libres de conjuguer des centres d’intérêt extérieurs ou des activités communes. Des facteurs répulsifs jouent aussi dans l’origine de la non-parentalité : il s’agit essentiellement de la perte d’identité qu’engendrerait le fait d’avoir un enfant et du rejet de tout ce qui lui est associé. La maternité est dans ce cas perçue comme un sacrifice, un devoir, voire un fardeau. La paternité est davantage liée à la peur de changer ou de transmettre un héritage trop lourd. Le pessimisme sur le monde environnant est aussi dissuasif, nous y reviendrons.
Contrairement aux attentes, le souhait de privilégier sa carrière professionnelle ou les difficultés à concilier travail et maternité sont rarement invoqués par les femmes sans enfant. Mais est-ce parce qu’il s’agit d’une raison moins avouable en France ? En Suède, ces explications sont davantage assumées. Dans une société plus ouverte à l’absence volontaire d’enfants, des Suédoises déclarent explicitement qu’un enfant nuit à la carrière et que cela explique leur choix de ne pas en avoir.
Dans une grande enquête sur le cas français menée à la fin des années 2000, la sociologue Charlotte Debest dessine une autre piste : une grande partie de l’échantillon « pousse à leur paroxysme les normes professionnelles actuelles de mobilité, de flexibilité, d’indépendance, de liberté d’accepter ou de refuser un contrat ». Dans ce cas, le choix de ne pas avoir d’enfant précéderait le choix d’une vie professionnelle plus libre.
Un choix, vraiment ?
Procréer ou non ne relève pas que de choix personnels. Historiquement, l’accroissement du niveau d’éducation, les opportunités accrues d’emploi pour les femmes, la contraception, le mariage plus tardif, la fragilité des couples, ont participé au fait de ne pas faire d’enfant, ou d’en faire moins. Ajoutez à cela l’affaiblissement des normes sociales et morales, conduisant les individus à écouter davantage leur désir (ou leur absence de désir) d’enfant. Peu à peu, ne pas engendrer devient une option acceptable.
Si les chercheurs en sciences sociales reconnaissent au travail un rôle dans le choix d’une vie sans enfant pour les femmes, le lien entre les deux divise. Pour certains, la hausse de la demande de main d’œuvre féminine explique le développement de vies sans enfant. Pour d’autres, c’est l’instabilité du marché de l’emploi qui découragent les femmes à se lancer dans une maternité. Dans les pays occidentaux, les femmes cherchent à réunir certaines conditions avant de se lancer : partenaire stable, emploi, sécurité économique… Le couple et l’emploi passent avant.
Les politiques publiques d’aide familiale participent-elles à réunir ces conditions ? On pourrait l’avancer car avec une politique d’aide à l’enfance généreuse, la France n’a qu’une proportion relativement faible de femmes sans enfant. Mais avec une politique encore plus généreuse et un système social propice à la parentalité, la Suède compte un taux supérieur de femmes sans enfant… L’influence des politiques publiques ne serait qu’un facteur parmi tant d’autres expliquant le choix de rester ou non sans enfant.
Une affaire de circonstances biographiques et familiales
Les récits de vie analysés par Anne Gotman viennent à plusieurs reprises bousculer la notion de choix. N’est-ce pas plutôt un manque d’occasion ou jamais le bon moment ? Vouloir des enfants dans l’absolu mais ne pas être prêt(e), ne plus en vouloir, en vouloir mais ne pas être avec la « bonne personne », etc. Une vie amoureuse composée de plusieurs relations successives et de ruptures précoces conduit les personnes sans enfant à constater que « Ça ne s’est pas fait ». Puis l’horloge biologique, chez la femme comme chez l’homme, fait que cela devient de moins en moins possible. Des problèmes d’infertilité auxquels peuvent être confrontés également les couples qui ont ajourné volontairement la parentalité.
Les femmes sans enfant ne répondent-elles pas à l’injonction à l’indépendance de leurs aînées ? Des études, relatées dans l’ouvrage, montrent que des mères au foyer élèvent leurs filles dans l’idée de ne pas se faire piéger par la vie domestique et d’accomplir ce qu’elles n’ont pu réaliser elles-mêmes, endossant ainsi le rôle de contre-modèle. D’autres encouragent leurs filles nées dans les années 1960 et 1970 notamment, à se réaliser et à s’approprier les slogans féministes qu’elles portent, tels que « Un enfant si je veux, quand je veux ! » et « Notre ventre nous appartient ». Cet héritage a permis à certaines femmes de mettre à distance la possibilité d’être mère et de sentir légitimes à le faire.
Naissance d’une cause
Un tournant s’opère véritablement dans les années 1970 grâce à quelques pionnières anglo-saxonnes se saisissant de ce sujet jusqu’alors ignoré de la recherche sur la famille. En questionnant la norme, comme la Canadienne Jean Veevers en 1974 qui demande en quoi avoir des enfants représente une perspective nécessairement désirable et réjouissante. En s’intéressant aux moyens d’atteindre l’égalité entre hommes et femmes, pour l’Américaine Margaret Movius qui écrit en 1976 que le choix volontaire de ne pas procréer constitue « l’ultime libération », après la contraception et la légalisation de l’avortement, et qui voit dans cette alternative le seul moyen pour les femmes d’être libres de s’investir dans leur carrière et de rivaliser avec les hommes sur ce terrain.
À la même époque, des militantes féministes américaines revendiquent le terme childfree (libre d’enfant). Ce terme reste plébiscité par les porte-paroles de la cause encore aujourd’hui, car plus positif que les expressions françaises privatives : sans-enfant volontaire, sans-enfant par choix, ou pire, « nullipare » (pour une femme n’ayant jamais accouché).
Ces travaux et revendications gagnent timidement la sphère publique et des mouvements de soutien aux hommes et aux femmes sans enfant voient le jour aux États-Unis. Ils œuvrent notamment pour que l’option d’une vie sans enfant soit reconnue comme telle, avec des arguments qui restent d’actualité : la liberté individuelle et la préservation de la planète.
Aujourd’hui, une alternative de vie égale aux autres
La cause childfree trouve un second souffle à partir des années 1990 grâce à une nouvelle génération d’autrices dénonçant la stigmatisation des sans-enfant, surtout des femmes, et souhaitant banaliser ce choix encore trop souvent incompris (Roux et Figeac, 2022). Elle gagne en visibilité d’abord dans le monde anglo-saxon, plus tardivement en France. Les travaux de Charlotte Debest menés à la fin des années 2000 mentionnent encore le sentiment de mise à l’écart et de solitude de personnes sans enfant.
Aujourd’hui, outre l’objectif de diffuser largement le terme, les childfree proclament davantage ce choix comme une alternative de vie égale aux autres, que comme une transgression de la norme dominante. Pour la journaliste et militante féministe Fiona Schmidt, il s’agit de lutter contre la charge maternelle, c’est-à-dire contre les injonctions liées à la maternité et à la non-maternité, afin de normaliser ce choix aux yeux de l’ensemble de la société.
Le « sens de l’histoire » ?
« Avoir un enfant en moins » permettrait de réduire drastiquement son empreinte carbone, pouvait-on lire dans une infographie de l’AFP en 2018, tirant cette information d’une étude parue dans la revue Environmental Reserch Letters. On se souvient des réactions très vives suscitées par cette publication, qui a été beaucoup disséquée et nuancée depuis.
Le sujet est récurrent dans le débat public et reste clivant, même s’il exige au contraire rigueur et nuances. À tort ou à raison, la justification écologique est de plus en plus utilisée par certains childfree. Pour la sociologue Anne Gotman, cette justification les aide à conforter un sentiment de fierté, lié au fait de limiter la surpopulation et de préserver la planète. Invoquer un geste écologique est aussi plus facile, ou plus audible, que le simple « Je n’en ai pas envie ». Finalement, « en cette heure où, pour la planète, croître signifie périr, les sans-enfant seraient ainsi les seuls véritablement responsables de leur espèce ». En d’autres termes, les générations en âge de procréer, et celles qui suivront, se trouvent face à un paradoxe : faut-il refuser de donner la vie pour mieux la préserver ?
Pour aller plus loin :