[Infographie] Lutte contre le changement climatique : qui fait quoi, avec ou contre qui ?

Article
Quel réseau d’acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique ?
Interview de Claude Pillonel
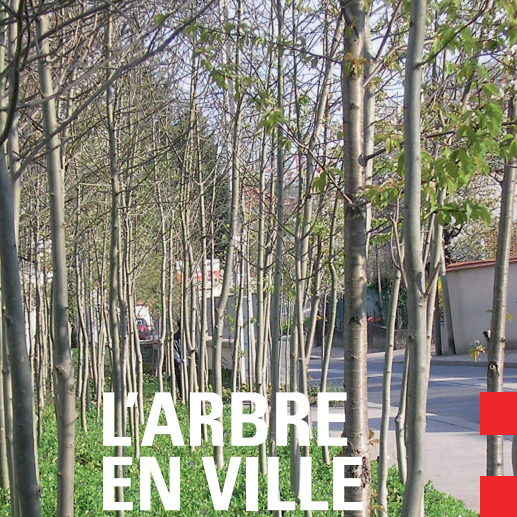
<< A l’époque où le réseau Eurocités s’est créé, j’ai été le premier président de la Commission Environnement >>.
Claude Pillonel est Maire de Poleymieux, conseiller communautaire du Grand Lyon, ancien vice-président de l’écologie urbaine de 1989 à 2001, président d’honneur du Grand Parc Miribel-Jonage et de l’ALE.
En tant qu’élu, à partir de quand avez-vous manifesté un intérêt pour les questions environnementales ? Pour quelles raisons ?
C’est dans le cadre de mon premier mandat, à partir de 1983, que j’ai commencé à considérer ces questions. Je m’étonnais que la Communauté Urbaine, alors présidée par Francisque Collomb, réalise des routes, des projets urbains, des bâtiments, sans prendre en compte les incidences environnementales éventuelles. D’autres projets, comme le doublement de la capacité de l’usine d’incinération de Rillieux, ne me paraissaient pas vitaux. Je constatais aussi que la plupart des projets d’urbanisme ne prévoyaient aucune plantation d’arbres. Et quand j’interrogeais les services pour en connaître les raisons, l’on me répondait que ces questions n’étaient tout simplement pas de la compétence du Grand Lyon.
Quand Michel Noir a été élu, comment avez-vous accédé au poste de vice-président à l’écologie urbaine ?
Michel Noir avait entendu mes positions de conseiller communautaire sous le précédent mandat. Il m’a alors proposé de devenir vice-président. Cependant, le poste qui me paraissait le plus pertinent n’existait pas puisque l’environnement n’était pas encore une compétence du Grand Lyon. Il m’a alors nommé secrétaire délégué attaché à la sécurité, traitant des questions d’environnement. Je suis devenu vice-président à l’écologie urbaine deux ans plus tard.
Quand Michel Noir a été élu en 1989, quels arguments lui avez-vous donnés pour l’inciter à prendre en compte les questions d’écologie urbaine ?
Je lui ai dit qu’il me semblait incohérent de structurer l’urbain et les espaces agricoles des communes rurales sans avoir la compétence environnementale. Il fallait donc acquérir cette compétence. Michel Noir a bien compris les enjeux.
Comment avez-vous fait avancer la question ?
J’ai d’abord demandé à Michel Noir de créer un cadre dans lequel seraient traitées les questions d’écologie. Au départ, comme il n’y avait pas de vice-présidence, il n’était pas envisageable de créer un service. Une cellule environnement a donc vu le jour en 1990, puis la mission écologie urbaine, en 1991. Il y avait une indication formelle dans ma demande : la structure constituée devait avoir un mode de fonctionnement transversal, pour nous faciliter l’accès à tous les projets en cours.
Comment avez-vous incité les services à prendre en compte l’écologie urbaine ?
En réalisant un document de cadrage en concertation avec eux : la charte de l’écologie urbaine en 1992. Ce fut un outil mémorable qui a permis de convaincre les services de mettre en place des actions qui prendraient en compte cette thématique. Le Conseil communautaire le vota à l’unanimité. Nous n’avions pas un budget élevé, l’originalité de la démarche résidait dans le fait que les projets étaient ceux des services. La mission écologie n’apparaissait pas directement en tant que maître d’œuvre.
D’où est venue l’idée d’avoir une structure transversale ?
Du sujet lui-même. En effet, il n’était pas envisageable de prendre les questions environnementales de manière partielle, sectorielle. Par exemple, la question de l’eau nécessitait d’être abordée sous différents angles : la qualité, la gestion des cours d’eau, la protection de la ressource etc. L’agriculture aussi concernait de nombreuses directions. Et il en était de même pour les questions d’assainissement et d’urbanisme.
Comment Michel Noir a-t-il intégré politiquement l’écologie urbaine au cours de son mandat ?
Au départ, c’est essentiellement Jean Villien, responsable de la mission Ecologie, et moi-même, qui avons œuvré pour que l’écologie soit prise en compte dans les différents projets du Grand Lyon.
La charte de l’écologie, fut le cumul de toute l’expérience que l’on avait depuis trois ans. Elle a été votée à l’unanimité parce que nous avions fait un gros travail d’explication auprès des techniciens et des élus. A la fin du mandat, l’ensemble des vice-présidents avait même été mis à contribution pour recueillir de manière publique les attentes et les buts poursuivis par le « monde de l’environnement » lors d’une grande réunion qui avait eu lieu à l’Ecole Normale Supérieure. Elle devait servir de « pont » entre la population et l’instance politique qui devait répondre de son action. Les élus n’étaient pas sûrs de pouvoir répondre à tout. Ils répondaient donc de manière simple qu’il y aurait des réponses aux préoccupations émises, même si elles devaient être différées dans le temps.
Pour les autres élus du Grand Lyon, était-il aussi évident de prendre en compte l’écologie urbaine ?
Pour beaucoup, l’aménagement de l’espace portait prioritairement sur l’habitat ; les zones urbaines s’étendaient en tâche d’huile. La pression foncière s’accentuait. Il fallait expliquer aux administrés la nécessité de protéger les milieux naturels, y compris les zones humides. Certains agriculteurs estimaient mieux connaître le sujet que nous, alors que leurs pratiques agricoles aggravaient les risques d’inondation, de pollution et dénaturaient les paysages par la suppression des haies bocagères, ou le non traitement des lisières des bois etc. Nous n’avons pas été pris au sérieux immédiatement. Il a fallu que l’on fasse nos armes en prouvant, grâce à des données scientifiques que nous centralisions, les conséquences de certaines actions.
En tant qu’élu des Monts d’Or, étiez-vous finalement plus sensible aux questions d’écologie urbaine que les autres élus ?
Sans doute que la présence de plusieurs communes rurales a permis au Grand Lyon d’évoluer dans ce sens. En tant que maire de Poleymieux, il ne m’était pas concevable de traiter l’urbain en laissant les autres sujets de côté, et notamment les questions environnementales.
Mener une telle politique passait souvent par des luttes ? Quels étaient alors vos arguments ?
Il a fallu parfois affirmer nos positions et l’on nous prenait souvent pour des rêveurs, alors que telle n’était pas notre intention. Pour convaincre, je prenais pour argument le besoin de conserver des continuités vertes, des friches agricoles, des corridors écologiques pour préserver la faune ou la flore etc. Aujourd’hui, protéger certaines zones ou certaines espèces parait évident, mais à l’époque, il fallait lutter pour limiter les constructions. Nous avons d’ailleurs essuyer quelques échecs, souvent parce qu’il n’était pas évident de négocier financièrement les terrains concernés. La création de la Maison de l’environnement a permis un soutien fort des associations de protection de la nature et de la faune.
L’agglomération lyonnaise vous a semblé en retard ou en avance sur son temps ?
J’avais plutôt l’impression que nous étions en avance par rapport à d’autres grandes agglomérations, au moins dans les idées. Mais nous étions persuadé que celles-ci allaient tôt ou tard prendre corps. Celle de mettre en place les continuités vertes de Miribel-Jonage jusqu’à Vernaison s’est bien réalisée. Pourtant, il paraissait invraisemblable à l’époque de protéger certains secteurs comme la Feyssine par exemple porteur initialement d’un projet urbain important.
Le contexte national et international vous a-t-il aidé dans votre démarche ?
Cela a manifestement joué un rôle. Je crois qu’au niveau international notre expérience a aussi influé sur d’autres agglomérations. A l’époque où le réseau des Eurocité s’est créé, j’ai été le premier président de la commission environnement et pendant plusieurs années, Lyon a organisé des colloques internationaux sur les questions d’écologie urbaine. C’était l’une des premières fois que l’on voyait douze à quinze villes européennes, souvent représentées par leur maire, réunies pour échanger sur leurs pratiques.
Au-delà de l’échange de pratiques, comment avez-vous façonné la section environnement des Eurocités ?
J’ai tout d’abord dit qu’il fallait profiter des expériences d’autres villes européennes. Ensuite, si l’Europe s’intéressait vraiment à l’environnement, il fallait que nous obtenions des aides financières. Donc la question de savoir comment cette question pouvait s’intégrer dans les budgets européens s’est posée. L’idée était de demander une aide pour que les agglomérations s’occupent davantage des questions environnementales et de leur qualité de vie. A l’époque, les échanges d’expériences ont été fructueux, mais nous n’avons pas obtenu les budgets escomptés…
Et qu’avez-vous ramené de la Conférence de Rio de 1992 ?
J’ai ramené une volonté de faire davantage encore. J’ai aussi constaté la manière dont la France était reconnue au niveau international par des associations caritatives et des ONG environnementales. J’ai senti qu’il y avait une réelle demande de leur part, à laquelle nous n’étions pas sourds d’ailleurs. Cela était peut-être dû au fait que nous nous étions préparés, pendant le mandat de Michel Noir, à être dans un dialogue constructif avec la société civile. Un mouvement mondial était en marche, et j’ai su que ce que nous demandions était inéluctable, que nous allions être obligés de continuer. Je me suis senti en phase avec les acteurs présents à Rio, et avec les conclusions et les compte-rendu dont certains axes étaient très applicables et concrétisables dans une agglomération comme la nôtre.
Quelles incidences concrètes ces échanges de pratiques ont-ils eu sur le Grand Lyon ?
Ils ont rendu crédibles nos demandes auprès des services. Nous pouvions nous appuyer sur ce que faisaient des villes comme Amsterdam, Lisbonne, Turin ou Barcelone. Nous constations d’ailleurs que Barcelone évoluait déjà dans le sens d’une large place faite à l’écologie urbaine. A l’époque, ils venaient alors chercher l’expérience chez nous, alors que désormais c’est nous qui allons chercher l’expérience chez eux.
Et aujourd’hui, pourrait-on revenir en arrière et moins prendre en compte l’environnement ?
Non, je ne crois pas. Je pense simplement que pour qu’il y ait une continuité de la démarche, il ne faut pas une trop grande démultiplication des fonctions pour répondre à ces questions. Sinon, cela peut générer un manque de cohésion entre les acteurs.
L’approche transversale que vous avez instaurée existe-t-elle toujours ?
Lors de la création de la Mission Ecologie, c’était indispensable. Depuis, les services sont devenus adultes et disposent tous de référents pour les questions d’environnement ou de développement durable. Ils ont donc peut-être moins besoin de cette approche, sans pour autant dire qu’ils n’y a pas de besoin.
L’écologie urbaine n’est pas un sujet comme les autres ?
Non, parce qu’il existe toujours une alternative qui peut être crédible pour ne pas prendre en compte cet enjeu. Par exemple, une personne qui voulait installer une zone artisanale dans une continuité verte arrivait avec des arguments économiques et financiers qui primaient souvent sur l’environnement ! Un autre argument, interne celui-là, était la mise du poids financier de l’entretien des zones naturelles. Faudra-t-il payer des cantonniers ? Alors que j’avais assorti ce projet de conventions entre le Grand Lyon et des agriculteurs, pour maintenir à la fois cette continuité verte et l’agriculture… Beaucoup ne croyaient plus à l’agriculture péri-urbaine.
Et donc lutter pour la prise en compte de l’écologie urbaine et de l’environnement, est-ce encore fondamental aujourd’hui selon vous ?
Oui, tout à fait. Si nous étions sur les mêmes bases que celles qui existaient avant 1980, nous aurions une agglomération très minérale. Nous n’aurions plus beaucoup d’arbres. La démarche que nous avons menée était volontaire. Si nous ne l’avions pas menée, nous aurions perdu manifestement une vraie qualité de vie. Il ne faut pas non plus abandonner l’agriculture péri-urbaine qui est l’une des plus rentables. Il faut une vraie volonté politique pour afficher sa nécessité. L’idée politique à exploiter est de dire que l’agglomération lyonnaise présente tous les atouts culturels d’une ville, et, à quinze kilomètres, tous les atouts culturels de la campagne, au-delà même des parcs urbains. Peu de villes peuvent s’enorgueillir de tels atouts. Pour les personnes qui viennent de l’étranger, c’est un vrai argument qui deviendra de plus en plus payant dans le temps.

Article
Quel réseau d’acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique ?

Interview de Anne-Marie Laurent
De la Direction Environnement du Département du Rhône à celle de la Métropole de Lyon

Interview de Jérémy Camus
Vice-président du Grand Lyon chargé de l’Alimentation

Interview de Équipe Notus et ferme FUL

Interview de Frédéric Ségur
Responsable de l'Unité Arbres et Paysage

Interview de Nadia MABILLE
Chargée de mission Agenda 21 au Grand Lyon en 2009

Interview de Jean VILLIEN
"Le Ministère de l’environnement de l’époque s’est inspiré de la politique menée dans le Grand Lyon pour mettre en place une méthode de réalisation des chartes d’écologie urbaine".

Article
Cet article appelle à s'extraire du dualisme nature/culture et donne à voir d'autres manières d'être au monde.

Article
Quelques données pour prendre la mesure du côté sombre de l’éclairage artificiel.