De l’intérêt des jardins et du jardinage pour l’habitat social et la santé psychique

Texte de Béatrice CHARRE et Mireille LEMAHIEU
De nouvelles formes de jardins se développent et présentent un grand intérêt pour l’habitat social.
Interview de Benoit EYRAUD
<< Le développement partenarial n’a pas à se faire au détriment d’une réflexion continue des missions, mandats et compétences de chaque institution >>.
Benoit Eyraud est sociologue au CERPE (Centre d’Etude et de Recherche sur les Pratiques de l’Espace, Lyon.)
Dans le cadre de la Conférence d'Agglomération de l'Habitat, le Grand Lyon a initié un travail partenarial dans le but de traiter la situation de familles en grande difficulté dans leur environnement. On a pu constater, à cette occasion, qu'une part significative des familles approchées compte un de ses membres comme souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques importants. La nature de ces troubles dépasse les compétences des organismes qui interviennent habituellement en matière d'accompagnement social lié au logement.Pour y remédier, une démarche a été engagée avec les hôpitaux psychiatriques de l'agglomération lyonnaise et avec tous les organismes concernés par la santé mentale. L’objectif étant de concilier le maintien ou l’accès au logement, pour les personnes souffrant de troubles et d’assurer la tranquillité pour tous. Le Grand Lyon copilote ce projet avec l’État, en lien avec un nombre important de partenaires : hôpitaux, bailleurs sociaux, bailleurs privés, CAF de Lyon, associations….Les « 4 familles » de partenaires sont parties prenantes à ce projet (les bailleurs, les hôpitaux, les associations et les familles, les intervenants sociaux et médico-sociaux).
Des processus de concertation inter institutionnels sur la « santé psychique et l’habitat » apparaissent un peu partout en France, et notamment à Lyon. Qu’en pensez-vous ?
Il faut faire un petit détour historique pour comprendre pourquoi les institutions sanitaires, les institutions du logement et de l’action sociale se sont mises à travailler en réseau. A partir des années 80, il y a eu de nombreuses interpellations en provenance du terrain. Infirmiers de la psychiatrie, accompagnateurs RMI, personnels des missions locales… faisaient le même constat : « les difficultés dont nous parlent les usagers ne sont pas celles pour lesquelles nous sommes mandatés ». Des questions de santé et santé psychique se sont dites auprès de professionnels du travail social et des questions administratives et financières se sont dites auprès de professionnels de la psychiatrie et du psychisme. Ce court-circuitage a, bien sûr, rendu difficile le travail des uns et des autres et a nécessité une réflexion collective sur la manière dont ils pouvaient s’adapter. Le détour historique qu’il est nécessaire de faire pour comprendre une telle situation se situe à la fin des trente glorieuses, avec le début de la crise économique et ses répercussions sur le marché du travail. Des raisons sociales ont causé des souffrances psychiques. Chômage, pauvreté, baisse de l’estime de soi et dépression sont devenus des symptômes concomitants. Le développement d’une nouvelle forme de précarité a conduit différents publics à confier ses souffrances à des professionnels qui étaient jusque-là aptes à y répondre. Ceux-ci ont été mis en difficulté. Cette nouvelle réalité a été problématisée par de nombreux travaux de chercheurs et d’acteurs de santé publique. Parmi les plus célèbres, il y a eu le rapport Lazarus, « Une souffrance qu’on ne peut plus cacher », au milieu des années 90 ; l’ouvrage de Pierre Bourdieu « La misère du monde » en sociologie, les travaux de l’Orspere dans le champ de la santé mentale, et « Souffrance en France » de Christophe Desjours… Cette thématisation de la souffrance sociale a rendu politiquement acceptable sa prise en compte dans la réorganisation des prises en charge.
Ce n’était quand même pas nouveau en psychiatrie ?
Le détour historique permet également de mieux comprendre ce qui s’est passé du côté de la psychiatrie. La politique de « deshopitalisation » qui a remplacé le traitement asilaire de la maladie mentale à partir des années 60 considère que les personnes doivent être laissées dans leur milieu de vie et soutenues par un accompagnement de proximité. Cette nouvelle politique psychiatrique s’est développée à travers la forme du secteur. Secteur qui est finalement resté très « hospitalo-centré » ! Les malades qui, il y a quelques années, auraient été hospitalisés sur une longue durée, ne font plus qu’un bref séjour à l’hôpital ou bien sont pris en charge sur un mode ambulatoire. La psychiatrie porte peu les conséquences des difficultés rencontrées au quotidien par ces personnes. C’est la famille qui se retrouve en première ligne, avec, à défaut, le voisinage, la communauté de vie, puis les professionnels de l’habitat, de l’action sociale, de l’éducation, de la protection tutélaire, et, parfois, du milieu pénitentiaire. Le terme de « santé mentale » est venu désigner ce champ assez large dans lequel se trouvent les maladies mentales traditionnelles et les nouvelles formes de souffrance psycho-sociale. La convergence de ces deux types de difficultés sont venues se dire dans la ville, dans la communauté, dans l’habitat, auprès des proches et de l’environnement familier. C’est cette formulation dans des lieux nouveaux qui a déclenché la réflexion sur le besoin d’autres modes de prises en charge et d’autres formes de partenariats. Les professionnels de l’habitat ont notamment pris une place qu’ils n’avaient pas auparavant : ils sont parmi les premiers à être interpellés par les voisins et l’environnement proche.
A votre avis, qu’est-il possible d’attendre de ces processus de concertation ?
Ces partenariats peuvent prendre des formes variables selon les territoires : conseils locaux de santé mentale, lieux de concertation à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’une communauté urbaine comme celle du Grand Lyon. Ces concertations sont le fruit de réflexions qui ont eu lieu initialement dans chaque institution. La psychiatrie s’est interrogée sur les modes d’accompagnement qui seraient les plus adaptés pour permettre à des patients de revenir en logement indépendant. Les bailleurs sociaux se sont demandés s’il fallait recruter des professionnels de la médiation ou de l’accompagnement social pour gérer certaines situations délicates. Les tuteurs et curateurs ont réfléchi aux moyens de préserver le lieu de vie de personnes en difficultés. Tous ont fait le constat qu’il fallait travailler de manière transversale et redéfinir au cas par cas les interventions des uns et des autres, car tout le monde était confronté à l’expression de la souffrance psycho-sociale dans la ville et l’habitat. Les temps de concertation sont l’occasion de présenter les compétences mises en œuvre par chacun tout comme leurs limites d’intervention. Des situations ne relevant de la responsabilité directe d’aucune tutelle sont discutées pour trouver collectivement des solutions : cas d’une réclusion à domicile, locataire qui se laisse envahir par des « squatters », avec tous les troubles de voisinage que cela peut entraîner… La question qui se pose désormais de manière plus générale, c’est « qu’est-ce qu’on attend de ces nouvelles formes d’intervention dans la vie des personnes » ?
Pourriez-vous donner des exemples concrets d’intervention ?
Il s’agit d’interventions à domicile. Un infirmier psy, un tuteur ou un professionnel du logement va interpeller quelqu’un sur l’état d’hygiène de son appartement. Ce peut être aussi l’organisation d’une médiation entre un locataire qui fait régulièrement trop de bruit et ses voisins. Actuellement, aucun professionnel n’est spécifiquement mandaté pour ce type d’actions. Cependant, dans le cadre des politiques sociales du logement, certains se spécialisent dans l’accès et le maintien à domicile de personnes fragilisées : aide à l’appropriation et à l’ameublement de l’appartement, attention donnée au bon versement des loyers, régulation des relations avec l’entourage… L’intervention à domicile est un exercice difficile. Les risques d’intrusion et de violation de l’intimité sont importants. L’enjeu est de se donner des garde-fous, des points de repère pour savoir jusqu’où et comment intervenir. Que faire face à une porte fermée ? Il faut toute une négociation empreinte de grande prudence pour qu’une personne en difficulté accepte d’ouvrir sa porte et se laisse aider, au gré des visites. Il existe des formes contraintes d’intervention, avec appel aux services d’hygiène et d’environnement de la ville pour des questions de salubrité publique, appel à la police ou aux services psychiatriques si la personne se met en danger ou met en danger autrui. La coopération de la personne va néanmoins être recherchée au maximum : beaucoup de professionnels appréhendent fortement ces recours à la contrainte. Si la psychiatrie en a une certaine pratique, c’est quelque-chose de relativement nouveau pour les professionnels de l’habitat et de l’action sociale. La concertation sert à se donner des critères collectifs pour savoir quand et comment utiliser ce type d’outil.
Donc, pour reprendre votre propre question, qu’est-ce qu’on attend de ces nouvelles formes d’intervention dans la vie des personnes » ?
L’idéal commun à ces professionnels était de favoriser l’émancipation de personnes en proie à diverses formes de dépendance : santé, conditions de vie, relations… La visée politique sous-jacente était de rendre à chacun sa place de citoyen apte à s’investir dans la vie sociétale. Cet idéal a pris du plomb dans l’aile ! La crise économique a drastiquement restreint l’accès au travail des personnes handicapées. Elles sont par conséquent maintenues dans une assistance économique, quelle qu’elle soit, qui réduit d’autant leur niveau d’indépendance. L’idéal d’émancipation s’est peu à peu transformé en idéal de mieux-être : les interventions des professionnels visent désormais à améliorer les conditions de vie des gens, ou, a minima, à soulager une partie de leurs souffrances. Comment ? En tentant d’assurer une prise en charge médicale adéquate, si besoin est, et en facilitant la régulation sociale des gens avec leur entourage. Ce type d’interventions a, bien sûr, un impact sur la façon dont il est perçu par les bénéficiaires. Lorsque l’individu a cumulé une longue période de chômage assortie de la reconnaissance d’une invalidité et que sa vie familiale est fortement dégradée (divorce, rupture avec les enfants, isolement), les aides qu’on peut lui apporter sont tout à fait recevables. Un individu jeune, qui sait que les enjeux de son existence se situent bien au-delà de l’investissement dans son logement et d’une bonne entente avec son voisinage, peut manifester des réactions de refus. Les modes d’intervention apportant des améliorations de proximité peuvent, en effet, être interprétés comme la confirmation douloureuse d’un renoncement fait des idéaux de vie et d’autonomie. C’est intéressant à souligner car ceci explique le décalage qui peut exister entre la bonne volonté, le remarquable travail de professionnels de terrain et la réticence de certains usagers. Cela peut susciter incompréhension et repli des professionnels mais, à l’échelle de la vie de l’individu, accepter ces aides reviendrait à s’inscrire dans une démarche de renoncement beaucoup trop coûteuse.
A votre avis, quelles sont les limites éventuelles d’un processus de concertation ?
Il n’y a pas de limites intrinsèques à la concertation. Elle est juste à resituer dans un contexte global de politiques publiques et de dynamiques professionnelles. Le développement partenarial n’a pas à se faire au détriment d’une réflexion continue des missions, mandats et compétences de chaque institution. Que la psychiatrie, les bailleurs sociaux et l’action sociale travaillent ensemble ne doit pas dissimuler l’enjeu qu’il y a pour la psychiatrie de se réorganiser et de s’adapter aux mutations actuelles. La concertation sert parfois de vitrine pour éluder ces questions. Très concrètement, l’écart entre le niveau de réflexion très poussé des acteurs de terrain sur la souffrance psycho-sociale et celui de l’institution elle-même est important. Cette rupture peut être dissimulée et dédouanée par la concertation. Je pense la même chose pour les acteurs de l’action sociale et de l’habitat. Il y a, depuis une vingtaine d’années, une mutation du métier de bailleur social qui passe par un fort développement des postes de fonction sociale. Ces professionnels s’investissent dans des réunions partenariales, mais l’insuffisance de communication effective avec leurs directions empêchent les uns et les autres de prendre la juste mesure des réorganisations et de s’interroger sur leurs pertinences. Quand les bailleurs sociaux se positionnent sur le maintien à domicile des habitants âgés en organisant la venue de services ou bien lorsqu’une politique d’attribution, ou, autrement dit, de peuplement se fait en sélectionnant des profils de locataires plutôt que d’autres, les directions s’assurent-elles d’être en phase avec les difficultés rencontrées par leurs professionnels de terrain ? Le temps passé à la concertation ne devrait-il pas davantage être consacré à faire remonter les problèmes au sein de l’organisme ? C’est bien souvent un alibi pour ne pas réfléchir de manière plus globale à l’orientation des institutions concernées.
Pourtant, des solutions innovantes peuvent émerger des processus de concertations et nourrir des instances décisionnelles ?
Je m’explique. La concertation ne doit, par exemple, pas dissimuler la pénurie de logements disponibles. Des moyens importants sont alloués au développement de l’accompagnement social pour garantir une certaine sécurité aux bailleurs. Certes, c’est important d’être à l’écoute des difficultés sociales là où elles s’expriment. Néanmoins, cette réponse « micro » dispense parfois d’apporter davantage de réponses « macro » en termes de politiques de l’habitat, de l’emploi, de l’aménagement du territoire et de santé publique. Les bricolages inventifs des professionnels de terrain, le développement du réseau, les partenariats… tout cela est très riche en ce qu’il conduit à reformuler des limites, des frontières, des compétences. Je trouve cependant que tout le savoir qui s’échange là ne remonte pas beaucoup et n’est pas tellement pris en compte au niveau des politiques plus globales. Il y a là un hiatus qui est problématique.
La concertation semble au moins bénéfique à l’usager, puisqu’il arrive souvent que des solutions soient proposées au cas par cas ?
Chaque institution ne s’adresse pas au même public. Un médecin s’adresse à un patient ou à un malade (ce qui n’est déjà pas tout à fait la même chose), un psychiatre à un patient, un usager de la psychiatrie ou de la santé mentale. Chez les professionnels de l’habitat, il s’agit de locataire, de résident, d’habitant ou de client. Quant aux acteurs de l’action sociale, ce peut être des usagers, des bénéficiaires ou des consommateurs. Bref, selon la dénomination, l’angle sous lequel est abordé la personne n’est pas le même. Il est important d’avoir conscience de cette pluralisation de l’individu. D’un côté, je suis pluriel pour les institutions, de l’autre, je suis une seule et même personne. Il y a une tentation bien compréhensible à dire qu’une prise en charge globale est nécessaire, qu’il y en a assez de la parcellisation des dispositifs, etc. Néanmoins, dans ce mouvement, il y a un risque de toute puissance en croyant que l’intervention va avoir une prise sur l’ensemble de l’individu, avec forcément des conséquences sur sa liberté, son autonomie, son indépendance, son intimité et sa vie privée.
Cette tendance à la prise en charge globale au moment de la concertation présente des dangers pour la personne : comment évaluer jusqu’où cette globalisation lui sera bénéfique ?
Pourriez-vous donner un exemple ?
Un locataire ne souhaite pas forcément que ses voisins ou son bailleur social sachent qu’il est régulièrement hospitalisé en psychiatrie parce qu’il est schizophrène, dépressif ou autre. Il a besoin d’être considéré comme simple voisin, ou simple locataire. L’interlocuteur qui s’occupe de son logement n’a pas à le considérer comme malade ou handicapé. Ce qui ne veut pas dire que cette même personne n’ira pas un jour se présenter pour expliquer un impayé ou faire respecter un droit en disant « je suis malade/je suis handicapé ». C’est une démarche différente. La concertation amène rapidement à la question du secret professionnel. Les informations qui sont partagées vont avoir un impact sur la manière dont la personne va être considérée et sur la violence qui va être faite à son identité sociale ou personnelle. C’est à la fois un intérêt et une limite des réunions de concertation.

Texte de Béatrice CHARRE et Mireille LEMAHIEU
De nouvelles formes de jardins se développent et présentent un grand intérêt pour l’habitat social.
Interview de Régis HERBIN
Directeur du CRIDEV
Interview de Paul MONOT
Président de la Coordination 69, soins psychiques et réinsertions sociales, Président d’ASSAGA, association pour l’accompagnement et la guidance vers l’autonomie des personnes handicapées psychiques, ancien directeur de l’Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu.
Interview de Marie-Christine PILLON
Médecin chef, responsable du pôle intersectoriel de soins et de réhabilitation de l’hôpital Saint-Jean de Dieu

Texte de Stéphanie Pornin et Cécile PEETERS
Cinq dimensions liées à la conception et ayant un impact primordial sur le bien‐être individuel.

Texte de Jean-Pierre VIGNAT
Le besoin est évident en logements protégés et aménagés alors que l’offre est très réduite.

La santé mentale est partout. Entre présentation d’impasses actuelles et évocation de pistes prometteuses, ce dossier vous propose un verre que vous pourrez juger à moitié vide ou à moitié plein.

Interview de Pascal Blanchard
Vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé, aux politiques des solidarités, du grand âge et du handicap.
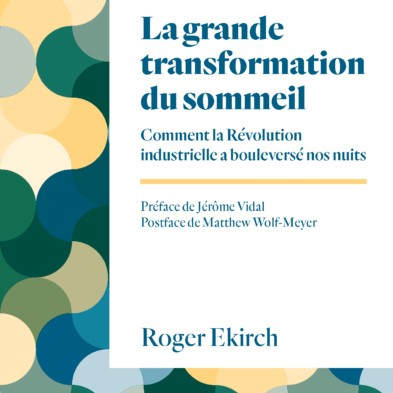
Article
Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.