L’ESPRIT DES LIEUX : Pour sortir de l’alternative : patrimoine contre projet urbain

Étude
Présentation de l'expérience « esprit des lieux » à Vaulx-en-Velin.
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Régis NEYRET
<< C’est pour des raisons de développement touristique - donc rien à voir au départ avec un intérêt pour le patrimoine - que nous avons décidé de nous intéresser au Vieux Lyon, quartier à l’époque complètement déshérité >>.
Interview de Régis Neyret, passionné par le patrimoine à Lyon et en Rhône-Alpes, directeur de presse et éditorialiste à la retraite.
Surnommé parfois « Monsieur Patrimoine » à Lyon tant il s’est investi dans ce domaine, Régis Neyret a été de ceux, qui, à la tête de l’association La Renaissance du Vieux Lyon ont imposé à la municipalité de Louis Pradel la sauvegarde de ce quartier dans les années 60.
Retour sur ce combat qui s’est ensuite déplacé à d’autres échelles (avec Civitas Nostra, « Patrimoine Rhônalpin », etc.) et a amené près de 40 ans plus tard à l’inscription du site historique de Lyon au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
J’ai commencé ma vie professionnelle durant les dernières années de la vie d’Edouard Herriot dont je me se suis rendu compte, bien plus tard, qu’il avait été un très grand maire pour Lyon, du moins jusqu’aux années 1935/38. Patron d’une petite affaire de presse périodique, j’éditais à la fois des journaux économiques (dont « Bref Rhône-Alpes » et « Entreprises Rhône-Alpes » qui existent toujours) et une revue (« Résonances » bientôt associée à « La vie lyonnaise ») qu’on appellerait aujourd’hui un news magazine. J’ai assisté, en tant que journaliste, à l’élection de Louis Pradel, il faudrait plutôt dire la prise de pouvoir… Les conseillers municipaux se battaient pour la succession. La gauche avait voté pour Pradel, et dans les couloirs on commentait : « bien sûr, ils ont pris le plus anodin et cela ne va pas durer ! » Cela a duré 20 ans… On s’est vite aperçu que le pouvoir qui se mettait en place était un vrai pouvoir. Le seul contre-pouvoir était autour de la presse, pas encore autour des associations.
La presse écrite bien sûr — « Le Progrès » très puissant et son concurrent « L’Echo-Liberté » — qui avait un grand pouvoir sur le plan local, dans ces années 60/70, largement perdu depuis. Songez que la télévision n’est arrivée à Lyon qu’en 1955, seuls quelques milliers de foyers en étaient équipés, les radios n’avaient pas connu le développement qu’elles ont eu depuis… « Le Progrès » était certes très pradélien, ayant toujours été partisan du maire de la ville de Lyon, mais parmi ses journalistes, certains n’étaient pas pradéliens. Au moment où l’on a commencé à s’intéresser au Vieux Lyon, on a essayé de faire de ce réseau du pouvoir, une forme de contre pouvoir.
Il fallait aussi, évidemment, compter avec l’Etat, infiniment plus présent qu’il ne l’est aujourd’hui. Pour les réalisations urbaines et l’aménagement, les choses ne pouvaient bien se passer que s’il y avait une relative complicité ou entente entre les services exécutifs de l’Etat, dont la direction de l’Equipement, et le maire.
Tout commence avec ma participation à la Jeune Chambre Economique [JCE], mouvement international qui réunit, encore aujourd’hui, les jeunes cadres de moins de 40 ans. J’en étais membre dans les années 56-57 ainsi qu’un certain nombre de mes confrères, dont Jean Matagrin, patron du « Tout Lyon », et Marc Levin dont le petit journal « 15 jours à Lyon » était lié au Syndicat d’initiatives. A la JCE, au sein d’un petit groupe très dynamique qui comptait aussi le président du Syndicat d’initiatives et commerçant lyonnais Paul Defond, on s’est cherché des sujets pour faire avancer la vie de la cité.
C’est pour des raisons de développement touristique — donc rien à voir au départ avec un intérêt pour le patrimoine — que nous avons décidé de nous intéresser au Vieux Lyon, quartier à l’époque complètement déshérité, habité par des gens modestes, souvent copropriétaires de leurs appartements qu’ils avaient rachetés dans les années 40. Depuis la guerre de 1914 jusque dans les années 70, on manquait de logements en France, et les propriétaires dont les loyers étaient bloqués par la loi de 1948 n’en tiraient aucun profit et ne pouvaient guère les améliorer. Le Vieux Lyon se dégradait… Pour que Lyon soit une ville touristique — ce qu’elle proclamait tout en en étant très loin ! —, nous avons estimé qu’il fallait pouvoir offrir aux touristes des occasions de sorties, de distractions. Le Vieux Lyon s’imposait à nous comme une évidence. Nous nous sommes alors aperçus que Louis Pradel sortait des cartons un projet de la précédente municipalité, consistant à démolir le pont du Change, premier pont permanent de la cité, pour le remplacer par un nouveau pont (l’actuel pont Maréchal Juin) et le prolonger ensuite par un grand boulevard urbain qui monterait jusqu’à Fourvière.
C’était complètement incompatible avec notre projet de développement touristique ! On est alors parti en guerre contre ce projet, avec la JCE. J’ai conservé pieusement une lettre où Pradel exposait au président de la JCE que cette opération permettrait de dégager à la fois Fourvière, et la mairie du 5ème arrondissement, située alors dans le Vieux Lyon, ce qui, nous disait-il, « facilitera les photos de mariage » ! L’argument était maigre et nous avons décidé d’empêcher la destruction du pont du Change. Nous étions trop petits pour avoir gain de cause. Il n’empêche que cette bataille nous a soudé et que nous avons décidé de nous inscrire à l’association locale, la Renaissance du Vieux Lyon (RVL) qui existait depuis une dizaine d’années, mais dormait quelque peu. Avec notre dynamisme, nous avons convaincu l’association qu’il fallait faire découvrir ce quartier.
Oui, une des dates essentielles pour moi est ce 8 décembre 1959, quand, avec nos amis de la JCE et de la RVL nous avons décidé d’éclairer dix cours dans le Vieux Lyon. Elles étaient dégueulasses, mais la nuit on ne le voyait plus ! Le directeur du Service d’éclairage de la Ville de Lyon, Monsieur Pabiou a accepté de les éclairer. Nous avions branché des Teppaz, les tourne-disques de l’époque, aux prises que les résidents nous fournissaient. Avec nos amis de la RVL, on a réalisé une propagande fabuleuse, fait publier des articles dans « Le Progrès », l’Echo-Liberté, etc., pour dire aux gens : au lieu de vous promener le soir du 8 décembre dans la Presqu’île, d’aller voir la vitrine de Bonnard, charcutier rue Grenette…, comme vous le faites chaque année, venez voir le Vieux Lyon ! Ce soir-là, plus de 100 000 personnes se sont précipitées dans le Vieux Lyon à la suite de cette opération de relation publique ; cela a été exceptionnel, au point que les autorités ont fait fermer la passerelle Saint-Georges qui menaçait de s’écrouler. St-Georges était le plus visité car c’était à alors le quartier le plus à la mode du Vieux Lyon — si l’on peut dire —, car des artisans s’y étaient installés, dont Simone Pelosse et son atelier de céramique. Cet événement a fait démarrer le quartier.
C’est probable, car un groupe folklorique « La Lyonnaise » avait organisé en liaison avec nous une soirée dans le Vieux Lyon. La question du pont nous divisait, ceci étant, le pouvoir politique était plutôt sympathique et nos relations parfaitement correctes.
Suite à une opportunité (un prêt d’argent de mon père), nous avons eu la chance avec ma femme de pouvoir nous installer en 1960 dans le Vieux Lyon, place du Change, alors qu’à la JCE nous étions tous extérieurs au quartier. Dès ce moment, je suis devenu pourrait-on dire un « Vieux Lyonnais », ce qui a facilité mon élection en 1961 comme président de La Renaissance du Vieux Lyon. Alors que je connaissais l’influence d’un homme de presse, j’ai pris conscience de celle que l’on peut acquérir en tant qu’association.
Nous n’étions pas des « excités » qui allions bloquer le passage des engins. De son côté, Pradel avait bien pris conscience du besoin d’un quartier intéressant et avait assez vite accepté que l’on crée une Société d’Économie Mixte de Restauration du Vieux Lyon (SEMIRELY), avant que le quartier ne soit classé « secteur sauvegardé » suite à la loi Malraux du 4 août 1962. Le Vieux Lyon a été un des premiers de France, sinon le premier, en 1964, mais la restauration du Vieux Lyon avait déjà été lancée, en accord avec Louis Pradel, dès 1961 par la création de cette société. C’est dire que la municipalité n’était pas contre. A la RVL on travaillait aussi beaucoup avec les services de la Ville. Louis Pradel s’est intéressé au Vieux Lyon dont il a décidé la piétonisation, une des premières d’un quartier en France.
Par contre, Louis Pradel et les élus pensaient toujours réaliser un boulevard : la restauration du Vieux Lyon d’un côté, les voitures de l’autre, ce n’était pas incompatible à leurs yeux. Il a fallu la création, en 1964, du secteur sauvegardé pour que le projet de boulevard disparaisse. A partir du moment où l’Etat a interdit à Pradel de faire sa percée, il a fait construire « son » pont, car il y tenait, un pont à moustaches allant à droite et à gauche. Autre manifestation de ces bonnes relations : une fois élu président de la RVL, j’ai demandé pour le « Bulletin de la Renaissance du Vieux Lyon » que je venais de créer, une préface au maire de Lyon… ; il l’a fait bien volontiers. On avait des relations tout à fait correctes, ce qui ne nous empêchait pas de dire ce que l’on pensait quand quelque chose n’allait pas. C’était plutôt constructif.
Effectivement, pendant que nous menions notre combat, des promoteurs lyonnais démolissaient, en face du Vieux Lyon, rue Mercière, des bâtiments Renaissance de même qualité que ceux actuellement restaurés dans le Vieux Lyon. Considérant qu’il était insupportable de démolir un quartier tout aussi beau que le Vieux Lyon, des associations nationales de sauvegarde avaient lancé des campagnes contre la démolition ; les habitants de la rue Mercière menaient aussi leur combat alors que pendant longtemps ils avaient accepté de se faire dédommager pour partir ; ils s’étaient rendus compte qu’ils pourraient gagner plus d’argent en râlant un peu, et se sont alors mis à exister aussi. Mais Louis Pradel tenait à ce que cette rue Mercière soit démolie. Je me souviens d’une soirée organisée salle Molière par une association nationale de sauvegarde contre la démolition de la rue Mercière, où Pradel était venu très sportivement répondre à ses opposants. Alors qu’on lui avait dit qu’il y avait un escalier Renaissance extraordinaire au 4, rue Mercière, il avait eu cette phrase merveilleuse — car la culture n’était pas sa tasse de thé — : « mais si vous voulez cet escalier on peut le démonter pierre par pierre et le mettre dans le musée gallo-romain »… Pour lui, tout ça, c’était du vieux.
Il est vrai qu’à la RVL on avait une position un peu ambiguë : nous étions contre la démolition de la rue Mercière, mais ne voulions pas le crier trop fort parce qu’on avait surtout envie que l’on restaure le Vieux Lyon.
C’était en effet chacun pour son quartier. Notre bataille était pour le Vieux Lyon ; et les quartiers étaient inégalement dotés en associations qui pouvaient supporter la défense du patrimoine. Ainsi, j’ai toujours été étonné qu’il n’ait jamais existé de véritable association croix-roussienne, alors que les Pentes de la Croix-Rousse sont riches en patrimoine ; quand je me suis battu en 1975 contre la démolition de la montée de la Grande Côte, il y avait peu de support local.
Pour revenir à la rue Mercière, l’association de défense de la rue a finalement obtenu gain de cause, une fois que les promoteurs eurent fini de détruire le nord de la rue, puisque ces derniers se sont rendus compte qu’il leur coûtait moins cher de restaurer que de démolir pour reconstruire, alors que les prix du foncier avaient grimpé de façon considérable. La société promotrice de la rue Mercière a décidé, à la fin des années 70, de restaurer la partie sud de la rue dont elle était propriétaire simplement parce que c’était une meilleure affaire. L’esthétique n’est pas seule en jeu dans ces combats, la dimension économique est très importante…
Oui, le passage du local au national s’est fait à l’occasion du premier colloque national des cités et quartiers anciens que j’avais organisé en 1963 à Lyon en tant que président de la RVL, en liaison avec le Syndicat d’initiatives et la municipalité qui avait prêté l’Atrium de l’Hôtel de Ville pour l’exposition ainsi que les jardins du Palais St-Pierre pour le diner de gala. Le succès a été extraordinaire, c’était un moment important pour le Vieux Lyon. L’événement a attiré de nombreux journalistes et spécialistes parisiens de la question — et chacun sait que tant que Paris ne se mêle pas de ce genre d’opération, on a de la peine à exister — ce qui nous a valu quatre pages entières de reportage sur les quartiers anciens dans Le Monde, deux pages dans Le Figaro, plusieurs papiers dans Combat…
Le préfet du Rhône de l’époque, Roger Ricard, était passionné par notre combat ; nous étions aussi en relation avec l’Etat par le biais du cabinet d’André Malraux, ministre des affaires culturelles. C’est aussi grâce à une aide efficace de l’Etat que les premiers travaux de restauration du secteur sauvegardé du Vieux Lyon ont pu démarrer. La SEMIRELY a touché une somme de 500 000 francs pour les démarrer, sous la conduite d’un architecte en chef des monuments historiques, parisien — à l’époque ils étaient tous parisiens —, André Donzet. La restauration a connu un certain nombre de difficultés, car avant de restaurer, il fallait que la SEMIRELY devienne propriétaire ou s’entende avec les propriétaires.
Elle a, dans un premier temps, acheté des immeubles ou morceaux d’immeubles, et peu restauré. Petit à petit, elle a engagé malgré tout ses premiers travaux, mais s’est vite trouvée à court d’argent. En parallèle, on se battait pour que l’architecte en chef quitte le terrain. Au début des années 70, André Donzet prévoyait en effet un plan de sauvegarde que l’on jugeait désastreux parce qu’il démolissait les deux tiers du quartier, pour en reconstruire un tiers en faux vieux, et pour aérer le quartier avec le troisième tiers. Ce n’était pas du tout ce que nous souhaitions. Mes relations avec Michel Denieul, directeur de cabinet du ministre Jacques Duhamel, nous ont permis d’intervenir de façon efficace. En 1969, il est venu à Lyon, et on a pu lui montrer que les projets prévus par l’architecte en chef n’étaient pas bons du tout.
Vous avez raison. Avec nos amis réunis au colloque sur les quartiers anciens on a créé, « à la lyonnaise », avec des amis du Sud-Est de la France, du Val d’Aoste et de Suisse, une fédération, Civitas Nostra. C’était la Romandie, la Lotharingie si vous voulez, en tout cas ça ne passait pas par Paris. Je me suis ensuite un peu détaché de la RVL (d’autant qu’à la RVL on avait fait voter un principe : le président de la RVL change tous les 3 ans) pour travailler à l’échelle régionale et avec la Suisse. Nous organisions des expositions, publications, etc., mais sans structure, sans statut, Civitas Nostra étant restée pendant des années une espèce d’amicale jusqu’en 1975, où il a fallu créer une association française pour réaliser une étude qui nous avait été confiée par le ministère de l’Environnement de l’époque.
Une des premières réunions de Civitas Nostra s’est terminée par un slogan que la RVL continue à appliquer : « dans les quartiers anciens, les hommes passent avant les pierres ». Notre optique, c’était les hommes. Nous étions révolutionnaires si l’on veut par rapport aux associations de sauvegarde nationales qui se battaient pour garder des pierres, mais semblaient totalement indifférentes à la présence des gens dans ces pierres. La bataille menée contre l’architecte en chef était motivée par le caractère de son projet qui mettait à la porte énormément de gens, et allait dévitaliser le quartier. La Ville de Lyon a accepté d’indemniser André Donzet et l’Etat a nommé à sa place un nouvel architecte en chef, lyonnais cette fois, Jean-Gabriel Mortamet, à qui il a confié le Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon (le plan sera publié seulement en 1981).
Parallèlement à la RVL, dans les années 70, des associations d’habitants se sont créées pour se défendre contre la SEMIRELY estimant qu’on les mettait dehors trop rapidement, qu’on ne les dédommageait pas assez, etc. Quelques promoteurs plus ou moins délicats ont commencé à s’intéresser au quartier. Pour qu’ils ne fassent pas trop de dégâts, on a engagé des batailles, mais c’étaient des batailles feutrées, car à Lyon, on n’emploie pas le canon…
C’est ce qui différencie les secteurs sauvegardés des autres opérations de restauration : les architectes doivent prendre en compte l’intérieur des logis comme l’extérieur, alors que dans les zones de protection du patrimoine, on ne s’occupe que de l’extérieur.
Il y a aussi un autre aspect. Quand on est une association locale de quartier comme la RVL, s’occuper des hommes relève de l’évidence. Travailler avec les gens du quartier, avec les commerçants a été une des originalités du Vieux Lyon. J’insisterai sur les commerçants, car pour transformer l’image d’un quartier, il faut d’abord, puisque dans la ville on voit jusqu’à 4 mètres de hauteur, transformer les rez-de-chaussée ! Une de nos actions principales a été lancée au début des années 60 avec Jean Ferdinand, un de mes vice-présidents, bistrotier rue de la Baleine. Nous avions imaginé une formule avec la municipalité. Elle nous avait avancé de l’argent, 60 000 francs, que l’on avait mis en dépôt dans une banque. Nous distribuions l’intérêt produit aux commerçants qui acceptaient de restaurer leurs façades, en enlevant les placages pour retrouver les arcades d’origine. Nous avons pu les convaincre de participer à notre caisse de prêts, présidée par Ferdinand, qui leur remboursait une partie des intérêts des emprunts consentis. Durant une dizaine d’années, la RVL est intervenue sur 60 commerces, et 60 commerces dans un quartier, cela se voit ! On peut dire que le Vieux Lyon a d’abord changé d’image grâce aux rez-de-chaussée.
Pas seulement Civitas Nostra. En 1977 j’ai été désigné comme représentant des activités culturelles au Comité économique et social qui venait de se créer en même temps que la Région Rhône-Alpes, au côté de Catherine Tasca, directrice de la Maison de la culture de Grenoble, devenue ensuite ministre. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience que la région devenait un espace important, et de l’intérêt à créer une association régionale sur le patrimoine pour discuter avec les pouvoirs régionaux. Cela a donné lieu à la création de « Patrimoine Rhônalpin » en 1983.
Oui, d’un seul coup, alors qu’on sortait d’une époque où avec Pradel il y avait deux pouvoirs, un pouvoir municipal et un pouvoir de l’Etat et aucune concertation, on voit arriver des instances de concertation et une ébauche de pouvoir associatif, en raison aussi de l’action de Paul Scherrer qui avait créé l’Union des comités d’intérêt locaux (UCIL). Tout cela dépend des hommes. Dans la nouvelle municipalité de Lyon, Alain Chaboud et Jacques Moulinier ont été nommés adjoints à l’urbanisme, puis, à la suite des élections de 1983, Jacques Moulinier a eu la charge du patrimoine. J’ai eu l’occasion d’interviewer en 1981/82 Jacques Moulinier ainsi que Bernard Rivalta qui venait d’être nommé adjoint à l’urbanisme à Villeurbanne, alors que j’étais correspondant régional du « Moniteur des bâtiments et travaux publics ». Ils répondaient de la même manière, affirmant qu’il fallait faire participer les gens à l’avenir de leur quartier.
De fait, Jacques Moulinier a été le premier à lancer des opérations programmées d’amélioration de l’habitat avec des comités de pilotage au niveau des quartiers, où il réunissait élus et associations pour réfléchir à l’avenir du quartier. Il a appliqué cette méthode dans le Vieux Lyon où existait une instance de concertation informelle entre les élus (maire adjoint de l’arrondissement, etc.), les habitants, les commerçants, pour réfléchir ensemble à l’orientation des réhabilitations. Jacques Moulinier a été aussi le premier à s’intéresser à la transformation des bâtiments anciens pour en faire des bâtiments contemporains, pour adapter le patrimoine à notre époque. La première opération de ce type a concerné la caserne Villemanzy, sur les pentes de la Croix-Rousse, transformée en résidence d’accueil de chercheurs et artistes étrangers. C’était le début d’une très longue chaîne qui verra par exemple, sous le mandat de Michel Noir, la réhabilitation de la Manufacture des tabacs, ou sous celui de Raymond Barre, celles du fort Saint Jean et du Grenier d’Abondance. A travers ces opérations, l’intérêt que la ville prenait au patrimoine s’est concrétisé.
En 1990, je suis devenu président du Collège régional du patrimoine et des sites, responsable de la création des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). J’ai travaillé autour de la création de la ZPPAUP des Gratte-Ciel à Villeurbanne puis avec Henry Chabert, adjoint en charge de l’urbanisme de Michel Noir puis de Raymond Barre, à la ZPPAUP des Pentes de la Croix-Rousse.
Avant Raymond Barre, il n’y avait pas d’adjoint au patrimoine à la Ville de Lyon. A partir de son élection en 1995 à la mairie de Lyon, il y a un adjoint à la culture et au patrimoine, en la personne de Denis Trouxe. Ce dernier me propose d’être son chargé de mission sur le patrimoine.
Lorsque Raymond Barre a réuni l’ensemble de ses adjoints pour établir son programme, Denis Trouxe lui a parlé de son idée de transformer les Subsistances, caserne abandonnée, en lieu de création culturelle. Raymond Barre a accepté, puis s’est tourné vers moi : « Mr Neyret, sur le plan du patrimoine, auriez-vous quelques idées, mais qui ne coûtent pas trop cher » ? Je lui ai proposé l’inscription du Vieux Lyon parmi les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce à quoi Raymond Barre, homme très cultivé et international, a donné son accord. Peu après, alors que la RVL fêtait son 40ème anniversaire dans les salons de l’Hôtel de Ville, un expert de l’UNESCO et archéologue tunisien, Azzedine Bechaouche a estimé qu’il faudrait rajouter Fourvière au Vieux Lyon ; par la suite, Didier Repellin, l’architecte en chef des Monuments historiques du Rhône et du Vaucluse, auteur du dossier qui avait permis au Palais des Papes d’Avignon d’être inscrit au patrimoine mondial, a fait venir des experts étrangers. Ils ont passé 48 heures à Lyon et conclu qu’il fallait présenter ce qu’on appelle le « site historique du Lyon », incluant les Pentes de la Croix-Rousse et la presqu’île, soit la ville de Lyon telle qu’on la voit sur tous les plans jusque vers 1800, puisqu’elle est restée dans les mêmes limites de l’époque romaine jusqu’à la Révolution française. Il fallait ensuite convaincre Paris, parce que ce sont les Etats qui présentent les candidatures à l’UNESCO.
Quand les services parisiens de l’architecture et du patrimoine ont reçu notre dossier, ils sont allés trouver leur ministre en disant — nous l’avons su par la suite — : « il n’est pas possible que l’on présente Lyon, puisqu’à Lyon il n’y a rien !» C’était la vision que l’on avait de Lyon, depuis Paris et sans doute du monde entier. Le ministre de la culture, Philippe Douste Blazy, ami de Raymond Barre, ne pouvait cependant refuser le dossier. Les services ont alors proposé au ministre que la France présente aussi Provins, petite ville moyenâgeuse au sud de Paris, pour donner au moins une chance à notre pays. Le 5 décembre 1998, l’UNESCO réuni à Kyoto a accepté Lyon et n’a pas accepté Provins. Une grande joie pour nous, mais une joie modeste à Lyon, parce qu’à Lyon on ne manifeste pas sa joie de façon inconsidérée ! Ceci étant, je ne suis pas sûr que tous les Lyonnais sachent que les Pentes de la Croix-Rousse et la presqu’île figurent au Patrimoine mondial. Pourtant, on essaye de faire passer cet élargissement considérable de la notion urbaine de patrimoine, étendue aujourd’hui à l’ensemble de l’agglomération lyonnaise.
Non, je n’en suis pas sûr. Lorsque le site historique de Lyon a reçu l’onction de l’UNESCO, une convention patrimoniale a été signée entre la Ville de Lyon et le Ministère de la culture, avec trois engagements réciproques : restaurer le musée Gadagne pour en faire le musée historique de Lyon ; créer une commission de l’inventaire; et réaliser un programme patrimonial de restauration des monuments historiques appartenant à l’Etat (St-Nizier, St-Jean….), achevé en 2008. On a vu là une ébauche de politique patrimoniale, mais centrée autours des monuments. Depuis, il n’y a pas de nouvelle convention et je ne vois pas de politique patrimoniale à Lyon, contrairement à ce que l’on observe à Vienne par exemple où l’Etat, le Département et la Ville arrivent à s’entendre, malgré des appartenances politiques différentes, sur une politique patrimoniale.
Il y a longtemps que la RVL aurait dû s’occuper d’autre chose que du seul Vieux Lyon ! L’actuelle présidente a accepté la création d’une commission, Lyon Patrimoine. C’est important car le patrimoine à Lyon, c’est aussi l’Hôtel Dieu, les prisons de St-Paul et de St-Joseph. Alors que l’on compte de nombreux « objets » d’intérêt lyonnais ou grand lyonnais, il n’y a pas encore de groupement sur le patrimoine à ces échelles.
Il y a aussi une prise de conscience des comités d’intérêts locaux de la nécessité de passer des problèmes du Vieux Lyon, à ceux de Lyon puis du Grand Lyon. En 2003, le président de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux, Denis Eyraud m’a chargé d’organiser les premiers États généraux du patrimoine du Grand Lyon. Nous avons obtenu de Gérard Collomb l’autorisation d’utiliser la salle du Conseil de la Communauté urbaine pour réunir les associations de l’agglomération. Les 5ème états généraux auront lieu au printemps, sur le thème de la multiculturalité et des patrimoines immigrés.
En parallèle, on assiste à une prise de conscience associative depuis plusieurs années à l’échelle du Grand Lyon. Dans l’Est lyonnais, une dizaine d’associations se sont réunies pour valoriser le patrimoine de leur territoire, à l’image de ce qu’a fait l’Ouest lyonnais autour des Monts d’Or.
Nadine Gelas, vice présidente du Grand Lyon chargée des activités de création et des manifestations culturelles a voulu que les Journées du Patrimoine soient prises en charge par le Grand Lyon, en lien avec la Ville de Lyon. Elles mobilisent la quasi-totalité des communes de l’agglomération sur deux jours par an ; même en ajoutant les grands événements culturels, peut-on appeler cela une politique du patrimoine ?
Je verrai le Grand Lyon comme acteur d’une telle politique le jour où les élus en auront le désir ; cela sera d’autant plus possible que certaines communes ont déjà un adjoint au patrimoine.

Étude
Présentation de l'expérience « esprit des lieux » à Vaulx-en-Velin.

Interview de Gilbert COUDENE
"Il est important et urgent de décréter la culture « cause nationale », tout autant que le défi écologique, c’est une question de survie de l’espèce humaine"

Interview de Régis NEYRET
Journaliste

Interview de Bernadette Angleraud
« Lyon a été très marquée par l'activité de la soie et l'industrie a toujours été plus ou moins dévalorisée ».

Interview de Michel KNEUBUHLER
Direction Régionale des Affaires Culturelles
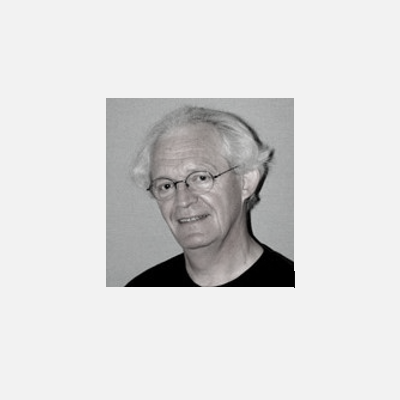
Interview de Philippe DUJARDIN
Politologue, chercheur au CNRS

Étude
Analyse de a place du patrimoine depuis le XIXè siècle : de l'émergence de la conscience de l'intérêt des monuments historiques aux dernières attributions accordées par les ministères de la Culture.

Texte de Philippe Dujardin
« C’est d’une tragédie sans précédent qu’est né le projet de constitution d’un espace public européen ».

Étude
En 20 ans notions de biens publics et de biens communs ont vu leur sens renouvelé par des chercheurs qui y ont vu des outils performants pour la gestion des ressources communes.
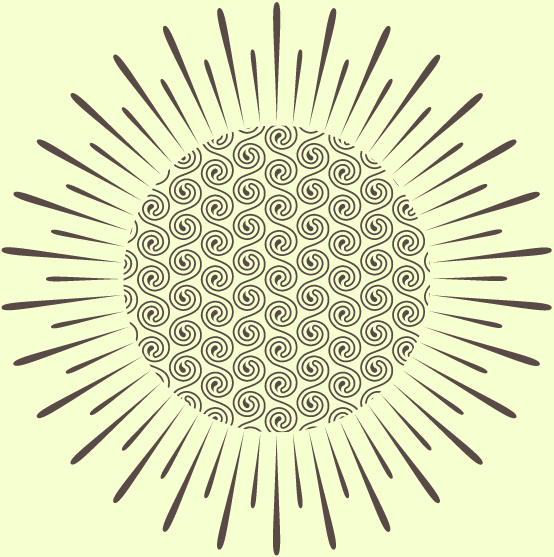
Étude
6 chronologies des emblèmes du territoire du territoire.

Comment l’activité de fabrication de la soie devint-elle un marqueur de révolutions techniques, industrielles et sociales ?
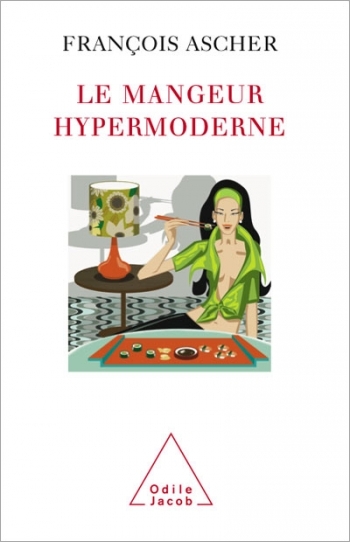
Article
En 2005, l’urbaniste et sociologue F. Ascher imaginait le mangeur d’aujourd’hui. Retour face à ce miroir déformant, qui en dit beaucoup sur le chemin parcouru depuis.

Étude
Le Grand Lyon bouillonne d’initiatives, de projets, d’envies de faire et d’inventer : puisse ce guide aider, encourager et multiplier ces enthousiasmes !

Etat des lieux : le cinéma un secteur en pleine mutation. Et demain? L'avenir du cinéma en salle. L'impact des révolutions technologiques. Interactivité et transmedia : les principales pistes du futur

Retour sur l'héritage technique de Lyon et ses résonances actuelles et futures.
Interview de Daniel Meguerditchian
Historien, responsable de la médiathèque du Centre national de la Mémoire Arménienne

Interview de Marie-Claude JEUNE
Ancienne conseillère pour les arts plastiques à la DRAC Rhône-Alpes

Interview de Marianne HOMIRIDIS
Directrice du bureau et de la galerie des Projets