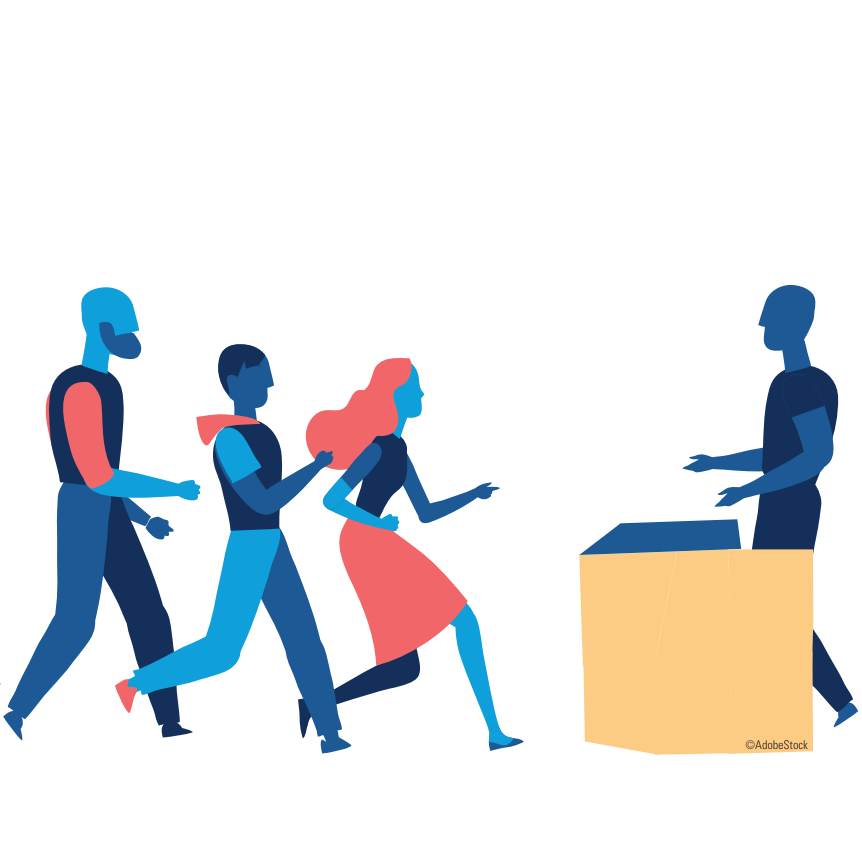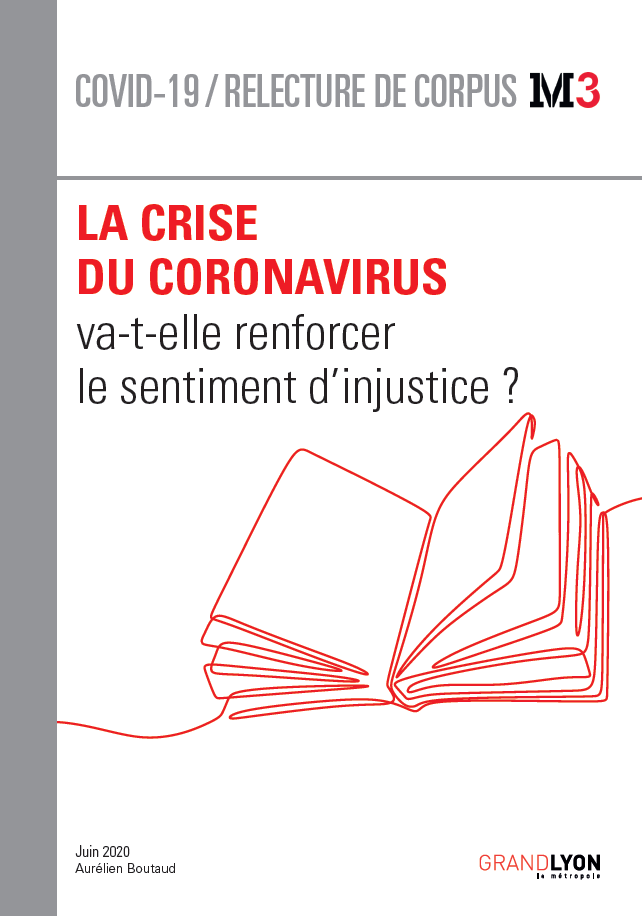Je suis à moitié d’accord avec cette thèse très en vogue selon laquelle le communautarisme est une construction imaginaire et que le communautarisme musulman n’existe pas. Il est indéniable que la notion est pour partie fabriquée par des intellectuels, des élus, des acteurs. Dans le 93, en Seine-Saint-Denis, fabriquer du communautarisme est une manière pour des maires de gérer leur commune. Souvent, les mairies ne cherchent pas le vote de citoyens, mais celui de musulmans. On passe donc de la citoyenneté abstraite au particularisme culturel. Ce passage révèle les antinomies entre une gauche républicaine et sociale et une gauche libérale et multiculturaliste. Comme Michel Onfray le constate, il s’agit de l’opposition entre le peuple « old school » et le peuple « new school ». Sauf que dans cette dernière version, le peuple n’en est pas vraiment un, parce qu’on se contente d’affirmer un dispositif d’identitarisme dans lequel « les communautés » coexistent mais ne se mixent pas. Le politique en est transformé : au lieu de construire une communauté politique autour du principe de fraternité, il « manage » des différences identitaires, réifie des communautés ethno-religieuses dont les membres sortent alors de la citoyenneté et de son universalisme.
Sur le plan historique, le communautarisme est également une construction intellectuelle. Elle concourt à une hégémonie, permet de séparer la culture du groupe dominant, celle de l’homme blanc, posée comme universelle, des cultures minoritaires ou locales. Dans le 93 et même à Paris, à Château Rouge, à Marcadet-Poissonniers, vous trouvez des cafés 100% blancs-bobos, des cafés 100% arabes, des cafés 100% africains. Pourquoi ne pas parler du communautarisme bobo ou blanc ? Pourquoi le communautarisme serait-il uniquement du côté des immigrés ? Il y a une mauvaise foi dès le départ qui va justifier la « lutte contre le communautarisme ». Rappelez vous cette question entendue juste après les attentats de Charlie Hebdo et au moment des « Marches républicaines » des 10 et 11 janvier : « eux vont-ils venir ? », sous entendu, parce qu’ils sont dans le communautarisme. Ceux qui posaient cette question appartenaient à une communauté républicaine, mais blanche. Or cette communauté républicaine s’oppose au républicanisme en tant qu’affranchissement de racines primordiales (race, religion, couleur de peau, y compris la couleur blanche). Il faut déconnecter l’histoire de la République de l’histoire d’une « communauté », arriver à dissocier ce qui est de l’ordre du républicanisme de ce qui est de l’ordre de groupes dominants blancs qui se revendiquent de la République pour véhiculer leurs conceptions. Personne n’a le monopole de la vertu… Cela étant dit, j’ai perçu dans mes enquêtes ce qui pourrait relever de formes de communautarisme.