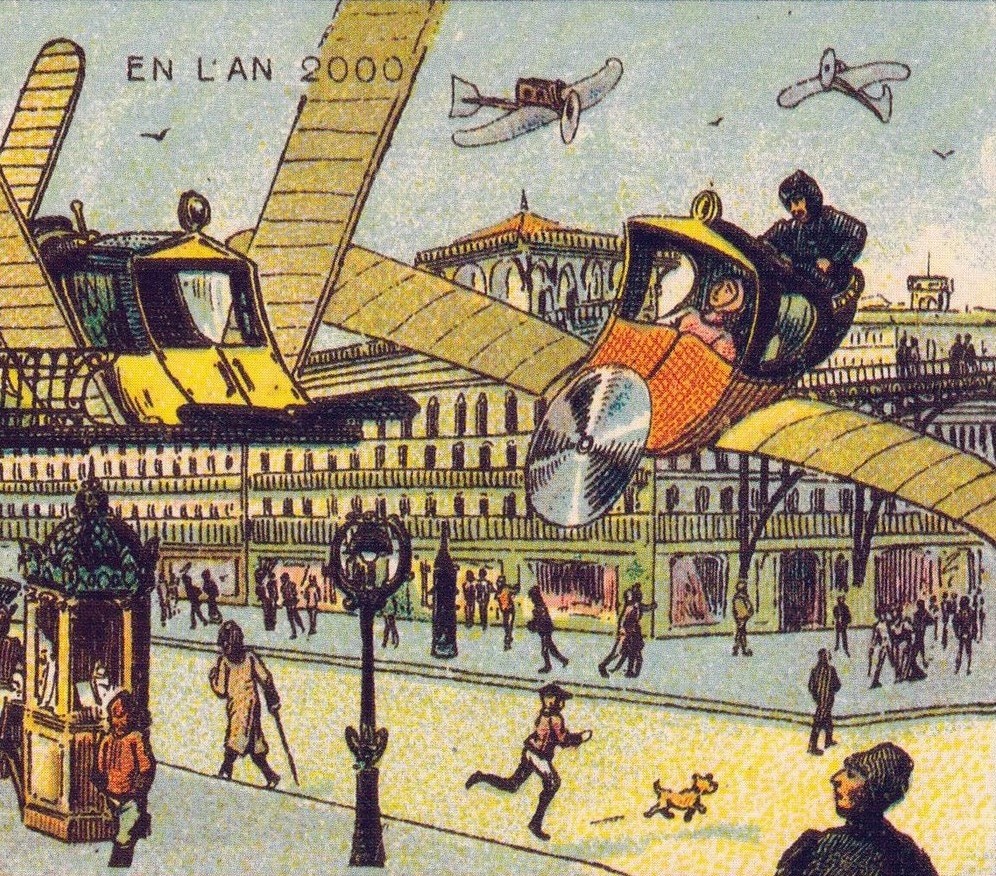Les consommateurs subissent le choix d’un système de production, notamment de l’électricité, qui relève d’un choix politique fait à une époque sans concertation. Bref, un choix confisqué aux usagers et qui oriente considérablement nos modes de consommation. Electricité peu chère, chauffage électrique partout (même si on est en train d’y revenir) : c’est ce qui caractérise notre système de consommation à la française depuis les années 70. Les consommateurs sont captifs d’un système économique qui repose sur une tromperie : on fait croire à tout le monde que l’électricité n’est pas chère, sauf que le coût de l’électricité est en fait dilué dans des taxes, que quoiqu’il arrive le consommateur paie par ailleurs. Résultat, on consomme sans regarder.
On n’a jamais regardé ce qu’on consommait, sauf ponctuellement quand il y a eu le choc pétrolier. En effet, dès qu’on a retrouvé un peu de pétrole ou autre, on s’est remis à consommé comme avant. On fonctionne dans une société qui laisse croire que l’énergie serait toujours abondante. Même aujourd’hui, on sait qu’il y a une crise, mais on nous ressort très rapidement des opportunités liés aux gaz de schistes, aux gaz de houilles, à des ressources qu’on irait trouver en Guyane ou ailleurs. Il y a des débats sur la transition énergétique entre politiques et scientifiques, et dans le même temps, dans la presse, on vous faire croire qu’il ne faut pas s’inquiéter, que dans très peu de temps l’énergie va redevenir abondante, qu’on va remettre des EPR, etc. On fonctionne sur un leurre qui traverse nos sociétés depuis plusieurs décennies.
Donc l’addiction n’est pas une bonne image. On n’est pas addict à la consommation d’énergie : on a fait en sorte que le consommateur soit dans une sorte de spirale. S’il y a un black-out, on ne peut plus rien faire. Un usager qui a opté pour des volets électriques pourra rester dans le noir, et dans le froid parce que sa chaudière – même au gaz – ne démarrera pas… Pas d’eau chaude, pas de système de cuisson, pas de possibilité de connexion… Les choix politiques ont placé notre système dans une dépendance totale. Avec la démultiplication des appareils électriques, et notamment électroniques, il est quasiment inenvisageable qu’on sorte volontairement de cette dépendance. Sauf s’il y a un gros accident et qu’il faille faire des choix drastiques... Mais dans l’état actuel des choses, on est sur une dérive vertigineuse.
Ce n’est pas de l’addiction, car un toxicomane a un choix ; ici, l’usager n’a pas eu le choix de tomber dans cette spirale. Je poursuis la métaphore : pour sortir de l’addiction, il faut que le toxicomane le veuille, il n’est pas question d’envisager qu’un toxicomane soit sevré sans le vouloir. Pour l’énergie, avec la multiplication des appareils électriques et surtout électroniques, il est complètement inenvisageable d’en sortir comme ça. Sauf à envisager un accident… On est dans une dérive technologique stupéfiante, et face à cela on a des « usagers » qui sont de plus en plus « consommateurs », pas des « consom’acteurs ». On ne réfléchit même plus. Dans le même temps, notre société ne peut fonctionner que sur ce modèle là…