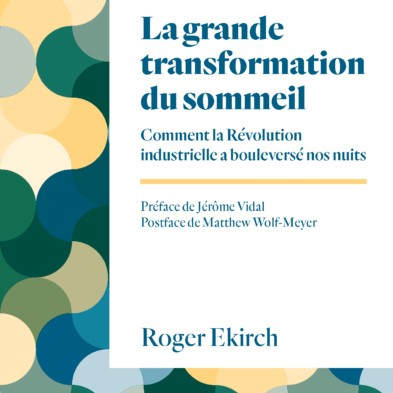L’addiction aux écrans n’est pas un effet indésirable des plateformes numériques : c’est le premier objectif qu’elles visent. Notre temps, c’est leur argent. Michel Desmurget, docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’Inserm, résume les effets de cette addiction dans un ouvrage intitulé La Fabrique du crétin digital. Il montre que les écrans empiètent sur bon nombre des activités utiles au développement psychologique et cognitif de l’enfant : discussions, lecture, activités physiques et manuelles, sommeil, ou même ennui. Sans surprise, les jeunes enfants surexposés aux écrans - ce qui est aujourd’hui le cas de la majorité d’entre eux - ont davantage de risque de développer des troubles de l’attention, des retards de développement psycho-cognitif ou des difficultés d’apprentissage du langage.
Outre les dégâts directement associés à l’addiction, les réseaux sociaux exacerbent notre « instinct » de comparaison sociale, et peuvent induire une préoccupation maladive de l’image que nous donnons aux autres et que ceux-ci nous renvoient. Les cas très médiatisés d’instagrameuses entraînées vers l’anorexie, d’adolescents radicalisés ou d’influenceuses acculées au suicide pourraient être vus comme autant de faits divers si la responsabilité des plateformes sociales dans la dégradation de la santé mentale n’était pas établie par une littérature scientifique croissante. De très nombreux troubles psychiatriques sont corrélés à leur usage excessif : dépression, anxiété, troubles du sommeil, hyperactivité avec déficit de l’attention, désordres alimentaires…
Les médias sociaux sont ainsi conçus pour induire un état de dépendance psychologique et social. Et ce malgré, comme l’ont rappelé les Facebook files, l’intime connaissance qu’ont leurs dirigeants des conséquences dramatiques de cette dépendance pour notre santé mentale.
Pourtant, l’impact psychologique des médias sociaux ne fait toujours pas consensus, au sens scientifique du terme. Pas une semaine ne passe sans qu’une voix ne s’élève pour, alternativement, pointer la responsabilité des plateformes numériques dans la recrudescence du mal-être des jeunes générations, ou, au contraire, instiller le doute quant à la solidité des preuves avancées par les plaignants. Un échantillon de tribunes publiées dans des grands quotidiens aux États-Unis au cours de l’année 2023 suffisent à rendre compte du désordre épistémologique ambiant.
On trouvera d’un côté :
De l’autre :
Évidemment, les journalistes se prévalent toutes et tous des meilleures garanties académiques, études scientifiques et méta-analyses à l’appui. Or ces dernières semblent avoir toutes les difficultés du monde à converger. Les principales raisons mentionnées sont l’absence de distinction, dans les enquêtes statistiques nationales, entre les différents loisirs numériques (télévision, jeux vidéo, réseaux sociaux) ; l’absence d’échantillon témoin (plus de 95 % des jeunes utilisent les réseaux sociaux et les 5 % restants en subissent indirectement les effets) ; une longue liste d’hypothèses alternatives pour expliquer la crise de la santé mentale…
Du doute à revendre
Sans prétendre départager les deux camps en quelques lignes, il est utile de rappeler un fait trivial : les conditions économiques imposées à la recherche influencent l’état des connaissances scientifiques par sélection des hypothèses explorées, des échantillons utilisés, voire des résultats publiés. Pour certaines célèbres controverses scientifiques historiques (telles que l’effet du tabac sur la santé ou l’origine anthropique du dérèglement climatique), l’examen du contexte de la recherche éclaire plus surement les causes du désaccord que l’épluchage méthodique des études publiées. Sans industrie du tabac pour financer les marchands de doute, l’opinion publique se serait rapidement rangée du côté de l’avis majoritaire de la profession médicale.
À cet égard, il est intéressant de constater que le budget que les géants du numérique consacrent annuellement à leurs départements Recherche et Développement (R&D) dépasse celui de n’importe quelle institution garante de l’intérêt public. Le budget R&D de Meta (anciennement Facebook) atteint 25 milliards de dollars pour l’année 2021 ; celui du groupe Alphabet (société mère de Google), 32 milliards de dollars. Ces montants dépassent d’un facteur dix celui de n’importe quelle université américaine et équivalent au budget total du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France. Les centres de recherche privés de Meta et Alphabet emploient ainsi plusieurs milliers de scientifiques, souvent parmi les spécialistes mondiaux les plus réputés de leurs domaines. Ils contrôlent de ce fait une large partie les efforts de recherche dans chaque discipline susceptible de trouver une application rentable dans l’économie de l’attention : intelligence artificielle, data science, traitement du langage naturel, ou encore… psychologie et santé mentale.
Les Gafam ne se contentent pas de laisser passivement infuser les résultats de leurs études dans le débat public : ils dépensent des millions de dollars pour plaider leurs intérêts auprès des instances politiques. Les géants de la Silicon Valley sont désormais les sociétés qui dépensent le plus en lobbying, devant l’exploitation pétrolière et l’industrie du tabac.
Nous laisserons aux historiens des sciences le soin de démêler les efforts de recherche relevant de la quête de vérité ou de la poursuite d’intérêts privés. Armés des solides a priori que ce préambule nous invite à adopter, explorons deux manifestations particulièrement sordides de la crise de la santé mentale induite par les médias sociaux.
Un exemple vaut mille maux
Les faits divers ont toujours eu, et fait, mauvaise presse. Le sociologue Pierre Bourdieu accusait la classe dominante d’en abuser pour « faire diversion ». André Gide appelait journalisme « tout ce qui aura moins de valeur demain qu’aujourd’hui » ; ses mots n’auraient sans doute pas été tendres pour les faits-divers. Déclasser une nouvelle au rang de fait-divers, c’est lui dénier toute importance politique et historique. C’est pointer son caractère singulier et non représentatif d’une situation d’ensemble. C’est la remettre à sa place : dans les colonnes d’un tabloïd tapageur, entre l’horoscope et le test de personnalité.
C’est un fait : les faits divers ont cette étrange qualité de se jouer des statistiques. Tous les jours, les rubriques faits-divers et autres nouvelles en trois lignes en attestent. Ils ne se soucient guère d’être des cas isolés. Bien au contraire, leur principal attrait réside dans leur originalité. Le criminologue Laurent Mucchielli déplorait que « l'érection du fait divers criminel en priorité de l'information le transforme en un fait de société ». Et pour cause : nos cerveaux, mal équipés pour gérer le chaos des probabilités, ont tendance à transformer les exceptions en règles, les mauvaises coïncidences en complots et les hold-ups en insurrections armées.
Pourtant, les faits divers ne sont pas toujours de pures contingences. Parfois, les indices qu’ils laissent convergent et corroborent une théorie. La fascination qu’ils exercent ne tient alors pas à la rareté, mais au caractère extrême des cas qu’ils relatent. « La réalité est souvent plus étrange que la fiction », affirmait Mark Twain, « car la fiction est obligée d’être vraisemblable, tandis que cette obligation ne s’impose pas à la réalité ». Le fait-divers démontre cette propriété de la réalité : à quel point elle peut être extrême.
Lorsqu’il exemplifie parfaitement un fait de société, le fait divers est sans doute le meilleur moyen de lui donner une forme tangible dans notre esprit. Pacôme Thiellement en tire son parti. Dans son livre Infernet, il mène l’enquête. La victime est notre santé mentale, les suspects sont les médias sociaux et les pièces à conviction sont… des faits divers.
Cachez ce malheur que je ne saurais voir
Dans son billet Gabby Petito, l'influenceuse lifestyle et la mort, Pacôme Thiellement relate un fait-divers aussi fascinant que tragique. Gabby Petito, une jeune Américaine de 22 ans, comptait parmi les vanlifers les plus populaires d’Instagram, une communauté virtuelle de nomades aussi proches de la nature que de leurs smartphones. Ayant dédié sa vie au road-trip, Gabby traversait les grands parcs nationaux états-uniens en partageant les clichés idylliques de son voyage avec son fiancé Brian Laundrie. Leur aventure dans un van aménagé passait pour le rêve éveillé de tout amateur de grands-espaces et de liberté. Mais en septembre 2021, Gabby disparaît soudainement. Son dernier message public est une photographie d’elle-même, une citrouille entre les mains, assortie d’un commentaire « Happy Halloween » en plein mois d’août. Son sourire radieux ne laisse rien présager de l'inquiétant silence qui va suivre.
Car le conte de fées que Gabby s’ingénie à mettre en images sur Instagram a pris une tournure macabre. Sous l’une des vidéos mises en ligne par l’influenceuse dans les derniers jours de son existence, un des innombrables enquêteurs anonymes du Web résume la situation, deux ans après le drame : « C'est terrifiant de constater qu'une relation abusive, marquée par la violence domestique, des signaux d'alarme et se soldant par la mort tragique d'une jeune femme pleine de vie, peut être dissimulée derrière une façade d’idéal créée sur les réseaux sociaux. J'espère sincèrement que cela servira de message pour rappeler à tous de ne jamais prendre pour argent comptant ce que l'on voit en ligne, et de réaliser que l'on ne sait rien des individus ou des situations qui se cachent derrière ces belles images ou vidéos soigneusement éditées. Repose en paix, Gabby. » Pendant que des millions de followers attendent des nouvelles du couple, la police découvre le corps sans vie de Gabby dans le parc national du Wyoming, à des milliers de kilomètres de son domicile en Floride.
Pacôme Thiellement, en recueillant les indices exhumés sur le Web par les milliers d’enquêteurs anonymes d’Internet, montre que sous la surface parfaite que Gabby présentait à ses abonnés se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Derrière l’objectif, l’histoire ressemblait davantage à un cauchemar. Bien avant le drame, des rapports de police décrivaient des altercations avec son fiancé, des situations de contrôle et de manipulation aux antipodes des tableaux de bonheur exhibés sur Instagram.
Les violences conjugales restent souvent dissimulées jusqu’à leur fin tragique : en cela, l’histoire de Gabby n’est malheureusement que trop ordinaire. Ce qui rend cette histoire originale, c’est l’immense fossé creusé par les réseaux sociaux entre l’apparence virtuelle et la vie réelle du couple. Pacôme Thiellement inculpe « Instagram, divinité du bonheur, se nourrissant du malheur, et transformant la vie privée de tous ses utilisateurs en métier. »
L’excès, ou la recette du succès
Les plateformes de médias sociaux sont des incubateurs de radicalisations politique et morale. C'est un processus simple à comprendre : l'extrémisme captive, incite à dévorer les nouvelles qui confortent nos croyances et à répliquer avec véhémence contre l'« adversaire ». Et chaque instant passé à scroller sur un flux d'actualités est une opportunité supplémentaire de profits publicitaires. Un rapport confidentiel de Facebook daté de 2016 a révélé que deux tiers des utilisateurs ayant adhéré à un groupe extrémiste l’avaient fait sur suggestion de l'algorithme de la plateforme.
L'immoralité, tout comme l’extrémisme, est très compétitive dans la guerre de l'attention. Cela donne naissance à des « tendances culturelles » qui n'ont d'autre raison d'être que l’exposition outrancière de la dégradation humaine. Le mukbang, un phénomène né en Corée en 2009, du mot coréen meongnuen (manger) et bangsong (diffusion), en fournit un exemple saillant. Le principe consiste tout simplement à filmer l’ingestion d’une quantité obscène de nourriture. Le concept a d’abord suscité l’étonnement amusé et la consternation des spectateurs étrangers. Mais il a malgré tout été importé en Occident en 2015 par une youtubeuse américaine. Son succès a été tel que d'autres youtubeurs ont rapidement adopté la pratique.
Parmi eux, un jeune vidéaste américain Nikocado Avocado. Pacôme Thiellement fait de ce youtubeur le sujet d'une de ses fascinantes investigations. Il annonce la couleur : « Nikocado Avocado est l’incarnation extrême d’un phénomène extrême. Et ce phénomène extrême, ce n’est pas le mukbang. Le mukbang n’est que sa manifestation matérielle. Le mukbang n’est que son allégorie. Ce phénomène extrême, c’est YouTube. Nikocado Avocado est YouTube. Le mukbang est la manifestation matérielle de la course à l’attention ».
Sur YouTube, Nikocado consacre d’abord sa chaîne à des tutos de préparation de repas végétaliens sains et équilibrés. Un jour, il change radicalement de cap avec une vidéo controversée révélant son renoncement au véganisme. Cela fait instantanément grimper sa cote de popularité. Avec le temps, il constate que le succès de ses vidéos semble indexé sur leur caractère provocateur et immoral. Il fait alors sienne la pratique du mukbang et se met à se filmer en train de dévorer des montagnes de nourriture. Sa chaîne subit une avalanche de critiques, mais cela n'a pas d'importance : ses vidéos sont plus regardées que jamais, et donc promues par l’algorithme de YouTube.
Cinq ans plus tard, Nikocado Avocado a fait du mukbang sa profession. Il produit en moyenne deux vidéos par jour, alternant des festins, des accès de colère et des scènes d’auto-apitoiement pathétiques. Il possède six chaînes YouTube cumulant 6 millions d'abonnés et habite un vaste appartement à Las Vegas. Pesant 160 kilogrammes, il est contraint de dormir avec un respirateur. Il partage régulièrement l'écran avec d'autres youtubeurs atteints d'obésité morbide. Il apostrophe ses spectateurs en criant : « C'est de votre faute ! », conscient du malaise causé par ces mots.
Derrière les écrans de fumée, un nouveau théâtre de la cruauté
En 1985, bien avant l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, paraît un ouvrage au titre prémonitoire : Amusing ourselves to death [Se distraire jusqu’à ce que mort s’en suive]. Son auteur, le spécialiste américain des médias Neil Postman, produit un réquisitoire contre la télévision qui résonne à travers le monde. Il compare dans son ouvrage deux archétypes de récits dystopiques, respectivement incarnés par 1984 de Georges Orwell et Le Meilleur des Monde de Aldous Huxley.
Dans son célèbre roman, Orwell craignait qu’un jour prochain « la vérité nous soit cachée », là où Huxley s’attendait simplement à ce que « la vérité ne soit noyée dans une mer d’insignifiances ». Pour lui, il n’y aurait « aucune raison de bannir un livre, puisqu’il n’y aurait personne pour vouloir en lire un ». C’est aujourd’hui le scénario d’Huxley qui semble se concrétiser.
Nous sommes pris de court : la principale menace ne vient plus d’un autodafé ordonné par un gouvernement autoritaire, mais de la banale poursuite d’intérêts privés par des entreprises tentaculaires. En s’appropriant les nœuds de réseaux numériques planétaires, et en contrôlant l’accès à l’information de la moitié de l’humanité, elles dégradent notre culture et notre santé mentale. Nul besoin d’une puce électronique implantée dans le cerveau pour que la technologie nous transforme.
- Infernet - Pacôme Thiellement – Éditions Massot (2023)