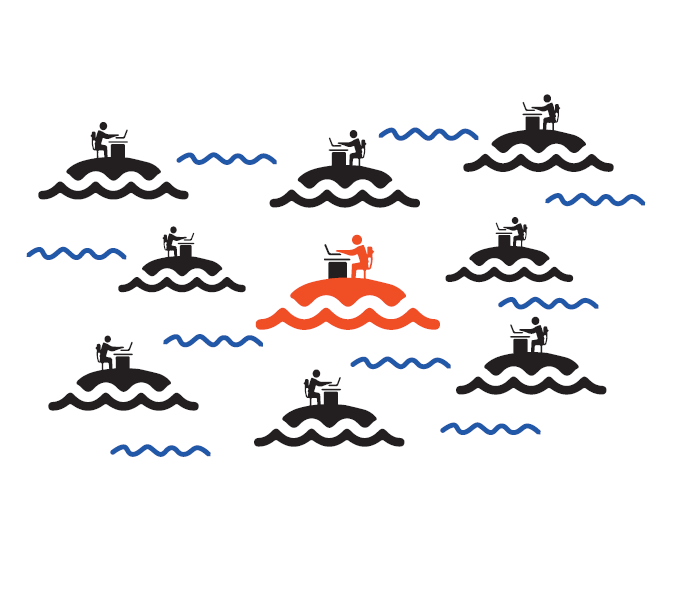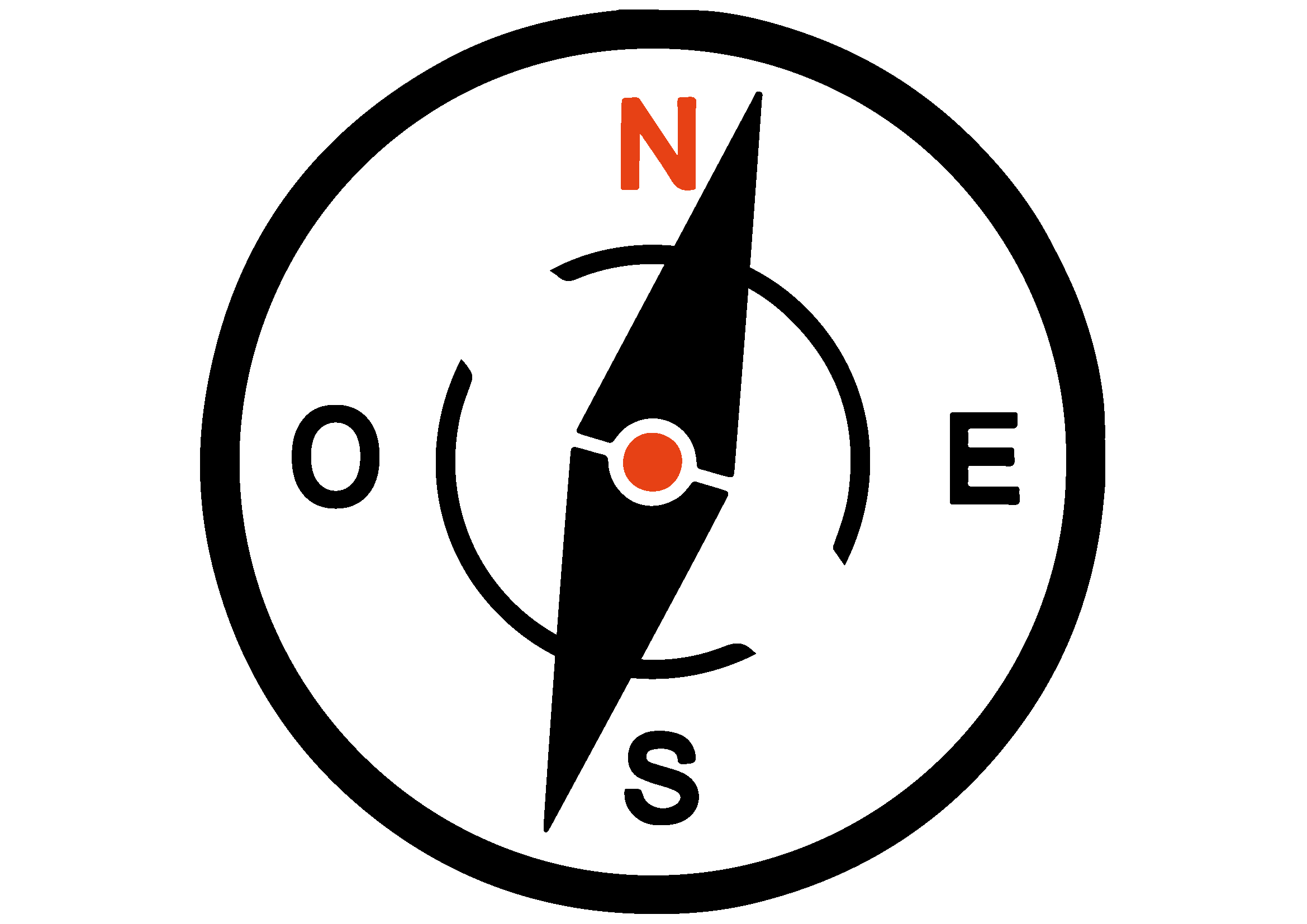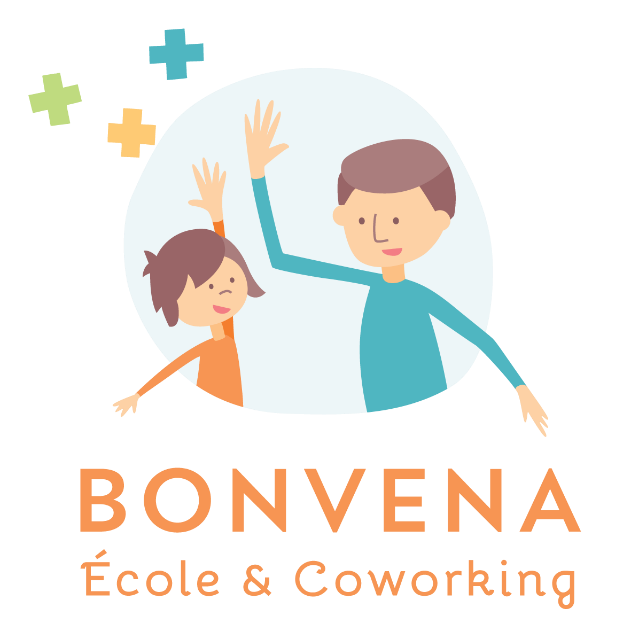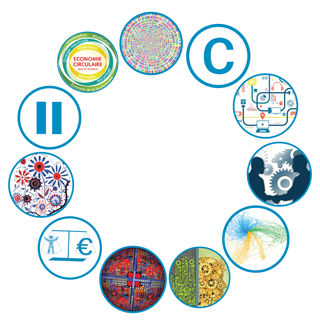L’attractivité est la capacité d’une structure à attirer des candidats et se réfère donc principalement au recrutement. Elle passe par des éléments propres à la structure – comme l’image de marque, la rémunération proposée, le processus de recrutement- mais aussi des dimensions plus sectorielles ou sociales comme l’image sociale du métier ou son accessibilité. L’attractivité s’adresse à deux profils de candidats différents : d’une part, les personnes qui se prédestinaient au métier concerné (par leurs études et leur parcours professionnel) mais qui pourraient décider de travailler chez un concurrent et, d’autre part, les personnes qui ne se prédestinaient pas à ce métier. La frontière entre les deux n’est pas toujours facile à fixer mais les stratégies d’attractivité diffèrent. Ainsi, pour ceux qui sont à l’heure des choix de formation, il est nécessaire de travailler l’attractivité très tôt dans leur cursus.
La fidélisation a une dimension complémentaire à celle du recrutement : c’est la capacité à retenir des personnes qui sont en poste dans la structure et, si l’on se place au niveau du secteur, dans le métier concerné. Les deux ne vont pas toujours de pair : pendant longtemps, la restauration n’a pas rencontré de problème de rétention au niveau sectoriel mais les structures, prises individuellement, pouvaient connaître des difficultés pour retenir leurs employés. La boulangerie est une autre illustration : les boulangers savent qu’ils peuvent démissionner parce qu’ils pourront trouver du travail facilement dans d’autres boulangeries. Dans ces deux exemples, Il n’y a pas nécessairement de problème de rétention au niveau du secteur mais un problème de fidélisation au niveau de l’entreprise.
L’attractivité et la fidélisation ne renvoient pas aux mêmes enjeux. Pour les salaires par exemple, l’attractivité pose la question de la rémunération supposée alors que la fidélisation pose la question de la rémunération réelle. La fidélisation intègre aussi plus fortement la question des conditions de travail au quotidien (pénibilité, qualité du management, justice organisationnelle) ou encore celle de la fierté professionnelle : certaines personnes restent dans leur métier parce qu’il leur donne une image sociale forte. On peut citer également l’intégration à un collectif de travail, les relations avec les collègues, l’épanouissement que l’on retire de son métier.
Ces différentes dimensions jouent sur la fidélisation. Si une structure n’est pas obligée de « cocher toutes les cases » pour fidéliser, elle aura tout intérêt à disposer de certains points forts plutôt que d’être moyenne sur l’ensemble des facteurs de fidélisation.