Comprendre la place des ressentis dans la société pour mieux y répondre

Étude
Positifs ou négatifs, les usagers portent de nombreux ressentis envers les administrations, que les collectivités doivent prendre en compte.
Interview de François Dubet

<< L’écrasante majorité des Français pense que leur société va mal, une majorité tout aussi grande, dit qu’elle vit bien. Le problème est celui de la défiance et elle est moins forte dans la proximité que dans la distance. Un nouvel acte de décentralisation devrait advenir, alors que nous assistons souvent au retour du centralisme laissant croire que seul l’État peut nous sauver >>.
Sociologue, François Dubet a été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et professeur à l'université Bordeaux II.
Il a consacré plusieurs ouvrages à la question des inégalités, dont "La Préférence pour l'inégalité : Comprendre la crise des solidarités", Le Seuil, 2014 et "Le Temps des passions tristes : Inégalités et populisme", Le Seuil, 2019.
Inégalités, sentiment d'injustice, justice sociale... Plusieurs termes ou expressions servent à caractériser des situations qui paraissent proches. Est-ce qu'il est possible de les préciser les uns par rapport aux autres dans le contexte actuel ?
Nous avons toujours intérêt à nous accorder sur le sens des mots afin de connaître la nature de nos accords ou de nos désaccords.
Les inégalités se mesurent en fonction de deux grands critères. Le premier est celui des groupes et des ensembles dont on veut connaître la situation : les ouvriers, les cadres, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, les pays… Le second critère est celui des biens inégalement répartis selon ces groupes : les revenus, les patrimoines, les diplômes, le niveau de santé… De manière générale, les inégalités sont affaire de statistiques objectives.
De leur côté, les sentiments d’injustice procèdent de la perception des inégalités par les acteurs sociaux. Alors que certaines inégalités paraissent aller de soi, d’autres sont perçues comme étant injustes. Par exemple, alors que les inégalités entre les adultes et les enfants ne sont guère contestées, les discriminations, la grande pauvreté des uns et l’hyper richesse d’une minorité apparaissent généralement comme scandaleuses. Il importe donc de distinguer les inégalités mesurées et les sentiments d’injustice car il y a une grande distance entre les deux dimensions. Les sociétés les plus inégalitaires ne sont pas forcément celles qui se perçoivent comme les plus injustes et les sentiments d’injustice ne « reflètent » pas les inégalités mesurées. Il y a les inégalités que l’on voit et celles que l’on ne voit pas, comme il y des inégalités scandaleuses alors que d’autres semblent être « normales ».
Enfin, les sentiments d’injustice appellent des conceptions plus ou moins explicites de la justice sociale. Chacun peut dire : « C’est injuste parce que…, parce que le mérite n’est pas reconnu, parce que les inégalités excessives portent atteinte à l’égalité des citoyens, parce que les inégalités empêchent d’agir… » Généralement, chaque société élabore des principes de justice, des « philosophies de la justice » qui permettent des critiquer certaines inégalités, mais aussi d’en justifier d’autres.
Il semble que le débat, en France, se soit construit à partir du cadre d’analyse des « inégalités » (entendues comme une « différence jugée injuste ») plus qu’à partir du cadre d’analyse de la « justice sociale ». Comment l’expliquez-vous ?
Il me semble que le débat français porte plus sur l’évolution des inégalités que sur les sentiments d’injustice et les conceptions de la justice sociale. On discute beaucoup de la croissance des inégalités, du taux de pauvreté, des inégalités entre les sexes, des inégalités territoriales… comme si les sentiments d’injustice reflétaient les inégalités mesurées. Or, je le répète, ce n’est pas toujours le cas. Certaines inégalités se réduisent et sont cependant perçues comme plus insupportables que naguère, comme dans le cas des inégalités entre les sexes ou dans celui des inégalités de diplômes. De manière générale, la perception des inégalités injustes est assez détachée de la situation sociale des individus, certaines inégalités scandalisent alors qu’elles sont plus faibles que d’autres qui ne scandalisent pas, comme le sont les inégalités entre les pays pourtant bien plus fortes que les inégalités internes à chaque société. L’étude des sentiments d’injustice liés aux des inégalités est d’autant plus nécessaire que ce sont eux qui comptent pour les acteurs, ce sont eux qui engendrent des mobilisations et qui se transforment en demandes politiques.
Quant aux conceptions générales de la justice sociale, elles semblent aujourd’hui en retrait dans le débat public, depuis que les grands clivages entre la droite et la gauche se sont brouillés et depuis que nous avons le sentiment de voir surgir de nouvelles inégalités, comme les discriminations, qui, jusque-là, étaient relativement absentes de nos débats alors qu’elles étaient extrêmement fortes dans la vie sociale.
Dans d’autres cadres de référence, le terme « inégalité » ne paraît pas lesté du même contenu négatif, notamment chez Rawls puisqu’il y a des inégalités justes (référant à la justice sociale) et des inégalités injustes. Comment une inégalité finit-elle par être perçue comme une injustice ?
Que l’on s’intéresse aux sentiments d’injustice ou aux théories de la justice, la question est la même. Elle est celle de savoir quelles sont les inégalités acceptables et, au-delà, quelles sont les inégalités justes. Comment réduire la contradiction entre l’affirmation de l’égalité fondamentale des êtres humains, d’une part, et le fonctionnement plus ou moins inégalitaire des sociétés, d’autre part ? On connaît la réponse de Rawls à ce problème : les seules inégalités justes dans une société libérale, dans laquelle les citoyens sont a priori également libres, sont issues d’une compétition méritocratique ouverte à tous ; mais comme cette compétition ouverte engendre de grandes inégalités, elle n’est acceptable que si la société améliore le sort des moins favorisés. En définitive, il s’agit là d’un modèle de justice social-démocrate combinant le dynamisme du marché à la plus grande égalité sociale possible, modèle opposé à l’idéal égalitariste communiste, et au modèle libérale de la seule compétition. On s’interroge sur les inégalités justes plus que sur l’abolition définitive de toutes les inégalités ou sur l’acceptation des inégalités, aussi grandes soient-elles, dès lors qu’elles résulteraient d’une compétition équitable. Tout le paradoxe vient de ce que la pensée de John Rawls est au cœur de la philosophie de la justice au moment où les modèles sociaux-démocrates commencent à s’épuiser.
Y a-t-il aujourd’hui encore des normes de justice largement partagées ou assiste-t-on à une multiplication de ces normes, ce qui rendrait plus difficile de s’accorder collectivement sur ce qu’est une société juste ?
Les enquêtes de Michel Forsé, Olivier Galland ou moi-même montrent que les normes de justice sont largement partagées : on croit dans l’égalité fondamentale, le mérite, la liberté… Mais cet accord ne signifie pas que les acteurs mobilisent ces principes de la même manière en fonction des situations, et qu’ils tirent de ces principes les mêmes conséquences pratiques en fonction de leurs intérêts et de leurs valeurs. Par ailleurs, l’accord sur les principes ne doit pas cacher que, souvent, ces principes sont contradictoires entre eux. Par exemple, la valorisation exclusive du mérite détruit l’égalité sociale, mais la priorité à l’égalité finit par abolir le mérite. Or, la plupart d’entre nous sont attachés à ces deux principes. Dans la vie sociale, la justice est sans cesse discutée, même si nous nous accordons sur les grands principes.
Est-ce un effet des sociétés multiculturelles qui se traduit par un plus grand relativisme des valeurs ?
Les sociétés multiculturelles multiplient les « mœurs », (les goûts et les conceptions de la vie bonne) et il est possible que quelques chapelles refusent les principes d’égalité et de liberté au nom de la priorité donnée à certaines traditions religieuses. Mais les enquêtes montrent que la grande majorité des individus, appartenant aux minorités ou pas, croyants ou pas, tiennent l’égale liberté pour un principe central au-delà des différences culturelles.
À mes yeux, le problème essentiel n’est pas là. Il tient à ce que la recherche de la justice suppose un fort sentiment de solidarité (on disait de « fraternité » dans le triptyque républicain) ; elle exige que nous soyons prêts à faire des sacrifices pour des semblables que nous ne connaissons pas. C’est pour cette raison que l’essentiel de la justice reste enfermé dans des sociétés nationales. Or, la diversité culturelle peut affaiblir ce sentiment de solidarité : pourquoi faire des sacrifices pour ceux qui ne me ressemblent pas ? Les comparaisons internationales indiquent que les sociétés multiculturelles sont moins attachées à l’égalité que celles qui se perçoivent comme homogènes. Aujourd’hui, force est de constater que bien des mouvements que l’on appelle populistes réclament la justice et l’égalité pour les majoritaires, les nationaux, les citoyens « de souche », et s’opposent en fait à l’égalité des minorités et des nouveaux venus. Un des problèmes de la justice tient à ce que ses principes universels sont en fait enracinés dans des communautés nationales, religieuses, sociales et quand ses communautés se fractionnent et se crispent, on pourrait finir par ne vouloir la justice que pour ses proches et ses semblables.
Quels sont les mécanismes qui produisent les sentiments d'injustices ?
Il m’est difficile de répondre précisément à cette question plus familière aux psychologues, mais je crois que l’on peut distinguer deux mécanismes. Le premier est de nature cognitive, celui de la perception de la société et des comparaisons qu’elle engendre entre « nous » et « eux », et entre moi et les autres. Le second mécanisme est de nature normative et répond à la question de la justice ou de l’injustice des inégalités vécues : sont-elles légitimes ou illégitimes, procèdent-elles de mécanismes impersonnels comme le marché, sont-elles intentionnelles comme les discriminations, en suis-je responsable ou pas ? De ce point de vue, on peut faire l’hypothèse que l’expérience des inégalités s’inscrit dans une évolution générale. D’un côté, l’expérience des inégalités est de plus en plus individuelle, de moins en moins inscrite dans des collectifs de castes ou de classes ; de l’autre, conformément au raisonnement de Tocqueville, nous sommes de plus en plus attachés au principe d’égalité conçu comme le droit d’être traité comme étant l’égal de tous. Ainsi, des inégalités qui pouvaient aller de soi sont de moins en moins tolérées.
À côté de mécanismes tels que la comparaison, la référence à une norme éthique ou juridique... on trouve aussi des registres comme l'indignation, la revendication, etc. Cela ne brouille-t-il pas la compréhension de la formation du sentiment d’injustice ?
La question que vous posez est celle de l’articulation des expériences individuelles et des mouvements collectifs. Comment les colères et les indignations personnelles peuvent-elles s’inscrire dans des mouvements et des récits collectifs de nature morale, sociale, religieuse, politique ? Longtemps, dans les sociétés industrielles, la conscience de classe, la croyance dans le progrès, la vision de l’avenir, ont donné un sens collectifs aux expériences individuelles. Il me semble qu’aujourd’hui ce récit s’épuise et que beaucoup d’entre nous pensent que les inégalités qu’ils subissent sont « invisibles », purement singulières et qu’elles sont une forme de mépris et d’absence de reconnaissance. À terme, tout se passe comme si les colères personnelles n’entraient pas dans la vie collective autrement que sous les formes de la souffrance et de la violence.
Qu’est-ce qui a changé dans les grands champs d’injustice réelle ou perçue contemporains que vous identifiez ?
Les sentiments d’injustice se déploient dans une multitude de domaines : conditions de vie, situations familiales, âge, sexe, sexualité, revenus, patrimoines, mobilité, qualification, santé, éducation, origines sociales et culturelles… La liste est infinie et d’autant plus large que nous mesurons assez bien les inégalités et que chacun peut en avoir une vision relativement rationnelle au-delà de son propre cas. Ce qui est nouveau, c’est que ces divers registres d’inégalités ne sont pas toujours cohérents entre eux. À l’exception des très riches et des très pauvres, on peut être relativement bien placé sur une échelle d’inégalité, tout en étant mal situé sur une autre. Ceci contribue à singulariser les expériences des inégalités.
Quels sont les risques qui y sont attachés ?
La multiplication des inégalités, leur « explosion » plus que leur seule croissance dans le cas français, a de grandes conséquences politiques. La première est la difficulté de se reconnaître dans des causes communes à l’exception de l’opposition du peuple et des élites, mais le peuple n’a pas beaucoup d’unité. La somme des colères et des indignations ne crée pas un mouvement homogène comme le montre le cas des gilets jaunes qui ont refusé les porte-paroles. L’autre conséquence est celui de la multiplication des politiques publiques. Tout se passe comme si les politiques publiques universalistes avaient été remplacées par une accumulation de politiques ciblées sur des problèmes et des publics singuliers en fonction de multiples critères : emploi, âge, situation familiale, lieu de résidence, environnement, origines… Dans ce cas, le sentiment de cohésion sociale peut être affecté puisque chacun peut avoir le sentiment d’être à côté de la cible alors que d’autres bénéficieraient d’aides illégitimes. Le risque est alors celui d’élargir le règne de la concurrence des pauvres et des victimes. On se méfie des plus riches, mais aussi des plus pauvres.
Quelle place tient la spécificité des territoires dans la formation du sentiment d’injustice ? Et comment articuler plusieurs échelles de proximité politique (locale, métropolitaine, nationale, etc.) pour y répondre ?
Depuis quelques années et plus encore avec les gilets jaunes, s’impose l’idée d’une fracture territoriale opposant les métropoles riches aux territoires abandonnés. À mes yeux, il s’agit d’un clivage parmi bien d’autres, et d’un clivage assez grossier. Il y a plus de pauvres dans les métropoles que dans les zones rurales, et tous les territoires ne sont pas pauvres et abandonnés. Mais il reste que le sentiment de marginalisation est très fort. Un des enjeux essentiels de cette question est celui de la mobilité car le sentiment d’injustice est celui d’une assignation à résidence pour travailler, se soigner, étudier et, inversement, celui d’une obligation de se déplacer. À terme, l’injustice vient d’un différentiel de mobilité ; même quand les gens pensent vivre dans un endroit agréable.
Cependant, il faut d’autant plus se méfier de la construction d’une lutte des territoires remplaçant la lutte des classes que les territoires sont eux-mêmes hétérogènes et, surtout, on sous-estime souvent leur dynamisme, l’intensité de la vie associative, la proximité des élus… Bien souvent, quand on regarde notre société « par le bas », par la vie locale, les choses se passent mieux qu’on ne le croit quand on la voit « par le haut ». D’ailleurs, si l’écrasante majorité des Français pense que leur société va mal, une majorité tout aussi grande, dit qu’elle vit bien. Le problème est celui de la défiance et elle est moins forte dans la proximité que dans la distance. Un nouvel acte de décentralisation devrait advenir, alors que nous assistons souvent au retour du centralisme laissant croire que seul l’État peut nous sauver.
Quels sont les leviers pour répondre aux sentiments d’injustice, si on part du principe qu’il existe une pluralité de normes de justice qui sont parfois antinomiques ? Est-ce que le politique n’est pas toujours piégé par cette question ?
À mes yeux, c’est là le problème essentiel. Quand les inégalités sociales paraissaient relativement structurées autour des classes sociale et des professions, les expériences des injustices pouvaient se transformer en conflits, en revendications et en négociations. Quand ces expériences se multiplient, se diversifient et qu’elles éclatent parfois chez les mêmes individus, les indignations et les colères ont du mal à se donner une expression publique collective et les demandes sociales apparaissent alors multiples et souvent contradictoires entre elles. Il n’est pas rare que le même mouvement réclame, à la fois, moins d’impôts et plus de services publics, plus d’écologie et moins d’éoliennes près de chez soi… Les élus le savent bien : il est difficile de faire plaisir à tout le monde, mais il aussi difficile de satisfaire chaque citoyen qui peut demander les politiques opposées.
Cette tendance est accentuée par le rôle d’internet des réseaux. Alors que la construction de demandes collectives exigeait des rencontres, des militants, des organisations et des discours communs, aujourd’hui chacun accède directement à l’espace public et devient un mouvement social à lui tout seul. Les colères s’individualisent et s’accumulent plus qu’elles ne s’agrègent et ne construisent des revendications. Bien souvent, les partis et les syndicats paraissent hors-jeu ou « à la remorque » des protestations.
Les mobilisations autour de la transition environnementale témoignent-elles de quelque chose de radicalement nouveau ou s’agit-il seulement un déplacement des questions sociales ?
Il va de soi que la question environnementale est essentielle ; chacun en a conscience, y compris en termes de survie. Cependant, je ne crois pas que toute la politique puisse se réduire à cette question car le vrai débat oppose moins des défenseurs de l’environnement à ceux qui lui serait hostile (Je laisse Trump de côté) qu’il ne concerne la manière dont les politiques économiques, les politiques sociales, les politiques de santé, prennent en charge la question de l’environnement. Au fond, on peut imaginer que des politiques écologiques radicales ignorent tout de la justice environnementale, mais on peut aussi imaginer que des politiques sociales généreuses aggravent dangereusement l’environnement.
Évidemment, dans le ciel des idées, des idéologies et des programmes électoraux, tout est compatible. Les indignations n’aiment pas les contradictions. Mais la politique est une affaire d’éthique de responsabilité, de possibles et de conséquences. Et les convictions écologiques, pour honorables et indispensables qu’elles soient, comptent moins que leur articulation avec les politiques de l’emploi, les mutations du travail, la solidarité et les politiques sociales et la prise en charge des inégalités environnementales.
Vous avez développé la notion « d’égalité des places » plutôt que celle « d’égalité des chances ». Pouvez-vous préciser ce qu’elle recouvre et ce qu’elle implique ?
Au lendemain des révolutions démocratiques affirmant que « les Hommes naissent libres et égaux », s’est posée la question du scandale des inégalités sociales. Deux grandes conceptions de la justice sociale ont émergé. La première, dominante dans les sociétés européennes industrielles et se percevant comme nationalement homogènes, est celle de l’égalité des places. Comme les travailleurs sont exploités, la société doit leur rendre ce qui leur été « volé ». La justice consiste à réduire les inégalités entre les positions sociales, entre les riches et les pauvres, grâce à l’impôt progressif, aux droits sociaux, à la redistribution sociale, à l’État providence, aux services publics… Entre les années 1900 et les années 1980, cette conception de la justice défendue par les syndicats et les gauches a sensiblement réduit les inégalités sociales.
La seconde conception de la justice s’est plutôt développée aux États-Unis. C’est l’égalité des chances qui affirme que tous les individus ont le droit de faire valoir leur mérite et d’accéder à toutes les positions sociales aussi inégales soient-elles. L’égalité des chances méritocratique vise à construire des inégalités justes, reposant sur le mérite plus que sur les héritages sociaux. Ce modèle, qui n’est pas moins exigeant que le précédent, lutte contre les discriminations qui affectent l’égalité des chances plutôt que contre l’exploitation.
Bien sûr, les deux conceptions de la justice ont cohabité, mais on voit bien que, depuis une trentaine d’années, en Europe et en France, l’égalité des chances se substitue à l’égalité des places. La justice sociale vise moins à réduire les écarts qu’elle ne veut promouvoir une compétition équitable pour accéder aux diverses positions sociales. Le langage des discriminations s’est élargi et bien des inégalités de positions sont perçues comme des discriminations. Ce processus tient à la multiplication et à l’individualisation des inégalités, à la multiplication des identités culturelles et des minorités.
Il faut bien comprendre que ces deux conceptions de la justice sont parfaitement légitimes, mais qu’elles ne conduisent pas vers les mêmes politiques. Le risque de l’égalité des chances est de multiplier les cibles des politiques et d’accroître ainsi la concurrence des victimes. Il est aussi d’être particulièrement cruel à l’égard des vaincus de la compétition méritocratique car si l’égalité des chances peut fonder l’orgueil des vainqueurs, elle peut aussi légitimer l’humiliation des vaincus, de ceux qui n’auraient pas su saisir leurs chances.
Est-ce que les normes de justice sont susceptibles de faire l’objet d’un débat collectif et produire du commun ?
Je ne sais pas si les normes de justice feraient l’objet d’un débat tant elles semblent partagées, au moins idéologiquement. En revanche, les modèles de justice qui articulent ces normes et les mettent en jeu, devraient être clarifiés et débattus autour de questions sensibles : éducation, politiques urbaines, environnement, travail, héritages et patrimoines… Cependant, ces débats sont parfois loin du compte. La décomposition des partis sociaux et des partis libéraux conservateurs aboutit à un face-à-face des forces populistes et d’un État identifié à la rationalité économique et aux « premiers de cordée », affrontement dans lequel les indignations et les invectives pèsent plus que les arguments rationnels. Les mutations des inégalités ont désorganisé la représentation politique en France comme dans la plupart des pays comparables.
Il faudra donc reconstruire un système de représentation et de catégories politiques capables de produire les débats autour de la société que nous voulons dans un monde que nous n’avons pas choisi. Je crains que ce travail soit un peu long.

Étude
Positifs ou négatifs, les usagers portent de nombreux ressentis envers les administrations, que les collectivités doivent prendre en compte.
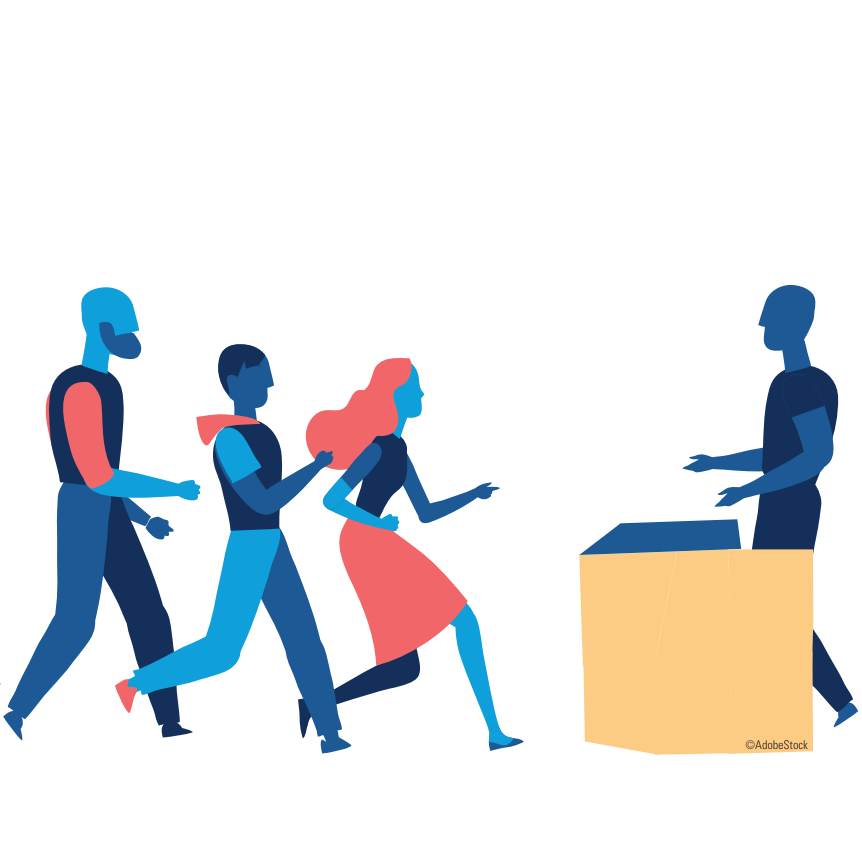
Article
Aborder le sentiments d'injustice comme des ressources utiles, pour une action publique plus à l’écoute des citoyens.

Texte de Nicolas Rio
Que peuvent faire les collectivités locales pour se rendre attentives aux sentiments d’injustice exprimés par leurs habitants/usagers, et mieux les accompagner ?

Étude
Synthèse de huit entretiens avec des chercheurs en sciences sociales, pour mieux appréhender les (dés)équilibres entre normes, ordre et inégalités.

Interview de Caroline Lejeune
Enseignante-chercheuse en humanités environnementales à l'Université de Lausanne
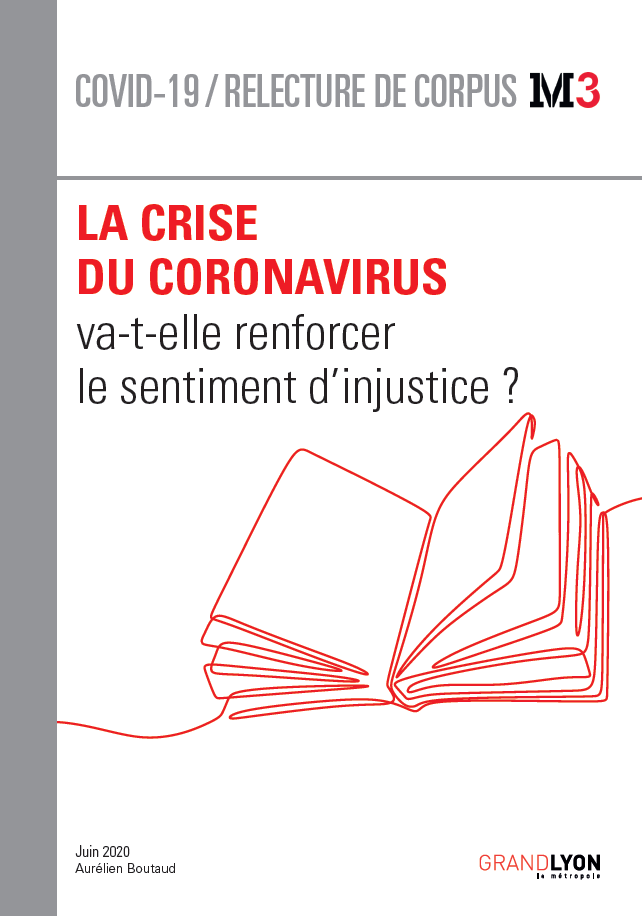
Étude
Inégalités face aux conditions de confinement, à la continuité pédagogiques, à l’exposition au virus : les sentiments d’injustices peuvent-ils sortir renforcés de la crise ?

Interview de Valérie Deldrève
Directrice de recherche en sociologie à l’Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement

Interview de Samuel Depraz
Géographe et maître de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3

Étude
Basée sur les articles parus dans le quotidien local Le Progrès entre juillet 2018 et juillet 2019, cette étude analyse le climat de défiance des citoyens envers les formes d'autorités et de pouvoirs publics.