Comprendre la place des ressentis dans la société pour mieux y répondre

Étude
Positifs ou négatifs, les usagers portent de nombreux ressentis envers les administrations, que les collectivités doivent prendre en compte.
Interview de Ivan Sainsaulieu

<< On constate une diminution de l’extrême pauvreté mais la classe moyenne s’appauvrie et les écarts entre les plus pauvres et les plus riches augmentent. Ce qui domine, c’est une répartition inégalitaire des richesses qui accroît les inégalités existantes et qui nourrit le sentiment d’injustice >>.
Ivan Sainsaulieu est professeur de sociologie et chercheur au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé). Il est également collaborateur scientifique à l’Institut d’études politiques historiques et internationales (IEPHI) de l’Université de Lausanne. Il a notamment co-dirigé "Où est passée la justice sociale ? De l'égalité aux tâtonnements", Presses universitaires du Septentrion, 2019.
La justice sociale est une notion ancienne, comment la décrire dans le contexte actuel ?
Effectivement, la question de la théorie de la justice sociale est une question très vaste qui a été traitée par de nombreux penseurs depuis l’Antiquité. Elle décrit un principe d’équilibre entre différentes valeurs, comme l’égalité, la liberté, etc., dont on va essayer de s’accorder sur le fait qu’elles sont universelles ou au contraire contextualisées, la façon dont elles s’accordent ou non, laquelle prioriser, etc. Aujourd'hui encore, la question de la justice sociale est insondable : elle n’a pas de réponse simple et ne renvoie pas immédiatement à des objets sociaux identifiés. C’est une réflexion qui reste très théorique, qui s’en tient aux principes.
C’est donc un concept peu opératoire et un peu fourre-tout. Ainsi, au niveau des acteurs, rares sont ceux qui sont hostiles à la justice sociale mais personne n’y met la même chose. C’est pourquoi il est sans doute préférable de référer au sentiment d’injustice, qui se rapporte à une émotion vécue en réaction à des formes d’oppression. Pour autant, cela ne règle pas tout. Parce que si l’on peut assez facilement décrire ce qu’il y a sous les sentiments d’injustice, ceux-ci sont extrêmement divers, ce qui rend là encore la question complexe. Par exemple, les enquêtes sur les sentiments d’injustice au travail montrent que les sentiments d'injustice des uns ne correspondent pas nécessairement à ceux des autres et qu’ils ne peuvent donc pas trouver de solutions communes.
Mais on voit bien le rapport de l’un à l’autre : la notion de justice sociale est difficile à appréhender mais propose des normes d’équilibre entre les valeurs quand la notion de sentiment d’injustice s’appréhende bien à travers les émotions vécues mais ne donne pas de solutions collectivement partagées sur les réponses qu’il convient d’y apporter. Si je reprends l’exemple du monde du travail, on voit des syndicalistes parfois confrontés à des situations où ils doivent défendre des salariés qui expriment des sentiments d’injustice mais qui sont considérés comme « des canards boiteux » parce qu’ils ne travaillent pas bien, qu’ils sont défaillants, etc. Comment faire ici ? Quels principes prioriser ? Les défendre parce qu’ils ont les mêmes droits que tout le monde où moins les défendre parce qu’ils ne remplissent pas complétement leurs devoirs ? Ce sont des situations classiques, très concrètes, qui mettent en tension les principes d’égalité, de justice – ici justice salariale –, etc., avec le sentiment d’injustice vécue. Il y a donc une forme d’aporie.
On a le sentiment qu’en France le débat s’est davantage construit à partir du cadre d’analyse des inégalités qu’à partir de celui de la justice sociale ou même de celui du sentiment d’injustice. Pourquoi ?
Parce que les inégalités, c’est très facilement objectivable alors qu’il n’y a pas vraiment de cadre d’analyse de la justice sociale. Certes, il y a une inflation de l’emploi du terme dans le discours public mais, encore une fois, ce n’est pas un concept univoque ni clairement défini. Pour autant, des liens entre justice sociale et inégalités existent. On le voit bien avec un auteur comme Rawls, qui a réintroduit le concept de justice sociale dans les années 1970. Lorsqu’il mobilise la notion de justice sociale, il renonce à l’idéal d’égalité pour viser des « inégalités acceptables » et prioriser la valeur de liberté. Il entre dans une « négociation », inhérente à la démarche de la justice sociale, entre ces valeurs. Mais ce faisant, on passe d’un monde qui se référait à une gauche radicale, égalitaire et universaliste, à un monde qui se référait à une gauche plus modérée, pour parvenir à un monde pluraliste dans les valeurs et qui s’est complexifié du fait de revendications minoritaires et / ou identitaires, individuelles et/ou collectives. On constate que, aujourd’hui, la valeur dominante est celle de la liberté et pourtant, paradoxalement, il y a aussi une forte demande d’égalité. Donc il faut de nouveau arrimer la question de la justice sociale et des sentiments d’injustice à celle des inégalités sociales.
Comment la question s’est-elle transformée ?
J’en reviens à la négociation entre liberté et égalité inhérente à tout débat sur la justice sociale. Soit on privilégie l’égalité, et cela implique des contraintes, notamment pour les mieux lotis, soit on privilégie la liberté, et cela suppose des inégalités. L’équilibre de ces valeurs porte toujours un risque ; favoriser la liberté, c’est minimiser l’égalité, et inversement, favoriser l’égalité c’est restreindre les libertés individuelles. Quel que soit le choix, on peut apporter des corrections, mais la tendance néolibérale récente c’est que, en matière de correction des inégalités, on a lâché l’affaire. On a ajouté un filet de sécurité minimal et, en contrepartie, on a réduit les ambitions de redistribution des richesses. Après la guerre, les classes favorisées, les entreprises, en France ou aux États-Unis, étaient beaucoup plus imposées qu’aujourd'hui. Donc le choix de la liberté a été fait, contre celui de l’égalité, avec cependant une correction minimale pour les plus pauvres (en France surtout). Cette transformation des équilibres fait suite à des transformations historiques. Au sortir de la guerre, il y a une activité forte et des capacités de mobilisations des ouvriers qui l’étaient également. Depuis, dans les pays occidentaux, on a assisté à un grand mouvement de désindustrialisation et de délocalisation des emplois industriels ce qui a fortement touché le rapport capital / travail. Aujourd'hui avec des corps intermédiaires moins puissants, des capacités de mobilisations moindres, s’est développé un rapport défavorable à l’égalité.
N’y a-t-il pas aussi un affaiblissement des valeurs universelles et une fragmentation des luttes dus à l’individualisation ?
Un aspect tangible pour la France, ce sont des courants d’idées ou de valeurs particularisés, avec d’un côté la lutte pour les droits des homosexuels, de l’autre la lutte pour les droits des femmes, etc., alors que tout ça était davantage englobé, auparavant, dans une théorie globale héritée du marxisme. Mais aux États-Unis, races, classes, genres, etc., tout cela a toujours été des catégories défendues par les mouvements assez séparés, jusqu’aux discussions récentes sur l’intersectionnalité. Mais replaçons cette question de l’individualisation dans l’histoire. D’abord, avec Durkheim, il s’est agi de désigner une détérioration des liens traditionnels : la disparition des solidarités du village pour l’anomie de la vie urbaine et concurrentielle d’un capitalisme sauvage qui supprimait le lien social et les corps intermédiaires. Aujourd’hui, c’est une autre phase, puisqu’on constate la disparition des liens sociaux tels qu’ils s’étaient (re)constitués dans la société industrielle. Et dans le même temps, on constate également une communautarisation des relations sociales. Je ne parle pas de communautarisme au sens où on l’entend le plus souvent pour désigner des communautés – souvent fantasmées –, mais pour décrire les petits groupes qui se forment, notamment sur les réseaux sociaux et qui créent des entre-soi. Ces entre-soi fonctionnent comme des accélérateurs de conscience particulière. Vous avez des réseaux de gens qui se connaissent, se parlent et intensifient ainsi leurs points de vue communs du fait de la possibilité technologique d’accélérer la relation. Si ces groupes sont rattachés à des grands mouvements sociaux, ça peut avoir des effets massifs universalisants, comme pour les Printemps arabes mais, le plus souvent, ça reste de l’entre-soi particulier. Ce qui est frappant, c’est la possibilité de vivre avec son groupe, chacun dans son coin. Les solidarités locales n’ont pas la même signification selon le milieu social concerné, entre la stigmatisation-hiérarchisation (façon concours de la téléréalité) ou entraide égalitaire (façon épicerie solidaire).
Est-ce que les questions environnementales ont contribué à faire évoluer la question ?
Oui, là la notion de territoire devient plus heuristique, même si elle sent parfois le « terroir rural ». La justice environnementale consiste à prendre en considération les injustices sociales dans un espace donné et auxquelles se rajoutent les problématiques écologiques qui pèsent plus fortement sur les classes inférieures de la société. De ce point de vue, la question renvoie à des cumuls d’injustices – sociale, environnementales, raciales, etc.
Quels sont les mécanismes qui produisent les sentiments d’injustice ?
Les enquêtes de sociologie du travail menées ces dernières années montrent qu’il y a une pluralité de ces sentiments d’injustice et qu’ils sont très relatifs : finalement, chacun peut ressentir un sentiment d’injustice et de façon parfois injustifiée. Mais je pense que les politiques néo-libérales, qui sont conduites un peu partout, sont des accélérateurs d’inégalités sociales et mènent à des contrastes de plus en plus importants entre pauvres et riches qui sont générateurs d’augmentation des sentiments d’injustice et des risques d’explosion sociale.
En France, la pauvreté s’est stabilisée à un taux qui est parmi les plus bas des pays de l’OCDE. Il semble qu’il y a un décalage entre le ressenti des Français et leur situation. Comment l’expliquer ?
Il y a des filets sociaux de sécurité qui se sont progressivement mis en place, étape par étape, comme le RMI, puis le RSA, la CMU, etc. Ce sont des dispositifs assez spécifiques – et parfois sans équivalent, en tout cas dans les pays anglo-saxons – s’adressant aux plus pauvres, qui souvent sont sans emploi. Mais dans le même temps, beaucoup de salariés se sont appauvris, à tel point qu’on peut être à la fois pauvre et en emploi. Donc, oui, il y a un filet de sécurité tout en bas, mais beaucoup de gens se sont approchés du bas. Il y a entre 8 et 9 millions de pauvres en France, ce qui est quand même considérable.... On constate une diminution de l’extrême pauvreté mais la classe moyenne s’appauvrie et les écarts entre les plus pauvres et les plus riches augmentent. Ce qui domine, c’est une répartition inégalitaire des richesses qui accroît les inégalités existantes et qui nourrit le sentiment d’injustice. Il faut donc convenir qu’il y a à la fois une relativité et une objectivité du sentiment d’injustice, qui devient possible quand on le rapporte à des indicateurs bien établis.
Quels sont les risques attachés à ces sentiments d’injustice ?
L’un des risques est celui d’une instabilité sociale, voire de révoltes. La stabilité des démocraties repose sur l’importance de la classe moyenne. Or, pour qu’elle existe, il faut lutter contre les inégalités et « moyenniser » la répartition des richesses. Sans quoi il y a un risque de fracturation sociale qui entraîne une fragilisation de la démocratie.
Inégalités ne signifie pas seulement appauvrissement, mais aussi enrichissement. Il y a aussi un risque lié à la concentration du capital ; elle fragilise les équilibres démocratiques en tirant du côté d’une ploutocratie. Les liens entre politiques et milliardaires se sont resserrés, quand ces milliardaires ne deviennent pas présidents eux-mêmes.
Les spécificités des territoires ont-elles un impact sur la formation du sentiment d’injustice ?
À part la région parisienne, il ne semble pas qu’il y ait de territoires avec une culture de la contestation plus forte qu’ailleurs. Même les anciennes zones industrielles, parce qu’elles ont subi la désindustrialisation, n’ont plus la cohésion suffisante pour porter de grandes contestations. Je pense plutôt que c’est le traitement par les politiques publiques des inégalités dans les territoires qui peut jouer sur le sentiment d’injustice. Par exemple, une politique qui contribue à diminuer la présence des services publics dans des territoires isolés va contribuer à ce que les habitants se sentent injustement traités. De la même façon, la question des mobilités peut peser dans la formation du sentiment d’injustice. Moins de trains, peu de transports en commun, des taxes sur les carburants, etc., ceux qui sont isolés se sentent maltraités par la puissance publique. Ça a été une problématique commune aux révoltes des banlieues et des gilets jaunes. De ce point de vue, on peut parler de désaffiliation des territoires et de cumul des handicaps sociaux. Au fond, ceux qui peuvent donner le plus libre cours à une colère sociale sont ceux dont le sentiment d’injustice s’alimente par confrontation avec un cumul de handicaps.
Comment l’action publique locale peut-elle prendre en compte et répondre au sentiment d’injustice ?
Sauf exception, il y a une différenciation sociale, spatialement ancrée, entre les centres villes qui concentrent les richesses et les banlieues qui concentrent la pauvreté (ou l’inverse). Un des enjeux est de réduire les inégalités entre les deux. Mais le traitement politique de la misère n’est pas très rentable politiquement, puisque dans les zones déshéritées, il y a peu de mobilisations politiquement construites, peu de votants, etc. La misère n’est pas un enjeu politique électoral, c’est plutôt un enjeu politique d’urgence, en cas de révoltes. Selon le rapport du PNUD (en 2018), Cuba a ainsi éradiqué l’analphabétisme (99.7%) mieux que les Etats-Unis ou la France (99.3%)…
Vous parlez du sentiment d’injustice chez les plus pauvres, mais on le trouve aussi chez les classes moyennes et jusqu’aux classes les plus aisées qui peuvent trouver injuste de payer pour les plus pauvres…
Certes, mais la légitimité n’est pas la même. Pour moi, cela devrait être une priorité de ceux qui s’intéressent à la question du sentiment d’injustice d’objectiver la situation des gens qui s’indignent, comme de personnes qui vivent bien mais qui trouvent qu’elles paient trop d’impôts ou ne veulent pas que l’on touche à leurs intérêts. Il est vrai qu’en luttant contre les inégalités – et donc le sentiment d’injustice des plus pauvres – on peut nourrir le sentiment d’injustice d’autres parties de la population. On l’a vu par exemple dans les pays d'Amérique du Sud où des dirigeants comme Lula ou Morales ont eu des politiques fortes de lutte contre la pauvreté qui ont provoqué un sentiment d’injustice dans la classe moyenne qui s’est sentie abandonnée. De la même façon, les mesures d’affirmative action ou discrimination positive, qui visent à corriger une inégalité dans la distribution des places dans la société, peuvent être ressenties comme des injustices par ceux qui, par exemple, ont toutes les compétences pour un poste mais n’appartiennent pas à telle ou telle minorité. En Inde, les mesures prises pour soutenir les basses castes ont créé des jalousies parmi les autres. Donc il y a un enjeu de solidarité ou de traitement global de l’ensemble des personnes. Il y a un danger de délitement social auquel il faut répondre en objectivant les situations – et ce ne sont pas les indicateurs qui manquent, c’est la volonté politique. Entre contrôler les revenus des plus riches (notamment l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux), ne pas payer la dette ou vendre les bijoux de famille (les services publics), la tendance néolibérale a choisi depuis longtemps, au risque de développer le populisme autoritaire.

Étude
Positifs ou négatifs, les usagers portent de nombreux ressentis envers les administrations, que les collectivités doivent prendre en compte.
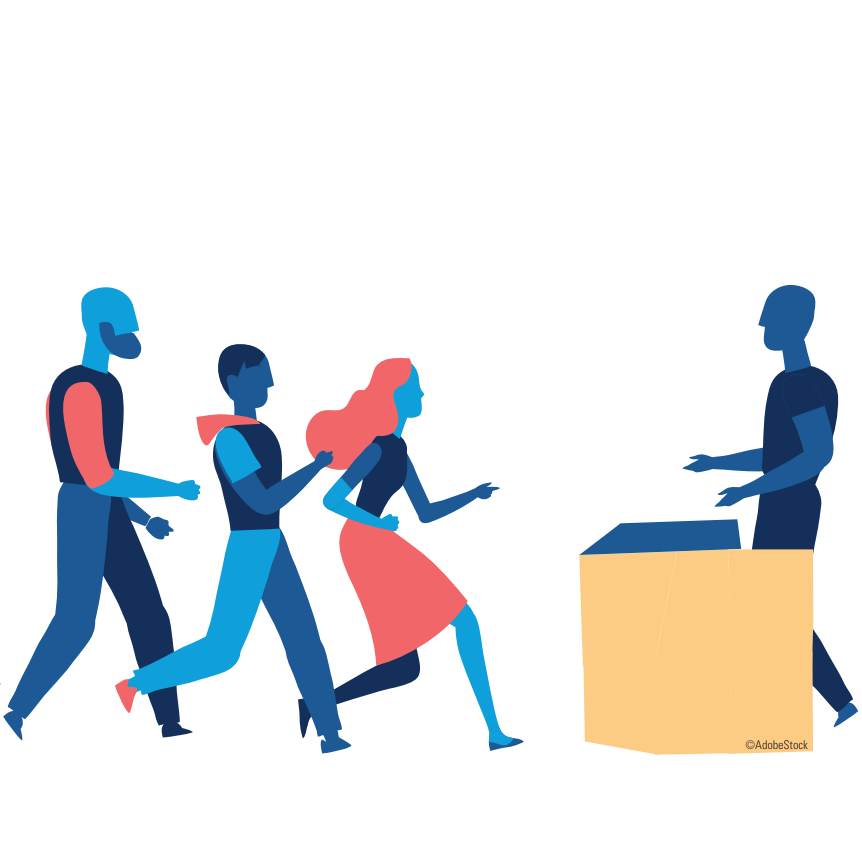
Article
Aborder le sentiments d'injustice comme des ressources utiles, pour une action publique plus à l’écoute des citoyens.

Texte de Nicolas Rio
Que peuvent faire les collectivités locales pour se rendre attentives aux sentiments d’injustice exprimés par leurs habitants/usagers, et mieux les accompagner ?

Étude
Synthèse de huit entretiens avec des chercheurs en sciences sociales, pour mieux appréhender les (dés)équilibres entre normes, ordre et inégalités.

Interview de Caroline Lejeune
Enseignante-chercheuse en humanités environnementales à l'Université de Lausanne
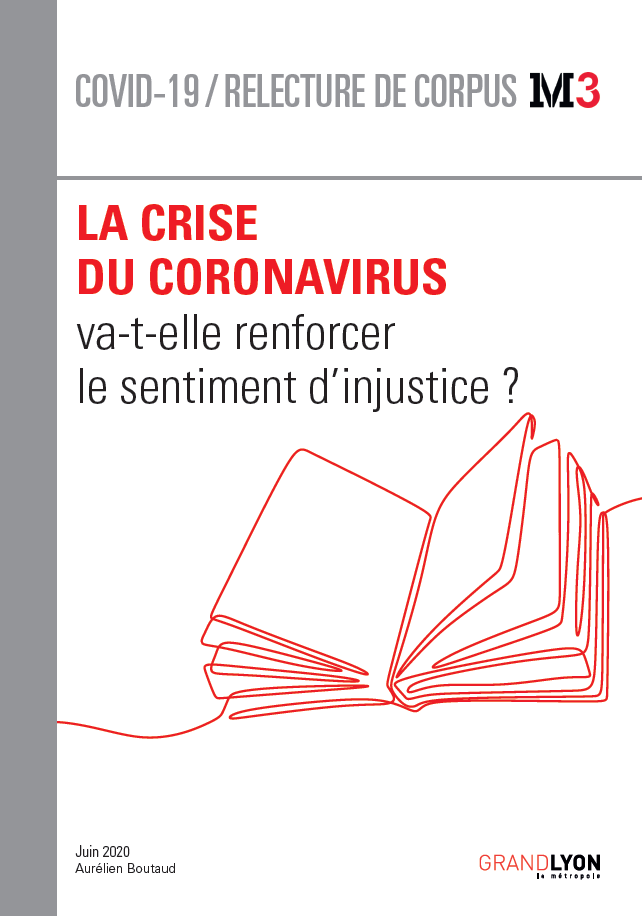
Étude
Inégalités face aux conditions de confinement, à la continuité pédagogiques, à l’exposition au virus : les sentiments d’injustices peuvent-ils sortir renforcés de la crise ?

Interview de Valérie Deldrève
Directrice de recherche en sociologie à l’Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement

Interview de Samuel Depraz
Géographe et maître de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3

Étude
Basée sur les articles parus dans le quotidien local Le Progrès entre juillet 2018 et juillet 2019, cette étude analyse le climat de défiance des citoyens envers les formes d'autorités et de pouvoirs publics.