Synthèse temporelles 2023 (1/2) : Quels temps pour vivre le collectif ?

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du jeudi 9/11/2023.
Interview de Nicole AUBERT

<< L'urgence fabriquée par notre économie gagne peu à peu les individus >>.
Interview réalisée pour la revue M3 n°3 par Caroline Januel, octobre 2012.
Nicole Aubert a mené de nombreuses recherches sur le coût psychique et humain généré par l'exigence de performance et d'excellence à l’œuvre dans l'univers professionnel (« Le Coût de l'excellence », 1991, réédition 2007). L'avènement de la « dictature du temps réel » l'a conduite à revisiter notre rapport au temps et à explorer ses modifications les plus récentes « (Le Culte de l'urgence. La société malade du temps », 2003). Ses recherches se poursuivent notamment sur les questions posées par la visibilité (« Les Tyrannies de la visibilité. Être visible pour exister ? », 2011) et sur les expériences de déconnexion. Nous l'avons interrogée sur les processus qui ont instauré dans l'entreprise et dans la société le règne de l'urgence et sur les conséquences de ce dernier sur les individus.
Depuis toujours, notre rapport au temps est complexe. Mais il semble que notre époque vive actuellement une mutation radicale. On parle d'accélération du temps, du culte de l'urgence, du règne de l'immédiateté... Est-ce réellement nouveau ?
Les rapports entre l’homme et le temps sont devenus conflictuels au moment du développement du capitalisme, quand s’est développée la corrélation entre le temps et l’argent. Pour le comprendre, il faut remonter au début du XIIe siècle, lorsque le temps était totalement déconnecté d’une quelconque correspondance avec la notion d’argent et de profit. Avant que le capitalisme ne se développe, le temps social dominant était celui de l’Église. Il était régulé grâce aux battements des cloches de la paroisse ou du couvent qui annonçaient les offices et rythmaient les travaux des champs. Il se fondait sur le déplacement du soleil et de la frontière entre le jour et la nuit. Le temps appartenait alors à Dieu, et non aux hommes. Mais les bourgeois négociants, qui circulent de ville en ville pour vendre leurs marchandises, ne pouvaient pas se contenter de ce temps de l’Église. Ils découvraient le prix du temps au fur et à mesure de leur exploration de l’espace, contraints d’intégrer dans le prix de leurs produits le coût de leurs déplacements d’une ville à l’autre. Le développement du capitalisme, ce sont aussi des horloges qu’on installe au fronton des beffrois et qui affichent un temps uniformisé, découpé en heures, qui rythme le temps du travail et celui du commerce. Plus tard, le chemin de fer qui impose des horaires, celui des horloges pointeuses dans les usines qui enregistrent le temps de travail des ouvriers, le temps GMT, le temps universel instauré en 1912 pour répondre aux exigences de la vie internationale, le développement des machines pour produire toujours plus vite. À partir du XVIIIe siècle, le temps apparaît étroitement lié à l’argent et devient quelque chose que l’on veut maîtriser et posséder. « Le temps, c’est de l’argent », conseillait Benjamin Franklin au jeune homme qui voulait devenir riche. Ce lien ne fera que s’intensifier au cours des siècles. Une nouvelle étape est franchie dans les années 1990 avec le développement des TIC (technologies de l’information et de la communication) qui fait apparaître un nouveau rapport au temps fondé sur l’instantanéité et l’exigence d’immédiateté : « Puisque je peux l’avoir dans l’instant, je le veux dans l’immédiat. » La logique du capitalisme financier, et d’une mondialisation économique de plus en plus concurrentielle, radicalisera ce lien dès la fin du XXe siècle et dans les premières années du XXIe siècle. Puisque gagner du temps a pour conséquence de gagner plus d’argent, le rapport au temps devient toujours plus tendu, calqué sur le rythme induit par les nouvelles technologies, les transactions financières se jouant désormais en termes de millisecondes.
Pourriez-vous nous expliquer les liens entre l'évolution du monde économique et ce phénomène d'accélération du temps ?
Notre rapport au temps est indissociable du régime économique dans lequel nous évoluons. Jusqu’à la fin des années 1970, le capitalisme industriel faisait de l’entreprise une source de profit, mais aussi une réalisation, une œuvre construite autour d’un métier ou d’un produit. Les grands industriels étaient animés par l’ambition de révolutionner les modes de vie, voire de changer le monde. Ils prenaient le temps de lancer leurs produits et savaient attendre pour récupérer leurs investissements. Regardez les parcours de Marcel Dassault, de Francis Bouygues, de Bill Gates ou encore de Steve Jobs. Ils ont fait de leurs passions un métier et ont consacré leurs vies à développer leurs entreprises, à innover, créer de nouveaux produits. Dans le régime du capitalisme industriel, les salariés sont invités à adhérer à la culture de l’entreprise et à partager ses valeurs. S’ils sont prêts à y faire carrière, ils seront récompensés de leurs efforts. Plus récemment, le capitalisme financier qui l’a supplanté évolue au rythme du des nouvelles technologies. Le retour sur investissement doit être réalisé très rapidement. Les traders utilisent des logiciels sophistiqués pour être plus rapides que leurs concurrents et anticiper le cours de la Bourse par des mouvements financiers appropriés. À ce rythme, l’humain ne décide plus grand-chose. La logique de l’enrichissement immédiat ne prend en compte ni la dimension humaine, ni celle de l’intérêt général. Le capitalisme a basculé dans un « délire de l’illimité », pour reprendre une expression de Frédéric Lordon, aussi bien dans la captation quantitative (la rentabilité financière) que dans la captation qualitative des salariés. Ce capitalisme mortifère s’installe au cœur des entreprises et des individus qu’il va utiliser, formater, épuiser pour améliorer la productivité de l’entreprise et générer toujours plus d’argent. Les individus s’engagent alors dans une quête pour gagner toujours plus de temps, aller toujours plus vite, vaincre le temps.
Cela signifie-t-il que l'urgence fabriquée par notre économie et par l'organisation des entreprises, gagne peu à peu les individus ?
Le règne de l'urgence s'inscrit dans un contexte de « flux tendus ». Ce qui, au départ, constituait une méthode de gestion de la production s'applique désormais à la gestion des salariés. En effet, ce processus « en flux tendus » s'applique aussi à la manière dont les individus sont contraints de gérer leur temps dans un contexte où il s'agit en permanence de parer au plus pressé, où l'urgent l'emporte sur l'important et le temps de l'action immédiate sur celui de la réflexion.
La « culture d'urgence » de l'entreprise diffuse ainsi ses exigences et n'est pas sans conséquences sur le plan humain. Outre la contrainte de réactivité immédiate aux sollicitations du marché, ces « cultures d'urgence » se caractérisent pas une survalorisation de l'action, conçue comme antidote à l'incertitude. On note aussi un phénomène de compression du temps, des hommes et des compétences, qui se traduit par la nécessité de « faire plus avec moins » : faire le plus possible, dans le moins de temps possible, avec le moins de gens possible et des compétences toujours plus polyvalentes ! Cette exigence accrue de polyvalence induit une déstabilisation par perte des repères. A force d'être flexible, mobile, de devoir s'adapter chaque jour à des tâches différentes, les personnes expriment souvent le sentiment de ne plus avoir de place nulle part.
Mais l'individu joue aussi un rôle dans cette diffusion de l'urgence. Quels sont les facteurs personnels qui rendent les uns esclaves de l'urgence, tandis que d'autres composent plus sereinement avec l'urgence ?
Certains individus évaluent l’urgence à sa juste mesure, d’autres la démultiplient. C’est cette urgence « intérieure » qui explique que, à situation égale, les uns parviennent à résister à la pression de l’extérieur et les autres non. Les psychologues évoquent le manque d’assertivité comme explication à la difficulté particulière de certaines personnes face à l’urgence. Est plus vulnérable celui qui a une capacité moindre à exprimer à l’autre son désaccord ou ses reproches
d’une manière ferme, sans agressivité, sans tension, sans s’énerver ni manifester une émotion excessive. A contrario, est protectrice la capacité à dire non et à refuser de céder à la pression d’une fausse urgence ou d’une urgence impossible à satisfaire dans les délais demandés. Certains sont entraînés dans une forme de démonstration de leur propre supériorité ou de leur propre puissance : « Je peux en faire plus que les autres (ou plus vite que les autres). » Cela n’exclut pas le sentiment qu’on s’est soi-même piégé, quand on réalise qu’il est impossible de faire marche arrière. Non une impossibilité réelle, bien sûr, mais une impossibilité mentale construite par la personne elle-même. On peut tirer un bénéfice secondaire de cette surcharge qu’on s’impose à soi-même, de cette impossibilité de refuser ce dont on se plaint : l’assurance qu’on est indispensable et, ainsi, la démonstration de sa supériorité et la justification de son existence. Dans le fait d’être en permanence débordé se joue une lutte contre une anxiété intérieure et un besoin de réassurance. Mais les choses peuvent aller plus profond encore et mettre en jeu l’angoisse plus fondamentale de mourir sans avoir vécu, sans avoir fait quelque chose de sa vie. Le vide est alors synonyme de mort. Le tourbillon d’activités fait alors fonction de sens à lui seul, l’urgence et la surcharge rassurent plutôt qu’elles n’angoissent.
L’instantanéité et l’urgence ne peuvent-elles pas aussi susciter des sentiments ou des attitudes positives?
Ce qui ressort de positif est le sentiment de pouvoir maîtriser, voire abolir le temps, et l’impression de toute-puissance qui en découle. Chez certaines personnes, il est indéniable que l’urgence agit comme un formidable démultiplicateur de performances. L’urgence les stimule, les incite à donner le maximum d’elles-mêmes et à se surpasser sans cesse. On retrouve les mêmes caractéristiques que celles du stress dit « positif ». Mais si l’urgence fonctionne ainsi sur certaines personnes, c’est qu’elles croient à la finalité de leurs projets, qu’elles peuvent les inscrire dans une continuité de sens. C’est aussi parce qu’elles affrontent l’urgence de manière relativement autonome et non subie. Cela n’est pas possible dans toutes les entreprises, loin de là.

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du jeudi 9/11/2023.

Article
Synthèse du colloque organisé par Tempo Territorial et la Métropole de Lyon – Retour sur les interventions du vendredi 10/11/2023.

Interview de Anca Boboc
Sociologue du travail et des organisations, spécialiste des usages du numériques en entreprise
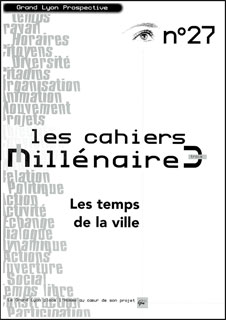
Étude
Le plan de mandat 2001/2007 du Grand Lyon met à l’ordre du jour une réflexion sur les temps de la ville.

Interview de Arnaud STIMEC
Professeur de gestion à l'université de Reims

Interview de Marie Peze
Docteur en psychologie
Interview de Michel WEILL
ARAVIS
Texte de Jean-Yves BOULIN

Étude
Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant