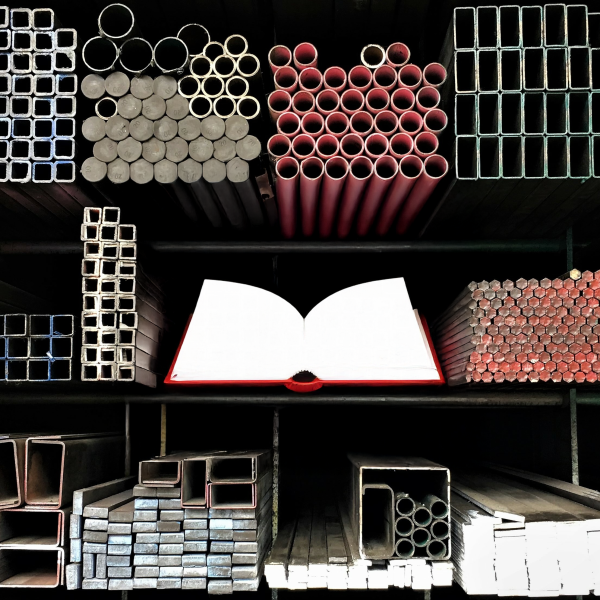Une première remarque est que, de fait, comme les villes sont dépendantes de l’extérieur, on ne peut pas penser la soutenabilité urbaine sans penser la soutenabilité de tout ce qui nourrit les villes. Ensuite cette question de la bonne échelle est une question ancienne sur laquelle se sont penchés de nombreux travaux pour essayer de comprendre dans quelle mesure la proximité des aires d'approvisionnement des villes est gage de soutenabilité de leur métabolisme. Je pense qu’il n’y a pas de réponse absolue à cette question dans la mesure où cela dépend de la taille des villes mais aussi des ressources dont on parle.
Dans le cadre de travaux portant sur le système alimentaire de l’agglomération parisienne, et selon les biogéochimistes avec lesquels je travaille, la bonne échelle de soutenabilité en termes d’alimentation serait le bassin de la Seine, c'est-à-dire à peu près 70 000 km², à comparer avec la région Île de France qui représente 12 000 km². Pourquoi ? Parce que ce qui dégrade fortement la qualité de l'eau de la Seine aujourd'hui, c'est l'agriculture, et plus précisément une agriculture qui n'est pas tournée vers l'agglomération parisienne mais vers les marchés mondiaux. Si l'on prend en compte cette interdépendance majeure entre la production alimentaire et la qualité de l’eau, c'est à l'échelle du bassin versant qu'il faut penser la soutenabilité de l'alimentation de la région parisienne. On voit bien à travers cet exemple que l'on n'est pas dans l’idée selon laquelle l’alimentation doit être produite en bas de ma porte !
Pour d'autres ressources, les périmètres à prendre en considération vont être différents. J’ai coutume de prendre l’exemple du sel : si on a besoin de sel, vu que les gisements de sel sont localisés, il y a nécessairement une ère de chalandise élargie. Encore une fois, il faut prendre acte de ces réalités et organiser les approvisionnements en conséquence. Ceci est vrai pour les villes et pour l’ensemble des territoires. C'est la raison pour laquelle on peut aussi parler de métabolisme territorial et pas seulement de métabolisme urbain.