Abécédaire de l’alimentation du futur

Article
Les mots-clefs d’un avenir proche, bientôt servi dans nos assiettes !
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Jacques Mathé
<< Le territoire est porteur d’une image qui peut accroitre la valeur immatérielle des produits qui en sont issus >>.
Cette interview a été menée en 2018, alors que la Métropole de Lyon souhaitait se doter d’une stratégie alimentaire à l’occasion de l’ouverture de la Cité de la gastronomie à l’horizon 2019. L’identification des enjeux alimentaires du territoire s’appuie notamment sur une série d’entretiens auprès d’experts du système alimentaire.
Dans cet entretien, Jacques Mathé appelle à davantage de pragmatisme dans le développement des circuits courts alimentaires, la préservation du foncier et la dynamique entrepreneuriale constituant deux leviers clé.
Jacques Mathé est économiste au réseau CERFRANCE (réseau associatif de conseil et gestion agricole) et Professeur-Associé à la Faculté de Sciences Économiques de l'Université de Poitiers.
Expert de l’économie rurale et il étudie particulièrement le développement des circuits courts de proximité et leurs impacts sur l'économie des territoires. Ceci l’a amené à développer des relations intenses avec des acteurs agricoles d’Amérique du Nord et témoigner des d’innovations majeurs qui s’y déroulent actuellement dans le lien entre la ferme et l’assiette. Il a publié en 2016 « 10 clés pour réussir dans les circuits courts ».
Face aux limites du système agro-industriel, un certain nombre de villes entendent reprendre la main sur leur approvisionnement alimentaire pour aller vers une alimentation durable. Partagez-vous ces préoccupations pour une reterritorialisation du système alimentaire ?
Je pense que ces nouvelles approches pêchent par idéalisme. Certes le système alimentaire actuel n’est pas satisfaisant en matière d’impact sur la santé et l’environnement, de partage de la valeur entre acteurs économiques, etc. Mais ce qui est en cause n’est pas nécessairement le caractère industriel du système. Il faut reconnaître l’intérêt du modèle industriel au niveau de la transformation. Par rapport à un modèle artisanal, éclaté entre de multiples acteurs, le modèle industriel présente un impact environnemental bien moindre si on raisonne à l’unité produite. Plus largement, penser que l’on aura demain des territoires autonomes au plan alimentaire me paraît largement illusoire.
Un point important ici c’est la demande du consommateur. Le consommateur se tourne vers des produits toujours plus élaborés. La demande pour des produits impliquant de cuisiner n’a pas le vent en poupe et occupe une place secondaire. Je préfère aller au cinéma et sortir une pizza du congélateur, plutôt que faire la pizza moi-même à partir de produits locaux. Lorsque que les gens veulent cuisiner, c’est à des occasions précises qui leur font plaisir, et alors ils vont aller sur le marché du coin chercher les produits dont ils ont besoin. On ne voit aucun retournement de tendance à ce niveau-là. Donc comment voulez-vous accroître significativement l’autonomie alimentaire des territoires simplement grâce aux circuits courts de produits peu ou pas transformés que l’on connaît aujourd’hui ? Par leur caractère artisanal, les circuits courts actuels ont une productivité beaucoup plus faible que dans le modèle industriel : les quantités produites par unité de travail n’ont absolument rien à voir. Cela a deux conséquences. Le prix unitaire des produits en circuits courts est beaucoup plus élevé. D’autre part, les circuits courts sont incapables de produire en grande masse, on reste sur des petits volumes. Une grande force du modèle industriel est qu’il est justement capable de produire en grande quantité des aliments très élaborés qui sont difficiles à réaliser à la ferme.
En bref, si les circuits de proximité tels qu’on les entend aujourd’hui parviennent à couvrir 15% des besoins locaux, ce sera bien le maximum. Il restera encore 85% de la demande qui sera satisfaite par des circuits, pas nécessairement longs, mais complexes au niveau du produit fini et du nombre d’intervenants entre le champ et l’assiette. Par contre, il me paraît essentiel de voir comment maximiser les externalités positives de ces 15% en circuits courts, en termes de redistribution de la valeur, de pédagogie et d’éducation alimentaires, de création d’activités et d’emplois, etc. Avec 15% d’approvisionnement local, vous pouvez avoir des bénéfices sociaux tout à fait significatifs, qui peuvent largement dépasser le poids du local dans l’assiette !
Vous suivez de près les initiatives nord-américaines en matière de circuits courts. De quelle vision du système alimentaire sont-elles porteuses ?
La vision idyllique du système alimentaire localisé que je viens d’évoquer est très franco-française. On ne retrouve pas cela en Amérique du Nord qui est pourtant en pointe sur les circuits courts alimentaires. L’approche nord-américaine est beaucoup plus pragmatique, plus concrète. Elle ne consiste pas à dire il faut remplacer un système par un autre. Au plan politique, la question alimentaire a pris une ampleur très forte ces dernières années en raison des enjeux de santé publique colossaux qu’elle soulève. C’est en Amérique du Nord que la dénaturation du système alimentaire est allée le plus loin dans le monde. L’ampleur du phénomène d’obésité provoque un électrochoc et un retour de balancier. Le gouvernement fédéral a pris conscience du sujet lorsqu’en 2005 le ministère de la Défense n’a pas réussi à embaucher son quota de GI. La raison principale était que trop de jeunes candidats étaient obèses. L’obésité devient un problème de sécurité nationale et on assiste depuis à la mise en place d’actions en faveur d’une meilleure alimentation. Les questions de santé publique constituent le premier motif des politiques alimentaires en Amérique du Nord.
Cela se traduit par quel type de politiques publiques ?
Au-delà des initiatives fédérales, ce sont les États qui détiennent les principales compétences sur le sujet. C’est intéressant de voir par exemple un État très conservateur comme le Texas mettre en place des politiques ambitieuses en matière d’éducation alimentaire. Par ailleurs il faut rappeler que le soutien à l’agriculture aux États-Unis est constitué à 80% par le soutien à la demande à travers le versement de bons d’aide alimentaire à plus de 50 millions d’américains. On observe par exemple que l’État du Vermont a doublé l’aide alimentaire en faveur de produits bio et locaux. Vous imaginez l’impact que cela peut avoir sur le développement de l’offre des producteurs ! Le Vermont est sans doute le territoire dans le monde où la part des produits bio locaux dans l’assiette du consommateur est la plus élevée. À Burlington, capitale du Vermont, elle atteint 50% ! Vous allez dans n’importe quelle pizzeria locale, vous trouvez une carte du Vermont avec la provenance des ingrédients utilisés. En France, nous en sommes à des années-lumière.
Vous soulignez également l’importance du foncier agricole dans le développement des circuits courts en Amérique du Nord.
La question foncière me paraît centrale dans la mesure où les circuits courts ne peuvent pas se développer sans accès à la terre, et inversement le développement des circuits courts constitue une motivation forte à préserver le foncier agricole. Il faut le dire et le répéter, l’accès aux terres agricoles en périphérie des zones urbaines constitue un enjeu central sur lequel les collectivités ont un vrai rôle à jouer. Au-delà des postures et des déclarations d’intention, les efforts en faveur du foncier agricole constituent un bon indicateur de l’engagement concret des responsables politiques en faveur des circuits courts. À ce sujet, les dispositifs de conservation des terres agricoles sont particulièrement développés aux États-Unis, notamment dans les régions proches des villes. Des fonds mutualistes collectent des donations monétaires ou en nature (foncier) auprès de membres bienfaiteurs. Ces fonds permettent d’acheter des terres agricoles. Par ailleurs, des propriétaires apportent des terres afin de défiscaliser les droits de succession sur le patrimoine foncier. Les terres cultivables ainsi collectées sont ensuite louées à des agriculteurs.
Beaucoup de fondations adossent le bail à des conditions d’exploitation respectueuses de l’environnement ou avec des objectifs de production particuliers : maintien de prairies, production bio, maraîchage, circuits courts, etc. Pour donner un exemple, en 2010 Land Trust Alliance a acquis 1,7 millions d’hectares et gère aujourd’hui 14 millions d’hectares sur l’ensemble des États-Unis, ce qui représente le quart de la surface agricole française. Cela a un vrai effet de levier. En France, ce type de dynamiques se développe, à l’instar de Terres de liens, mais cela manque encore d’ampleur. Du côté des collectivités territoriales, il manque des outils pour aller plus loin. Je pense notamment qu’il faudrait créer l’équivalent de la zone d’activités pour le foncier agricole, une sorte de zone alimentaire locale avec des droits de préemption associés. De façon indirecte, l’action de maîtrise du foncier agricole peut aussi se justifier par le fait qu’elle constitue le terreau pour lancer des projets éducatifs auprès des habitants et en particuliers des enfants.
Pourquoi faites-vous de la dynamique entrepreneuriale un ressort essentiel des circuits courts ?
Parce que c’est la clé de voûte ! Les producteurs nord-américains en circuit court s’inscrivent avant tout dans une logique entrepreneuriale où il s’agit de satisfaire le consommateur par une alimentation de qualité et durable qui fait la différence par rapport au reste de l’offre alimentaire. Aux États-Unis, les porteurs de projets ont certes une éthique affirmée, mais ils ont également une forte rigueur entrepreneuriale car ils savent que s’ils échouent il n’y aura personne pour les relever. Les projets sont généralement mieux charpentés et plus ambitieux sur le plan du modèle économique par rapport à ce que l’on voit en France. Chez nous c’est souvent folklorique. Trop de projets sont des projets non aboutis : le produit n’est pas terrible, on ne sait pas comment on va le vendre, les volumes de production envisagés sont ridicules, les prix de vente sont trop bas, etc. D’une manière générale, il y a beaucoup d’amateurisme, l’idéalisme de certains porteurs de projets prend souvent le pas sur leurs compétences entrepreneuriales. On observe ainsi beaucoup de projets en échec.
Le risque est encore plus élevé en production bio qui demande des compétences accrues pour maîtriser le produit. Cela pose problème car il ne suffit pas d’avoir du foncier agricole pour développer les circuits de proximité, il faut aussi des producteurs compétents. Une collectivité peut faire de gros efforts en matière de foncier, elle va aussi être confrontée à la question de savoir quels producteurs vont s’installer sur les terres. Comment s’assurer que leur projet est pertinent et viable ? A l’opposé, on observe aussi de belles affaires en circuits de proximité qui ne trouvent pas de repreneurs parce que ce sont des activités plus exigeantes, plus difficiles à conduire que les exploitations conventionnelles.
Il faut également souligner le fait qu’une part croissante des porteurs de projets n’est pas issue du monde agricole. Je vois arriver le même type de profil « hors cadre familial » que l’on observe en Amérique du Nord. Il s’agit de personnes bien formées – niveau ingénieur, bac+5, grandes écoles – mais qui bien souvent ne disposent pas de formation aux métiers agricoles. Ils viennent plutôt de formations en lien avec l’environnement. Ce sont des personnes qui viennent avec des projets beaucoup plus construits et porteurs d’innovation et de transformation du métier d’agriculteur, à la croisée de la production, de l’artisanat de bouche et du commerce.
Quels sont les enjeux de l’accompagnement des projets d’installation ?
Il y a déjà de nombreux acteurs qui interviennent dans l’accompagnement des producteurs, comme les chambres d’agriculture. Le problème c’est que l’on manque cruellement de personnes compétentes pour assurer un accompagnement spécifique sur les enjeux spécifiques des circuits de proximité : il faut être compétent non seulement sur les techniques de production mais aussi sur le modèle économique, la stratégie, la transformation, la commercialisation, etc. Un bon conseil pour les porteurs de projets c’est de prendre le temps d’aller voir ce qui se fait de mieux en Amérique du Nord, passer un an dans une exploitation bio pour maitriser tous ces aspects.
Au plan de la formation, je rencontre des lycées agricoles qui commencent à proposer des modules sur les circuits courts, mais cela reste balbutiant parce que l’on manque également de professeurs sur ces sujets. On part de très loin au plan conceptuel. Sur le sujet du modèle économique des exploitations, c’est-à-dire comment gagner de l’argent par la production alimentaire, il y a très peu de travaux en France. Tous les chercheurs qui font des travaux intéressants, tous les penseurs du système alimentaire comme Michael Pollan, sont en Amérique du Nord. Autre exemple, le Crédit Agricole, principal acteur bancaire du secteur agricole, est peu au fait des potentiels et des spécificités des circuits courts. La France est loin d’être un pays leader. Il y a un manque d’anticipation flagrant et c’est assez inquiétant de mon point de vue. En région lyonnaise, on a quelques acteurs comme Terres d’envie qui jouent un rôle intéressant, mais c’est encore largement insuffisant. Une réponse de la collectivité pourrait consister à soutenir la mise en place de formation de développeurs de projets entrepreneuriaux en circuits courts. Avant de parler de reterritorialisation du système alimentaire, donnons-nous déjà les moyens d’accompagner correctement les porteurs de projets. Il y a urgence ! J’ajoute que l’accompagnement doit être individuel et collectif. En effet, une difficulté des producteurs en circuit court est la pression du travail. Donc, favoriser toutes les taches qui peuvent être partagées ou organisées en mode collectif, par exemple sur la transformation, est un facteur d’amélioration des conditions de travail et de la viabilité économique de l’exploitation.
Vous martelez la nécessité pour les producteurs en circuits courts de définir des prix de vente véritablement rémunérateur…
C’est une facette de cette défaillance entrepreneuriale. Certains producteurs proposent des produits de grande qualité mais continuent de les vendre à des prix à peine plus élevés que produits conventionnels. Ça ne va pas ! La demande pour des produits en circuits courts est en croissance constante, donc l’enjeu n’est pas de trouver un marché, c’est de proposer le bon produit à cette clientèle qui sera prête à payer le prix fort dès lors que le sens et la qualité sont au rendez-vous. J’accompagne des producteurs vraiment très efficaces dans ce qu’ils font et qui s’accordent des marges tout à fait substantielles, pouvant atteindre 50% : 100€ de chiffre d’affaires, 50€ de bénéfices ! Et cela pour des productions végétales comme animales, avec ou sans transformation. Il n’y a pas de règle, ce qui compte c’est d’être bon.
Qu’est-ce que ça veut dire « être bon » ?
Être bon, c’est ne rien laisser au hasard, c’est optimiser et rechercher l’excellence de l’exécution pour chaque étape de production. C’est être passionné par son produit, par ses qualités organoleptiques. Les producteurs qui réussissent sont aussi des personnes qui aiment leurs clients, qui aiment la relation au consommateur. Ils lui racontent l’histoire qu’il y a derrière le produit. Ils transmettent beaucoup de valeur immatérielle à leurs clients. Il se noue une relation, un plaisir à travers le produit qui n’a pas de prix si j’ose dire. Vous achetez du vin et du fromage et vous les faites gouter le soir à vos amis en leur disant « goutez-moi ce petit fromage, goutez-moi ce vin… ». Vous valorisez le produit mais aussi vous-même à travers cette envie de partage d’un produit exceptionnel… Tout est là ! On est dans la logique du parfum Dior dont le prix dépasse largement le cout de production parce que l’on achète bien plus qu’un flacon. La réussite entrepreneuriale en circuit court est la conséquence de la qualité du travail à la ferme et dans la relation avec le client.
Vous dites que la massification des produits locaux dans l’assiette du consommateur se joue au niveau de l’approvisionnement des industriels de l’agroalimentaire, c’est-à-dire ?
Notre consommation alimentaire se compose en large partie de produits transformés en raison de leur commodité et ces produits doivent être produits à travers des procédés industriels afin de maitriser les couts. Une voie possible consiste donc à ce que les industriels opèrent un approvisionnement en matières premières plus proches de leurs unités de production. Par exemple, plutôt que d’acheter du porc là où c’est le moins cher, l’entreprise vendéenne Sodebo est en train de contractualiser avec des producteurs de porcs de Vendée. Idem pour la farine. Blédina est un autre exemple sur le lait. On peut donc avoir des entreprises qui conjuguent un approvisionnement plus ou moins local avec une certaine efficacité de production. Entre le système agroindustriel indifférencié et les circuits courts artisanaux, il y a la place pour une troisième voie : la relocalisation de l’approvisionnement des transformateurs. Je pense que c’est celle qui offre les gains les plus importants pour rapprocher la consommation et la production. On voit bien qu’un nombre croissant d’industriels et de distributeurs souhaitent se positionner en ce sens et ont besoin de développer des collaborations plus étroites avec les producteurs.
Encore une fois, je le répète, ces acteurs font évoluer leur stratégie non pas pour la beauté du geste, mais bien parce qu’ils ont besoin de redonner du sens à leurs produits face aux attentes d’éthique et de proximité des consommateurs. Il faut rappeler quelque chose qui n’est pas toujours connu : l’agroalimentaire est le secteur industriel où la création de produits nouveaux est la plus importante. Le renouvellement des produits est incessant, plus intense que sur l’électronique par exemple. Or sur 10 nouveaux produits alimentaires mis en rayon il y a 8 échecs. L’échec ne veut pas nécessairement dire que le produit n’est pas bon, mais c’est tout simplement que les consommateurs n’en veulent pas. Donc vous imaginez bien que les industriels et les distributeurs sont très sensibles à la quête de proximité, de qualité exprimée par le consommateur. Bien entendu, ce sera au consommateur et au citoyen d’être vigilants sur la réalité de la promesse affichée par le produit. La loi pourrait aussi nous y aider en renforçant les exigences d’information sur la provenance du produit sur l’emballage.
Comment accompagner ce mouvement à l’échelle des territoires ?
Il y a un enjeu d’image pour les industriels et les distributeurs. Ces acteurs ont besoin du territoire pour parler aux consommateurs. Le territoire est porteur d’une image qui peut accroitre la valeur immatérielle des produits qui en sont issus. Il y a un bon exemple de cela, c’est la Bretagne qui a su développer une marque de territoire et fédérer les acteurs agroindustriels derrière. Aujourd’hui sur cette dimension « origine locale », ce sont les Bretons qui donnent le La. L’intérêt de ces marques territoriales – « produit en Bretagne » par exemple – est qu’elles peuvent faire sens aussi bien auprès des consommateurs locaux qui valorisent la proximité, que des consommateurs du reste du pays qui sont en attente de produits inscrits dans un terroir.
Sur un plan plus concret, se pose également la question de savoir si la région lyonnaise est suffisamment pourvue en unités de transformation – de la première transformation au produit fini – qui pourraient rentrer dans ce schéma alimentaire local, sur le lait, la viande, les fruits et légumes, etc. Cela suppose aussi d’avoir une vue plus précise des productions agricoles disponibles aux alentours, aussi bien en quantité qu’en qualité.
Quelle est l’échelle pertinente pour organiser ces filières d’approvisionnement local ?
Comparativement aux États-Unis, pays des food miles, il me semble que l’on raisonne généralement sur des périmètres trop étroits en France. À mon sens, une bonne échelle de travail est celle de la région. C’est à cette échelle que l’on peut trouver la diversité et les volumes de production nécessaires. On peut s’appuyer sur un ensemble de produits de terroir très qualitatif à partir desquels on peut valoriser l’ensemble des produits du territoire. De ce point de vue, la région lyonnaise paraît avantagée au vu de la diversité des terroirs qui l’environnent. Qui connaît la qualité exceptionnelle des abricots des Monts du Lyonnais ?
Dans votre livre, vous passez également en revue les principaux canaux de vente en circuit court. Les magasins de producteurs semblent rassembler de nombreux atouts…
Lorsque le projet est bien conçu, les points de vente collectifs constituent en effet une voie intéressante. Implanté dans des lieux plus accessibles aux consommateurs que la ferme, le magasin de producteurs regroupe la production de plusieurs exploitations qui sont impliquées dans la gestion du point de vente. De simple comptoir de vente, il devient une véritable supérette, soignant le décor, la présentation des produits et des fermes impliquées, etc. Ce qui est essentiel à la réussite des projets c’est la symbiose des producteurs autour d’objectifs et de règles de fonctionnement rigoureuses au niveau de l’organisation du magasin, son approvisionnement, son animation. Dans les Monts du Lyonnais, vous avez l’un des magasins pionniers en France : Uniferme. En 2015, près de cinquante ans après sa création, le point de vente rassemble 18 exploitations et accueille 13 000 clients par mois. Le magasin comprend un atelier de transformation des viandes et de stockage.
Les magasins de producteurs présentent plusieurs avantages. Ils permettent de générer un chiffre d’affaires important en attirant des consommateurs à la recherche d’une offre large, d’une facilité d’accès et d’un contact avec les producteurs. Pour les producteurs, le point de vente collectif offre des conditions de vente plus confortables : facilité de mise en rayon, bon rapport temps passé/chiffre d’affaires réalisé, partage des risques. Par rapport à la vente à la ferme ou sur le marché, ces atouts sont loin d’être négligeables. Pour autant, on voit aussi nombre de magasins péricliter en raison de dysfonctionnements au sein du groupe de producteurs, d’une préparation insuffisante en amont. Le risque c’est lorsque le projet est principalement poussé par la collectivité qui veut absolument avoir son magasin de producteurs. Les producteurs se laissent embarquer sans réfléchir suffisamment et se mettre d’accord en amont. La collectivité est tout à fait légitime pour soutenir ces projets, mais ils doivent avant tout être définis et portés par les producteurs.
Qu’en est-il de la grande distribution ?
Elle est de plus en plus friande des produits locaux à forte image qui apportent du sens et du plaisir dans le caddie du consommateur. Les distributeurs courtisent les producteurs en circuit court en réservant des têtes de gondoles, voire des espaces totalement dédiés aux produits locaux dans les magasins. Le lien se fait directement entre les responsables de magasin et les producteurs. Chaque magasin veut son producteur de fromage, de charcuterie, etc. Par exemple, en Vendée, Système U référence des producteurs dans plusieurs magasins sans les obliger à contracter avec la centrale d’achat du groupe. Les transactions se font généralement sur la base des prix proposés par le producteur car la demande est très forte. On est loin de l’image de la grande distribution croqueuse de fournisseurs ! Ce n’est pas toujours facile à reconnaître...
La restauration collective est souvent présentée comme un débouché de première importance pour développer les circuits courts. Qu’en pensez-vous ?
Le potentiel de la restauration collective est gigantesque. Mais se tourner vers cette demande n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît pour les producteurs en circuit court. Qu’on le veuille ou non, les cahiers des charges de la restauration collective restent guidés avant tout par des logiques de volume et de prix. Et les prix attendus s’avèrent généralement très en deçà de ce à quoi un producteur peut prétendre sur un autre canal en circuit court. Autrement dit, les producteurs qui proposent des produits fermiers assez élaborés, avec une image forte, n’ont aucun intérêt à vendre à la restauration collective. Celle-ci concerne plutôt des produits de base (pomme de terre, salade, etc.) pour lesquels le producteur dispose d’une certaine productivité et d’un certain volume de production. On retrouve l’enjeu que j’évoquais précédemment sur la massification de l’approvisionnement local à travers des industries de transformation. Par ailleurs, il y a une saisonnalité des besoins de la restauration collective – arrêt des livraisons pendant les vacances scolaires par exemple – qui peut poser problème pour les produits frais. Enfin, il reste la question récurrente de la complexité des appels d’offres et de la gestion des aspects logistiques. Sur tous ces aspects, l’organisation des producteurs en amont et l’adaptation des cahiers des charges du côté de l’acheteur paraissent indispensables pour que cela puisse fonctionner.

Article
Les mots-clefs d’un avenir proche, bientôt servi dans nos assiettes !

Article
De l’Antiquité à nos jours, de la mythologie jusqu’à la pop culture, comment ont évolué nos représentations symboliques de celui ou celle qui travaille la terre ?

Article
Une infographie pour mieux comprendre les enjeux et différents niveaux de la stratégie de la Métropole de Lyon.

Article
Alors que le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir, quelle est la part de responsabilité de notre système agroalimentaire ?
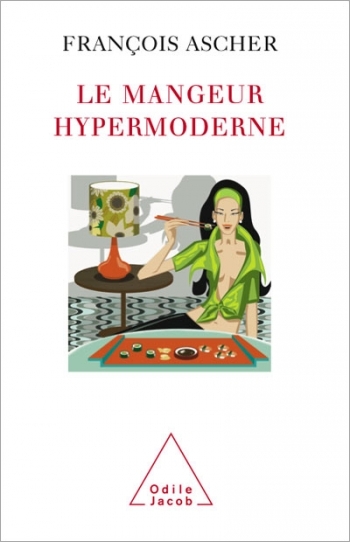
Article
En 2005, l’urbaniste et sociologue F. Ascher imaginait le mangeur d’aujourd’hui. Retour face à ce miroir déformant, qui en dit beaucoup sur le chemin parcouru depuis.

Interview de Jérémy Camus
Vice-président du Grand Lyon chargé de l’Alimentation

Interview de Lilian Vargas
Chef du Service agriculture, forêt, biodiversité, montagne au sein de Grenoble-Alpes Métropole

Interview de Jacques Mathé
Économiste

Interview de Michel H. Shuman
Expert du développement économique local

Interview de Jean-Louis Rastoin
Ingénieur agronome

Interview de Carole Chazoule
Sociologue à l'ISARA

Interview de Baudoin Niogret
Co-fondateur de Via Terroirs

Texte de Béatrice MAURINES et Lilian PELLEGRINO
Quelle agriculture en ville demain ?