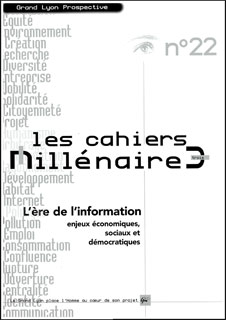C’est, pour beaucoup, une évidence : une ville fournit d’abord à ses habitants un ensemble de services. Plus elle se projette dans l’avenir, plus cette fonction prend de l’importance. Et pourquoi pas ? Cette évolution répond à une vraie demande des habitants dont les modes de vie individualisés, désynchronisés, ont besoin de s’appuyer sur des services multiples, efficaces et accessibles. La servicialisation est une autre manière de décrire l’extension de la division du travail aux tâches anciennement décrites comme ménagères et que les femmes, travaillant, n’assurent plus dans les mêmes conditions qu’auparavant. Elle répond également à l’impatience d’usagers face à des fonctions urbaines auxquelles nous avons progressivement imposé les critères de qualité et de performance attendus des services concurrentiels. Le changement que cela entraîne dans les termes a cependant été accueilli avec un sentiment mitigé. Les « usagers » sont devenus « clients », tandis que le mot « administré » prenait le chemin de l’enfer, qu’« habitant » et « citadin » cherchaient leur place et que « citoyen » s’envolait vers d’autres sphères. Les services liés à l’éducation, à l’eau, à la santé, à la mobilité sont regardés à travers les prismes de la productivité, de d’individualisation, du multicanal, de l’exigence consumériste et de la concurrence : car il y a toujours de meilleures façons d’obtenir ou de produire le même service.
Le moment est propice pour mettre le service au cœur de la question urbaine. D’un côté, cette ville à laquelle ses clients-citoyens demandent toujours plus n’a pas l’argent nécessaire pour répondre. De l’autre, l’exigence environnementale impose, à défaut de décroître, de dématérialiser. Le biais du service aide à desserrer ces deux contraintes. Dans les années 1980, on apprenait encore en économie que dans le domaine du service les gains de productivité étaient structurellement faibles. C’est pourquoi la tertiarisation de l’économie française a été considérée comme souhaitable, à la fois symbole de modernité et de bon augure en matière d’emploi. Mais, désormais, on peut automatiser la plupart des tâches de bureau, et même des fonctions relationnelles se voient remplacées par des batteries de téléopérateurs assistés par ordinateur, voire par des agents conversationnels automatisés. Le service peut également se proposer en substitut à des investissements lourds, comme c’est déjà le cas dans le domaine de la mobilité. Il y a autant, voire plus, de gains de productivité potentiels dans le service que dans l’industrie.
Un avenir écrit d’avance ?
En pensant service, on aboutit nécessairement à dissocier la finalité des moyens. Si l’objectif est atteint (éduquer tous les enfants, par exemple), est-ce un problème qu’il le soit au travers de partenariats public-privé, avec l’assistance active d’entreprises et d’associations périscolaires, voire directement par les parents ? Seul l’objectif relève encore du politique, le reste relève des moyens, qui se jugent par leur efficacité et leur efficience. Il suffit alors, pour dévitaliser entièrement le politique, de retirer les objectifs à leur tour du champ de la délibération. Les nouvelles smart cities de Songdo (Corée du Sud) ou de Masdar (Abu Dhabi) achèvent cette transformation. L’urbanisme, l’architecture et le système d’information y incorporent si profondément les principes fondateurs (économies d’énergie, économie circulaire, services ubiquitaires) qu’on se demande à quoi pourrait servir un maire élu. Aujourd’hui, pourtant, le champ s’ouvre à nouveau. Car le monde du service entre à son tour dans une période de crise et de mutation profonde.
L’industrialisation du service
La montée en puissance du service dans toute l’économie s’est accompagnée d’un formidable mouvement de formalisation et de professionnalisation – des processus, des modalités, des résultats – fortement appuyé sur l’informatique. Avec des résultats spectaculaires : pour en juger, il suffit d’évoquer le guichet administratif, le bureau de poste ou l’agence bancaire d’il y a quelques décennies. Au-delà de l’expérience du contact, l’informatisation a également transformé la nature et la diversité des services proposés et a permis au service de compléter, voire de concurrencer, la fourniture de biens physiques. On vend des copies plutôt que des copieurs, des kilomètres et non une automobile… Mais ce mouvement rencontre aujourd’hui plusieurs limites, tandis que la numérisation produit sa propre subversion.
L’industrialisation du service a progressivement éloigné les entreprises de leurs clients, alors même que s’élaborait le discours inverse. L’entreprise multicanal, 24/7, centrée client, entend fournir à ce dernier des services personnalisés grâce à la connaissance à 360° qu’elle a de lui. Mais ce client voit aussi une entreprise presque identique à ses concurrents, aux tarifs et aux gammes incompréhensibles, qu’il ne peut pratiquement plus joindre qu’au travers de canaux automatiques – et qui lui fait bien comprendre que parler à un opérateur humain coûterait trop cher. L’accumulation massive de données personnelles et d’outils capables de les traiter — ce que l’on nomme Big Data — renforce l’impression d’entreprises organisées autour de leurs ordinateurs et dont l’économie repose sur la capacité de substituer au maximum l’image de leurs clients à leurs clients réels, décidément trop imprévisibles. Résultat : ces investissements censés améliorer la rentabilité des clients la dégradent, la fidélisation qu’ils devaient produire s’étiole. Et le service se réoriente alors dans une autre direction, celle de la capture et de la mise en dépendance du client : le cloud computing transforme des produits (le disque dur, le logiciel) en services accessibles à distance à partir de n’importe quel appareil. Un service bien pratique, sauf au moment de changer de plateforme, où il devient difficile ou impossible d’emporter avec soi ses films, ses textes et autres (co)productions.
Un bien-être collectif qui se réduit
La transformation de formes collectives ou d’actes relevant de l’entraide en services apportés par des professionnels pose également d’autres questions et en particulier celle-ci : à partir de quand la transformation d’actes non marchands en actes marchands réduit-elle le bien-être collectif ? D’autant qu’à la minute où, par exemple, la visite chez un parent malade ou le prêt de sa tondeuse se transforment en services assurés par des professionnels, ils deviennent sujets aux exigences de productivité et candidats à l’automatisation. D’après Michèle Debonneuil, auteure en 2007 de L’Espoir économique : vers la révolution du quaternaire, le secteur quaternaire, essentiellement celui du service à la personne et du service à domicile, devait créer un million d’emplois en France : nous en sommes (et en resterons) loin.
La numérisation de l’économie ne produit pas seulement plus d’automatisation et un éloignement croissant entre des entreprises sur-outillées et des clients de plus en plus enfermés dans une relation subie. Elle produit aussi le covoiturage, Wikipedia ou la coproduction de cartes urbaines au travers d’OpenStreetMap, les réseaux de patients, une myriade de start-up dans la consommation collaborative ou les technologies vertes ou encore, l’omni-menace que les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) représentent — à tort ou à raison — pour à peu près tous les secteurs économiques… Autrement dit, la numérisation — appuyée sur l’Internet qui interconnecte les gens et les idées —, produit un mouvement constant d’innovation disruptive qui sape les bases des acteurs établis. Ce mouvement s’appuie à la fois sur quelques acteurs dominants du monde numérique, sur des éco systèmes d’innovateurs extraordinairement vivaces et sur les pratiques des utilisateurs eux-mêmes. Et l’innovation qu’il produit ne ressemble pas à la vision traditionnelle du service : de quoi relèvent par exemple les multiples projets de tricordeurs, ces appareils qui mesurent en quelques secondes plusieurs paramètres de santé et s’associent avec des applications de diagnostic, voire d’automédication ? Et La Ruche qui dit Oui, qui organise le lien entre agriculteurs régionaux et consommateurs citadins ? Et les Repair Cafés et autres Fab Labs où l’on se propose (entre autres choses) de s’aider à réparer des objets industriels le plus souvent conçus pour être jetés à la première panne ?
À la recherche de nouveaux agencements
La servicialisation de la ville répond à des attentes et à des contraintes réelles mais, parce que l’univers du service subit lui-même un bouleversement massif, elle ne suffit ni à satisfaire les citadins consommateurs, ni à réduire la pression budgétaire, ni à s’élever à la hauteur du défi environnemental et énergétique.
La réponse se trouve vraisemblablement dans la recherche de nouveaux agencements, outillés par le numérique et les réseaux, entre quatre pôles complémentaires : l’action publique régalienne, le service, les communs et les pratiques collaboratives. L’action publique régalienne (la gouvernance, la sécurité) doit viser l’efficacité et l’efficience, mais sans se vivre ni se présenter comme service. Le service, public ou privé, peut être marchand ou non, essentiel ou non, concurrentiel ou non… Les « communs » fournissent à tous un bénéfice mais sans prestation de service : la biodiversité, l’air, la carte (ouverte) du territoire, les open data, les lieux partagés… Et les pratiques collaboratives, de partage ou de coproduction entre (ex-)usagers : comobilités, échanges pair à pair de services, solidarités de voisinage, ruches micrologistiques, production et stockage locaux d’énergie…
En élargissant le regard au-delà du traditionnel dialogue entre institutions publiques et grandes entreprises publiques, on multiplie les options sans d’ailleurs se contraindre à en choisir une seule ; on oblige les uns et les autres à l’innovation ; on multiplie les ressources mobilisées au service de chaque morceau d’intérêt collectif ; on refait passer le message d’une communauté d’intérêts et de destin… Autre bénéfice potentiel, celui de s’autoriser plus aisément à penser d’une manière globale certains enjeux que la standardisation des unités d’œuvre nécessaire pour rémunérer les services rendus avait occultés, parfois depuis longtemps : le care plutôt que l’assistance, le bien-être au-delà du soin, l’apprentissage tout au long de la vie au lieu de la formation, la mobilité mieux que les transports, la multifonctionnalité des lieux…
En revanche, ces nouveaux agencements ont besoin de politiques et de dispositifs publics : une gouvernance ; des infrastructures et plates-formes physiques (lieux partagés) et numériques (cartes, interfaces logicielles, systèmes d’échange, médias publics…) ; des communs vivants et entretenus (espaces, données, connaissances…) ; des médiations et des médiateurs ; des autorisations (de prendre du temps, d’occuper l’espace, d’essayer, d’échouer…) ; des formes de reconnaissance des efforts et des réussites… Toutes additions nouvelles et peu familières à l’arsenal des politiques publiques, qui deviendront pourtant centrales dans les métropoles de demain.