Le soutien aux cultures urbaines et au hip-hop fait de Lyon un laboratoire de danses urbaines

Article
Le croisement des cultures émergentes à Lyon devient-il un symbole du territoire ?
Interview de Pierre Gilbert

<< Les opérations de rénovation urbaine suscitent parfois des réticences et des tensions, parce qu’elles déstabilisent un des principaux espaces de l’autonomie matérielle des classes populaires, un espace qui dans les cités est assez restreint comparativement aux fractions des classes populaires résidant dans des zones pavillonnaires >>.
Pierre Gilbert est sociologue, Maître de conférence à l’université Paris VIII et membre du CRESPPA–CSU (Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris – Cultures et sociétés urbaines). Ses recherches questionnent l’articulation entre l’espace et les processus de construction des groupes sociaux. Il a notamment réalisé une thèse de doctorat sur les transformations contemporaines des classes populaires au regard des travaux de rénovation urbaine dans une cité HLM de la banlieue lyonnaise : les Minguettes [1].
Deux axes structurent cet entretien. Premièrement, il s’agit de définir ce que désigne la notion de « classes populaires ». Elle doit s’employer au pluriel en raison des nombreuses lignes de fragmentation interne. Par exemple, le lieu et le type de résidence sont un clivage structurant au sein des classes populaires, induisant des usages et des rapports à l’espace domestique très différents.
Dans un second moment, Pierre Gilbert revient sur les conséquences des politiques de rénovation urbaine qu’il a pu observer aux Minguettes. Il évoque les effets de ces transformations urbaines sur les sociabilités locales, notamment marquées par des pratiques de mise à distance du voisinage, qui ne sauraient être compris sans se soucier des évolutions morphologiques du quartier.
Peut-on parler de classes populaires aujourd’hui ? Quelles sont les lignes de clivage identifiables ?
« Il y a des débats sur la manière dont on peut décrire la stratification sociale, l’échelle à partir de laquelle on peut l’étudier : est-ce à l’échelle de l’État nation que les choses se jouent ? À l’échelle transnationale ou infranationale ? Ce sont des débats qui interrogent beaucoup.
En France on a l’habitude de représenter l’espace social de manière ternaire, entre classes populaires, classes moyennes et classes supérieures, à partir notamment d’une sociologie bourdieusienne qui croise les styles de vie et les positions dans la sphère productive. Un des principaux outils empiriques est les PCS [1] et l’on pense souvent les classes sociales sur ce modèle. Avec la montée des inégalités de patrimoine, on peut aussi s’interroger sur le rôle croissant de l’opposition capital/travail qui permet notamment de distinguer la classe dominante de différentes fractions des classes moyennes et supérieures. Ce qui définit avant tout les classes populaires c’est la relation de subordination dans les relations de travail et la position d’exécution dans une relation de travail salarié.
Les travaux sur les classes moyennes montrent qu’elles sont très éclatées et qu’il y a des différences entre celles qui ont davantage de capital économique et celles qui ont davantage de capital culturel. C’est le schéma classique mobilisé par P. Bourdieu. Cela se retraduit en partie par des oppositions résidentielles, avec des classes moyennes et supérieures du privé qui résident dans des espaces davantage ségrégés, surtout pour celles du haut de la hiérarchie, alors que celles avec davantage de capital culturel résident plutôt dans des espaces « mixtes », du type « quartiers en gentrification », pour le dire assez rapidement.
Comme le montrent de nombreux travaux [2], la majorité des catégories d’ouvriers et d’employés, si l’on met à part les employés de bureau qui se rapprochent plus des petites classes moyennes, sont très proches en termes de conditions de travail, de revenus, de conditions d’existence, de styles de vie. Il y a des frontières qui ne sont pas hermétiques, avec les « petites classes moyennes » mais il demeure quand même des différences avec les classes populaires.
Qu’est-ce qui différencie les classes moyennes des fractions stables des classes populaires ?
Il y a d’abord la position dans la hiérarchie du travail. Les classes moyennes exercent des positions d’encadrement et des positions hiérarchiques intermédiaires, alors que les classes populaires, y compris les fractions stables (les ouvriers et employés qualifiés), occupent des emplois d’exécution. Donc elles ne sont pas situées au même endroit dans la chaîne hiérarchique. Par exemple les instituteurs sont des professions d’encadrement des classes populaires à l’école. La différence se joue également dans les écarts en termes de styles de vie, d’espérance de vie, de conditions de santé, de conditions au travail. On peut d’ailleurs noter un rapprochement depuis les années 1960 entre les conditions de travail des ouvriers et employés au niveau de la pénibilité au travail et des risques pour la santé physique et psychique. Au-delà du travail, il y a des différences en termes de loisirs et de distance vis-à-vis de certaines pratiques culturelles plus légitimes.
Lorsque l’on regarde à l’intérieur des classes populaires, on retrouve également des différenciations selon plusieurs lignes de clivages qui ne se superposent pas. Il y a des lignes de clivages qui sont liées à la qualification (opposition entre les ouvriers/employés qualifiés et non-qualifiés), des oppositions très fortes en termes de genre, des clivages qui renvoient à la précarité du travail et aux conditions d’emploi et des clivages renvoyant à la proximité avec le pôle de l’assistance sociale, pour le dire rapidement. Il y a aussi un clivage résidentiel, que l’on a souvent tendance à penser comme binaire (entre les cités et les pavillons) alors qu’il ne l’est pas : on a une grande diversité de situations qui vont de la rue et des SDF, en passant par les différentes strates de l’hébergement social, pour aller jusqu’à l’habitat pavillonnaire en accession à la propriété. Malgré cela, il y a tout de même une différence structurante entre les « cités HLM » et « banlieues pavillonnaires et milieu rural.
Vous associez les banlieues pavillonnaires et le milieu rural. Les conditions de résidence sont-elles réellement similaires ?
Il y a des conditions qui sont davantage liées au statut de la propriété et des styles de vie qui peuvent être éloignés des cités, à la fois dans les conditions d’existence mais aussi symboliquement. Très souvent, ce sont des classes populaires stables, qui développent pour reprendre les propos d’Olivier Schwartz, une "conscience triangulaire" [1] puisqu’ils sont à la fois à distance des classes supérieures et des classes populaires des cités HLM qui sont plus précaires mais aussi racisées. On a alors un clivage symbolique assez marqué entre ces deux strates dans les représentations sociales même si objectivement, il n’est que partiellement vrai puisqu’il y a des propriétaires dans des cités HLM et il y a de nombreux ménages de classes populaires qui résident encore dans des quartiers centraux. Il y a également des logements sociaux à la campagne. De même que beaucoup de villes ne sont pas gentrifiées notamment des petites ou moyennes villes où le modèle de la ségrégation se caractérise plutôt par un centre pauvre et une partie de la périphérie plutôt « bourgeoise », comme cela peut-être le cas de la ville de Saint-Etienne pour la région lyonnaise, ou de Marseille.
Les rapports à l’espace et aux mobilités ne sont pas les mêmes entre une zone pavillonnaire de banlieue et le milieu rural. Les voisins sont plus espacés, les trajets quotidiens peuvent-être plus longs et différents…
…Oui, cela créé des effets en termes de styles de vie, notamment la question de la mobilité et de l’importance de la voiture est déterminante, avec l’augmentation des déplacements quotidiens. C’est d’ailleurs un des éléments de contexte de la crise des gilets jaunes.
Il y a d’une part cette question de la mobilité et d’autre part, celle du rapport à l’espace : la possibilité pour les habitants d’avoir des espaces à eux. Dans les zones pavillonnaires, les habitants peuvent avoir des petites maisons avec une surface plus grande, un jardin, des espaces pour bricoler et pour faire ce que Florence Weber appelle le "travail à côté" [1]. C’est une économie à la fois productive et symbolique qui engage des échanges avec le voisinage. Et il y a plus d’autonomie dans la gestion de ces espaces que les habitants des cités, qui eux, disposent de logements souvent plus petits et de bien moins d’espaces appropriables. De plus, en tant que propriétaire ou locataire, les droits d’aménagement du logement et des alentours sont différents. Cela a des incidences sur les styles de vie et rend possible des pratiques et des usages différenciés.
Vous expliquez dans vos travaux que la sphère domestique est une sphère d’autonomie des classes populaires, en reprenant la thèse d’Olivier Schwartz. Elle serait d’ailleurs bouleversée par la rénovation urbaine. En quoi peut-on considérer qu’il s’agit d’une sphère autonome, à l’abri des rapports sociaux ? N’y-a-t-il pas des rapports de domination qui se jouent tout de même à l’intérieur de l’espace domestique ?
C’est relatif : cette sphère n’est pas complètement à l’abri des rapports de domination en réalité. Les classes populaires les plus précaires, en particulier, sont soumises à de nombreuses intrusions dans leur vie privée par diverses institutions, qu’il s’agisse de l’aide sociale à l’enfance, des institutions qui encadrent les budgets, etc. Par ailleurs, dans les cités les gens sont plus souvent locataires, donc ils ont une autonomie relative : ils n’ont pas un droit d’usage identique aux propriétaires. Le degré d’autonomie est aussi un des critères de différenciation des classes populaires. Cela renvoie non seulement au fait d’avoir des espaces à soi, mais aussi au degré auquel on peut s’approprier réellement les lieux.
Ceci étant dit, même si cette autonomie de la sphère privée est relative, elle est bien réelle comparativement aux expériences sociales que font les classes populaires dans d’autres espaces, où elles sont soumises de manière répétée à des situations de domination sociale : dans les rapports aux administrations, les interactions au guichet sont des relations de domination, dans les parcours scolaires on est aussi dans des relations hétéronomes avec des effets très clairs en termes de socialisation, dans l’univers politique, au travail, etc. Par contraste, l’espace privé est un univers que l’on peut aménager à sa guise à travers les pratiques de décoration, à travers les sociabilités, etc. Je reprends l’expression populaire de "Charbonnier maitre chez soi" : même le plus humble, dès lors qu’il franchit le seuil de son logement est maître chez lui.
La question de l’autonomie renvoie également à la question des rapports sociaux, qui ne sont pas que des rapports sociaux de classe. Par exemple les rapports de genre et la domination masculine traversent l’ensemble des classes sociales. Dans cette perspective, l’autonomie n’est-elle pas à relativiser ?
Vous avez raison, ce qu’il faut préciser, c’est que l’autonomie relative dont on vient de parler existe dans les rapports sociaux de classe. En revanche, à l’intérieur du logement se jouent très clairement des rapports sociaux de sexe, qui y prennent une forme spécifique. On connaît le rôle historique de l’invention du foyer dans la séparation à la fois théorique et pratique des sphères privée et publique, mais aussi des sphères de vie et dans l’exclusion des femmes de la vie publique et politique ainsi que de l’économie marchande [1]. Donc la création du foyer correspond à l’exclusion des femmes à la fois de la vie politique et des affaires marchandes et à leur assignation à la réalisation du travail gratuit qu’est le travail domestique. Cet espace privé est aussi un espace très clairement de domination masculine. On sait que les violences les plus fréquentes, physiques mais également sexuelles, sont commises par des proches, dans l’espace intime (le logement est un huis-clos dans lequel se déroule ce type de violences). Quand on articule genre et classe, le constat de l’autonomie est donc plus relatif.
Cela dit, à l’intérieur du logement, il peut y avoir de l’autonomie pour les deux conjoints. C’est ce qu’Olivier Schwartz nomme des « espaces personnels », qui peuvent être masculins ou féminins. Il y a l’idée qui était développée par la romancière féministe Virginia Woolf dans Une chambre à soi [2], qu’une des conditions matérielles de l’autonomie politique des femmes est d’avoir une pièce à soi et une somme d’argent pour être indépendante financièrement. Il y a des travaux plus récents qui soulignent aussi combien les espaces spécifiquement féminins dans le logement sont ambivalents et sont à la fois des espaces d’enfermement domestique et de domination masculine (type les pièces spécialisées dans l’accomplissement des tâches domestiques comme la cuisine), mais qui en même temps peuvent aussi être mobilisés comme des espaces d’émancipation féminine et féministe [3]. C’est une dimension que j’ai moins abordée dans ma thèse, où je me suis plutôt focalisé sur les classes sociales, même si maintenant je m’intéresse un peu plus aux questions de genre. Votre remarque est juste, il faut préciser que l’autonomie se manifeste vis-à-vis du critère de classe. Et on pourrait y ajouter aussi de « race »[4] car c’est un espace où l’on échappe davantage aux assignations racialisantes et l’on peut être soi sans être renvoyé à sa position subalterne dans le monde politique et du travail, ni dans sa position d’altérité et de minorité raciale dans les relations aux institutions et aux autres.
À une échelle plus large que la sphère domestique, le quartier peut-il aussi remplir cette fonction d’espace de protection face aux expériences d’altérisation vécues en dehors, notamment pendant la jeunesse ?
Oui, complètement. Surtout que la jeunesse est un moment très important. Il y a, pendant cette période, un recouvrement des sphères de vie : les gens que l’on côtoie à l’école sont les mêmes que dans le voisinage. L’espace du quartier prolonge d’une certaine manière le logement. Mais en même temps il y a des rapports sociaux hiérarchiques entre fractions « respectables » ou non dans le quartier. Il y a des frictions qui se jouent autour des usages du quartier mais aussi des espaces intermédiaires à l’intérieur d’un immeuble. Il y a un continuum entre les espaces de plus en plus appropriables. Et le quartier est un espace où les gens peuvent se sentir à l’abri des effets de stigmatisation. Je le développe dans un article paru dans la revue Sociologie, lorsque je parle de l’effet de légitimité résidentielle [1].
Dans votre travail de thèse, vous mobilisez la notion de « capital d’autochtonie » qui renvoie également à la notion de « respectabilité ». Est-ce un critère de fragmentation interne aux classes populaires ?
Dans ma thèse je montre que le capital d’autochtonie [1] peut être une ressource pour accéder aux logements sociaux les plus valorisés localement. Il y a notamment un capital d’autochtonie à dimension racialisée, dont bénéficient les immigrés et descendants d’immigrés du Maghreb considérés par les agents des organismes HLM comme « respectables » et comme des « alliés » pour essayer de contrôler la population. Cela permet de penser l’articulation entre les effets de la domination et la construction de cette domination par rapport à des ressources symboliques de groupe.
Le fait d’être catégorisé comme « maghrébin respectable » par les institutions de logement social, offre une ressource pour accéder aux logements sociaux, dans le quartier, mais pas ailleurs. C’est un capital d’autochtonie qui comprend une double dimension, raciale et religieuse. Les modes de sélection des locataires sur des critères de « respectabilité » sont associés à la pratique d’un islam « respectable ». C’est le cas chez les "Chibanis", où dans un des quartiers étudiés, il y a une mosquée considérée comme respectable et tenue par des Chibanis depuis longtemps. Ils sont perçus comme jouant un rôle pacificateur dans le quartier, un rôle de régulation des comportements de jeunes. Cette mosquée est située dans une tour qui a été démolie. Il y a eu un conflit entre la municipalité qui cherchait à faire disparaitre les mosquées en bas des tours et l’organisme HLM qui reconstruisait sur place et qui a appuyé la demande de l’association pour la reloger. D’un côté, la Mairie souhaitait institutionnaliser la pratique de l’islam avec la construction d’une grande mosquée, comme une manière de créer des loyautés locales tout en contrôlant la pratique religieuse. De l’autre côté, l’organisme HLM voyait dans cette mosquée un allié dans l’entreprise de régulation du voisinage. La question de l’Islam qui peut conduire à des formes de stigmatisation dans d’autres espaces, se traduit différemment dans ce quartier précis. Ce n’est pas le cas dans d’autres quartiers que j’ai étudiés, notamment quand les membres des mosquées sont plus jeunes et considérés comme "salafistes".
Un des objectifs des politiques de rénovation urbaine était de faire venir des classes moyennes dans les quartiers populaires. Qu’en est-il aujourd’hui ?
« L’objectif tel qu’il est affiché politiquement au niveau des acteurs nationaux de la politique de rénovation urbaine est de faire venir des classes moyennes mais aussi, quoiqu’on ne le dise pas ouvertement, mais « blanches ». Cet objectif, dans la plupart des quartiers rénovés et c’est le cas aux Minguettes, n’est pas atteint parce que les acteurs chargés du relogement qui mettent en œuvre la politique localement – que l’on appelle en sciences sociales les street level bureaucrats [1] – s’adaptent à la réalité et sont pris dans des logiques qui les conduisent à privilégier les fractions stables des classes populaires locales, notamment par rapport à cet enjeu de contrôle. Dans des immeubles dont on veut tout faire pour qu’ils ne connaissent pas la trajectoire de dégradation qu’ont subi les grands-ensembles, il est beaucoup plus sûr pour les bailleurs sociaux de placer dans des logements sociaux neufs quelqu’un que l’on connaît et dont on sait qu’il est respecté dans le voisinage, dont on pense, par expérience, qu’il saura « bien » se comporter, mais qu’en plus il aura l’autorité de dire au voisin de se comporter de telle ou telle manière.
Il y a aussi des logiques structurelles qui déterminent les choix résidentiels et qui font que les cités HLM conservent une image négative. En particulier, dans le cas des Minguettes, même s‘il y a des stratégies pour modifier le nom et l’image, ce stigmate fait que les gens qui en ont les moyens contournent et évitent ce types de logement. C’est d’autant plus le cas lorsqu’ils n’ont aucune expérience des cités HLM, ou lorsqu’ils ne sont pas immigrés ou descendants d’immigrés ou pour ceux qui ont un rapport que l’on pourrait qualifier de compliqué à « l’altérité raciale ». Il est quand même difficile d’attirer dans ces quartiers de nouvelles personnes. C’est ce que l’on peut observer lorsque l’on regarde la mise en location des logements en locatif libre aux Minguettes, qui offrent des rapports qualité-prix imbattables dans toute l’agglomération, pour des ménages salariés dans des grandes entreprises qui cotisent au 1% patronal et avec des planchers de revenus. En principe, cette offre, qui est mise en location par une des grandes agences de l’agglomération lyonnaise, devrait attirer sur place de nombreux candidats, qui en raison de ces critères d’entrée appartiennent nécessairement aux classes moyennes. Mais les logeurs ont eu du mal à les louer et ont été contraints d’assouplir les critères d’éligibilité. Ceux qui déposent des dossiers, après avoir vu que c’était aux Minguettes, sont en effet des ménages à la limite entre fractions stables et "petits moyens" [2] et qui pour beaucoup sont descendants d’immigrés, ont déjà une expérience des cités et ont donc moins d’appréhension à s’installer dans ce genre de quartiers. Par ailleurs, ces ménages connaissent sur le marché privé locatif des discriminations ethno-raciales importantes qui leurs laissent moins de choix que les autres.
Peut-on dire que les politiques de rénovation urbaine tendent à stabiliser les mobilités résidentielles ?
C’est compliqué de répondre parce que j’ai observé la rénovation à ses début et il faudrait poursuivre l’enquête sur un plus long terme pour le montrer. Pour les logements que je viens d’évoquer, qui sont minoritaires, il y sans doute une rotation importante, car c’est un statut locatif libre, et ce sont des ménages plus jeunes qui s’y installent et pour qui il s’agit d’une étape. Par contre, la majorité des autres ménages qui s’installent dans des logements neufs (en HLM ou en accession à la propriété) sont plutôt au milieu de leur trajectoire, ont entre 35-45 voire 50 ans, ont déjà des enfants, ont des réseaux dans le quartier, notamment familiaux, qui jouent un rôle important pour la garde des enfants et certains accèdent à la propriété. Cela favorise l’ancrage de ces habitants, en lien avec les clauses anti-spéculatives qui obligent à rester dix ans sur les lieux sous peine de devoir rembourser certaines aides perçues. Certains ménages que j’ai rencontrés avaient cependant intériorisé les nouvelles règles du jeu liées à l’explosion des prix de l’immobilier et envisageaient de vendre à un moment pour faire une plus-value et partir après, mais je ne sais pas s’ils ont pu le faire. D’autres envisageaient une installation plus durable dans les logements sociaux neufs. Pour une partie des habitants l’arrivée dans ces logements est assez contrainte, notamment pour les ménages qui ont trois enfants ou plus : les logiques d’accès au logement font que les personnes racisées et ayant beaucoup d’enfants ont moins de chances de trouver des logements ailleurs, encore moins sur le marché privé, à la fois pour des raisons de montant des loyers et de discriminations ethnoraciales. Mais l’entrée dans ces logements est en même vécue comme une mobilité socio-résidentielle ascendante, un sentiment que viennent appuyer les discours institutionnels, qui présentent ces logements comme une véritable rupture, une forme de promotion sociale en rupture avec l’habitat des tours HLM, dans lesquels beaucoup ont vécu.
Cela créé des effets importants, notamment en termes de rapports avec les autres habitants par la fabrication de logiques de distinction et de mise à distance partielle dans les sociabilités de voisinage.
Comment se matérialisent ces logiques de distinction et de mise à distance partielle du voisinage ?
Il y a d’abord des discours liés à un sentiment de promotion sociale qui se construit contre le modèle des tours HLM, qui met également à distance le modèle de « l’assistanat » et donc une partie des anciens voisins. À l’inverse, en réponse à cela, ceux qui se sentent vulnérabilisés par la rénovation urbaine et qui résident dans l’habitat ancien décrivent les nouveaux logements comme des logements pour "les riches" ou "les bourgeois" et se sentent très fragilisés économiquement, avec la peur de devoir quitter le quartier à terme. C’est la dimension symbolique de ces logiques de distinction.
Du côté pratique, il y a chez ceux qui connaissent une promotion locale un moindre investissement dans les sociabilités de voisinage et de quartier. Cela est directement lié au fait que les logements neufs, y compris les logements sociaux sont plus chers, donc il y a quasiment une obligation d’avoir deux salaires. Or, le taux d’emploi et en particulier des femmes aux Minguettes est très faible notamment en raison de discriminations multiples (sexe, niveau de diplôme, attributs ethno-raciaux, lieu de résidence). De fait, elles sont très disponibles pour les sociabilités locales. Or les couples qui connaissent des trajectoires de promotion sociale, en raison du coût des logements neufs, sont très souvent bi-actifs, et se trouvent moins disponibles pour s’investir dans les relations de voisinage. Ce moindre investissement résulte également d’une logique de mise à distance d’une partie du voisinage et elle transparaît dans la question cruciale du devenir des enfants. Cette question cristallise les angoisses parentales et se traduit par des logiques de contrôle de la scolarité : soit en investissant les établissements et les associations de parents d’élèves pour essayer de contrôler les conditions de scolarisation et s’assurer que tout se passe bien, qu’il y a des classes spécialisées. Ou alors en contournant la carte scolaire, notamment en allant dans l’établissement privé situé au nord de Vénissieux à la frontière du 8e arrondissement de Lyon, qui accueille une partie de ces élèves, ou encore dans le secteur public, pour certains par des choix d’options rares du type Russe ou autre.
Ces différences apparaissent aussi dans le choix des loisirs des enfants, sur lequel s’exerce un contrôle strict des sociabilités. Il y a deux craintes : celle de l’échec scolaire et celle de la mauvaise influence des autres enfants. Attention, il n’y a pas la volonté de se couper des enfants du quartier parce que pour beaucoup, il ne s’agit pas de renier leurs origines populaires de cité, mais il y a la volonté d’éviter que son enfant se fasse entraîner par les phénomènes de bande. Il y a l’idée de faire en sorte que les enfants aient des loisirs sur place, mais qui soient toujours encadrés par un adulte. Ces loisirs peuvent être des activités sportives mais aussi culturelles pour certains. Il y a par exemple une école de musique qui s’est installée aux Minguettes avec la rénovation urbaine et on constate un regain d’inscriptions des habitants des Minguettes, mais celui-ci concerne davantage les résidents des quartiers neufs alors qu’une partie des habitants anciens considèrent que "jouer de la flûte" ne correspond pas aux goûts des enfants des Minguettes (même si cela n’est pas systématique).
Y-a-t-il aussi des effets de quartiers qui se matérialisent spatialement entre des populations plus précaires concentrées dans le cœur du quartier, et à l’inverse des fractions plus stables des classes populaires situées à la lisière du centre-ville ?
C’est le modèle général mis au jour par les travaux de Christine Lelévrier et de Christophe Noyer [1], qui opposent le "cœur" et les « franges » des quartiers rénovés. Aux Minguettes, cela prend une forme particulière puisqu’il s’agit d’un grand ensemble de grand format, puisqu’au départ il y avait 36 000 habitants, pour à peu près 20 000 aujourd’hui. Il y a ainsi de nombreux équipements situés dans le centre géographique du grand ensemble, qui concentre également les nouveaux équipements : par exemple l’école de musique qui s’installe à côté du cinéma, une antenne de centre de formation pédagogique pour les futurs professeurs des écoles, un centre commercial qui a été refondé pour en faire un espace ouvert, etc. Tout cela se situe donc au centre des Minguettes, avec tout au long du tramway, une continuité urbaine qui vise à « banaliser » l’urbanisme du grand ensemble. Ces quartiers ne sont pas formés de tours mais plutôt de barres, et sont davantage valorisés. Six tours y ont été rasées et remplacées par des immeubles de petite taille. Autour du tramway des immeubles de petite taille en front de rue ont été reconstruits avec à la fois du logement social et de l’accession à la propriété. À l’inverse, sur l’extérieur, à la périphérie, on trouve des quartiers plus stigmatisés, formés essentiellement de tours barres HLM, avec une population plus précaire. Cette hiérarchie existait déjà avant la rénovation urbaine, mais va être renforcée par les choix de localisation des nouvelles constructions, les promoteurs ayant préféré les secteurs avec le plus de potentiel. Finalement on va ajouter à l’espace résidentiel une strate de logement supérieur, ce qui contribue au renforcement des hiérarchies déjà existantes. Il y a en moyenne 1 logement sur 10 qui est déconstruit puis reconstruit donc cela reste tout de même marginal. Au début de la rénovation, il y avait par ailleurs énormément de doutes et d’angoisses du côté des institutions sur la capacité de ces logements à attirer des candidats. Avec la crainte d’un nouveau fiasco, encore plus aux Minguettes où l’histoire a été marquée par un dépeuplement massif : en 1983 il y a 2 200 logements vides, qui s’expliquent en partie au refus de la préfecture et de la mairie de loger des familles immigrées, alors qu’il y avait des candidats. Ces vacances de logements étaient liées au départ des ouvriers qualifiés et des classes moyennes qui accèdent à la propriété et qui ont quitté les Minguettes.
Comment ces différences se traduisent dans les usages de l’espace public ?
Il y a des effets liés aux profils sociaux et aux logiques de distinction, comme on vient de le voir, et il y a des effets propres à l’architecture. Le modèle historique des grands ensembles est fondé sur une division fonctionnelle des espaces et sur la présence de nombreux espaces indéterminés : les espaces vides au pied des tours, les parcs (il y a un grand parc aux Minguettes). Ce sont des espaces de rencontres informelles et notamment de sociabilités féminines pendant les horaires de journées, autour des sorties d’écoles, etc. Or le modèle architectural de la rénovation urbaine est le modèle de la résidentialisation : c’est un dispositif d’aménagement urbain et résidentiel qui vise à clôturer les espaces extérieurs (codes d’entrée, clôtures) afin de normaliser les usages. Cette architecture se rapproche plus d’un urbanisme de centre-ville, dans laquelle il y a beaucoup moins d’espaces publics indéterminés et davantage d’espaces de circulation, ce qui ne favorise pas la rencontre.
Il y a différentes étapes dans ce processus. Les premières rénovations aux Minguettes datent de 2002 et, à ce moment, on n’est pas encore complètement dans la logique de la résidentialisation. Par exemple, trois immeubles neufs sont accolés les uns aux autres et, derrière, se trouve une petite rue menant aux garages, formant un cul-de-sac contraire aux préconisations sécuritaires en matière d’aménagement, qui cherchent depuis à éviter ce type de dispositif. Aux beaux jours, ces espaces semi-privés sont appropriés parfois pour organiser des repas de voisins. Or, dans les nouvelles résidences livrées à la fin des années 2000, ces espaces n’existent pas. Un des propriétaires que j’ai rencontré cherchait ainsi à organiser des repas de voisins mais ne trouvait pas d’espace approprié. À l’intérieur de sa résidence, il y a des espaces verts mais qui demeurent inaccessibles. Les opérations de rénovation urbaine suscitent parfois des réticences et des tensions, parce qu’elles déstabilisent un des principaux espaces de l’autonomie matérielle des classes populaires, un espace qui dans les cités est assez restreint comparativement aux fractions des classes populaires résidant dans des zones pavillonnaires. Ces espaces indéterminés, qui tendent à disparaître, étaient des espaces de sociabilités fortes. Ils étaient aussi à l’origine de conflits d’usages, notamment autour des jeunes qui occupent les rues et qui peuvent parfois créer des micro-conflits entre les différents habitants, pesant beaucoup sur leurs expériences quotidiennes et sur l’image du quartier.
À propos de ces images négatives des cités. Peut-on parler de ghettos urbains, comme se l’autorisent certains sociologues ?
Le problème avec les "théories du ghetto", par exemple celle de Didier Lapeyronnie, c’est qu’elles induisent une vision réductrice des styles de vie. Dans les moments de montée en généralité, il décrit les styles de vie des cités en les réduisant à l’économie informelle, à la culture de rue et à la domination masculine. Comme si la domination masculine (comme l’économie informelle) s’arrêtaient aux frontières des cités – alors que les enquêtes montrent que les violences domestiques et sexuelles sont très bien distribuées dans l’espace social et résidentiel, et ne sont pas plus fortes au sein des classes populaires. C’est aussi un raisonnement qui procède par synecdoque, qui part des recherches sur une fraction spécifique de la jeunesse et sur une dimension (la culture de rue ou l’économie informelle) pour l’étendre à l’ensemble de la population. En fait, cela ne concerne qu’un groupe minoritaire de jeunes hommes et pas l’ensemble des habitants du quartier, et y compris pour ce groupe de jeunes, ne saurait suffire à décrire leurs styles de vie. En réalité cela correspond plutôt à une sous-culture de classe d’âge et qui disparait après, quand les gens deviennent adultes. C’est ce que montrent par exemple les travaux de David Lepoutre [1].
Dans ce cas, est-ce que l’on peut dire que ce concept de « ghetto » existe mais que pour certains groupes sociaux ?
Non, car le concept sous-entend que c’est un style de vie qui dominerait l’ensemble du quartier. Dans ghetto, il y a l’idée d’enfermement, de relégation qui aurait pris une forme radicale, ce qui est faux empiriquement, et d’une contre-société qui concernerait l’ensemble de la population et qui s’opposerait au reste de la société. Ces deux postulats sont très discutables [1].
CARTIER, Marie, et al. La France des" petits-moyens". Enquêtes sur la banlieue pavillonnaire. La Découverte, 2008.
DAVIDOFF, Leonore et HALL, Catherine. Family fortunes: Men and women of the English middle class 1780–1850. Routledge, 2013
FASSIN, Éric, et Didier FASSIN. De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française. La Découverte, 2006.
GILBERT, Pierre. « “ Ghetto”," relégation"," effets de quartier". Critique d’une représentation des cités ». Métropolitiques. eu, 2011.
GILBERT, Pierre. « L’effet de légitimité résidentielle : un obstacle à l’interprétation des formes de cohabitation dans les cités hlm ». Sociologie, vol. Vol. 3, no 1, juin 2012, p. 61‑74.
GILBERT, Pierre. Les classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Transformations spatiales et changement social dans une cité HLM. Thèse de doctorat en sociologie, université de Lyon II, 2014.
LAMBERT, Anne, et al. Le monde privé des femmes: genre et habitat dans la société française. 2018.
LELÉVRIER, Christine, et Christophe NOYÉ. « La fin des grands ensembles ? », in DONZELOT Jacques (dir.), À quoi sert la rénovation urbaine ?, Presses Universitaires de France, 2012, p. 185‑218.
LEPOUTRE, David. Cœur de banlieue: codes, rites et langages. O. Jacob, 1997.
LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation, 1980.
RETIÈRE, Jean-Noël. « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire ». Politix. Revue des sciences sociales du politique, vol. 16, no 63, 2003, p. 121‑43.
SIBLOT, Yasmine, et al. Sociologie des classes populaires contemporaines. Armand Colin, 2015.
SCHWARTZ, Olivier. « Vivons-nous encore dans une société de classes? » La Vie des idées, vol. 22, 2009.
WEBER, Florence. Le travail à-côté: étude d’ethnographie ouvrière. Vol. 35, Institut national de la recherche agronomique, 1989.
WOOLF, Virginia. Une chambre à soi. 1929

Article
Le croisement des cultures émergentes à Lyon devient-il un symbole du territoire ?

Interview de Jean-Christophe Vincent
Président du club de football de La Duchère
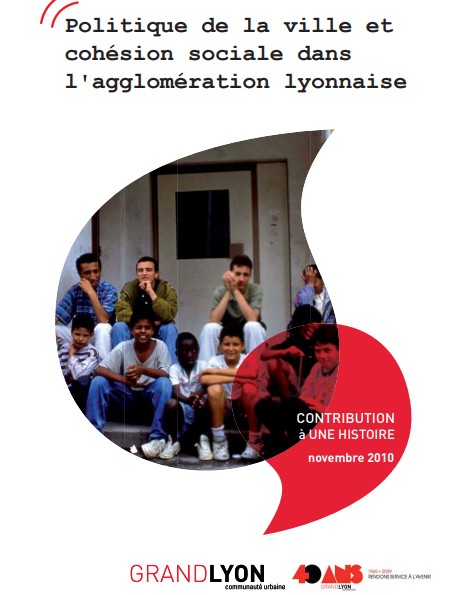
Étude
A travers ce qui sera appelé « politique de la ville » à la fin des années 80, de multiples enjeux se croisent, d’urbanisme, de peuplement, de mixité sociale, de transports, de diversité, etc.

Interview de Camille Peugny
Sociologue

Tour d’horizon des méthodes de modélisation urbaine et réflexions autour de leurs usages dans les politiques publiques.

Interview de Patrice TILLET
Président d'ABC HLM du Rhône
Interview de Michel ROUGE
Responsable en 2002 de la mission habitat du Grand Lyon

Étude
Cette étude revient sur ce qui marque les années 2000 de la politique de la ville.

Interview de Nawel Bab-Hamed
Chargée d'études sociologiques, culture & modes de vie à l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise (UrbaLyon)