Prendre soin des métiers du prendre soin

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
Interview de Gisèle Dambuyant-Wargny

<< Il me semble important de penser l’accompagnement des personnes vulnérables à partir de leurs corps >>.
Gisèle Dambuyant-Wargny est maitresse de conférences à l’Université Paris 13, habilitée à diriger des recherches, enseignante-chercheure au Département Carrières Sociales de l’IUT de Bobigny, membre du laboratoire de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS-CNRS/EHESS/INSERM/Paris13). Auteur de Quand on n'a plus que son corps. Soin et non-soin de soi en situation de précarité (Armand Colin, 2006), elle est spécialisée dans le champ de la précarité et du travail social.
Vous avez été assistante de service social avant d’être chercheure, ce qui n’est pas courant. Quel a été le déclencheur pour basculer dans le monde de la recherche ?
C’est vrai, j’ai une formation de travailleur social, puisque j’ai été assistante de service social de polyvalence. Au moment de la mise en place du Revenu Minimum d’Insertion, nous travailleurs sociaux avons vu arriver des publics que nous ne connaissions pas du tout : des hommes, isolés, sans famille, à cette époque en dehors des mailles de la protection sociale. Dans mon équipe d’une vingtaine de travailleurs sociaux, nous étions bien en mal de les prendre en charge. Je me sentais désarmée face à ces populations très marginalisées, fragilisées, exclues, je pense notamment aux SDF. Je me suis alors engagée dans un cursus en sociologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, avec l’idée de mieux les comprendre pour améliorer les modes d’intervention. J’ai fait deux rencontres importantes, l’une avec Georges Vigarello, spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps, qui a dirigé ma thèse qui portait sur le corps fragile et sa prise en charge, l’autre avec Robert Castel qui écrivait à l’époque son livre, Les métamorphoses de la question sociale.
Pourquoi avoir choisi de travailler sur la problématique du corps ?
Chez les « sans », parce que c’est bien en termes de manques que l’on peut les définir, par leur cumul de « sans », sans abri, sans travail, sans argent, sans ami, l’ultime ressource personnelle et mobilisable qu’ils possèdent encore est le corps. Le monde de la précarité est fondamentalement à lier au corps, par les pratiques inhérentes à la survie : problèmes d’hygiène, recours à des pratiques addictives, non-prise en compte des problèmes de santé. L’idée a été de travailler auprès de ces personnes, et de penser la question de leur corps comme ressource, dans toutes ses dimensions. Ma thèse est devenue un ouvrage, Quand on a plus que son corps. J’ai mis en évidence que les mécanismes qui en font des « sans » va de pair avec des mécanismes de l’ordre du « sur » : surexploitation de leurs corps, surconsommation, surexposition. Dans le monde de la précarité, ces corps deviennent une ressource surdimensionnée.
Pourquoi dire que le corps des personnes les plus précaires est une ressource surdimensionnée ?
Pour les sans-abri, cela s’observe dans les différentes sphères de leur vie quotidienne. Dans l’espace privé, le corps est surexposé aux violences de toutes natures et aux aléas climatiques. Pour avoir de l’argent, ils font la manche et ce faisant surexposent leur corps. On observe aussi une surexploitation du corps dans les parcours prostitutionnels, où des personnes consentent à des rapports sexuels, contre de l’argent, contre de l’hébergement, etc., une surexploitation des corps encore dans les pratiques addictives, avec consommation d’alcool, de drogues, de médicaments pour tenir… Le corps est forcément impacté par cette consommation excessive. Il est également sursollicité au niveau relationnel, parce les relations sociales sont très fluctuantes, notamment avec les travailleurs sociaux : en effet, dans les services où les professionnels s’occupent de corps en grande souffrance, le turn-over est très important, parce qu’il est difficile de s’occuper au quotidien de ces situations. Au sens large du terme, je dirais que le corps des plus précaires est dans un fonctionnement de surexploitation. Dans le monde de la survie, tant physique que sociale, il existe trois sous-groupes : les sans-abri qui résident dans l’espace public, les hébergés majoritairement domiciliés en centre d’hébergement, où se commettent beaucoup d’actes de violence et d’agressions, et les domiciliés précaires qui habitent dans des espaces — cabanes, abris de jardins, tentes…—, au bord de la Seine ou de la Marne par exemple. Pour tous, le corps est en surexposition permanente et les pratiques d’autodestruction, où l’on met son corps en danger de diverses manières, sont innombrables.
Comment avez-vous procédé pour savoir ce que la grande précarité fait aux corps ?
Pour accéder à cette réflexion, il me fallait considérer le corps dans toutes ses dimensions. Avant d’avoir mon poste d’enseignante-chercheure à l’université, j’ai travaillé cinq ans comme chercheure au SAMU social de Paris. J’avais accès aux données quantitatives et j’ai pu tourner sur les maraudes. Fondamentalement, l’observation est restée très centrale dans mes enquêtes, in situ et à toutes les heures du jour et de la nuit. J’ai réalisé des entretiens approfondis avec l’ensemble des acteurs concernés. Des personnes en situations de précarité avec de multiples parcours : des femmes, des hommes, de cultures et d’âges différents ; des professionnels très variés, médecins, travailleurs sociaux, agents de sécurité et gardiens de nuit, mais aussi les proches des personnes précaires, notamment les bénévoles dont le discours et les pratiques sont complémentaires à celle des professionnels sur la prise en charge du corps.
Nos corps sont fragiles et vulnérables, quand on est enfant, malade, handicapé, âgé… Que rajoute la précarité ?
Effectivement, on peut penser le corps fragile pour des raisons physiologiques, d’âge par exemple. Les petits et les personnes âgées sont fragiles, ce qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de ressources, qu’ils ne sont pas entourés, puisque majoritairement, la famille vient en support. Le corps des personnes handicapées est fragile donc vulnérable, de par la situation de handicap. La question des entourages change complètement la donne dans l’impact de la vulnérabilité sur le corps. Dès lors que la personne est dans l’exclusion, il lui reste moins de ressources. Trois types de groupes ont un corps particulièrement vulnérable : les exclus, les fragiles, les précaires. Tous les publics de l’intervention sociale cumulent des difficultés qui marquent les corps, et les discriminent physiquement et socialement. Les corps ont été détériorés par des traumatismes, des agressions, des violences physiques et/ou sexuelles, des pratiques addictives, même si les situations sont extrêmement différenciées en raison des parcours, des modes de vie et des profils. Ces réalités sont souvent associées à un sentiment de honte et de culpabilité. Le corps est alors à prendre en charge par les professionnels et par les bénévoles, de façon différenciée parce que les supports et les ressources mobilisables, notamment relationnelles, ne sont pas les mêmes.
Combien de personnes en France sont à ce point fragilisées ?
En France métropolitaine, dans la seconde moitié des années 2000, 133 000 personnes étaient sans domicile : 33 000 en très grande difficulté (entre la rue et les dispositifs d’accueil d’urgence), 100 000 accueillies pour des durées plus longues dans des services d’hébergement social ou dans un logement bénéficiant d’un financement public. Par ailleurs, 117 000 personnes également sans logement personnel, recouraient à des solutions individuelles (chambre d’hôtel à leurs frais ou hébergement par des particuliers). En outre, 2,9 millions de personnes vivaient dans des logements privés de confort ou surpeuplés, le cumul des deux insuffisances concernant 127 000 personnes.
Quel est le processus qui conduit à la dégradation de l’image corporelle de la personne et au sentiment de honte ?
Dans l’image corporelle et l’estime de soi, il y a ce que l’on pense de soi, et ce que l’autre nous renvoie de ce corps, malgré lui, par l’intérêt accru qu’il nous porte ou au contraire par son désintérêt : il n’y a rien de pire que de passer à côté de quelqu’un comme s’il n’existait pas. C’est pourtant ce qui arrive tout le temps lorsque des gens passent devant des sans abri : on leur renvoie malgré nous le fait qu’ils n’existent plus. Quelle image corporelle peut-on alors avoir de soi ? Il y a un troisième niveau, celui de l’autre et de soi dans l’interaction, où se pose alors de façon centrale ce corps stigmatisé, et où s’associe alors le sentiment de honte. La honte ne peut pas être mise de côté dans une situation de vulnérabilité. On ne peut pas faire certaines choses lorsqu’on est petit ou quand on est âgé, mais c’est normal. En revanche, lorsqu’on ne travaille pas alors qu’on est en âge de le faire, encore plus si on est un homme, c’est hors norme. Majoritairement, l’anormalité est assortie au sentiment de honte. Au-delà, cette réalité impose de prendre en compte l’ensemble des émotions de tous les acteurs, pour essayer d’avancer avec elles. Pour les personnes fragilisées nous avons tendance à prendre l’émotion dans son versant négatif, mais il faut savoir utiliser des émotions positives, certes moins fréquentes, pour faire avancer leur situation. Je pense à des réalisations faites avec des personnes en situations de handicap et de rééducation motrice qui vont éprouver de la joie et seront valorisées du fait d’avoir réussi quelque chose qu’elles ne pouvaient pas faire auparavant.
Vous avez pu établir dans vos travaux que la honte liée au corps a des effets importants, lesquels ?
La vulnérabilité dont les causes sont multiples s’associe fréquemment au sentiment de honte. Ce sentiment prend ses sources dans une double dimension intérieure et extérieure, ressentie et renvoyée. La honte est un sentiment éminemment social, puisqu’elle naît sous le regard d’autrui dans la confrontation du sujet au monde, elle vient du décalage entre ce que l’individu est et ce qu’il voudrait être, aussi bien individuellement que socialement. La honte impacte les plus démunis à divers niveaux en se focalisant sur la dernière ressource à leur disposition : leur corps. Il y a la honte du corps éprouvé, parce que le corps vulnérable est rapidement marqué par la précarité : corps souffrant d’un handicap, corps sale, nauséabond, délabré au point de ne plus être soigné, il y a la honte du corps désocialisé, et la honte du corps stigmatisé qui résulte de l’interaction sociale entre les individus. Le sentiment de honte provoque de la souffrance et une perte d’estime de soi. Ces réalités peuvent être prises en charge par les intervenants sociaux.
Des chercheurs ont établi un lien entre le sentiment de honte liée à l’image corporelle négative, et le non recours à des droits sociaux ? L’avez-vous aussi observé ?
Tout à un chacun connaît les normes sociales, les normes corporelles. D’où une volonté d’être ou pas dans la norme, d’être ou pas dans l’hygiène, d’être ou pas dans la présentation, mais aussi de recourir, au pas, à l’offre que l’on vous propose. D’ailleurs ma thèse s’intitulait : « Entre choix et destin, la condition sociale des plus démunis : la place du corps dans la désocialisation ». Je me suis beaucoup intéressée à la question de la part de choix qui reste aux personnes les plus désocialisées. Quand vous les interrogez sur la raison qui explique leur situation d’être dans la rue, ils vous répondent : « c’est mon choix ». Je suis persuadée qu’être sans abri n’est pas un choix délibéré mais le résultat d’un processus de disqualification. Pourtant il reste des choix possibles, y compris pour les plus démunis, concernant des choses très basiques. Ne pas se laver par exemple, c’est être sûr de repousser l’autre, ou en tout cas tout faire pour éviter les relations sociales. Le corps devient l’ultime ressource dont dispose l’individu pour exercer des choix, en tout cas tant que le corps le permet — parce que dès lors qu’ils ne peuvent plus bouger, ils se font attraper de force —. J’ai observé des stratégies extrêmement sophistiquées pour se cacher — quand on voit de loin des travailleurs sociaux ou des médecins —, pour s’exhiber, pour dissimuler, autant que possible la réalité sociale. Par exemple, certains choisissent d’aller aux bains douches, plutôt que d’aller gratuitement dans les centres d’accueil, parce que ce sont des lieux normalisés. Pareil pour les vêtements : on n’ira pas dans un vestiaire, on fera la manche pour s’acheter à 5 euros une chemise à tel endroit. Bref, le choix est restreint mais il existe, tant sur la façon de s’occuper de son corps, que de le parer, de l’habiller, de le soigner, éventuellement de le détruire… et ce choix doit être réhabilité.
Le corps des personnes en insertion peut faire obstacle à leur employabilité, parce que le recruteur pourra être rebuté par des vêtements sales et inappropriés. Quels conseils donneriez-vous aux professionnels de l’insertion pour lever ces « freins corporels » ?
Le corps parce qu’il est délabré, très dégradé, ou à cause des odeurs qu’il dégage peut être parfois repoussant, il peut heurter. Comment faire ? Il convient que le professionnel et la personne fragilisée, dans le cadre d’une relation de confiance, se posent la question et arrivent à pointer ce qui est fondamental pour ne pas entraver une relation. Tout dépend de ce qui peut gêner l’interaction. Pour avoir ne serait-ce qu’une petite chance d’avoir un emploi, il faut y aller propre, avec une tenue vestimentaire adaptée. Je suis persuadée que les personnes même les plus précarisées ne sont pas hors de la compréhension des normes de la société. Nous ignorons, ou tout du moins sous estimons, leur extrême lucidité qu’elles ont d’être en dehors de la norme. Cela les fait souffrir. Toute proposition qui peut les ramener dans la norme peut générer une situation d’acceptation et de reconnaissance. Il y a là quelque chose à penser sur la norme et leur distance à la norme. On peut alors penser, dans un premier temps, à des pratiques d’hygiène et de soin, avant de penser, dans un deuxième temps, l’arrêt de conduites addictives comme la consommation d’alcool, ce qui est bien plus compliqué. Les pratiques peuvent bouger, je l’ai observé maintes fois en tant qu’assistante sociale et en tant que sociologue : dès lors la confiance s’installe, des mécanismes s’enclenchent, des choses se mettent en place. Il faut accepter que le changement se fasse dans la durée. Une personne du SAMU social disait qu’il fallait des années pour se remettre d’une année à la rue, où se mettent en place des mécanismes de survie, où l’on se repose, sans vraiment dormir, par crainte de se faire violenter ou voler… rapidement, une fatigue considérable s’accumule. Il est donc strictement impossible que du jour au lendemain la personne adopte un comportement normé, notamment par rapport au travail. Le corps doit se reposer, et reprendre des mécanismes basiques. Déjà dans mon ouvrage, sorti en 2006, j’avais proposé des ateliers de récupération corporelle, où le seul « contrat » passé entre les professionnels et ce public serait de stabiliser l’état de santé. Par la suite, dans le cadre de retour à l’emploi, il est nécessaire de proposer des adaptations de poste, par exemple du travail à temps partiel, pour que petit à petit des choses se réenclenchent.
Que peuvent faire les différents métiers du social et du médico-social sur les corps ?
Evidemment c’est très compliqué. Le corps est central pour toute personne, et il est très difficile de l’aborder. Pour cela, je suis persuadée qu’il faut diversifier les pratiques professionnelles. Il y a les médecins qui s’occupent prioritairement de l’aspect médical, les psychologues du traitement psychologique, les intervenants sociaux de la prise en charge sociale par l’aide psychosociale du corps désocialisé. Dans le champ social et médico-social, de multiples interventions peuvent prendre en compte la dimension sociale du corps, et améliorer l’estime de soi et la revalorisation de la personne. Mais il faut faire entrer de nouveaux professionnels, qui ne sont pas encore considérés comme des travailleurs sociaux. Je pense aux socio-esthéticiennes qui pour moi font partie des intervenants sociaux, parce qu’elles ont une approche complémentaire du corps en souffrance. Là où les assistants de service social sont dans l’aide psychosociale qui passe par la verbalisation, très importante puisque le corps s’exprime aussi par le langage verbal, les socio-esthéticiennes touchent directement le corps, ce que ne font pas les travailleurs sociaux. Elles interviennent dans les hôpitaux, notamment dans les centres où sont prises en charge les personnes atteintes de cancer, mais aussi dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS), dans les centres pénitentiaires…
Quelle différence entre le métier d’esthéticiens et celui de socio-esthéticiens ?
Ce sont des esthéticiennes tels que les connaît le grand public, leurs soins restent des soins esthétiques « traditionnels », soins du visage, de la peau, beauté des mains et des pieds, maquillage, épilation… mais ils sont adaptés aux réalités du corps en souffrance. Il faut avoir un diplôme d’esthéticien et suivre ensuite une formation complémentaire pour apprendre à faire des soins auprès de corps en souffrance. Cette formation en France se fait dans deux écoles, dont une dans un centre hospitalier de Tours. Les soins peuvent se réaliser par des séances individuelles ou collectives. En trente ans, il a été formé plus de 1 300 socio-esthéticiens intervenant auprès de publics variés en situation vulnérable. Concrètement, ces pratiques visent à soulager le corps en souffrance, à le rendre plus opérationnel, à le soigner, à l’embellir. Dès lors, c’est aussi, dans un autre registre, un traitement possible du sentiment de honte. S’occuper de ce corps permet de le réhabiliter de façon plus valorisante. Par exemple, en retrouvant un rapport à la féminité, masquée le plus possible dans des conditions d’exclusion. Toutefois, cela implique de redoubler d’attention et de précaution dans ces pratiques consistant à toucher ces corps dans la mesure où la maladie mentale par exemple peut faire ressentir ce toucher comme une agression. Pourtant, cet accompagnement corporel de la souffrance et de la douleur par le toucher peut assurer un « aller mieux » car la prise en charge s’effectue par un autre langage : celui du corps. Le langage corporel n’utilise pas des mots mais des sensations. Ces dernières sont surtout négatives – à l’hôpital, dans une institution sociale ou en prison – et les séances de socio-esthétique permettent d’en éprouver d’autres, plus positives. Utiliser le langage du corps semble alors approprié dans cet univers de fragilité, car partagé par tous, quelle que soit son appartenance sociale et culturelle, il est moins bloquant que la parole.
N’est-il pas compliqué de vivre avec un corps dégradé, abîmé et de les prendre en charge, dans des sociétés qui valorisent le corps performant ?
C’est une tendance actuelle dans nos sociétés que de penser le corps comme étant toujours plus performant. Georges Vigarello dans son séminaire consacré au corps à l’EHESS et dans ses travaux l’a bien montré. Le corps est de plus en plus perçu comme un capital à entretenir puis à améliorer autant dans ses performances que dans son apparence. Les normes contemporaines concernant l’esthétique exigent que tout individu prenne soin de son corps, anticipe les effets du temps, tout en essayant de le rendre le plus efficient possible.
Qu’apporte à des professionnels du travail social ou médico-social un éclairage sur l’importance du corps ?
Avoir pris en compte la centralité du corps permet aux professionnels de ramener des valeurs communes dans la prise en charge du corps, d’être inventifs. On voit depuis quelques années des nouvelles formes de prise en charge, où l’on part des personnes telles qu’elles sont. Les initiatives viennent souvent du Canada comme l’expérimentation TAPAJ, Travail Alternatif Payé à la Journée, sur laquelle je vais travailler prochainement. Il s’agit d’un dispositif d'insertion permettant aux jeunes en errance, souvent toxicomanes ou en situation extrêmement précaires, d'être rémunérés en fin de journée, pour une activité qui ne nécessite ni qualification, ni expérience professionnelle, ni engagement sur la durée. On essaye de les remettre pas à pas dans la norme mais en les prenant comme ils sont, dans leur situation actuelle. Il y a quelques années, on parlait de structures « bas seuil » — il pouvait s’agir d’antennes médicales, hébergements d’urgence ou encore de lieux offrant des repas ponctuels : on n’a pas d’a priori ni de projet pour les personnes, on les accueille telles qu’elles sont, avec ce qu’elles peuvent ou non proposer, en l’état, sans contrepartie, sans exigence, sans contrat. C’est le même esprit. C’est important parce qu’avec certaines personnes il faut en passer par là.
Quel rapport voyez-vous entre ce genre d’expériences et les grandes tendances de société évoquées à l’instant ?
Elles font écho à l’importance du corps dans notre société. Je ne suis pas certaine que l’on aurait pu penser à ce genre d’alternatives sociales si, dans nos sociétés contemporaines, le corps n’était à ce point magnifié, pensé comme performant, et si les relations sociales n’étaient pas aussi fragilisées par la montée de l’individualisme. Toutes ces tendances — culte du corps, individualisme…. — amènent à penser l’importance du soin, et remettent le corps au centre de nos réflexions.
L’intérêt reconnu du dispositif TAPAJ est celui d’une temporalité au jour le jour adaptée aux personnes les plus précaires, puisqu’il leur est difficile de se projeter sur le long terme. Pouvez-vous préciser son intérêt au regard de la problématique du corps ?
Dès lors que votre ultime ressource est votre corps, votre temporalité est forcément le quotidien, et le quotidien se réalise dans trois espaces. L’espace économique, celui du rapport à l’argent, parce que de toute façon il faut de l’argent pour assouvir ses besoins. L’espace relationnel, où les échanges s’établiront souvent avec des pairs, mais éventuellement avec un bénévole, ou avec le travailleur social de tel endroit. L’espace privé, celui du rapport à l’intime, y compris dans l’espace public : tel abribus, tel square. Ce quotidien est très rythmé — de telle heure à telle heure on fait la manche, etc. — et sur des modes très ritualisés. Leur rapport au temps est fort loin de celui des travailleurs sociaux qui se projettent sur des semaines ou des mois. Donc vous avez raison, la journée est le bon timing pour le rapport au temps. En revanche, dans un premier temps, je pense que l’on gagnerait à faire rentrer ce public non par le travail, mais pas le corps en se posant la question des activités réalisées dans la journée, pour tout ce qui correspond à des besoins physiologiques : où la personne se repose-t-elle, où va-t-elle manger, où va-t-elle se laver… ? Et dans les interstices autres que physiologiques, placer des activités qui les ramèneraient à une sorte de travail, en tout cas à des activités plus normées dans leur monde hors norme. Le point central, c’est de penser l’accompagnement des personnes vulnérables à partir de leurs corps.
C’est votre conviction en effet. Revoir les modes d’accompagnement à partir du corps pourrait-il s’appliquer à d’autres publics que les personnes les plus exclues ?
Oui, on pourrait faire la même chose pour les personnes vieillissantes. Je viens de collaborer à un ouvrage collectif consacré à la manière de penser le maintien à domicile des personnes âgées[1]. Le corps va devenir fragile avec l’avancée en âge, comment alors accompagner ces corps fragiles et vieillissants à leur domicile, puisque c’est leur souhait, tout en assurant de la bienveillance, de la bientraitance des travailleurs sociaux qui seront de plus en plus amenés à penser cet accompagnement ? Hier aux informations, une jeune infirmière de 24 ans disait avoir envoyé une lettre au Ministre : elle s’occupait d’une centaine de personnes âgées et disait qu’elle ne pouvait plus travailler à ne pas pouvoir prendre soin correctement des personnes. Elle pointe là une réalité : il n’est plus possible de continuer à prendre en charge des corps vulnérables dans ces conditions, c’est-à-dire prendre en charge des corps sans prendre en charge des personnes. Dans mon enquête sur le maintien à domicile je suis allée rencontrer des aides-soignantes : elles me disent qu’elles ont 8 minutes pour faire une toilette, ce qui est juste impossible ! Elles sont obligées de penser le corps comme un objet, sinon elles n’y arrivent pas. Dans des pays comme le Japon, on remplace du personnel par des robots. Des robots qui lèvent des personnes, les soulèvent, les lavent, les replacent… Où est le soutien de la personne par la parole, par le regard, par le toucher ? Que fait-on de la relation sociale ? Le soin du corps est forcément un acte global, s’il devient uniquement un acte technique, le corps devient un objet, on ne peut plus parler de soin, et il devient logique que le robot prenne la place de l’humain...
[1] Dambuyant-Wargny Gisèle, Rôle et évolutions de l’encadrement intermédiaire : quelles compétences professionnelles pour les encadrants de proximité de services à la personne ? In S. Payre (dir.), « Des services à la personne à la silver économie – Comment accompagner le vieillissement de la population à domicile sur les territoires aujourd’hui et demain ? », Management Prospective Editions, 2017
Selon vous, quels seront les impacts potentiels des évolutions du travail et des tendances que l’on peut observer dans les décennies à venir ?
J’ai l’impression que l’écart va se creuser entre les travaux où la pénibilité sera très marquée, et les travaux qui mettront les corps à l’abri. La question du rapport à la pénibilité qui va se poser de plus en plus. Le contraste va s’accentuer, et on sera moins qu’avant dans un partage de la pénibilité. Mais il faut aussi s’entendre sur la notion de travail parce que là aussi cela devient très diversifié selon les contextes et les pays. Aux personnes fragilisées, on demandera des tâches à la fois pénibles, répétitives, qui mettront le corps en difficulté.
Parmi les corps vulnérables, il y a ceux des personnes qui arrivent après un parcours migratoire. L’arrivée de mineurs étrangers non accompagnés est la porte ouverte à l’exploitation des corps, à l’esclavagisme, aux trafics de toutes natures, aux parcours prostitutionnels. Il y a aussi les réfugiés climatiques. Pour penser et accompagner les corps vulnérables, il nous faudra davantage de complémentarités professionnelles, entre sociologues, travailleurs sociaux, corps médical, anthropologues… Il faudra aussi penser ces questions à l’échelle internationale. Lors d’une recherche menée sur les parcours prostitutionnels entre la Pologne et la France, on s’est rendu compte que des jeunes femmes passaient par l’Italie avant d’arriver en France. Si des liens ne sont pas établis entre les personnes qui dans ces pays les prennent en charge, en France les travailleurs sociaux, en Pologne des ecclésiastiques, on est incapable d’endiguer ces réseaux mafieux de traite d’êtres humains.
La prise en compte du corps me semble être un objet sociologique fondamental, à analyser dans toute sa complexité et à tous les niveaux. En fonction des âges de la vie, mais également de la trajectoire, il faut l’éduquer, le soutenir, le soigner. Il convient donc de penser la relation au corps dans l’accomplissement d’actes techniques, mais au-delà de penser la relation humaine. Discuter pour discuter, pour savoir comment l’autre va, c’est fondamental. J’ai parlé des socio-esthéticiennes, mais il me semble que plusieurs métiers dans l’intervention sociale pourraient apparaître ou réapparaître comme celui des dames de compagnie, à réhabiliter et à réactualiser. Ouvrons la réflexion.

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?
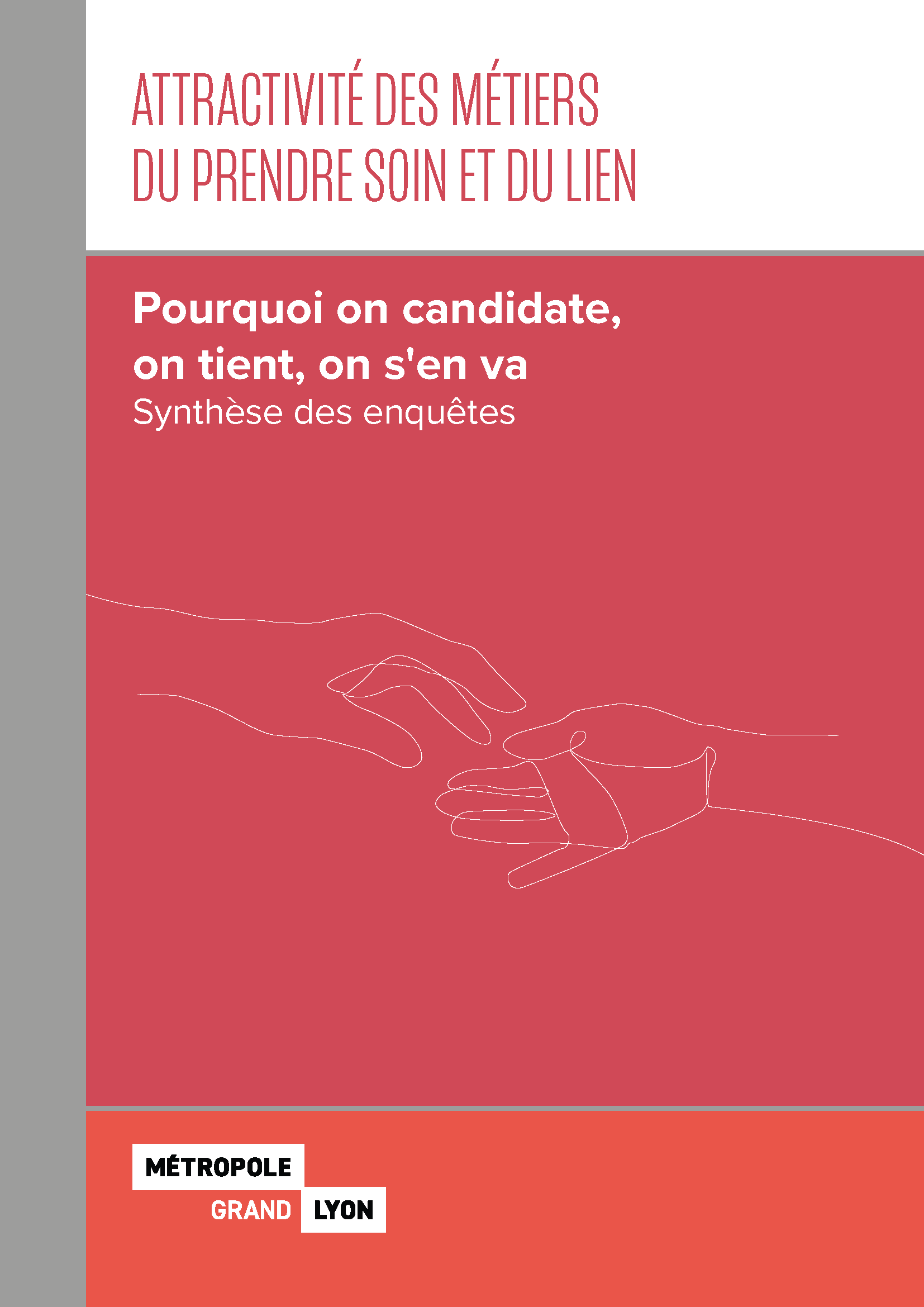
Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.

Article
Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article
Investigations théoriques et pratiques sur l'exclusion dans la ville, par le laboratoire de recherche et création LALCA.

Interview de Sarah Abdelnour
maîtresse de conférence en sociologie à l'université Paris-Dauphine

Interview de Philippe Warin
Directeur de recherche au CNRS
Texte de Catherine FORET
L'auto-organisation des citoyens pour s’entraider face aux difficultés de la vie, à l’inadéquation ou à la baisse de la protection sociale engendrée par le recul de l’Etat providence.

Étude
Comment soutenir une dynamique d'innovation au sein de la métropole lyonnaise ?

Interview de Catherine FIESCHI
Directrice de Counterpoint, cabinet d’analyse des risques culturels