Michel Desmurget : « C’est l’ensemble de notre humanité qui est impacté par les écrans »

Interview de Michel Desmurget
directeur de recherches en neurosciences à l'INSERM, à l'Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod
Interview de Guy WALTER

<< Si l’on fait en sorte que ces gens se rencontrent, ils vont penser autrement. savoirs, pluridisciplinarité, numérique, urbanisme, accélération du temps >>.
Entretien réalisé par Pierre-Alain Four, avril 2013
Guy Walter, à travers Walls & Bridges et Mode d'Emploi, nous donne son regard sur les humanités et les SHS.
Pourquoi, à la tête de la Villa Gillet, avec Walls & Bridges puis avec le festival des idées Mode d’emploi, cherchez-vous à décloisonner les disciplines du savoir ?
En réalité, la Villa Gillet a été conçue dès le départ comme un lieu interdisciplinaire. Elle est la traduction publique d’un petit cercle –le « patch club »– constitué d’intellectuels, d’universitaires, d’artistes, de chercheurs venus de disciplines très diverses, qui se réunissaient régulièrement dans les années 80 à Lyon. Jacques Oudot1 , alors élu de la Région Rhône-Alpes, était l’un des animateurs de ce groupe et c’est lui qui, en 1987, a imaginé la Villa Gillet comme un lieu pluridisciplinaire, destiné justement à ce que se croisent des gens venus d’horizons les plus variés. La Région Rhône-Alpes voulait créer un observatoire de la pensée contemporaine et rendre visibles les multiples langages des idées. La Villa Gillet est donc la traduction institutionnelle de cette utopie du métissage des savoirs. Oudot se situait alors dans le sillage d’Edgar Morin et avait pour maître mots : croisements, hybridations, carrefours. Lorsque j’ai été recruté, j’avais d’emblée ce cahier des charges d’ouverture disciplinaire, qui correspondait aussi à ma sensibilité. Aujourd’hui, avec la mondialisation des échanges, cette position est d’autant plus pertinente.
Cela ne pouvait-il être possible qu’en dehors du cadre académique ?
La Villa Gillet est une institution culturelle, pas une émanation de l’université. Par conséquent, elle n’est pas liée comme peut l’être l’université par une histoire longue, un cloisonnement disciplinaire, etc. Elle n’a pas les mêmes contraintes de distribution épistémologique. L’étanchéité entre les disciplines que l’on déplore à l’université s’explique par la construction de ces disciplines. Dans une institution culturelle récente, on peut pratiquer une approche différente des savoirs et délaisser un quadrillage disciplinaire qui n’aurait pas nécessairement de sens dans ce lieu-là. Les universitaires se trouvent confrontés à toutes sortes de contraintes qui sont liées à l’histoire de leur institution. Leur marge d’action est beaucoup plus étroite.
Par ailleurs, être pluridisciplinaire, c’est aussi une manière de s’affranchir des enjeux de pouvoir, qui sont très prégnants au sein de l’université et qui expliquent en partie les difficultés qu’éprouve cette institution pour se réformer. Alors que nous, nous pouvons sélectionner des questions en fonction d’un calendrier qui nous appartient et d’une évaluation de leur pertinence, dont nous sommes les principaux garants. On travaille donc très librement. J’ajoute que la question de la discipline n’est pas une entrée qui m’intéresse en tant que telle. Je préfère constituer des problématiques, pointer des questions et solliciter ensuite toutes sortes d’acteurs venus d’horizons divers, capables de les traiter avec leurs spécificités, leurs regards propres.
Que pensez-vous des approches associant plusieurs disciplines – comme les visual, cultural, gender studies – et pourquoi sont-elles essentiellement d’importation anglo-saxonne ?
Il me semble qu’il faut nuancer cette perception du monde anglo-saxon : l’université américaine demeure elle aussi cloisonnée, soumise à des rigidités, elle n’est pas dans une totale liberté disciplinaire telle qu’on se la représente de ce côté-ci de l’Atlantique. Et les nombreux intellectuels nord-américains que j’ai eu l’occasion de fréquenter m’en ont souvent parlé. Mais il est vrai aussi que le système anglo-saxon est bien plus ouvert que le nôtre, les universités sont organisées en département et pratiquent un système d’invitation que nous ne connaissons guère en France. Ces invitations sont lancées vers toutes sortes de gens, des politiques, des acteurs associatifs, des écrivains, des chercheurs, des gens de la « société civile », etc. Cela provoque un brassage très productif des idées et des positions, d’autant plus que les départements n’invitent pas nécessairement dans leur discipline de base. Ils pratiquent au contraire une forte hétérogénéité. Récemment, un chercheur qui s’intéresse au genre et à l’histoire culturelle a été invité en résidence au MIT (Massachusetts, Institute of Technology), qui est une institution à la pointe de la recherche scientifique. Une proposition qui paraît encore assez improbable en France.
Quelles sont selon vous les forces et les faiblesses des équipes qui travaillent sur des objets faisant intervenir plusieurs disciplines et sont implantées sur le territoire Lyon / Saint-Étienne ?
Il y a un terreau de chercheurs extrêmement dynamique sur le territoire Lyon / Saint-Étienne, j’en ai eu à maintes reprise la confirmation, notamment lorsque nous organisons Mode d’emploi. À mes yeux, la question n’est pas tellement celle des individualités, mais de la capacité des universitaires à instaurer de nouveaux modes de travail, des lieux véritablement ouverts, qui leur permettent à la fois de développer leurs réflexions, mais aussi de les confronter à d’autres producteurs d’idées, d’analyses, comme à des gens qui sont dans l’action, dans le « faire ».
Par exemple, le département de philosophie de Lyon 3 a recruté Thierry Hoquet, qui a vraiment un profil atypique et passionnant. Il s’intéresse à l’hybridation des genres et des savoirs. Le doyen de ce département, Jean-Philippe Pierron, est aussi très ouvert à une problématisation des questions contemporaines, franchissant les limites disciplinaires.
Quels sont, selon vous, les nouveaux objets, les questions de recherche qui vont se poser ou sur lesquelles il faudrait réfléchir dans les prochaines années ?
Aujourd’hui, on doit faire face à des interrogations inenvisageables il y a seulement une dizaine d’années. Par exemple, la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique provoque la disparition de certaines îles et l’arrivée de réfugiés climatiques, de sans abri, d’apatrides… L’espace, le territoire, les migrations, la refondation écologique…, tout cela va ensemble et je discerne plusieurs problématiques majeures qui, d’une manière ou d’une autre, ont partie liée à la notion d’espace. Il me semble en effet que l’espace est un point de croisement central aujourd’hui. Je me réfère ici notamment à l’ouvrage de Michel Lussault, qui aborde brillamment ces problématiques2 . C’est aussi une question qui a déjà été développée par Michel de Certeau, par Paul Virilio, par Bruno Latour, qui sont tous des intellectuels ayant compris que l’analyse de l’espace est fondamentale.
Car dans un monde « fini », dont les limites s’imposent chaque jour un peu plus à nos consciences, il faut repenser l’usage de l’eau, de la terre. L’espace est une question éminemment politique, qui touche à notre modèle de développement et à notre capacité à cohabiter sur une planète qui n’est pas extensible. La notion d’espace touche aussi au corps, à la manière dont on prend corps, comment on habite, comment on voyage, comment on co-habite. L’espace, c’est un mot clé qui aimante la pensée et fait converger des approches très diverses. C’est un énorme champ de travail qui réunit toutes les disciplines : architecture, urbanisme, géographie, histoire, sciences, techniques de communication, etc. Liée à cette question de l’espace, je pense aussi à celle de l’urbanisation et du maintien des espaces ruraux. L’urbanisation croissante, l’indistinction émergente de la ville à la campagne ou de la campagne urbanisée conduit à repenser les limites et les définitions en usage.
Voyez-vous d’autres objets ou questions à venir ?
L’autre grand champ de réflexion est à mon avis, même si dit comme cela, cela peut sembler un peu grandiloquent, la question du sens que nous donnons au monde dans lequel nous vivons. Il faut repenser le sens de notre quotidien. Si la religion est si présente aujourd’hui, c’est qu’elle réoccupe ce terrain. Mais peut-être y-a-t-il d’autres visions du monde à développer ? C’est indispensable, car face à tant de mutations, il faut trouver des clés pour vivre dans un monde qui change de plus en plus vite. Il faudrait refonder une métaphysique, ou pour parler comme Elisabeth de Fontenay, « reconstruire un matérialisme enchanté »3. Il faut absolument trouver un langage qui parle du réel, qui puisse, par la littérature, par le discours politique, ré-enchanter le réel. Je suis par exemple frappé qu’à propos de la crise, on ne sache qu’énumérer des mesures, prendre des décisions, mais que l’on ne nous raconte rien de cette crise. Certes, il faut rééquilibrer les budgets, rebâtir l’Europe, mais j’aimerais que tout cela ait du sens pour moi, qu’on me raconte ce temps présent. Il nous faut une vision téléologique, qui nous dise vers quoi nous voulons aller. Aujourd’hui, on est accablé par cette approche pragmatique et gestionnaire. On ne laisse pas de temps à une philosophie de l’action, c’est quelque chose de dramatique, de dangereux. Il faut redéployer un espace politique au sens plein du terme, un espace philosophique, un espace religieux qui permette de réinventer un sens commun et des fictions dans lesquelles on se retrouve.
Que vous inspirent les développements technologiques et en particulier celui du numérique ?
Même si cela peut paraître une évidence, je crois qu’on n’a pas encore pris toute la mesure du bouleversement que provoquent les nouvelles technologies, qui changent elles aussi notre rapport à l’espace et au temps. Il y a 20 ans, je ne pouvais pas envisager tous ces questions, même si un penseur visionnaire comme Michel Serres avait en partie anticipé ces changements. La révolution numérique est proprement hallucinante, nous vivons ce qu’ont vécu les hommes au moment de l’invention de l’imprimerie. Le monde a totalement changé, c’est encore une question d’espace. Il y a une proxémique à développer. Mon espace mental a changé, nos actes cognitifs ont changé. Sensoriellement, techniquement, temporellement, je travaille et je vis de manière différente Je suis en permanence dans un hypertexte, mon corps est appareillé par mon téléphone portable, ma tablette numérique… Dans cette situation nouvelle, il me semble aussi nécessaire de penser notre héritage : que faisons-nous de nos savoirs disciplinaires et de notre histoire scientifique ? Comment puis-je continuer à lire Virgile dans ma navette spatiale ? Il y a un risque de bascule et d’oubli, il ne faut pas évacuer tout ce que ces disciplines scientifiques ont porté. C’est une inquiétude pour moi, point il faut refonder les humanités, ce qui est hyper stimulant. Aux États-Unis, on y pense, il y a des institutions dédiées à cette refondation. Je crois que la Villa Gillet peut s’inscrire à son tour dans cette perspective.
Comment faire pour initier la réflexion sur les chantiers que vous venez de décrire ?
Je pense que cela passe par un aller-retour entre action et réflexion. Lorsqu’on invente la ville, il est crucial de développer un récit, une fiction, c’est-à-dire quelque chose qui permette d’ancrer l’imaginaire. Quand le Grand Lyon a un projet urbain pour la Part Dieu, il le fait avec des questions. Aménager une ville, c’est penser un projet de société. C’est penser comment on va respirer dans un lieu public, comment on va y vivre, envisager où seront l’ombre et la lumière et la beauté. Je crois vraiment à une politique par l’action. Il faut faire en sorte que nos actes concrets soient une incitation à penser nos valeurs. Je milite pour un humanisme pratique. La pratique, l’expérience et la pensée se soutiennent mutuellement dans un va et vient cumulatif.
Le festival Mode d’emploi est le lieu par excellence du croisement des savoirs et des récits d’expériences, parce qu’on y invite des écrivains, des philosophes, des chercheurs en sciences sociales, des acteurs de la vie politique, des associations, des universitaires… Si l’on fait en sorte que ces gens se rencontrent, ils vont penser autrement. On fait naître un « transgenre », au sens épistémologique du terme : on est à la fois là où on pense et là où il y a de l’action, pour faire en sorte que la pensée se conjugue au faire. Agir, c’est penser, rêver, concevoir, trouver les moyens, le bon dispositif, la bonne réponse.
Il faut que penser soit agir et agir soit pensée.
Et par ailleurs, je milite aussi pour qu’on développe une véritable réflexion sur le temps, sur l’accélération démentielle de nos journées… Si on regarde le champ politique, les responsables doivent prendre le temps du retrait, prendre le temps de penser. Actuellement, ils n’ont pas matériellement le temps de penser. Un homme ou une femme politique doit pouvoir prendre ses décisions en conscience : c’est-à-dire les faire mûrir pour développer un art de la décision. Il faut prendre le temps de la pensée, réfléchir en profondeur au sens de l’action et de la décision. C’est pour moi un grand chantier que de reconnecter la réflexion et la décision. Si on s’intéresse par exemple à la culture dans le projet politique, il faut vraiment y réfléchir autrement, savoir quelle place elle occupe, comment elle est relayée dans le projet politique général, commet elle est portée politiquement.

Interview de Michel Desmurget
directeur de recherches en neurosciences à l'INSERM, à l'Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod

Étude
Quatre grandes tendances qui caractérisent les liens de la jeunesse avec l'espace public.
Texte de Bruno Marzloff

Article
Si toute notre vie sociale tient dans un smartphone, à quoi bon profiter de sorties nocturnes ?

Article
Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article
Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.
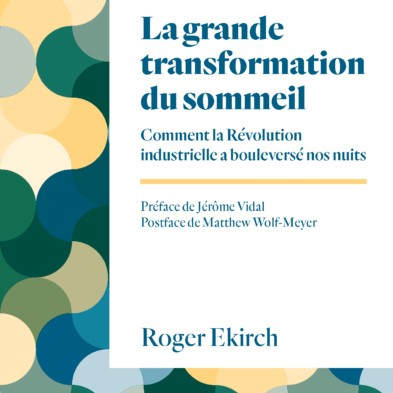
Article
Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.
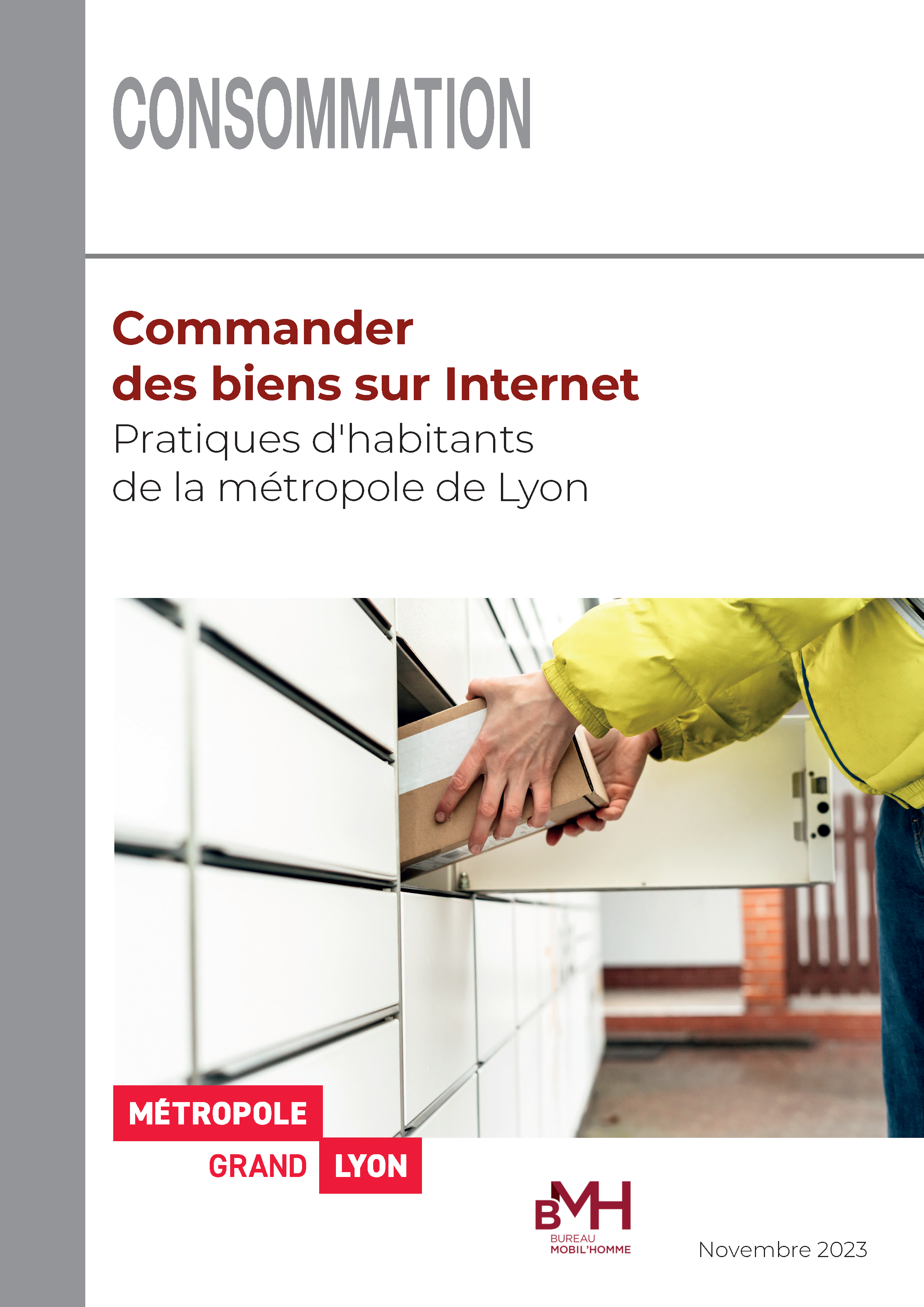
Étude
Pourquoi acheter en ligne ? Quelles préférences entre se faire livrer à domicile, en point-relai ou en drive ? Une douzaine d’habitants témoignent.

Étude
Comment les commerces de proximité s’adaptent à la vente en ligne ? Cette étude donne la parole à une dizaine de commerçants indépendants du territoire.