Richesse et Pauvreté entre collectivités : quelles formes de solidarités instaurer ?
Texte de Patrice RAYMOND
Un point de vue critique du système de péréquation redistributive des recettes des collectivités.
Interview de Flore BERLINGEN

<< Le fait que les citoyens se réapproprient pas mal de choses qui correspondent à leurs besoins est un mouvement de fond, que l'on n'arrêtera pas. Il faut veiller à ce que l'Etat, les acteurs publics, ne disparaissent pas totalement, face à ce mouvement. Parce qu'eux seuls peuvent assurer que personne ne soit laissé de côté >>.
Diplômée de Sciences Po Paris en 2008, Flore Berlingen a travaillé sur la coordination des programmes régionaux à la 27ème Région, et au Cniid pendant 4 ans, avant d’être nommée directrice de cette association fin 2013.
Co-fondatrice de OuiShare, communauté ouverte internationale composée de plusieurs centaines de personnes (entrepreneurs, designers, chercheurs, ingénieurs, décideurs publics, citoyens…), elle est questionnée ici sur la manière dont l’économie collaborative et les échanges "de pair à pair" (co-voiturage, couchsurfing, location entre particuliers…) contribuent à recréer des liens entre individus, à la fois au niveau local et au niveau global.
Elle évoque également le rôle que la puissance publique, et en particulier les collectivités locales, peuvent jouer pour encourager le fonctionnement "en bien commun" de ces modèles d’échange.
Vous êtes très jeune…, comment vous êtes-vous intéressée à l’économie collaborative ?
C’est en travaillant au sein du Cniid, une association environnementale indépendante qui porte un discours militant, très exigeant, que je me suis intéressée de plus en plus à l’amont de la question des déchets, autrement dit à leur réduction à la source. Ma porte d’entrée sur le sujet a d’abord été la consommation collaborative comme moyen, en mutualisant des ressources, de réduire les déchets. C’était en 2011, c’est à ce moment-là que nous avons démarré OuiShare, sous forme de rencontres puis d’un blog, dans le but d’encourager et d’accompagner le développement de l’économie collaborative. Je m’y suis consacrée pendant un an à temps plein, de manière bénévole. Il fallait monter le projet, le développer, c’était très prenant. Je viens juste de reprendre un emploi, à la direction au Cniid. Et je continue à contribuer à OuiShare.
Comment définissez-vous l’économie collaborative ?
Au sein de OuiShare, nous en proposons une définition assez large et ouverte, qui recouvre en gros tous les systèmes basés sur des échanges en peer to peer, de pair à pair, c’est-à-dire de personne à personne au sein de communautés souvent "connectées" via des plateformes d’échange sur le web. Ce qui nous intéresse, ce sont les initiatives qui remettent en lien direct des particuliers — des pairs — pour produire, financer, échanger, mutualiser ou partager des biens ou des services. Dans l’économie collaborative, il y a une partie très visible, la consommation collaborative, mais il y a aussi d’autres aspects moins connus, qui portent sur le financement d’une part (le crowdfunding, financement participatif sous ses différentes formes) et sur la production contributive d’autre part : tout ce qui se développe depuis plusieurs années dans le monde du logiciel libre, de la coproduction dématérialisée, en logique open, où on libère la connaissance pour construire du bien commun. Wikipedia est un bon exemple de ces modes de production de biens communs immatériels… Mais ces méthodes de travail s’appliquent de plus en plus au monde matériel, à la conception et à la production manufacturière de biens.
Par exemple ? Avec les imprimantes 3D ?
Oui, mais les imprimantes 3D, c’est un peu le gadget, la cerise sur le gâteau. Le milieu qu’on appelle des makers fait partie du mouvement plus large de la production contributive, dont le principe est de concevoir et produire de manière décentralisée, avec un échange de connaissances et des outils de production plus distribués. Un projet emblématique en la matière, par exemple, est celui de Wikispeed, une voiture conçue en opensource par plusieurs groupes de contributeurs dispersés à travers le monde. L’ensemble de ces groupes forment la "communauté Wikispeed". Le prototype ainsi développé est fonctionnel, il a passé des tests de sécurité aux Etats-Unis, il peut être commercialisé, etc. ; mais il est libre, c’est-à-dire que n’importe qui peut reprendre les plans et le construire chez lui, ou monter un groupe pour cela. C’est une production en réseau, dans laquelle, de plus en plus, on ne produit pas seulement du code logiciel, mais aussi des plans d’objets manufacturables, à fabriquer dans le monde matériel. Ces aspects de financement, production et partage de connaissances dépassent de beaucoup la consommation. Et ils ne concernent pas seulement la production de gadgets technologiques. En fait, il s’agit de se réapproprier les savoirs de production, mais aussi de réparation, des objets de notre quotidien.
Quelles sont les valeurs qui vous portent, dans vos engagements au sein du Cniid et de OuiShare ?
Ce qui a motivé mon engagement environnemental, ce n’est pas une sensibilité extrême à la Nature. C’était plutôt un point de vue politique, dans le sens noble du terme évidemment. Parce que je pense que les enjeux environnementaux et sociaux sont intimement liés. Et l’économie collaborative est elle aussi à la croisée de nombreux enjeux. Elle peut permettre de répondre à certains problèmes environnementaux, en tout cas on l’espère ; disons que c’est une piste d’action positive, par rapport à des problèmes qui semblent nous dépasser, face auxquels on a l’impression qu’il n’y a rien à faire. Et c’est aussi un facteur de création, ou de recréation, d’un lien social fort au niveau local. Avec en outre une dimension économique qui peut rendre plus facile l’accès à certains services, à certaines ressources, pour des populations qui en ont besoin.
Ce dernier aspect ne saute pas aux yeux…
Cela ne saute pas aux yeux, parce que pour l’instant, l’économie collaborative demeure quelque chose d’assez confidentiel, et que les personnes qui pourraient bénéficier le plus de tous ces systèmes de partage, d’échange, d’entraide… ne sont pas utilisatrices de tous ces systèmes, de ces réseaux. C’est là aussi que je vois le rôle de OuiShare : nous souhaitons à la fois travailler avec des porteurs de projet dans le domaine de l’économie collaborative, avec ceux qui veulent monter des start-up ou des projets associatifs ; et agir sur la vulgarisation, en collaborant notamment avec des acteurs publics, pour renforcer l’accessibilité de ces services à une population plus large.
La valeur "solidarité" fait-elle partie de votre référentiel, de votre vocabulaire ?
Non. Pour être tout à fait objectif, au sein de OuiShare, ce n’est pas un mot qu’on utilise. On parle de lien, d’entraide…, éventuellement de la construction de biens communs. Nous sommes vraiment dans un mouvement collectif, mais pas forcément dans une relation du type : « J’aide quelqu’un ». Il s’agit plutôt de s’entraider mutuellement. On n’emploie pas le terme, parce que dans un réseau de pairs, justement, il n’y a pas des aidants et des aidés. Tout le monde s’entraide.
Et ces "pairs", comment les définissez-vous ?
Ce sont des gens qui parlent d’égal à égal. Il n’y a pas un producteur ou un fournisseur de services et un client. Nous sommes tous producteurs, tous consommateurs, tout ça à la fois, en fait. Dans ces systèmes-là, je suis à la fois consommatrice d’un contenu qui est produit collectivement et productrice de ce contenu, parce que j’y contribue aussi. Chacun a plusieurs statuts à la fois, on est pair dans ce sens-là.
Ces systèmes reposent donc sur l’hypothèse que tout le monde est "capable", tout le monde a quelque chose à apporter. Vous pensez que c’est valable pour tous les groupes sociaux ?
C’est difficile à dire… Personnellement je vois des potentialités énormes dans ces systèmes, mais le problème, c’est que pour l’instant, ils ne sont pas assez démocratisés. Le plus connu, c’est peut-être le co-voiturage, dans le domaine de la consommation collaborative, donc. C’est à présent bien entré dans les mœurs ; je pense qu’on touche à peu près toutes les catégories sociales, à peu près tous les âges (même si les jeunes sont sur-représentés), des gens de milieux urbains comme de milieux ruraux. Le service s’est répandu au-delà de la sphère initiale des étudiants. Mais c’est loin d’être le cas de toutes les autres facettes de l’économie collaborative… Ce qui se démocratise bien actuellement, c’est tout ce qui concerne le don et la location d’objets entre particuliers. Parce qu’il existe dans ce domaine des acteurs "historiques", comme Recupe.net, ou Donnons.org, dont la fréquentation est vraiment très mixée. On peut repérer la diversité des origines sociales des utilisateurs à la manière, par exemple, dont les gens rédigent leurs annonces ou répondent aux messages. Sur certains réseaux vraiment étiquetés "consommation collaborative" et qui touchent davantage les jeunes, il existe certaines règles implicites, non écrites, mais que les gens respectent ; alors que là, non. Cela montre que l’on touche un public plus large ; parce que l’une des barrières à l’entrée sur certains de ces réseaux d’échange, de partage, de mutualisation…, c’est précisément la connaissance de ces petits codes implicites, qui permettent de se faire une place : le fait de savoir qu’il ne faut pas mettre une photo débile, par exemple, mais plutôt une photo relativement sérieuse, où l’on voit votre visage — parce que sinon les gens ne vous feront pas confiance… Il faut comprendre que ce qui permet à ces systèmes de fonctionner, c’est la réputation, la confiance. Tous ces sites-là, toutes ces plateformes ont organisé des systèmes de réputation, à base de commentaires, de notes, de profils enrichis avec plein de détails. Et donc, la manière dont on se construit son profil, son image, sur ces réseaux-là, est très importante. Si on a un mauvais profil de co-voiturage, personne ne va vous prendre dans sa voiture.
Mais en quoi le fait de favoriser l’échange de biens ou services entre particuliers, par Internet, contribue-t-il à créer du lien social ? A quoi collabore-t-on ? Quel bien commun construit-on, par exemple, en co-voiturant ?
En fait, quand on propose comme nous l’avons fait une définition large de l’économie collaborative, on intègre toute une diversité de modèles. On intègre des modèles qui se résument juste à ces échanges en peer to peer, qui ne sont pas forcément créateurs de bien commun, au sens d’un bien qui appartient à tous. C’est le cas par exemple de sites comme Leboncoin.fr : c’est du peer to peer, mais c’est la base, il n’y a pas d’âme ; c’est juste un système de petites annonces. Est-ce que ça crée du lien ? Parfois, les gens se rencontrent de manière physique, mais pas forcément. La manière dont le site est designé, animé…, entraîne ou non la création de relations entre les gens. Sur Leboncoin, on n’a même pas besoin de se créer un profil, tout est fait pour que ce soit rapide, fonctionnel, il n’y a rien de personnel. Mais ce qui est sûr, c’est que ça marche. Leboncoin.fr est le second site visité en France après Facebook. Autre exemple : Airbnb, une plateforme mondiale qui permet à des gens de louer leur chambre ou leur appartement à des touristes de passage. C’est une start-up américaine, qui a levé des millions des dollars, qui fonctionne avec une structure économique totalement capitalistique, une gouvernance pas du tout ouverte… Peut-on vraiment parler d’économie distribuée ? Dans un sens, ça distribue de la valeur auprès d’un grand nombre de personnes qui peuvent tirer un revenu de leur capacité excédentaire, mais en même temps, on n’a aucune idée de la manière dont sont redistribuées les larges commissions que prélève Airbnb sur chaque transaction. C’est un fonctionnement totalement traditionnel. Cela fait partie de l’économie collaborative, parce qu’effectivement c’est un système de peer to peer, et que cela suscite des pratiques nouvelles et intéressantes, mais ce n’est clairement pas le genre de modèle qui nous intéresse à OuiShare, en tout cas en ce qui me concerne.
Quels sont alors les modèles qui vous intéressent ?
Les sites sur lesquels, et avec lesquels nous travaillons sont ceux qui sont basés sur la création d’une communauté d’utilisateurs, qui vont notamment se rencontrer, et créer un lien ; qui peut être un mini-lien ou un lien plus durable. Recupe.net, par exemple, c’est du don d’objets très simplifié, on pose juste une annonce, on n’a pas besoin de se créer un profil non plus. Pourtant, il y a souvent un échange, un dialogue entre les personnes. Parce que généralement, il y a beaucoup plus de demandes que d’offres. Quand on publie une offre de don, on reçoit plusieurs annonces. Et puisqu’il n’y a pas de notion d’échange monétaire, quel va être le critère de choix ? Pour choisir la personne à qui l’on donne, on va se fier au feeling, autrement dit à quelque chose d’humain, au fait que la personne va vous dire que c’est pour faire telle ou telle chose... Bref, il y a souvent un dialogue en amont. Et quand on se rencontre physiquement pour le don, il y a à nouveau un petit échange social intéressant. La plupart du temps, ce sont des échanges très fugaces, sauf s’il y a un intérêt particulier et que du coup, les deux personnes décident de se revoir. Il peut ainsi arriver que l’échange social prenne le pas sur l’échange d’objets. Mais même si on ne se rencontre qu’une fois, on est content d’avoir eu ce contact humain avec quelqu’un du quartier, qui va réutiliser un objet dont on n’a plus besoin.
Du quartier ? La dimension locale est donc importante dans ces systèmes ?
Oui. Quand on donne un objet, c’est souvent en main propre. On ne va pas faire faire deux heures de trajet à la personne qui vient chercher l’objet. On se donne rendez-vous dans son quartier.
Et ces petits échanges éphémères vous semblent fonder quelque chose, au niveau sociétal ?
Cela recrée des liens de proximité, notamment dans les grandes villes où, concrètement, si l’on n’a pas des enfants qui fréquentent la même école, on n’a aucun lien avec le quartier. Pour des gens de ma génération, qui ont complètement perdu l’habitude d’adresser la parole à leurs voisins, c’est une manière détournée de re-rentrer en contact. Dans mon immeuble, par exemple, il y a vraiment zéro échange, les gens ne se connaissent pas. En me creusant la tête pour savoir comment faire pour que les gens se parlent, la première idée qui m’est venue, c’est de créer un groupe Facebook de l’immeuble. Ce qui peut paraître fou ! Mais en même temps, comme dans la plupart des ensembles résidentiels d’aujourd’hui, il est interdit de coller la moindre petite annonce… En fait il y a plein de choses qui sont sorties des habitudes des gens. On n’ose plus frapper à la porte pour demander des œufs ou autre chose… Je ne sais pas quel est l’obstacle, mais c’est la réalité. Et finalement, en passant par les réseaux sociaux, on a peut-être l’impression de moins empiéter sur la vie privée des autres, parce qu’on n’entre pas directement dans leur espace. Tout cela rejoint la question des motivations des utilisateurs de ces services. Il y en a plusieurs, et elles sont souvent combinées. Ce ne sont pas toujours des motivations environnementales, loin de là. La plupart du temps, le déclencheur est d’ordre économique. Mais ensuite — ce n’est pas prouvé, on n’a pas encore d’études pour le montrer —, je pense que ce qui fait que l’on continue à utiliser ces systèmes-là, c’est que l’on apprécie le processus : parce que c’est plus sympa que d’aller dans un grand magasin, par exemple. Et il y a aussi, de plus en plus, une motivation pratique. Très souvent, logistiquement parlant, en termes d’organisation, il est plus pratique de faire appel à quelqu’un de son quartier que d’aller chez un professionnel. C’est typique pour la location d’objets : vous avez besoin d’une perceuse, d’un appareil à raclette, d’une tente de camping, ou même de louer une voiture pour le week-end…, c’est à la fois moins cher et beaucoup plus simple de vous adresser à un particulier qui habite à deux rues de chez vous.
Pour que cela marche, il faut beaucoup d’utilisateurs dans le même espace local…
Oui, pour que le service devienne vraiment intéressant, il faut atteindre une masse critique d’utilisateurs. Parce qu’alors l’offre et la demande vont se rencontrer, vous allez trouver des gens près de chez vous. Covoiturage.fr — devenu aujourd’hui Blablacar.fr — a ainsi atteint une masse critique d’utilisateurs qui lui permet d‘être extrêmement performant et beaucoup plus pratique que la SNCF ; parce qu’on peut prévoir son voyage au dernier moment, parce qu’on trouve toujours un trajet… C’est à la fois souvent moins cher que le train, mais aussi beaucoup plus adapté en termes de trajet. Donc ce n’est pas juste une question économique, c’est aussi une question logistique, d’organisation. Sharewizz, par exemple, est une plateforme de prêts d’objets entre particuliers, qui a justement adopté une stratégie de développement local au départ. Les fondateurs, dont les bureaux étaient dans le 17ème arrondissement de Paris, ont d’abord cherché à avoir le maximum d’utilisateurs dans cet arrondissement, pour que le service fonctionne déjà à l’échelle locale. Parce qu’il ne sert à rien d’avoir mille utilisateurs s’ils sont répartis dans toute la France. . Pour renforcer leur communauté locale, ils organisent par exemple des apéros tous les mois, entre leurs wizzers, les gens qui se prêtent des objets. Et petit à petit, ils ont essaimé. Donc, la proximité géographique est un facteur important dans certains de ces systèmes. Mais il existe aussi des communautés, cette fois plutôt dans le dématérialisé, qui permettent a contrario d’entrer en contact avec des gens à l’autre bout du monde ; des gens qui s’intéressent à une question très précise, très pointue, qui vous intéresse aussi. C’est le cas du projet Wikispeed, qui combine ces deux échelles de liens : une dimension locale — parce qu’à chaque fois, ce sont des équipes locales qui fabriquent la voiture, c’est rarement une personne seule dans son garage —, et une dimension planétaire, les équipes locales étant connectées les unes avec les autres. Cela a démarré du côté de Seattle, aux Etats-Unis et maintenant, il y a des équipes en Asie, en Europe, partout…, qui enrichissent ensemble le prototype général.
Dans certains articles parus sur le site de OuiShare, il est fait référence à l’idée de « faire société » ; dans d’autres, on évoque l’idée de communauté…
Faire société, je ne sais pas, mais on peut se sentir appartenir à une communauté. Tout dépend de l’effort d’animation qui est fait par la plateforme. Suivant les plateformes, suivant la créativité des équipes, chacun adopte son style de communication, d’animation de communauté. Je sais que ce terme de "communauté" est très critiqué en France, mais il n’a pour nous aucune connotation négative. Nous l’utilisons beaucoup, pas du tout au sens de communauté fermée, mais plutôt au sens de communauté ouverte, de communauté en ligne. Wikipedia a une communauté de contributeurs, par exemple. Nous avons une vision plus anglo-saxonne de l’idée de communauté. On n’utiliserait pas le terme pour parler des clients de Nike, par exemple, parce qu’ils n’ont aucun lien entre eux. Par contre, on va parler de communauté des utilisateurs de Blablacar, parce qu’ils échangent entre eux. Et de communauté des contributeurs à Wikipedia, parce qu’ils construisent un objet commun.
Au sein de OuiShare, que partagez vous ? Que produisez vous en commun ?
Nous sommes une communauté de gens passionnés par tous ces nouveaux systèmes, ces nouvelles manières de consommer, de produire, de financer, etc. Et nous avons mis en place une plateforme qui permet aux gens intéressés par ce domaine de se rencontrer. Si l’on prend des références plus traditionnelles, on peut dire que nous sommes une association qui veut encourager, accompagner le développement de l’économie collaborative ; on est le mouvement citoyen qui pousse ces nouvelles formes. Concrètement, on produit de la connaissance, du savoir, de l’analyse sur toutes ces nouvelles dynamiques ; via notre magazine en ligne OuiShare.net, via des publications dans d’autres médias, via des études et des projets de recherche, en partenariat avec d’autres structures. C’est la partie think tank, analyse de fond, même si nous avons aussi un blog qui est plus "conso collaborative", "actu", etc. Nous organisons aussi des événements : c’est le deuxième grand pan de notre activité, qui explique que le réseau se soit développé de manière très organique, un peu partout en Europe et en Amérique latine. On se connaît de manière virtuelle, mais aussi de manière réelle, grâce à des événements au niveau local, mais aussi, tous les 6 mois à peu près, au niveau européen, pour ce qui concerne les gens les plus actifs de la communauté. Nous avons organisé l’an dernier le premier grand festival de l’économie collaborative, au Cabaret sauvage à Paris : le OuiShare Fest, avec deux journées professionnelles plutôt destinées aux porteurs de projet, aux start-up, et une journée grand public, qui a vu passer environ 4000 personnes. Il y a eu un bon retentissement, nous préparons la seconde édition en 2014. Et nous devrions également être présents cette année à la Foire de Paris, un énorme temple de la consommation, qui "brasse" 600 000 personnes, où nous devrions toucher un public beaucoup plus large, qui n’a peut-être jamais entendu parler d’économie collaborative.
Comment financez-vous vos activités ?
Lorsque nous avons commencé, nous n’imaginions pas un tel développement. Nous étions une poignée de gens, à Paris, qui s’intéressaient à ça, mais le sujet n’était pas sorti dans les médias. C’est vraiment en 2012 que cela a pris de l’ampleur, d’abord dans des médias de niche, puis des médias grand public. Pendant plusieurs mois, nous avons fonctionné sans structure juridique. Mais quand on a commencé à organiser des événements, qu’il a fallu payer des choses, nous avons choisi de créer une association. C’est un peu une coquille vide, dans le sens où notre gouvernance se joue ailleurs. C’est une association française, alors que le mouvement est international, par exemple… Mais elle nous sert, parce que c’est le seul moyen d’exister face aux autres acteurs économiques. Notre modèle économique s’est construit petit à petit. Au départ, lorsque nous n’avions qu’à financer des événements ponctuels, on a fonctionné via du sponsoring. Mais de plus en plus, nous avons des projets d’ampleur, qui demandent un investissement considérable en temps, des gens quasiment à temps plein sur plusieurs mois. Donc, nous cherchons à diversifier nos sources de financement. On est toujours sur du financement par projets pour l’instant, mais on commence à se dire qu’il va falloir aller chercher des sous pour notre fonctionnement, parce que plus on fait de projets, plus les frais de structure, inévitablement, augmentent. Le budget du OuiShare Fest, par exemple, c’est 150 000 euros, avec une partie billetterie, une partie sponsoring, une partie fournie indirectement par la Région Ile-de-France, via La Fonderie (l’Agence Numérique d’Ile de France), qui a pris en charge la location du lieu.
Vous avez employé l’expression "mouvement citoyen", vous vous pensez comme ça ?
Oui je pense que nous sommes à la fois un réseau et un mouvement. Le côté réseau, c’est finalement l’aspect fonctionnel ; alors que derrière l’idée de mouvement, il y a une notion d’engagement, qui est de fait présente au sein de OuiShare. Notre avons posé une définition très large de l’économie collaborative, mais nous avons aussi posé des valeurs, celles que porte le mouvement OuiShare. Nous en avons listé dix, elles figurent sur notre site. Parmi celles-ci, il y a notamment "l’impact". On se dit souvent en rigolant qu’on veut quand même changer le monde !
Changer le monde, dans quel sens ?
Nous pensons que toutes les facettes de l’économie collaborative (consommation, production, financement etc.) représentent une alternative au modèle économique dominant, qui ne nous satisfait pas, pour diverses raisons. Mais il faut bien voir que OuiShare est un carrefour, qui fait se croiser des personnes venant de milieux différents, avec des cultures différentes. Nous croyons tous à ces nouveaux modèles, mais peut-être pour des raisons différentes. Personnellement, j’y crois parce que j’y vois une solution à des problèmes environnementaux, avec des bénéfices sociaux qui ne sont pas négligeables ; d’autres personnes, qui viennent du milieu plus "business", y voient une manière de développer de l’activité de manière plus vertueuse, plus distribuée ; il y a des gens qui viennent du monde de l’environnement, des gens qui viennent de l’entrepreunariat, d’autres du numérique, du monde de l’opensource, avec des valeurs assez fortes aussi. Et les valeurs sur lesquelles nous nous sommes réunis sont entre autres celles de l’impact — arriver à changer des modes de fonctionnement pyramidaux qui ne nous conviennent pas ; et de l’ouverture — dans le sens opensource, parce que pour nous c’est la condition de la création de biens communs —, ce qui rejoint l’idée de distribution.
Vous portez donc un idéal de société, ou du moins d’une autre économie…
Oui, même si certains d’entre nous vont plus loin dans les notions de distribution, d’équité… OuiShare essaye à la fois de pousser l’économie collaborative en général, parce qu’on pense que c’est bien que ces systèmes se développent ; et d’un autre côté, nous ne sommes pas que les porte-parole des start-up, ou de ces plateformes fermées dont les utilisateurs, d’une certaine manière, sont captifs. On ne peut pas dire, par exemple : « Je n’aime pas la nouvelle manière de fonctionner de Blablacar, je m’en vais ». Parce que si on fait ça, on perd tout son historique, toute sa réputation. Donc, nous critiquons aussi ces systèmes, pour les inciter à davantage s’ouvrir. Dans l’idéal, il faudrait que les plateformes soient inter-opérables, que les personnes qui le souhaitent puissent partir avec leurs données. Et là, on rejoint les problématiques d’open data, de données privées, etc. Parce que la nouvelle valeur, sur ces plateformes, c’est vraiment votre réputation, ce sont tous les commentaires, c’est tout l’historique des échanges. Je ne parle pas au sens de valeur morale. C’est une valeur économique, un capital, parce que c’est ce qui va vous permettre de réaliser des échanges. Et le problème, c’est que pour l’instant ce sont les plateformes qui sont propriétaires de ces données.
Il n’y a pas de réticences, de la part des utilisateurs, à livrer leurs données ?
Mais ils n’ont pas le choix… Surtout quand il y a un acteur dominant, comme Blablacar pour le co-voiturage en France. Beaucoup de gens n’ont pas été contents quand Blablacar est passé à un système payant. Je pense qu’ils n’ont pas suffisamment expliqué pourquoi ils changeaient de système, le fait qu’ils avaient une équipe de 80 personnes à payer, etc. Pour moi ce n’est pas le fait qu’ils soient devenus payants qui est condamnable, c’est le fait qu’il n’y ait pas plus de transparence et de pédagogie sur la manière dont ils utilisent l’argent, les commissions, etc. Et le fait que les utilisateurs soient captifs : ils n’ont pas vraiment le choix de partir, d’une part parce qu’il n’y a pas d’autre plateforme qui regroupe autant d‘utilisateurs, donc qui soit aussi efficace ; et d‘autre part, parce que, s’ils veulent changer de plateforme, ils perdent tout leur historique, et donc ils repartent de zéro.
Et c’est compliqué à construire, un historique ?
Oui. Il y a des gens qui ont leur profil co-voiturage depuis des années. Encore, sur le co-voiturage, ce n’est pas forcément très long, parce qu’en 3 ou 4 voyages, vous pouvez avoir un profil de confiance suffisant. Mais je pense aux utilisateurs de Couchsurfing, où il s’agit d’accueillir des gens chez soi. Là, le besoin de confiance est encore plus important. Quand vous avez une douzaine de personnes qui ont dit que vous étiez quelqu’un de super sympa, cela joue, en plus du fait que sentimentalement, vous êtes attachés à ces souvenirs de vos passages. Et puis il serait très long de réunir à nouveau des témoignages de gens qui vous ont accueilli, ou des gens que vous avez logés. Donc vous n’allez pas changer… C’est là que OuiShare a un rôle à jouer : je pense que notre rôle, c’est de poser les questions qui fâchent, parfois, et de porter aussi la voix des utilisateurs. Cela dit, ce n’est pas simple… C’est bien gentil en effet de promouvoir un modèle où tout serait ouvert, où l’on pourrait emporter ses données partout ; mais ce que nous répondent les entrepreneurs, et on les comprend bien, et on essaye aussi de travailler là-dessus, c’est : « Quel modèle économique viable pour ces plateformes ? ». Parce que tout ça, ce sont des entreprises, des gens qui travaillent, et c’est très bien. Là, on rejoint d’autres débats, sur la gratuité sur le web, etc., etc.
Vous êtes intervenue au Conseil de l’Europe, en novembre 2013, dans le cadre d’une conférence sur « l’engagement des citoyens pour réduire la pauvreté et les inégalités ». Faites-vous un lien entre la montée en puissance de toutes ces initiatives collaboratives et la situation de crise économique que traversent les pays occidentaux ?
On nous pose très souvent la question. C’est une interprétation facile : pour faire face à la crise, les gens s’organisent, c’est le "système D". Oui, c’est un peu le système D. Mais pour nous, ce mouvement est beaucoup plus profond, il n’est pas que conjoncturel. Les difficultés économiques du moment sont peut-être un déclencheur... Mais, d’un point de vue micro, à partir du moment où l’on a trouvé un moyen plus pratique et plus économique de consommer, pourquoi l’abandonnerait-on le jour où ce n’est plus la crise ? Je ne pense pas, par exemple, que les gens vont s’arrêter de faire du co-voiturage ; parce que c’est entré dans les mœurs, dans la culture, dans les habitudes des gens ; et parce que c’est juste idiot de faire 500 kms quand on est tout seul dans sa voiture. Et d’un point de vue plus macro, tout ce mouvement est porté par des évolutions de long terme, qui ne sont pas directement liées à la crise économique : le développement du numérique, celui des applications mobiles, le besoin de recréer du lien, etc. Jeremy Rifkin, qui a écrit « L’âge de l’accès. La nouvelle culture du capitalisme » il y a presque dix ans, prédisait déjà ce passage de la propriété à l’usage, qui caractérise quand même beaucoup tous ces nouveaux systèmes, en tout cas en ce qui concerne les biens matériels. Il s’agit d’un mouvement de fond.
Pensez-vous que la puissance publique a un rôle à jouer auprès de vous ? Qu’attendez-vous, en particulier des collectivités territoriales, ou que pensez-vous pouvoir leur apporter ?
Nous sommes de plus en plus sollicités par des acteurs publics sur ces questions sociales, mais c’est très récent, quelques mois seulement. Il faut dire que les acteurs publics qui se sont intéressés à l’économie collaborative en premier lieu ne sont pas ceux de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), loin de là. Ce sont plutôt les acteurs du numérique, La Fonderie en Région Ile de France, le Ministère de Fleur Pellerin (Ministre déléguée auprès du Ministre du redressement productif, Chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique). C’est assez significatif d’ailleurs… Nous ne sommes pas du tout dans la revendication vis-à-vis des collectivités locales, mais disons qu’il y aurait plein de choses à faire pour que la ville soit plus adaptée aux échanges. Nous avons travaillé par exemple avec la Communauté Urbaine de Bordeaux et avec des acteurs de ce territoire pour savoir comment favoriser la mobilité partagée, les échanges d’objets, etc. Cela dit, on ne peut pas fournir des recettes applicables partout, il faut que les solutions soient adaptées à la réalité de chaque territoire. Mais on trouve intéressant qu’à l’échelon local, les acteurs publics se demandent comment ils peuvent encourager ces échanges. Ce peut être en mettant à disposition des espaces, des "tiers lieux" par exemple, ou en favorisant la création de fablabs ou d’espaces d’ateliers partagés…. En ce qui concerne la mobilité, je ne sais pas si les aires de co-voiturage sont d’une grande efficacité. Et les initiatives de co-voiturage régional sont un échec cuisant, dans l’ensemble, parce qu’elles n’ont pas permis, en général, d’atteindre la masse critique d’utilisateurs nécessaire à un bon fonctionnement. Au lieu de s’allier avec des acteurs qui avaient déjà commencé à construire quelque chose en la matière, chaque région a voulu construire sa petite plateforme de covoiturage, ce qui est idiot, parce que les gens ne se déplacent évidemment pas seulement à l’intérieur d’une région. Pour le coup, c’était le contraire de ce qu’il fallait faire, développer son propre outil au lieu de mutualiser, de faire de l’inter-opérativité… En revanche, je pense à une initiative très locale, menée avec zéro budget ou presque, pour promouvoir l’autostop en milieu rural. La collectivité en question, une communauté de communes je crois, a mis en place un système permettant d’augmenter la confiance entre automobilistes et autostoppeurs : les autostoppeurs intéressés s’inscrivent auprès de la collectivité, reçoivent un kit, du genre un gilet à porter sur le dos, avec le sigle de la collectivité ; et les conducteurs reçoivent de leur côté un autocollant. Autrement dit, c’est un système de reconnaissance qui augmente un peu le niveau de confiance entre les utilisateurs.
Voilà un bon exemple de la manière dont la puissance publique peut inter-agir avec ces systèmes. Il s’agirait d’aider des communautés d’acteurs à faire par eux-mêmes, plutôt que de faire à leur place ?
Oui, La Fonderie par exemple, qui nous a aidés en Ile de France, avait envie de travailler sur l’économie collaborative, mais savait très bien que ce n’était pas à elle d’organiser un événement comme le OuiShare Fest. Parce que c’est nous qui connaissions les acteurs du secteur, et qui étions acteurs nous-mêmes. Au final, cela s’est avéré une coopération vraiment très intéressante. D’une manière générale, il y a plein de choses envisageables. La collectivité publique peut jouer un rôle de garant. Elle n’a pas forcément besoin de mettre en œuvre elle-même, de proposer un service. Elle doit être garante de la protection du bien commun, ce qui implique de veiller à plusieurs choses : elle peut agir sur le niveau de confiance ; ou prévenir les risques d’appropriation du bien commun, ou de fermeture des systèmes ; elle peut garantir l’ouverture et l’inclusivité des modèles… Il faudrait plancher là-dessus. Comment une collectivité territoriale peut-elle être garante du fait qu’il n’y ait pas de personnes exclues de ces systèmes d’échange ? Soit elle propose une sorte de filet de sécurité, en aval, soit elle se place dans une position d’aide directe, en amont ; par exemple en agissant sur la fracture numérique. La puissance publique pourrait aussi encourager le fonctionnement en bien commun. Pour l’instant la plupart de ces systèmes d’échanges sont opérés par des acteurs privés, qui développent une activité économique. Ça fonctionne en peer to peer, c’est bien, les gens échangent entre eux, mais les utilisateurs sont captifs, et ils n’ont pas leur mot à dire sur la manière dont la valeur est redistribuée. On pourrait imaginer que ces plateformes-là soient conçues, mises en place et gouvernées par les utilisateurs eux-mêmes. Et que cela n’empêche pas de construire des activités économiques autour. Le fonctionnement en bien commun n’exclut pas forcément l’activité économique.
Pouvez-vous expliquer ce point ?
Par exemple, il existe plein d’entreprises qui produisent du logiciel libre. Ces développeurs de l’open source gagnent leur vie en se faisant rémunérer sur des adaptations du logiciel. Mais tout est repartagé derrière. En fait, le modèle économique s’appuie sur le service rendu, sur une production intellectuelle, et pas sur la rente. De même, les plateformes d’échange de biens ou services sont légitimes à se faire rémunérer, parce qu’elles font un travail d’animation, d’assistance des utilisateurs, etc. Ça ne fonctionne quand même pas tout seul : il faut mettre de l’huile dans les rouages, il y a du travail… Il faudrait juste que la totalité du modèle économique soit basé sur la rémunération du travail quotidien qui est réalisé, et non pas sur l’exploitation, la capitalisation d’un outil qui a été créé et que l’on vend…
Pensez-vous que ce que l’on partage ou ce que l’on construit ensemble dans ces systèmes collaboratifs répond à des besoins nouveaux, émergents ? Ou bien que ces services prennent la place de ceux que la puissance publique abandonne, faute de moyens ?
On dit la même chose des associations en général… Personnellement, je pense que le fait que les citoyens se réapproprient pas mal de choses qui correspondent à leurs besoins est un mouvement de fond, que l’on n’arrêtera pas. Par contre, il faut veiller à ce que l’Etat, les acteurs publics, ne disparaissent pas totalement, face à ce mouvement. Parce qu’eux seuls peuvent assurer que personne ne soit laissé de côté. Si on n’a que les citoyens et les acteurs privés dans ces systèmes d’échanges, je ne sais pas où cela nous conduira… Je veux dire que ce n’est pas forcément la solution à un certain nombre de problèmes sociaux. C’est positif, dans le sens où les gens sont de nouveau davantage acteurs. Pas forcément tous directement, mais c’est un processus qui va dans ce sens-là : on entre dans l’économie collaborative par le co-voiturage ; certains n’iront pas plus loin et resteront dans une logique de consommation ; mais le covoiturage peut aussi être une porte d’entrée vers d’autres systèmes. Une fois que l’on est adepte de la consommation collaborative, on va s’intéresser aux systèmes plus contributifs. C’est une évolution logique. Parce qu’on est davantage impliqué quand on est en relation directe avec un pair, en face-à-face, que lorsqu’on est simple client d’un magasin ou usager d’un service. Je pense que la logique d’assistance n’est plus tellement dans l’air du temps.
Certains le déplorent, c’est la fin de l’Etat providence…
l faudrait juste que cela ne supprime pas toute forme d’intervention publique. Je pense à une chose dont nous n’avons pas parlé : le jobbing, la mise en relation de particuliers pour accomplir des petits boulots ponctuels du quotidien. Cela s’est développé très rapidement aux USA, et commence à apparaître en France, où c’est forcément très freiné par la législation sociale. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose… Parce que de toute façon c’est un mouvement qui va avancer. Plutôt que de réfléchir à comment stopper ce mouvement, il faudrait se demander comment faire en sorte que ces échanges de services entre particuliers ne se fassent pas selon la loi de la jungle. Autrement dit, comment assure-t-on une protection sociale aux personnes qui tirent la majorité de leurs revenus de ces échanges de services ; comment organise-t-on ou sécurise-t-on la relation entre l’offreur et le demandeur, etc. Comment faire en sorte qu’il n’y ait pas des forts et des faibles dans cette relation ? Parce que le code du travail est là, a priori, pour protéger la personne en situation de faiblesse. Il y a ainsi, à un niveau global, de nombreuses questions de réglementation qui se posent. C’est un chantier de réflexion énorme, énorme…
Toutes ces nouvelles activités posent en effet la question du statut de ceux qui les initient, et plus généralement, des contributeurs. On voit que le bénévolat ne peut suffire, et que la récupération par le marché va très vite. Que faudrait-il imaginer ?
En France, la réponse, pour entrer à peu près dans le cadre légal, c’est le statut d’auto-entrepreneur. Personnellement, je pense que ce n’est pas la solution vraiment adaptée. Parce que c’est théoriquement un statut temporaire ; c’est censé être un tremplin vers le développement de l’emploi. Alors qu’avec ces systèmes d’échanges, on n’est pas du tout là-dedans. Il faudrait trouver un système adapté à une situation qui n’est pas juste temporaire. La puissance publique peut se dire : « Non, il ne faut pas que toutes ces micro-activités se développent, parce que c’est la précarisation, etc. ». Mais elles vont se développer dans tous les cas ! Je le vois au sein de OuiShare : nous sommes tous multi-casquettes, on a tous plein d’activités différentes, on multiplie les sources de revenus. Je pense que c’est le rôle des acteurs publics de se demander comment accompagner ce mouvement-là. Et comment faire en sorte qu’existe un système de solidarité adapté à cette nouvelle donne.
Texte de Patrice RAYMOND
Un point de vue critique du système de péréquation redistributive des recettes des collectivités.

Étude
Ce livret consacré à l'éducation au développement et à la solidarité internationale, « élément essentiel de l’apprentissage de la citoyenneté », vise d’une part, à faire comprendre les grands déséquilibres mondiaux et d’autre part, à encourager la réflexion des élèves sur les moyens d’y remédier.

Interview de Benjamin Lemoine et Edoardo Ferlazzo
Sociologue, socio-économiste
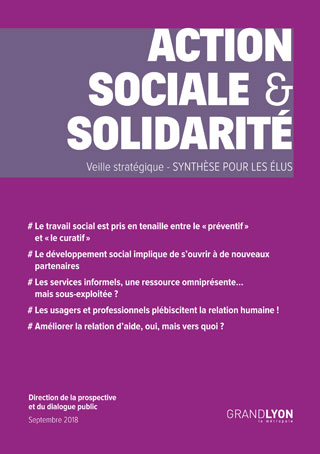
Étude
Veille stratégique - synthèse pour les élus.

Interview de Sarah Abdelnour
maîtresse de conférence en sociologie à l'université Paris-Dauphine

Interview de Marc Leroy
Professeur de finances publiques et de sociologie, Université de Reims, Vice-Président de la Société Française de Finances Publiques

Interview de Damien Catteau
Maître de conférences en droit public, Directeur du Master 2 Droit public - Parcours Carrières publiques - Université Jean Moulin Lyon3.

Interview de Olivier Landel
Délégué général de France urbaine et Directeur général de l'Agence France Locale

Texte de Valérie PEUGEOT
« Quand on se penche sur ce qui se passe dans les territoires de France et d’ailleurs, on observe un foisonnement d’individus et de collectifs qui cherchent, inventent, construisent pour répondre aux besoins que ni la puissance publique, ni les acteurs traditionnels du marché ne semblent en capacité de satisfaire ».