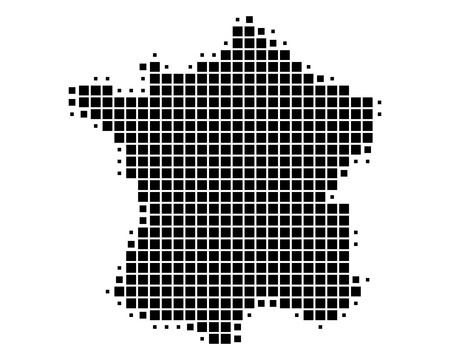Pourquoi les pratiques de coopération sont-elles importantes pour vivre en société ?
Si l’on en donne une définition générale, coopérer consiste à travailler avec d’autres pour faire ce que l’on ne peut pas faire seul. Mais la forme particulière de coopération qui m’intéresse, c’est la coopération complexe qui consiste à communiquer avec des personnes que l’on ne comprend pas, des étrangers, voire des personnes que l’on n’aime pas. Malheureusement je constate que ces pratiques de coopération dans la différence sont en déclin dans de nombreux pays. En France, par exemple, seuls un quart des individus pensent spontanément que l’on peut faire confiance à autrui. Et durant les trente dernières années, on observe que les gens pensent de moins en moins pouvoir compter sur leurs voisins. Et de fait, ils agissent de manière de moins en moins coopérative. C’est d’autant plus compliqué si les personnes vers lesquelles vous pourriez vous tourner pour obtenir de l’aide sont différents, en termes d’âge, de sexe, de culture... Pour moi, notre société devient de moins en moins coopérative. Or, la coopération constitue un enjeu social et politique majeur.
Le déclin des pratiques de coopération est-il dû à la diffusion de l’esprit de compétition qui a envahi l’école, le sport, les villes et même la famille ?
On pense en général que coopération et compétition sont deux opposés et c’est une croyance ancrée dans notre enfance. Les psychologues nous montrent bien que lors de son développement, l’enfant entre quatre et six ans est en pleine quête d’autonomie et croit que la compétition est un jeu à somme nulle. Il pense que dans toute relation il y a un gagnant et un perdant. Et c’est une croyance qui peut perdurer tout au long de la vie, si l’on ne grandit pas un peu... Réfléchissez, si vous avez pratiqué un sport, vous savez bien que vous devez coopérer avec votre équipe pour espérer vaincre l’équipe adverse. Mais, vous remarquerez aussi que dans le sport, il faut même coopérer avec son adversaire ! En effet, pour que le jeu et la compétition fonctionne, il est nécessaire de s’accorder sur les règles et sur ce que tricher veut dire. C’est entre cinq et huit ans que les enfants comprennent cela et apprennent à fonctionner en articulant coopération et compétition. De même, en tant qu’adultes, trouver le bon équilibre entre coopération et autonomie, entre coopération et compétition, fait partie du quotidien de notre vie. Pour que nous puissions vivre bien ensemble, notre société a besoin de cet état d’esprit, issu du jeu ou du sport, pour éviter de que notre monde devienne une caricature hobbesienne de société où la lutte entre les individus prime sur toute autre forme de relation. Mais je suis bien conscient que cet équilibres entre coopération et compétition est d’autant plus difficile à trouver que l’on interagit dans des situations difficiles, avec des personnes qui sont différentes, de nous en termes d’âge, de sexe, de culture...
Et ne pensez-vous pas que l’esprit de solidarité pourrait contribuer au « vivre ensemble » que vous évoquez ?
La solidarité, pour moi, n’est pas une bonne option pour faciliter les relations entre des communautés très différentes. Je ne crois pas dans la valeur de solidarité car elle a une connotation trop idéologique. En outre, elle nous conduit à lisser les différences entre les personnes plutôt que valoriser leur diversité. La solidarité conduit à sacrifier la richesse qu’apporte la complexité. Il faut mobiliser d’autres moyens pour permettre le vivre ensemble, pour que les gens communiquent entre eux malgré leurs différences, ou en valorisant leurs différences. C’est tout le sens des compétences de coopération dont je parle dans mon livre. Cette forme d’interaction est la plus créative et la moins oppressive, elle laisse davantage de place à l’expression des singularités des individus.
Le vingtième siècle a perverti les principes de la coopération au nom de la solidarité. En voulant lutter contre les méfaits du capitalisme, la Gauche au sens large, a porté une stratégie de solidarité vis-à-vis des plus faibles, portée en France par l’idée d’un État providence. D’après moi, cela a malheureusement conduit à renforcer une attitude générale de condescendance et des rapports « nous-contre-eux » dans la société. Dans le même temps, et peut-être en conséquence, le capitalisme n’a aucunement été adouci, on a vu s’accroître les inégalités, les élites se détacher de leurs responsabilités collectives, les personnes ordinaires se replier sur elles-mêmes. Au final, la société cherche encore la solution dans la solidarité, alors que je crois qu’elle est ailleurs, dans la coopération.
Vous décrivez pourtant le déclin des compétences sociales de coopération. Peut-on les réparer ou les remobiliser ?
Plutôt que de tenter de trouver les causes de ce phénomène pour y apporter des solutions globales, je propose d’observer la diplomatie du quotidien que déploient les gens dans leurs familles, dans leur vie professionnelle ou dans la rue. On y trouve des rituels et des pratiques de civilité qui ont traversé les âges et qui permettent à chacun de bien gérer ses relations avec l’autre, surtout quand il est vraiment différent de soi. Ces compétences mobilisées sont encore présentes et nous devons trouver le moyen de les réparer, de les reconfigurer pour pouvoir les mobiliser à nouveau dans la société. La première compétence que l’on observe est une forme d’écoute dialogique qui ne permet pas forcément d’aboutir à un consensus mais qui fait que l’on apprend beaucoup sur soi-même et sur l’autre. A l’inverse, lorsque vous échangez avec quelqu’un dans une logique dialectique, c’est pour aboutir à une conclusion et à une synthèse, après avoir écouté s’énoncer la thèse et l’antithèse. Vous écoutez en cherchant à reformuler ce que l’autre vous dit pour faire converger vos idées. Alors que si vous pratiquez l’écoute dialogique, vous vous intéressez à la personne qui vous parle, à ses intentions, à ce qu’elle veut dire à mots couverts. Ce type d’échange est ouvert et il n’y a pas de moment où l’implicite, le caché, est rendu explicite et clarifié. Il n’y a pas de conclusion. C’est la même différence que l’on trouve entre un orchestre qui cherche à s’accorder en répétition sur la manière d’interpréter un morceau, et un groupe de jazz qui improvise en s’écoutant. Pour moi, l’écoute dialogique est bien une des bases de la diplomatie quotidienne et de l’art de la coopération, qui nous amène à valoriser le processus plutôt que le résultat, à rechercher ensemble des questions pertinentes autour desquelles dialoguer plutôt que de vouloir aboutir à des solutions consensuelles.
La deuxième compétence clé consiste à savoir utiliser un mode d’expression subjonctif. C’est le contraire d’une expression déclarative qui vise au maximum de clarté et qui est très souvent employée dans les débats pour persuader son auditoire. Le problème c’est que cela ne laisse pas beaucoup de place à la discussion et à la subtilité. Vous pouvez être d’accord ou pas d’accord avec une formulation déclarative mais cela ne permet pas de construire une relation dans la durée. D’une certaine manière, le mode déclaratif répond à une logique de domination dans la mesure où il privilégie l’affirmation de vérité ou de positions tranchées. En revanche, en employant une parole subjonctive on ouvre des espaces de liberté et d’ambiguïté. Cela pourrait sembler contre-productif, en se faisant au détriment de la clarté. Mais pourtant ces espaces ouverts invitent à poursuivre l’échange pour en savoir plus... Prenez le cas d’une négociation tendue entre deux parties. Si chacun vient en déclarant des positions fermes et sans équivoques, les échanges vont avoir du mal à s’installer. Il vaut mieux ouvrir ce type de dialogue par une expression subjonctive : « il me semble que… ». Dans des situations de coopération complexes avec des personnes qui n’ont pas la même culture ou les mêmes positions sociales, le mode d’expression subjonctif est une manière d’installer la relation et de construire à partir de là.
La troisième compétence à laquelle j’attache de l’importance consiste à gérer ses rapports aux autres avec empathie plutôt que sympathie. Bien sûr, ces deux modes de relation impliquent une reconnaissance de l’autre, nécessaire pour créer du lien. Dans certains cas, la sympathie fonctionne, vous aidant à surmonter les différences pour aider une personne en difficulté. Lorsqu’un inconnu se fait renverser par une voiture, vous courrez lui porter secours, par sympathie, parce que vous vous mettez à sa place et ressentez sa souffrance. Vous vous identifiez à lui. Mais dans d’autres cas, la sympathie vous conduit dans une mauvaise voie. Vous pensez bien agir mais vous vous mettez en position de supériorité par rapport à l’autre et, en fait, c’est vous qui avez le contrôle, voire de l’emprise sur lui dans une relation émotionnellement chaude et intense. Je partage l’avis d'Hannah Arendt, pour qui la sympathie est proche de la condescendance et de la pitié... Bien souvent, pour entretenir une relation mutuellement enrichissante, l’empathie est plus appropriée. Vous vous intéressez alors à l’autre avec une forme de curiosité moins intrusive, avec une intensité émotionnelle plus faible. Il me semble que ce mode de coopération empathique est particulièrement adapté à l’action politique ou sociale lorsque vous devez travailler avec des personnes qui n’ont pas la même culture que vous, lorsque vous devez apprendre d’elles plutôt que seulement les aider ou parler en leur nom.
La ville est le lieu par excellence où se croisent une multitude de personnes très différentes. Mais y a-t-on vraiment besoin de coopérer avec ses voisins, ne peut-on pas tout simplement cohabiter ?
Effectivement, ce que l’on observe de plus en plus dans nos grandes métropoles, ce sont des citadins qui vivent ensemble mais séparément. C’est presque devenu la norme. Des « gated communities » apparaissent et les gens, au mieux, cohabitent ou s’ignorent, s’ils ne vont pas jusqu’à s’opposer les uns aux autres. Les Etats-Unis comme l’Europe sont devenus des sociétés tribales combinant un esprit de solidarité entre ceux qui se ressemblent et une agressivité de plus en plus marquée à l’encontre de ceux qui sont différents.
Pourtant, une société complexe comme la nôtre est dépendante des flux de travailleurs étrangers, s’enrichit de la diversité culturelle, ethnique ou religieuse, et accueille une multitude de modes de vies. Vouloir forcer cette diversité dans un moule culturel unique serait contre-productif et politiquement dangereux. En outre, ce serait nous mentir à nous-mêmes sur notre identité composite.
En laissant cette société tribalisée et cloisonnée se développer, nous passons à côté de ce qui fait la valeur d’une ville, c'est-à-dire la diversité des échanges qui stimulent la créativité. Ces interactions informelles produisent des conséquences inattendues sources d’innovation, d’enrichissement culturel et économique. Prenons l’exemple du développement d’un marché dans une ville, plus il rassemble des gens différents, avec des attentes et des produits variés, plus ils sont vivants et riches. Un marché où ne se rencontrent que des semblables a tendance à être très statique.
Aristote a été le premier philosophe occidental à se préoccuper des effets néfastes de l’uniformisation. Pour lui, la ville est un synoikismos, un rassemblement de peuples venant de tribus différentes, chacun de ces oikos ayant ses propres allégeances, ses dieux, ses traditions et son histoires. Or, pour favoriser le commerce et s’entraider en cas de guerre, la ville a besoin de cette diversité et les habitants ont donc besoin d’apprendre à vivre ensemble entre peuples différents. Et il ne s’agit pas simplement d’éviter de s’agresser, mais aussi de ne pas tomber dans les stéréotypes et d’apprendre à vraiment se connaître pour coopérer.
Vous dites que la ville ne s’enrichit de sa diversité que s’il existe des formes de coopération entre les différents habitants. Mais alors, comment la favoriser ?
On n’obtient pas ces effets positifs si les gens vivent dans la ville comme dans des silos, bien séparés les uns des autres. Malheureusement, force est de constater que les compétences sociales de coopération sont en train de décliner dans nos villes. Le risque que nous courrons est d’accentuer le penchant actuel de la société qui nous conduit à bâtir des villes homéostatiques, à chercher exclusivement la stabilité, l’homogénéité et le cloisonnement. Or, si nous fabriquons une telle ville qui ne favorise plus la sérendipité, les rencontres informelles et inattendues, c’est la capacité d’innovation et le vivre ensemble qui vont en pâtir.
L’enjeu ce n’est pas de changer les individus mais de prendre en compte leurs contradictions. De manière assez naturelle, ils veulent à la fois se protéger de ceux qui sont différents, et, en même temps, ils sont en quête de stimulations procurées par la diversité qu’ils rencontrent dans leur environnement. Dans la ville, les politiques et les urbanistes doivent offrir à ces individus un environnement qui leur permettent de vivre des expériences à la fois rassurantes et stimulantes, bref qui soit propice à la rencontre et à la coopération avec autrui.
Pouvez-vous nous donner un exemple de la manière dont on peut modifier l’environnement urbain pour favoriser la coopération ?
Je vais vous raconter un exemple venant de ma pratique professionnelle d’urbaniste à New York. Je devais développer un nouveau marché hispanique pour la communauté en question dans le Harlem espagnol. Nous avons choisi de le localiser en plein cœur du quartier. Après quelques temps, nous nous sommes aperçus que nous avions commis une erreur. Nous nous aurions mieux fait de le situer en bordure, à proximité du quartier chic de Upper East End. Cela aurait d’une part apporté une nouvelle clientèle plus aisée dans ce marché, mais surtout cela aurait favorisé un mélange de populations très différentes, riches et pauvres. Ces populations se auraient été amenées à se côtoyer et la plus-value sociale pour la ville aurait été bien plus importante.
Cette expérience m’amène à penser qu’un véritable projet politique pour une ville consisterait à bâtir un nouvel équilibre entre sécurité et ouverture sur l’autre. Cela passe par un travail sur ce qui se passe sur les bords, là où l’on fait l’expérience de l’altérité. En général, on a tendance à y construire des frontières étanches plutôt que d’aménager des bordures à la fois protectrices et poreuses. Concrètement, lorsque l’on doit construire un centre social ou une école, plutôt que de la construire en plein cœur d’un quartier ou d’une communauté, il faudrait l’implanter à la jonction entre deux quartiers pour, justement, animer ces bordures en permettant à différentes communautés d’utiliser des ressources communes.
Qu’entendez-vous par bordures protectrices et poreuses ?
Vous avez deux sortes de bords dans une ville : ceux que j’appelle des bordures et ceux que j’appelle des frontières. Nous avons le même type de distinction à l’échelle cellulaire entre une membrane et une paroi. La première est flexible et ouverte : elle est suffisamment résistante pour maintenir l’unité de la cellule mais poreuse pour permettre les transactions avec l’extérieur. La seconde est plus rigide et fermée.
Si l’enjeu est bien de développer les interactions et la coopération entre deux communautés qui s’ignorent dans une ville, le premier réflexe est de supprimer les barrières qui limitent les échanges, d’ouvrir la frontière. Pourtant, je suis persuadé que c’est une erreur. Pour permettre une véritable coopération sociale, nous avons besoin à la fois de protection et d’ouverture. C’est là qu’intervient l’idée de bordure parce qu’il combine les caractéristiques de porosité et de résistance. Dans ces zones de bordure, c’est là que les interactions se négocient, entre des individus différents.
Et vous pensez que les urbanistes dans nos villes utilisent les mauvais leviers ?
L’urbanisme moderne est beaucoup plus efficace pour développer des frontières que des bordures. Par exemple, les infrastructures routières forment souvent des murs et des frontières entre des quartiers. Et l’on peut même se demander si elles ne sont pas conçues ainsi de manière volontaire pour limiter les interactions entre les communautés, pour exclure les plus pauvres qui se retrouvent au-delà des périphériques... Pour moi ce n’est pas un processus innocent, l’urbanisme agit volontairement pour maintenir des cloisons entre des individus différents, sous couvert d’améliorer la sécurité et l’efficacité du fonctionnement de la ville. C’est peut être choquant à dire mais je crois que c’est volontaire. Ceux qui gèrent la ville se sentent en position de contrôle lorsqu’ils développent par exemple des systèmes d’optimisation de la ville intelligente, de la smart city. Pourtant, ce faisant, ils déqualifient tous ceux qui habitent la ville en réduisant leurs compétences sociales : les individus ne savent plus interagir avec des personnes qui leur sont étrangères, ils ne savent plus gérer la différence, l’inconnu et la complexité, ils n’ont plus les capacités pour pratiquer des échanges sur un mode dialogique, subjonctif et empathique.
A présent, il faut traiter cela comme un enjeu politique majeur pour la ville, si l’on souhaite construire durablement le vivre ensemble.
Outre les choix d’aménagement ou de modes de gestion de la ville, y a-t-il d’autres leviers pour développer la coopération dans la ville ?
Bien sûr, nous avons besoin d’espaces de coopération comme je viens de l’expliquer, mais nous devons aussi développer des institutions qui permettent aux différences d’entrer en dialogue. Je ne parle pas d’institutions qui puissent représenter les intérêts de certaines catégories d’usagers mais plutôt d’institutions qui accueillent la diversité en leur sein. Prenons l’exemple des syndicats : ils devraient sortir de leur rôle classique qui consiste à mobiliser des individus aux intérêts similaires pour défendre ensemble leurs causes communes. Ils devraient se transformer en institutions sociales qui accueillent des membres diversifiés et qui leur offrent un forum pour communiquer entre eux, pour créer de nouveaux liens, voire pour développer des projets collectif utiles à la société, gérer des crèches, des services intergénérationnels, etc. On pourrait transformer, à l’échelle locale, le rôle de toutes sortes d’institutions classiques, les syndicats bien sûr mais aussi les écoles ou les Eglises. Cette approche qui consiste à développer de telles institutions civiques a pris de l’ampleur aux Etats-Unis et se diffuse dans les pays scandinaves. Par exemple, je suis membre du Service Employees International Union, un syndicat qui compte près de deux millions de membres et qui met en pratique ce type de valeurs.
Mais pour que cette dynamique de coopération prenne corps, il faut accepter de croire que la société civile n’est pas juste une institution qui prend en charge ce que l’Etat ne veut plus gérer... La société civile peut faire émerger des idées nouvelles et des initiatives nouvelles, elle peut contribuer au mieux vivre ensemble. Or malheureusement, la France n’est pas du tout dans cet état d’esprit et j’ai le sentiment qu’en France on ne croit pas dans ce rôle de la société civile. Pourtant, créer ou renforcer ces institutions est un enjeu majeur pour l’avenir des villes et de la société, car c’est là que peuvent se réparer ou se reconfigurer les compétences de coopération informelle dont nous venons de parler.