Réflexions sur la « domocratie » locale

Texte de Chtristophe Chabrot
Une approche juridique et étymologique pour distinguer démocratie nationale et démocratie locale.
Interview de Jean-Pierre ALDEGUER

<< Combien de fois ai-je vu des directeurs de cabinets, des directeurs de services bloquer un dossier, bloquer l’accès des associations à l’élu >>.
Rencontre avec Jean-Pierre Aldeguer, directeur de la Mission Régionale d’information sur l’Exclusion (MRIE) Rhône-Alpes, ancien directeur adjoint de l’Agence d’urbanisme de la région lyonnaise et directeur de la Fédération Habitat et Humanisme.
Jean-Pierre Aldeguer, à l’issue de son parcours dans les milieux de l’urbanisme et de la construction du logement très social à Lyon, livre son point de vue sur les dynamiques associatives et leur relation avec l’action publique.
Vous avez maintenu, à travers des positions différentes dans l’urbanisme et la construction du logement social, des engagements complémentaires, professionnel, intellectuel, social, culturel… Comment êtes-vous d’abord venu à la militance, aux questions sociales ?
Je pense que cela tient à mon histoire personnelle, je suis fils d’immigrés, mes parents sont de milieux très populaires. Ma formation joue aussi un rôle : j’ai fait à la fois l’ESSEC et l’Ecole des Ponts, où l’on pensait que « changer la ville » était équivalent à « changer la vie ». A l’époque, nous n’étions pas des « techniciens de la ville », on se pensait « advocacy planners » ; ce mot venait des Etats-Unis et signifiait qu’on était au service des habitants, pour changer la ville. « Changer la ville pour changer la vie » était aussi le slogan d’Hubert Dubedout à Grenoble. J’en étais très imprégné, et n’étais pas le seul ! Dans l’urbanisme, le développement social, le travail social, on trouvait dans les années 70 une forme d’engagement très différente de celle qui vient depuis les années 90, où l’on se tourne vers ces fonctions pour trouver un métier, de l’argent, et non pas pour changer la vie. Quand j’ai obtenu mon premier emploi à la Direction Départementale de l’Équipement, j’étais dans cette forme d’engagement. En m’impliquant dans le syndicat CFDT, c’était la même chose. Quand je me suis retrouvé à Croix-Luizet, forcément j’étais dans le comité de quartier où l’on retrouvait les « nouvelles classes moyennes », des gens comme moi, des professionnels. Il y avait Jean-Jack Queyranne qui se retrouvait là aussi pour « changer la ville pour changer la vie ». Le terrain de la Sainte Famille a été l’objet d’une des premières manifestations importantes dans les années 73/75 autour du pouvoir urbain. La municipalité de Villeurbanne voulait que le terrain de la paroisse soit urbanisé, alors que pour tout le quartier, il fallait qu’il reste un espace vert. C’était la première fois que nous nous battions contre un maire.
Ce combat, avec qui l’avez-vous mené ?
Nous l’avons même gagné, parce toute la population du quartier et de la paroisse de la Sainte Famille s’est mobilisée. Dans ce monde italien du quartier de Croix-Luizet, ce terrain avait une fonction très importante. Toute la gauche, le PS, le PC et les syndicats sont venus renforcer ce mouvement de protestation, car s’opposer était une manière de se placer dans la course au remplacement du maire Etienne Gagnaire, qui était à la fin de ses mandats. En plus, apparaissait le thème du maintien des espaces verts dans la ville…Voilà tout ce qui fait que le terrain de la Sainte Famille est resté, encore aujourd’hui, un espace vert à Villeurbanne.
Etre à la fois professionnel de l’urbanisme à l’Atelier d’urbanisme puis à l’Agence d’urbanisme de Lyon, et à la fois militant, cela ne posait pas des problèmes ?
Non, le monde associatif à cette époque était quand même limité malgré les comités d’intérêts locaux et leur fédération, l’Union des comités d’intérêts locaux (UCIL) qui était une caisse de résonance des revendications des habitants. Y adhérer permettait de faire avancer des choses auprès de la municipalité, c’était aussi un moyen de faire bouger le CIL local qui portait plutôt le pouvoir conservateur des gens bien implantés sur place, mais il était clair que c’était Pradel qui décidait. Lorsque des associations se créaient en lien avec la ZAC Saxe-Paul Bert à Lyon 3è, Louis Pradel ne cherchait pas à entrer contact avec elles, il avait ses réseaux de promoteurs et de régies et il savait que quand il allait dans le quartier, nombre d’habitants l’approuvaient. Quand j’ai été recruté comme directeur adjoint à l’Atelier d’urbanisme, on savait certainement que j’avais des contacts avec des associations et comités de quartier de Saxe-Paul Bert, pourtant, mes engagements syndicaux et militants n’ont pas été pris en compte, alors qu’ils le seraient aujourd’hui, tellement il était clair pour l’élu que la politique était son rayon, alors qu’on attendait seulement du technicien qu’il soit un bon professionnel. Du coup, le professionnel avait la possibilité de s’engager dans sa vie privée, sa vie privée existait et était respectée.
Comment avez-vous vu évoluer au cours du temps le positionnement des techniciens par rapport aux élus ?
Il est allé dans le sens de la confusion entre l’élu et le technicien, dans la logique du partage de projets (élu et technicien peuvent être dans le même projet, dans le même positionnement politique) et dans la logique du copinage (élu et technicien se tutoient…). Cette confusion est au détriment du plus faible, l’élu n’ayant aucun problème pour renvoyer le technicien quand il y a un problème ! Il me semble qu’auparavant les rôles étaient beaucoup plus clairs, beaucoup plus nets, cela permettait une autonomie de l’un et de l’autre.
Quand on parle des ZAC, les zones d’aménagement concerté, il y a le mot « concertation ». Dans les années 70, des citoyens, des associations demandent à être parties prenantes de cette concertation...
Je me souviens effectivement des débats où les tenants d’une concertation populaire insistaient là-dessus. On leur répondait que la concertation consiste à mettre autour de la table tous les partenaires intéressés par l’opération : les services techniques de la ville, de la Communauté urbaine, les promoteurs, des administrations (santé, jeunesse et sport…). Ceci dit, c’était un monde finissant, des orientations nouvelles émergeaient. Quand j’amenais en 1976 des professionnels du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) visiter le quartier Saxe-Paul Bert et les mettais en relation avec les associations, critiques au projet, ils partageaient leur point de vue, ils savaient que le projet de rénovation urbaine de Louis Pradel était irréalisable, que le monde changeait… Après les élections municipales de 1977, le monde s’est transformé. Quand Charles Hernu est arrivé à Villeurbanne, la concertation pour le Plan d’Occupation des Sols a amené à rencontrer (pour la première fois) les habitants. A Lyon, la transformation après Louis Pradel a été énorme, on a vu arriver à l’urbanisme un adjoint comme Jacques Moulinier qui avait une habitude de la concertation. Les habitants ont trouvé dans les équipes municipales des gens qui les écoutaient, les entendaient… s’impliquer prenait du sens. 1977 a été un tournant très fort.
Sur une période de 30/40 ans, quelles sont les transformations des modes d’action des associations qui vous frappent le plus ? Entre les tentes de l’association Don Quichotte, les modes d’intervention médiatiques, festifs d’aujourd’hui, et les lettres et pétitions des comités d’intérêts locaux, il y a quand même un monde, non ?
Il ne faudrait pas généraliser Don Quichotte comme modalité d’expression aujourd’hui. Et puis dans les années 70, nous faisions le feu de la Saint-Jean sur le terrain de la Sainte Famille, organisions des repas festifs, dans un souci de popularisation !
Ce qui est différent, c’est l’apparition de mouvements portés par des leaders qui viennent de l’extérieur. Les Enfants de Don Quichotte, c’est un peu comme les Restos du cœur : on se demande ce que vient faire Coluche dans cette histoire, par rapport à « nous », du Secours populaire ou du Secours catholique, qui nous battons depuis longtemps. Ce qui est marquant, c’est qu’il y a d’un côté des associations qui sont dans l’action quotidienne en partant des gens, en respectant ce qu’ils sont, s’inscrivent dans des réseaux, et d’un autre côté des associations qui arrivent parachutées, portées par les médias, avec des modalités d’action très différentes, et un impact malgré tout.
Voyez-vous une perte d’autonomie des associations par rapport au politique, aux collectivités ?
Les projets associatifs ont des difficultés à se monter, ils ne retrouvent pas aujourd’hui la dynamique qui était par exemple celle de l’ALPIL, Action Lyonnaise pour l’Insertion par le Logement créée en 1979. On retrouve cette dynamique dans des mouvements récents comme « Demeurant partout », ou le réseau « Personne dehors ! ». Ces structures ont été créées par des bénévoles et salariés d’associations disant leur ras le bol que même les associations ne peuvent rien, tellement le pouvoir politique bloque les choses. Ils ont ressenti le besoin de s’organiser pour mener d’autres types d’actions. Il est vrai que même les associations montrent, à un moment donné, leurs limites compte tenu de leurs relations financières et politiques avec le pouvoir en place. Le politique contrôle tout, même les associations. Pour moi, l’ALPIL est une des rares associations qui ait gardé son autonomie et un engagement fort, ce qui lui crée des problèmes financiers…
Qu’a apporté précisément l’ALPIL à l’agglomération lyonnaise ?
Elle a apporté énormément, pour poser le problème du logement des immigrés, pour que des initiatives soient menées avec la société anonyme d’HLM Logirel, qui s’est transformée grâce à la dynamique de l’ALPIL ; l’ALPIL a eu un rôle énorme dans l’implication et la transformation des travailleurs sociaux, par exemple sur l’Observatoire du logement du 3ème arrondissement de Lyon, première tentative de ce genre dans l’agglomération ; plus récemment, sur les Roms, s’il n’y avait pas l’ALPIL, je me demande comment on ferait…
De manière plus générale, et du point de vue d’une municipalité ou d’un établissement comme la Communauté urbaine de Lyon, qu’apportent les associations ?
La dynamique entre l’élu, les professionnel et les associations est susceptible de faire bouger le pied en retard. On a vu souvent des associations et des professionnels se liguer pour faire avancer les élus, mais aussi des situations où élus et associations pouvaient critiquer les professionnels pour les faire avancer. Je me souviens de rencontres où les élus s’appuyaient sur les associations pour obliger Charles Delfante, très réticent sur les idées de concertation (à ses yeux, c’était l’architecte qui portait un projet) à accepter de se concerter ; ou de professionnels et élus s’alliant face à une association locale réticente aux changements…
Quand, dans les années 80, l’Agence d’urbanisme commande des études à des associations comme Economie et Humanisme, l’ALPIL, le Groupe de Sociologie Urbaine (GSU), sont-elles de simples prestataires de service, ou aussi des structures militantes, qui apportent leur vision ?
Je pense que le GSU était bien cela, un prestataire d’études avec des compétences sociologiques ; en revanche, en faisant travailler l’ALPIL, on soutenait la cause du logement des plus défavorisés ; avec Economie et Humanisme, on a plutôt réfléchi sur des orientations nouvelles, avec des personnalités comme Olivier Brachet, sur la participation par exemple ou sur le bilan Olivier de Serre. Economie et Humanisme était à l’époque une référence, c’était des réflexions qui s’engageaient, donc travailler avec eux était aussi une manière de se nourrir de tous leurs travaux…
Les idées que les familles doivent être actrices de leurs vies, participer déjà aux choix de leur cadre de vie… sont présentes dans les années 80 dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat ; avec le recul, qu’en pensez-vous ?
Nous n’avons jamais assez travaillé la question de la parole des personnes. On parlait de la participation des habitants, mais d’un point de vue de techniciens… Nous techniciens, interprétions la parole des personnes, en avions une représentation, plutôt que de considérer que cette parole est un moyen de faire avancer la connaissance. Certes, cette voie n’est pas facile… Admettre que la connaissance de cette parole transforme la manière d’appréhender un problème, c’est un peu s’effacer, puisque cela revient à admettre que c’est la parole des personnes qui porte connaissance, et non le technicien.
Je reste plutôt déçu de tout ce que j’ai fait à cette époque, et regrette qu’ATD Quart monde n’ait pas été aussi présent qu’il l’est aujourd’hui. ATD Quart Monde, le Secours populaire, le Secours catholique on progressé énormément en matière d’écoute et d’expression des personnes, utilisant des techniques comme le théâtre forum, pour rendre les personnes acteurs.
Face au défi de la ségrégation sociale dans l’agglomération lyonnaise, l’Agence d’urbanisme a-t-elle été capable d’apporter des véritables propositions ?
A l’Agence d’urbanisme on dénonçait, mais que pouvait-on proposer, sachant que l’on ne contrôle pas, contrairement à ce que l’on croit, les mécanismes qui génèrent ces mouvements. Ce n’est pas parce que l’on ne démolit pas un immeuble, ou que l’on augmente pas un loyer, que ses habitants ne vont pas partir en périphérie ! Les professionnel et les élus ont l’impression de pouvoir contrôler un monde qui leur échappe en vérité, car la réalité de ce monde, la ségrégation, leur échappe. On le vérifie quelle que soit la ville, pour ma part à Grenoble et Echirolles-Villeneuve où j’ai travaillé énormément sur les fonctions de mixité, en essayant de prendre en compte tout ce qu’il était possible de prendre en compte, comme des financements différents permettant à des personnes différentes de vivre dans un même immeuble… J’ai beaucoup travaillé dans ma carrière sur les équipements intégrés, pour que l’école soit ouverte, qu’elle soit aussi centre social, crèche, que les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux ne soient pas séparés. Mais la logique dominante est une logique de séparation, dans l’habitat comme dans le domaine des activités. C’est ce qui m’a fait me démarquer de l’urbanisme à un moment de ma carrière, car j’ai vu que la logique qui était la mienne, consistant à « changer la ville pour changer la vie » était fausse ! Il me semblait plus judicieux de rentrer dans la production concrète de logements pour les personnes les plus pauvres. Mais il est vrai que je porte beaucoup de doutes, ce qui m’entraîne à participer à une action, à me poser des questions, et à passer d’une étape à une autre.
Vous travaillez en effet à la Société d’équipement de Haute-Savoie puis vous rejoignez Habitat et Humanisme, au début des années 90. Pouvez-vous rappeler comment naît cette fédération ?
En 1985, l’association est crée par Bernard Devert, prêtre et promoteur immobilier. En 1990, la loi Besson permet aux associations de produire de l’habitat très social, ce qu’elles réclamaient, considérant que les organismes HLM n’étaient pas compétents en la matière et qu’il était possible d’innover dans les solutions. Bernard Devert a monté ses structures avec les collecteurs du 1% patronal. En 1993, alors que je suis en lien étroit avec la Caisse des Dépôts , financeur du logement social, je suis appelé pour réguler les structures qui se montent, Habitat et Humanisme insertion, Habitat et Humanisme construction, Habitat et Humanisme aménagement, etc.
Quelle est l’originalité d’Habitat et Humanisme ?
Je pense que son originalité est double : elle a été d’abord de trouver des modalités de financement de l’habitat social en utilisant l’épargne solidaire, alors que la fondation Abbé Pierre par exemple, créée à la suite de la loi Besson pour récolter de l’argent afin d’aider les associations à construire du logement, demande des dons ; elle a ensuite su impliquer le monde chrétien, notamment dans l’accompagnement des personnes. A un moment où l’on mettait en exergue le délitement du lien social, elle a eu cette capacité à faire en sorte que des personnes de Charbonnières ou du riche 3ème arrondissement de Lyon puissent s’impliquer dans des activités sociales, connaître un autre monde que le leur. J’ai vu des personnes du cours de la Liberté qui n’étaient jamais allées à Bahadourian, et qui, parce qu’elles accompagnaient, ont accepté de traverser, d’avoir un nouveau regard.
Ce que j’ai aussi découvert en entrant en 1993 à Habitat et Humanisme, c’est cette importance du monde chrétien et son lien avec le monde du 1% patronal, le logement et la formation dans l’univers patronal étant affectés aux patrons chrétiens. Du coup le patronat chrétien voyait d’un bon œil ce que lui proposait Bernard Devert, c’était dans la philosophie économique et sociale de l’église. De même, les cadres chrétiens trouvaient le moyen d’appliquer ce qu’ils trouvaient dans la doctrine sociale de l’église, une relation d’implication, comme bénévole, volontaire, financeur…
Cela signifie que l’histoire du catholicisme social n’est pas terminée à Lyon, elle est toujours vivace ?
Oui, Bernard Devert est innovateur, parfois en tension avec l’Eglise, mais toujours à se revendiquer de ce lien avec l’Eglise : Monseigneur Decourtray était président d’honneur d’Habitat et Humanisme, chaque fois qu’il y avait une manifestation on essayait d’impliquer l’évêque, etc. C’est ce qui fait ce lien, que la Chronique sociale n’a pas si bien gardé, et qu’Economie et Humanisme avait perdu. Economie et Humanisme a été le cercle le plus marxiste dans la pensée économique et sociale française, se faisant énormément d’ennemis dans le monde chrétien. Pour en avoir beaucoup parlé avec les personnes d’Economie et Humanisme, je pense qu’ils se sont coupés de l’Eglise.
C’est vivace aussi parce qu’Habitat et Humanisme vise les milieux de l’Eglise les plus dynamiques ; ce n’est pas un hasard si c’est majoritairement les catégories supérieures qui sont très présentes, des cadres supérieurs de plus de 45 ans. Et puis ce discours du prêtre… Il s’avère que je suis profondément agnostique, mais j’ai été marqué de voir combien la foi était en mesure de faire engager les personnes. Or cette foi semble manquer aujourd'hui aux milieux laïques des syndicats ou de l'éducation populaire puisqu'on note de partout une réduction du nombre de militants engagés alors que les mouvements comme Habitat et Humanisme, le Secours catholique, ATD Quart Monde ont un maintien sinon une croissance de leurs bénévoles. Il faudrait se demander pourquoi dans le monde de l’éducation populaire, on ne sait pas parler de la foi, ou de l’amour. Habitat et Humanisme, c’est cette force.
Tout cela renvoie à une question qui me préoccupe beaucoup, la dynamique entre transformation sociale et transformation personnelle. Très souvent, les urbanistes pensent la transformation globale, sociale, alors qu’en fait, il y a aussi le détail quotidien, cette transformation concrète qui peut se passer quand l’école fonctionne autrement, ou à un niveau personnel quand avec Habitat et Humanisme une personne s’engage. Comment reconnaître cette dynamique de transformation, alors qu’on est souvent dans des mondes qui les séparent ou qui ne valorisent qu’une dimension ?
C’est un peu une caractéristique du monde chrétien et des religions de se poser la question de la relation entre monde social et monde personnel ?
C’est vrai, mais pourquoi n’y a-t-il que le monde chrétien qui se la pose ? Autrefois, l’éducation populaire se posait fortement ce type de question. Quand je parle avec des militants communistes, ils me racontent les écoles du PC, les sorties du PC…, ils disent avoir été changés grâce au PC. Les luttes nous faisaient changer personnellement.
Bernard Devert à Habitat et Humanisme, Economie et Humanisme et le père Lebret… on a l’impression qu’une personne est souvent indissociable d’une structure et de son destin : faut-il chaque fois un leader, une personne à qui s’identifier ?
Oui, sans Bernard Devert, Habitat et Humanisme ne serait pas, quand je parle de l’ALPIL, il faudrait parler d’André Gachet, le Secours Populaire ou le Secours Catholique, c’est tel et tel leader selon les régions… Il y a certainement trois facteurs de réussite dans le monde associatif : un leader, des réseaux (chrétiens, politiques…) avec un tissu social permettant leur existence, et un contexte. Un contexte peut bloquer totalement l’action des leaders et des réseaux, quand une mairie contrôle tout politiquement par exemple.
Votre expérience du monde associatif lyonnais vous dit-elle que les associations sont plus souvent en opposition frontale avec la collectivité, ou qu’elles s’arrangent pour ne pas l’être ?
Ce que je vois dans le milieu associatif, c’est que la logique du compromis est toujours recherchée, et quand elle n’aboutit pas, c’est que soit le pouvoir politique soit la société civile qui sert d’intermédiaire n’est plus là. A Villeurbanne, nous avons occupé des immeubles avec Demeurant partout, la Ligue des droits de l’homme servant d’intermédiaire avec la municipalité, et on est arrivé à un résultat ; alors qu’à Lyon, le cabinet du maire avait interdit tout compromis lorsque nous avons occupé des bâtiments vides de la Communauté urbaine à Vaise ou dans le 3ème arrondissement, ce qui a créé des problèmes. Toutes les associations recherchent le compromis.
Arrive-t-il que la collectivité soit sourde ?
Oh oui !, combien de fois ai-je vu des directeurs de cabinets, des directeurs de services bloquer un dossier, bloquer l’accès des associations à l’élu, alors que l’élu a souvent une capacité d’entendre, une capacité de jugement à mon avis plus fine que celle de son directeur de cabinet parce qu’il est en contact avec les personnes, et une capacité à bâtir le compromis.
L’administration fait écran…
Oui, elle s’imagine que tout est politique, qu’elle simplifie aussi la vie de l’élu en disant non. Il est vrai que le plus simple, c’est de trancher, dire blanc ou noir, alors que le compromis c’est se casser la tête pour trouver un accord. Mais il est manifeste qu’un « niet » d’un directeur de cabinet créé plus de problèmes que l’acceptation de négocier. Et, une fois dans la négociation, il est incroyable de voir cette capacité qu’on les associations, les élus, les partenaires, tous ceux qui sont autour de la table, à penser ensemble, trouver des solutions… Etre capables par exemple de transformer une gendarmerie en logements sociaux, de trouver un terrain, de négocier avec les habitants, alors qu’on imagine que les habitants n’accepteront jamais, que la gendarmerie refusera, etc. Dans la dernière partie de ma vie professionnelle, j’ai été sidéré par cette inventivité des uns et des autres face aux problèmes de logement.

Texte de Chtristophe Chabrot
Une approche juridique et étymologique pour distinguer démocratie nationale et démocratie locale.

Étude
Les apsirations et clivages dans la société française.
Interview de Claudia GUTER
Responsable de la commission jeunesse et Formation au Conseil des étrangers de Munich

Texte de Paul BOINO
En quoi la forme associative apporte-t-elle une valeur ajoutée au développement métropolitain ?

Texte de Jean-Pascal Bonhotal
L'idée que la gestion associative est source d'avantages pour les administrations est à réévaluer.

Texte d'Emile HOOGE
Les associations ont tous les atouts pour permettre à Lyon de dépasser son statut de métropole régionale et devenir une métropole européenne.
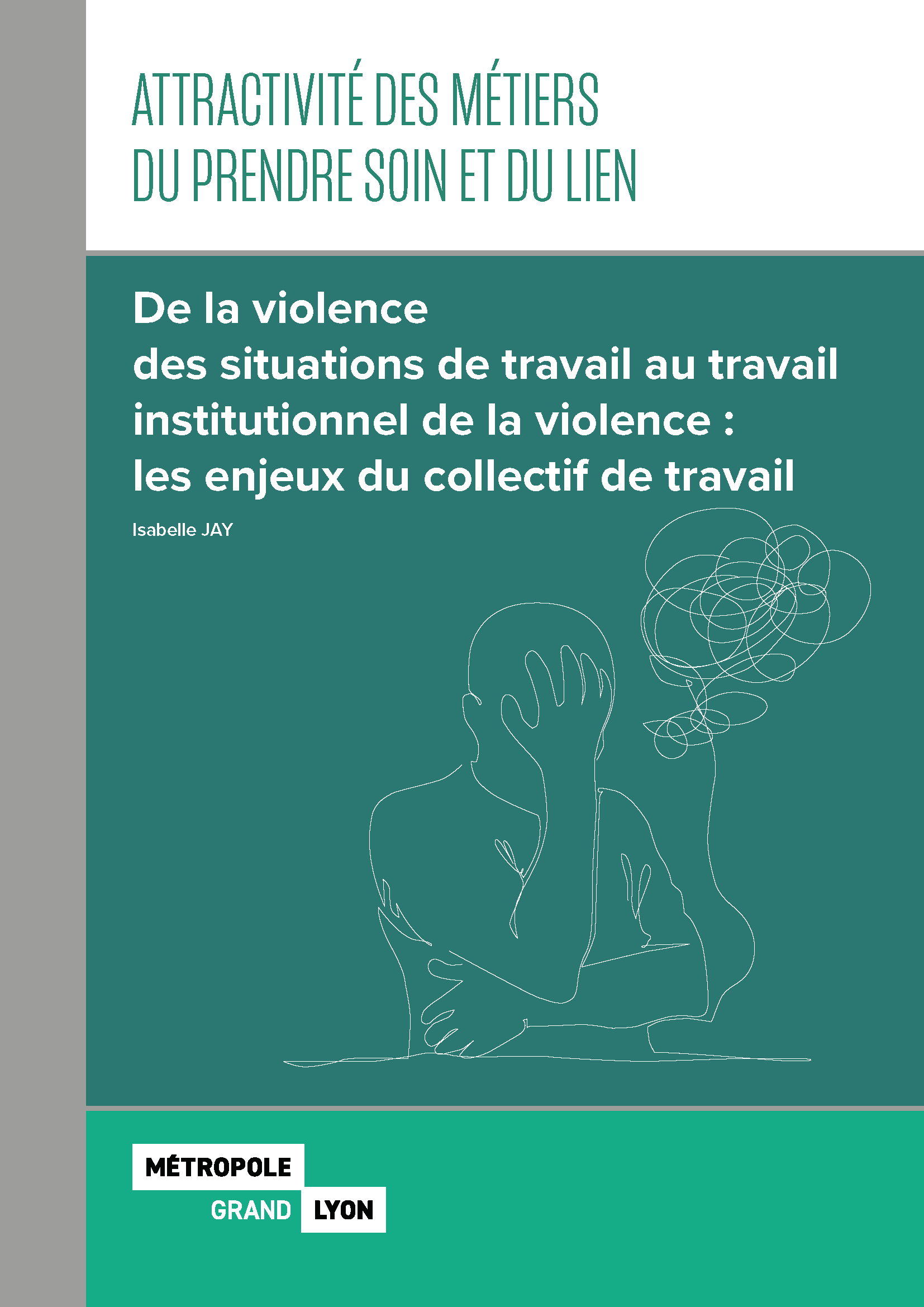
Étude
Lorsque les contraintes ne permettent plus aux professionnels de surmonter les aléas, quelle place donnée à l’autonomie et au collectif de travail pour affronter les difficultés ?

Article
Quel réseau d’acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique ?

Interview de Anne-Marie Laurent
De la Direction Environnement du Département du Rhône à celle de la Métropole de Lyon