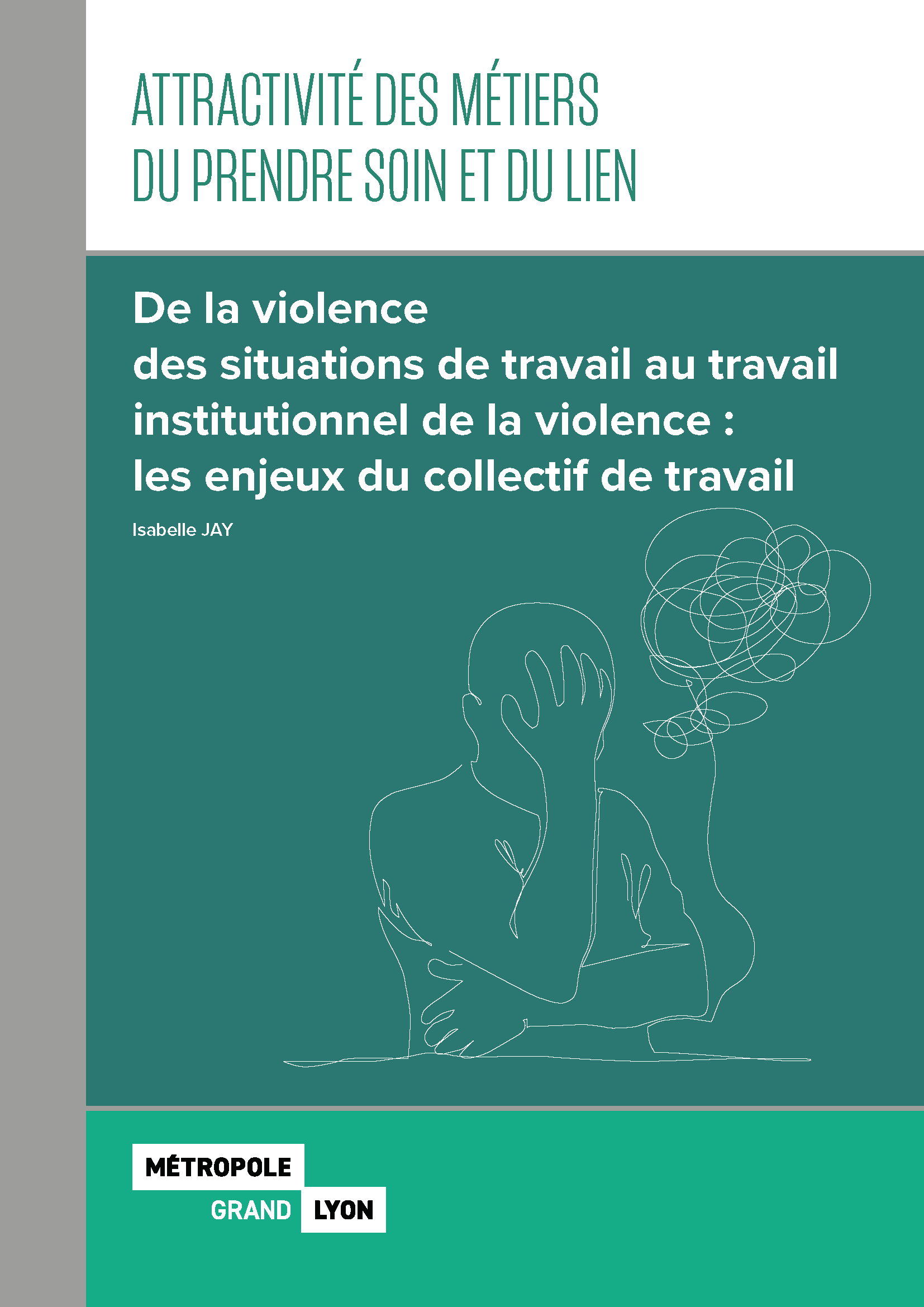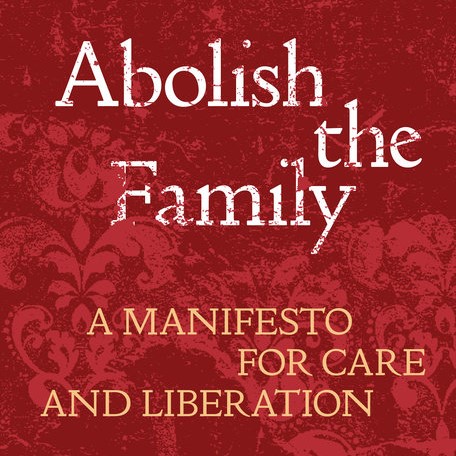Lyon et Saint-Etienne paraissent aujourd’hui deux villes en rivalité. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Nous partageons en fait une histoire commune ?
Oui, bien sûr. Non seulement notre géographie nous est à peu près commune — nous sommes entre deux grandes entités fluviales, le Rhône et la Loire, la ligne de partage des eaux se faisant entre ces deux mondes, le ligérien et le rhodanien — mais quelque chose s’est constitué, historiquement, qui nous a valu à un moment donné de ne faire qu’un. Il faut en effet se rappeler que nos deux départements, aujourd’hui distincts, n’en formaient qu’un à l’origine : en 1790, lors de la création des départements français, c’est bien le département Rhône-et-Loire qui a vu le jour. Et cette réalité administrative avait un sens : la liaison de Lyon à son Nord-Ouest était fondamentale pour son approvisionnement en céréales, le trafic avec Paris et l’Ile de France se faisant essentiellement par voie d’eau, avec transbordement au port de Roanne. Saint-Etienne, qui était alors une ville de petite manufacture centrée sur la production d’armes et la rubannerie, voyait d’un bon œil l’alliance avec Lyon : les Fabriques lyonnaises et stéphanoises relevaient du même univers. C’est une catastrophe historique — la sanction des insurgés lyonnais qui, en 1793, ont pu se fournir en armes et trouver un certain nombre d’alliés à Saint-Etienne — qui a voulu que la Convention abolisse le nom de Lyon et scinde le département en deux. Aujourd’hui, Lyon se retrouve dans le département le plus petit de France… Mais c’est une anomalie historique ! La Révolution avait créé les conditions d’une entité politique commune. Et l’histoire industrielle, qui débute au 19e siècle, va bien plus rapprocher les deux cités que les séparer. Le premier de nos patrimoines communs est là : c’est ce département perdu aussitôt que constitué, c’est une même participation à la première, puis la seconde révolution industrielle.
Pourquoi ce département Rhône-et-Loire n’a-t-il jamais été rétabli ?
Montbrison souhaitait garder sa qualité de chef lieu… Ce sont les divisions internes aux espaces agrégés au moment de la Révolution qui ont, aussi, contribué à créer la légende d’une opposition « naturelle » entre Lyon et Saint-Etienne. De là viennent bon nombre des stéréotypes qui ont consolidé une division artificielle entre les deux villes : la ville ouvrière, anarcho-syndicaliste contre la ville bourgeoise et cléricale… Il en va d’une certaine mise en ordre symbolique, qui n’advient pas sans raison. Mais l’histoire politique dit autre chose, et l’histoire économique le dit plus fort encore : les deux cités ont eu et ont toutes les raisons de s’allier, parce qu’elles sont complémentaires. La passementerie stéphanoise ne pouvait ignorer la technologie de la Fabrique lyonnaise. Et l’extraction du charbon de terre, sur une échelle qui en fait le premier bassin houiller de France au début du 19e siècle, a considérablement renforcé Saint-Etienne aux dépens de Montbrison, tout en créant un principe de solidarité évident avec Lyon. Le passage à l’ère industrielle des deux villes se réalise en effet grâce au charbon de la Vallée du Gier et de Firminy, qui sera bientôt acheminé jusqu’à Lyon par la première voie ferrée française. C’est littéralement un « Far West » que dessine alors l’épopée stéphanoise. La ville connaît un développement sans précédent, réoriente à 90 degrés sa composition urbanistique, puis se rend synchrone d’une révolution des mœurs avec le développement de l’industrie du cycle, qui exploite à la fois les savoir-faire manufacturiers mis en œuvre depuis près d’un siècle à la Manufacture Royale d’armes de Saint-Etienne et les acquis de la mécanique développés à Lyon lors du passage au tissage industriel.
Comment s’est manifestée concrètement cette connivence au 19ème siècle ?
L’invention du cinématographe en fournit un bon exemple. La condition du cinématographe, c’est à la fois un film perforé — la carte perforée, cela nous renvoie à Jacquard… — et le mouvement continu/discontinu, qui a pour propriété, par effet de permanence rétinienne, de produire l’illusion du mouvement, alors même que 16 images sont projetées par seconde. Louis Lumière va résoudre ce paradoxe du mouvement continu/discontinu grâce au principe mis en œuvre dans la machine à coudre, inventée par les Stéphanois Thimonnier et Ferrand. Autrement dit, différents savoir-faire capitalisés à l’époque dans la région vont se combiner : ceux de la chimie (les fils Lumière sont éduqués à La Martinière, cette école professionnelle où se forment les chimistes et les dessinateurs indispensables à la prospérité de la Fabrique) et ceux de la mécanique (pour être un bon tisserand, il faut être un bon mécanicien). À Saint-Etienne et à Lyon on passe, à la même époque, des savoir-faire manufacturiers aux savoir-faire industriels, grâce à la machine-outil. Les premières machines-outils sont d’abord importées d’Angleterre, puis copiées et fabriquées en même temps à Lyon et Saint-Etienne. La mécanique atteint son meilleur niveau : elle va ouvrir la voie à l’industrie automobile, à l’aviation, à l’industrie d’armement. L’optique est également en pointe : pour photographier et projeter, il faut des lentilles adéquates. Et l’électricité trouve de nombreuses applications après l’invention de la turbine hydraulique à Saint-Etienne, par Fourneyron. Toutes ces inventions ne « tombent » pas du ciel : elles « montent » du bassin lyonno-stéphanois ou stéphano-lyonnais, qui est alors le principal creuset de la révolution industrielle en France, avec Le Creusot et la région lilloise.
Cela sous-entend qu’il y avait déjà au début du 19e siècle beaucoup d’échanges entre Lyon et Saint-Etienne ?
Oui. La vallée du Gier assure la jonction entre ces deux pôles qui se complètent étroitement du point de vue technologique au 19e siècle. Il faut mettre en exergue, par ailleurs, des propriétés « négatives » communes aux deux villes : elles n’ont pas d’aristocratie, de sang, de robe ou d’épée et elles sont toutes les deux privées d’élite spéculative. L’université n’a que 30 ans à Saint-Etienne, et seulement 100 ans à Lyon ! Les deux villes, du même coup, ont vocation à valoriser et échanger non pas tant des savoirs que des « savoir-faire ». Leur histoire commune, c’est l’histoire longue de ces savoir-faire se reformatant sans cesse — puisque c’est le propre du génie technologique que de demander une constante amélioration, par adaptation, imitation ou invention.
Peut-on parler d’un certain art de « l’assemblage », à propos des deux cités ?
Oui, absolument. Ce sont des sociétés de bricoleurs. Les Jacquard, Lumière, Fourneyron, Weiss, Mimard, sont des bricoleurs de talent, voire de génie. Et cet esprit-là s’accorde avec le conglomérat urbain considéré, qui n’est ni du Nord, ni du Sud, ni de l’Est, ni de l’Ouest, mais un peu des quatre à la fois. La Gaule lyonnaise, ce n’est pas la Gaule belge, ce n’est pas la Gaule narbonnaise, ce n’est pas l’Italie et ce n’est évidemment pas l’Angleterre. C’est une espèce « d’entre », une articulation entre des aires géomorphologiques, géopolitiques et linguistiques très différentes. Les Romains avaient d’ailleurs bien compris que cet emplacement-là était stratégique : les routes de l’Empire partaient en rosace autour de la ville. C’est à partir de là que l’on pouvait conjoindre ou allier les contraires… Par ailleurs, sauf peut-être dans le domaine religieux, Lyon n’a jamais eu de statut véritable de ville-capitale. Au temps même de l’Empire romain, elle ne dominait pas, en dépit de son titre de Capitale des Trois Gaules. Elle était la ville où se rencontraient les délégués des trois provinces gauloises. Et c’est parce qu’elle n’a jamais eu d’autorité politique, militaire ou intellectuelle, parce qu’elle ne pouvait pas imposer sa marque, formater les territoires extrêmement diversifiés qui l’entourent, qu’elle a développé ce génie du bricolage, du « faire avec ». C’est une ville de marchands-fabricants, «fédéraliste », qui a été tenue, tout au long de son histoire, de « composer » avec ses voisins : elle polarise un espace, elle ne le domine pas, ne l’ordonne pas. Elle articule ce qui, ailleurs, à Marseille, Rennes ou Toulouse, peut se penser de manière plus homogène. Et elle doit inventer en permanence un mode de régulation qui corresponde à sa géographie — la ville-carrefour — et à son statut de ville-épicentre mais politiquement mineure.
Tout pousse aujourd’hui, dans la continuité de cette histoire, à l’invention d’un mode de gouvernance adapté à l’aire métropolitaine que les deux villes sont en train de constituer. Quels sont selon vous les enjeux de ce passage ?
Pour voir clair en la matière, il est important de comprendre que le mot de gouvernance, qui est aujourd’hui utilisé de manière incontrôlable, comme une sorte de prêt à penser institutionnel, vient du monde économique. Le terme de corporate governance ( gouvernement d’entreprise ) s’est diffusé dans la langue américaine au cours des années 1980/90 : il attestait de la modification des relations entre salariat, entrepreneuriat et actionnariat, autrement dit d’une triangulation nouvelle de la relation au pouvoir, effectuée aux dépens du salariat bien sûr, mais aussi de l’entrepreneuriat. Le terme a migré plus récemment dans le champ administratif et politique, en passant par l’univers des institutions économiques internationales, FMI et Banque Mondiale. C’est le PNUD ( Programme des Nations Unies pour le Développement ) qui lui a le premier donné un sens politique : la « bonne gouvernance » est celle qui est censée associer les peuples à la définition du « bien commun ». Au lieu de penser de manière binaire ( état/société, public/privé, droite/gauche.. ), il s’agit désormais de penser de manière triangulaire, voire multipolaire, de définir l’intérêt général avec les « partenaires » que sont les « forces vives » ou ces corps intermédiaires neufs, tels les O.N.G. Dans le projet de Constitution européenne, où le terme de gouvernance apparaît explicitement, il devient synonyme de démocratie participative : la démocratie représentative affichant ses faiblesses, il conviendrait d’inventer des formes nouvelles de débat, voire de délibération, associant les autorités publiques et ce que l’on appelle, en France, « la société civile ». Autour d’un objet, d’une question supposée commune, le « Rhône » par exemple, on crée une scène, dite de gouvernance, sur laquelle se présente qui « veut » : l’écologiste, l’ingénieur, le préfet, le riverain, le militant associatif. Le présupposé procédural est celui d’un « faire comme si » : faire comme si l’espace constitué l’était sur la base de relations de symétrie, de réciprocité, d’équivalence des « porte-voix ». On est proche de l’idéal du « contrat social » de Rousseau, mais aussi du type de relations qu’instaure l’espace marchand, dans lequel s’origine la procédure contractuelle. Entre villes, le modèle en la matière, c’est le système hanséatique, dans lequel des cités négocient et s’allient avec d’autres au profit d’une cause qu’elles se donnent provisoirement comme commune. A ce titre, la scène de la gouvernance relève d’un espace de régulation par négociation et « marchandage ». La gouvernance est, en fait, le symptôme d’une défaillance, ou d’une défection de l’espace politique qui, lui, relève d’un autre registre de la régulation. Le propre du politique, c’est d’ordonner un espace en mettant en composition ce qui est de l’ordre de l’universel et ce qui est de l’ordre du particulier. Le politique a toujours à voir avec cette problématique : comment assembler ce qui ne demande qu’à se dissocier ? Un espace politique, c’est un espace qui homogénéise de l’hétérogène, qui crée un principe centripète entre des forces centrifuges — l’homme libre/le serf, l’autochtone/l’étranger, le riche/le pauvre, l’homme/la femme, l’ancien/le jeune, le croyant/le mécréant, l’expert/le profane —, qui enjoint à ces entités de vivre ensemble, de « composer » ; qui agglomère ce qui tend à se distinguer : le bourg et le faubourg. Cela s’appelle la Cité. Ce travail de mise en composition des forces centrifuges, de mise à distance de la dissension, voire de la « guerre civile », toujours latentes, implique une mise en ordre qui ne relève pas de l’espace contractuel. Cette mise en ordre ne peut pas ne pas être hiérarchique et normative.
Nous sommes donc dans un moment historique où cet ordonnancement est remis en cause — ce qui pose de redoutables problèmes, spécialement en France où l’État est très hiérarchisé, très homogénéisant. L’idée de gouvernance met en effet en question le principe philosophique et juridique sur lequel se sont créés les États-Nations : sur une scène dite partenariale, de gouvernance, on ne peut pas faire jouer, en effet, le principe d’exclusivité des compétences, dans lequel s’actualise le principe étatique de souveraineté. Ce qui vaut pour les États vaut pour les villes : comment Lyon et Saint-Etienne, deux entités qui pouvaient se penser comme « souveraines », peuvent-elles associer leurs futurs en entrant dans un système méta-métropolitain ? Est-ce en mettant en place un système de gouvernance, c’est-à-dire de marchandage permanent (mais on risque alors de négocier pendant 30 ans le tracé d’une autoroute) ou en inventant un espace proprement politique, un système de « gouvernement métropolitain » qui reposerait sur une représentation élue (de quel type ?), disposerait d’un véritable exécutif (monocéphale/collégial, fixe/alterné ? ).
Dispose-t-on d’exemples, en France ou ailleurs, dont pourraient s’inspirer les deux villes pour inventer ce système de gouvernement métropolitain ?
Pas à ma connaissance. La région parisienne est un contre-exemple, avec des emboîtements de pouvoirs politiques qui ne parviennent pas à entrer en synergie sur une échelle pertinente. Ce sont la SNCF et la RATP qui configurent le territoire parisien, bien plus que la Mairie de Paris, les Conseils généraux ou la Région Ile-de-France. En envisageant de s’allier, Lyon et Saint-Etienne font figures de pionniers. Lyon, dit-on, a été moteur en matière de planification urbaine dans les 30 dernières années.
Pourquoi ne pas imaginer que s’instaure aujourd'hui une réflexion de type « constitutionnel » entre les deux villes ? Ce qui est sûr, c’est que ce moment de création d’un espace commun ne peut pas se détacher du moment symbolique : une « constitution » se rédige dans un moment particulier, un moment qui s’entoure d’un rituel. Au-delà de l’invention de formes administratives ou politiques nouvelles, les deux agglomérations ne pourront pas se soustraire à la contrainte de l’invention des formes symboliques adéquates à l’espace-temps nouveau qu’elles veulent inventer. Si elles ne se mettent pas en ordre de ce point de vue, le reste peinera à s’enclencher ou à suivre. Si les deux maires, les deux présidents ne se rencontrent pas, ne symbolisent pas leur alliance, on aura des additions de fonctionnalités (hospitalières ici, autoroutières là…), on n’aura pas une Cité, une Polis. Pour entrer dans le moment proprement politique, le moment où les corps s’allient — un corps métropolitain avec un autre corps métropolitain — il faut ritualiser. Cela peut passer par des célébrations communes. Rêvons un peu : les deux présidents se rencontrent à mi-parcours, à Givors, à la jonction Rhône-Gier. Ils se donnent l’accolade solennellement, sous l’œil des caméras. Là, on sort de l’ordre technico-administratif pour accéder à un ordre véritablement politique. En tout état de cause, la mise en « communauté » de ces deux agglomérations passe par le fait de rendre visible leur patrimoine commun et par la constitution d’un minimum de « biens communs ». Il s’agit de faire advenir de nouvelles causes communes, des « choses publiques », c’est-à-dire des objets désirables et partageables par un grand nombre de personnes. Ce peut être un objet technique — une autoroute, un canal —, un objet naturel — une réserve naturelle —, un objet culturel. Ces causes communes adviennent en fonction d’un possible, d’une histoire, ou parfois d’un trait de « génie », comme quand, à Lyon, s’inventent la formule du Défilé de la Biennale de la Danse puis celle de L’Art sur la place ou quand, à Saint-Etienne, s’invente la Biennale du design.