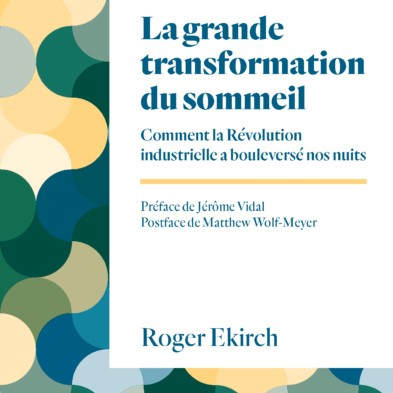La loi n’a plus le temps de fermenter
Du côté du législateur, l’urgence a également fait son oeuvre : un seul exemple, notre manière de légiférer, suffit à l’illustrer. D’où vient la loi ? De l’urgence ! Un fait divers, une loi – comme le dit Guy Carcassonne, « Tout sujet d’un 20 heures est virtuellement une loi ». Et en matière de sécurité, 10 ans, 30 lois. Comment est adoptée la loi ? Dans l’urgence… Schématiquement, un tiers des lois étaient votées selon la procédure d’urgence entre 1968 et 2007. Depuis lors, on est passé aux deux tiers. Aucune grande loi votée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy n’est passée par ce que l’abbé Sieyiès appelait la nécessaire « fermentation » de la loi. On légifère trop, trop vite et très mal. Cela aboutit à un paradoxe remarquable : la loi est plus rapidement adoptée, mais elle est plus lentement appliquée… D’abord parce qu’elle est plus souvent censurée par le Conseil constitutionnel. Ensuite – et surtout – parce que les décrets d’application ne parviennent pas à suivre le rythme et sont pris longtemps après l’adoption des textes législatifs.
Zara visité 17 fois par an…
Au-delà, l’urgence influence également notre vie privée et la manière dont nous consommons. Quelques exemples parmi d’autres : le rapport à la nourriture – le temps de préparation du dîner le week-end a diminué de 25 % depuis 1988. Le rapport à la mode : les clients d’une grande chaîne, comme Zara, visitent ses magasins 17 fois par an en moyenne, contre trois ou quatre pour ses concurrents, parce que le renouvellement de ses modèles est permanent. L’urgence a enfin investi nos vies professionnelles. Les processus de production ont été raccourcis, les informations s’échangent beaucoup plus vite — y compris lorsqu’elles sont inutiles — et, surtout, la pression qui pèse sur les employés se fait plus forte. Ainsi, lorsqu’on les interroge sur les délais qu’ils ont à respecter pour accomplir leur tâche, la progression du pourcentage de ceux qui répondent « une heure au maximum » est impressionnante : 5 % en 1984, 16 % en 1991, 23 % en 1998, 25 % en 2005… Quelles sont les causes de cette nouvelle dictature de l’urgence, dont l’existence est ainsi établie ? Elles sont triples. La première cause est instinctive : c’est la technique, qui s’incarne par la croissance exponentielle de la puissance d’Internet – parce que les utilisateurs se multiplient, parce que les accès aux réseaux sont de plus en plus nombreux (les tablettes et les smartphones sont en passe de détrôner les ordinateurs) et parce que la rapidité des échanges augmente sans cesse. La deuxième cause, c’est l’hégémonie du libéralisme depuis la fin des années 1980. C’est en effet le libéralisme qui a conduit des pans sans cesse plus importants de nos sociétés – et de la planète, c’est ce que l’on appelle la « mondialisation » – à se soumettre aux lois du marché. Or les lois du marché, ce sont celles du court terme, et donc de l’urgence. La troisième cause est morale : elle tient à la place que nos sociétés accordent à l’argent. L’ériger comme seule mesure de tout accomplissement entraîne inéluctablement une course à l’enrichissement – il faut devenir (très) riche, le plus vite possible.Aucune de ces explications, prise séparément, n’est la cause unique – ni même la cause structurante – de la dictature de l’urgence. Il ne faut pas additionner entre elles ces lectures technique, politique et morale, mais les multiplier chacune avec les autres. C’est ce qu’un grand sociologue allemand nommé Hartmut Rosa a appelé « la spirale de l’accélération ».
Quelles sont les conséquences de la dictature d l’urgence ? Certaines sont positives : à rebours de ce que nous avons connu du temps où l’empreinte des grandes religions et des grandes idéologies était plus forte, chacun veut vivre pleinement sa vie « ici et maintenant » et refuse de la sacrifier au profit d’un « salut éternel » ou de « lendemains qui chantent ». Mais d’autres conséquences de ce nouveau rapport au temps sont inquiétantes. L’urgence place nos sociétés sous tension et, dans le même temps, délégitime le
politique.
Un modèle français déstabilisé
Elle place particulièrement la société française sous tension – de nombreux indicateurs le démontrent : nous avons l’un des taux de suicide les plus élevés d’Europe de l’Ouest, nous sommes les plus pessimistes d’Europe et les plus gros consommateurs de psychotropes au monde – bien sûr l’urgence n’est pas à elle seule responsable de tous ces maux, mais elle a indiscutablement contribué à la déstabilisation des individus. Alors, pourquoi cette spécificité française ? Parce que les trois piliers de notre modèle républicain ont pris l’urgence de plein fouet. Notre universalisme est ébranlé : l’oeil rivé sur le présent, nous ne pouvons plus prétendre servir de « phare » au reste du monde… Notre égalitarisme est lézardé : notre modèle social se recroqueville sous l’effet de la mondialisation, et la cohésion de notre société en est fragilisée. Notre étatisme est bousculé : non seulement les pouvoirs publics gèrent mal l’urgence, mais leurs moyens d’actions traditionnels ne sont pas efficaces face à elle. Voilà pourquoi la France vit particulièrement mal la dictature de l’urgence. L’urgence délégitime enfin le politique. Elle le frappe d’inadaptation, puisque les processus démocratiques – et particulièrement les élections – ralentissent son rythme. Elle renforce son procès en inefficacité : combien de problèmes urgents et traités dans l’urgence deviennent récurrents ? On pense bien sûr aux sans-abris. L’urgence renforce l’inéquité de notre société : ce sont ceux qui détiennent le pouvoir sur le temps qui détiennent le pouvoir tout court – et ce ne sont jamais les plus démunis. Enfin, l’urgence renforce l’illisibilité de l’action publique : en gouvernant dans l’urgence, on prend en effet le risque de gouverner sans le futur – c’est-à-dire de ne pas prendre assez en considération les effets de long terme de nos choix –, quand ce n’est pas de gouverner contre le futur. Réchauffement climatique, atteinte à la biodiversité, pénurie énergétique, risque d’asphyxie urbaine, épidémie d’obésité : autant de sujets majeurs qui souffrent de n’être traités que dans l’urgence – quand ils sont traités…
Va-t-on redonner du temps au temps ?
Pourtant, la dictature de l’urgence peut être renversée. Il faut pour cela parvenir à « redonner du temps au temps », selon la belle formule de François Mitterrand. Très concrètement, cela implique pour chacun de savoir se ménager des espaces de décélération. Surtout, cela implique pour tous de renouer avec une gestion publique inscrite dans le temps long. Pour cela, l’exemple doit venir de haut – et même de tout en haut : nos dirigeants politiques doivent laisser à l’expérimentation, à la concertation, à l’évaluation le temps qui leur est nécessaire pour s’assurer que les décisions qui sont prises sont les bonnes. Avec la campagne présidentielle, nous n’avons pas seulement assisté au combat entre la gauche et la droite, ou entre le socialisme et le libéralisme – nous avons également été les spectateurs d’un affrontement entre deux rapports au temps. Celui du président sortant était connu – c’était même devenu sa marque de fabrique. Il considérait qu’il fallait répondre à l’accélération par l’accélération au carré et que, pour cela, tous les moyens étaient bons : procédure d’urgence pour les lois, décisions prises sans concertation, dispositions mises en œuvre sans évaluation, etc. Le nouveau président de la République a au contraire affiché sa volonté d’inscrire son action dans la durée, et parfois même dans la longue durée. Pour la première fois, ce sont donc le temps lent et le temps long qui l’ont emporté – et si c’était le début de la fin de la dictature de l’urgence ?