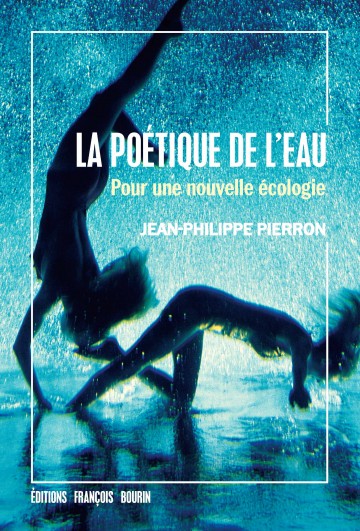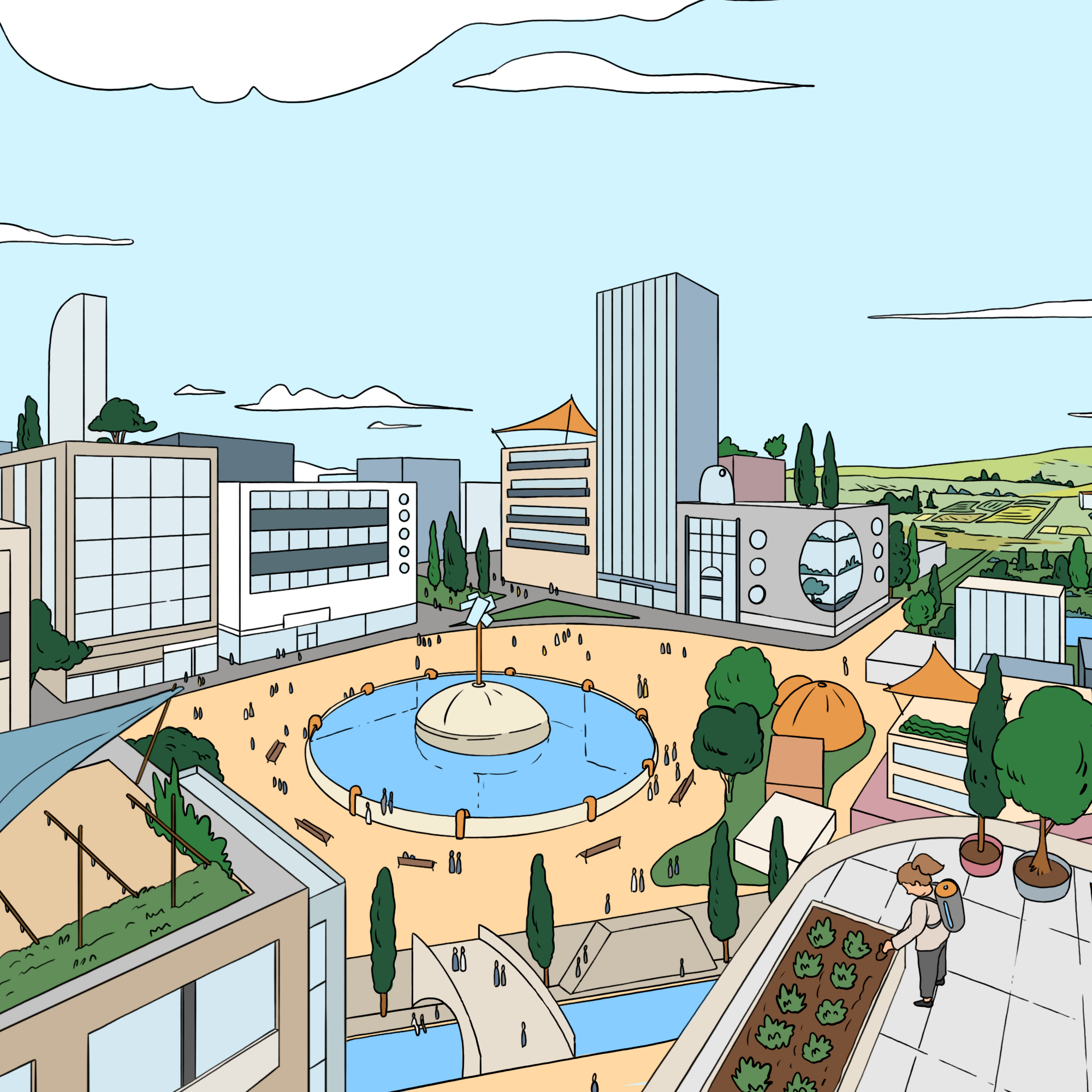Depuis une trentaine d'années, l’émergence de l’écologie comme terrain politique s’accompagne d’une remise en cause de l’infrastructure symbolique de notre modernité occidentale, jugée responsable de l’entrée dans l’Anthropocène. Sous l’influence de la nouvelle anthropologie, le naturalisme (Philippe Descola), ou « grand partage » (Bruno Latour), entendus comme la séparation ontologique entre l’humanité et la nature, sont battus en brèche. Pour son compte, la philosophie questionne la position cartésienne de l’homme comme « maître et possesseur de la nature », notamment à travers une réhabilitation de la voie spinoziste.
Le terme même de « nature » fait aujourd’hui débat. Accusé de sous-tendre le naturalisme, il est défendu comme central dans la pensée écologique par Catherine et Raphaël Larrère, délaissé par B. Latour ou Isabelle Stengers pour le terme de « Gaïa », à son tour perçu comme trop surplombant par Baptiste Morizot qui lui préfère celui de « vivant », plus apte à porter la position qu’il défend.
Cette réinscription de l’humanité dans son milieu change son rapport à l’eau. Élément qui singularise la planète Terre par son omniprésence, l’eau représente aussi les ⅔ de nos corps, alors que l’apport hydrique est notre premier besoin nutritionnel. L’eau est ainsi notre première dépendance, mais aussi la majeure partie de notre organisme. En cela, elle se pose comme l’agent de notre rapport au monde. « Si pour un esprit positif, le plus petit élément qui compose l’eau est l’atome, pour une pensée écologique de l’eau, le plus petit élément est la relation et ça change tout », invite à penser Jean-Philippe Pierron dans La Poétique de l'eau, Pour une nouvelle écologie.
Au fil des âges, la question de la symbolique de l’eau
De cette remise en débat de l’un des piliers imaginaires de notre modernité qu’est la place de l’homme dans son milieu, dérive naturellement la ré-interrogation de ses coordonnées politiques, économiques ou encore sociales. Sans son statut de « maître et possesseur », l’humain redevient un habitant de la planète parmi d’autres, et doit alors justifier ses actes vis-à-vis de ceux/ce qui n’est plus au rang de simple « ressource ». Quel statut donner au non-humain ? Quelle communauté établir avec nos riverains planétaires ? Au premier rang de ces interrogations, le statut de l’eau. Jean-Philippe Pierron distingue trois âges, ou plutôt trois imaginaires de l’eau dans les sociétés humaines.
Théologisée depuis l’antiquité, l’eau porte la possibilité d’être, et la possibilité de la transformation suivant l’ordre naturel des choses. Elle est soutenue par une éthique de la causalité nécessaire. L’eau est alors associée à des divinités ou génies des sources. Ce rapport enchanté à l’eau est largement répandu, de la Lorelei du Rhin à la Mâchecroute lyonnaise, ou encore à Fâro, déesse du fleuve Niger. L’eau est alors origine (le baptême chrétien) et parée de vertus régénératrices, purificatrices à travers la pratique de l’ablution (Wuḍū en islam, bain Mikvé dans le judaïsme, eaux sacrées du Gange dans l'hindouisme). Dans cette perspective, l’eau est une force mystérieuse et indomptable, puisque sa nature l’empêche de pouvoir être stabilisée dans une forme. Les techniques qui lui sont associées sont alors limitées à sa captation (puits) et à son acheminement (aqueducs ou qanat).
Avec la modernité, l’eau devient une équation à résoudre. Elle « n’est plus sainte, mais saine » explique Jean-Philippe Pierron. Réduite à l’acronyme H2O par Lavoisier, l’eau est détachée du territoire pour devenir une matière définie par sa composition chimique et ses propriétés physiques. La culture de l’eau devient une question analytique et technique, dont la maîtrise et la domination deviennent les objectifs. Plus qu’une ressource respectée comme ayant une forme d’existence, l’eau maîtrisée devient objet de préservation. Le milieu devient environnement, il n’est plus à habiter mais à réguler. L’eau sort de la culture pour devenir un élément de nature.
Sur le plan technique, l’infrastructure de gestion de l’eau se développe, des canaux aux canalisations, des barrages à l’imperméabilisation des sols. Si la Rome antique avait depuis Tarquin l’Ancien son cloaca maxima, ou que les ruines de Mohenjo-daro (IIIe millénaire av. J.-C) font apparaître un réseau d’égouts, leur généralisation, ainsi que le développement des systèmes d’approvisionnement, datent du 19e siècle, notamment grâce au système développé à Paris par Eugène Belgrand. L’eau, sous pression, élevée dans des réservoirs, stockée, ne coule plus, elle est acheminée.
Ce désenchantement de l’eau a conduit à sa surexploitation. L’âge écologique, celui de l’Anthropocène, impose une renégociation de nos égards, de nos rapports à notre milieu. L’eau nous invite à réinventer nos manières d’« habiter » notre environnement, de nous inscrire dans le tissu de relations qu’elles forment, plutôt que d’« aménager » nos territoires, c’est-à-dire de les anthropiser. C’est ce que Jean-Philippe Pierron nomme une « eau-territoire ».
Le philosophe plaide ainsi pour un réenchantement de notre rapport au monde, une reconquête du sensible dans « sa dimension d’ouverture relationnelle et d’élargissement de la compréhension de soi », contre ce que B. Morizot nomme « crise de la sensibilité ». Un plaidoyer hommage à l'œuvre de Gaston Bachelard, qui fait de l’eau l'élément structurel de nos imaginaires et de nos représentations. Ce support matériel de l’imagination que convoque Bachelard est ici mobilisé comme manière de nous réinscrire au monde, de replonger l’humain dans son milieu.
« Il consistera à prouver que les voix de l’eau sont à peine métaphoriques, que le langage des eaux est une réalité poétique directe, que les ruisseaux et les fleuves sonorisent avec une étrange fidélité les paysages muets, que les eaux bruissantes apprennent aux oiseaux et aux hommes à chanter, à parler à redire, et qu’il y a en somme continuité entre la parole de l’eau et la parole humaine. »
Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves
Vers un nouveau rapport au non-humain
L’eau est omniprésente dans les mythes et les arts. Miroir pour Narcisse, l’eau est support de la création chez Monet, des Nymphéas au brouillard de Londres qu’il partage avec Turner. Un « appareil à regarder le temps » chez Claudel ou à absorber les choses chez Poe, une « flamme mouillée » chez Novalis et le « désir même du langage » chez Swinburne. L’eau, par son mouvement perpétuel, irrigue nos imaginaires, et de ce constat découle la proposition de Pierron d’une eau-territoire, c’est-à-dire réinscrite dans un cadre de vie, puisqu’elle porte en elle de multiples réaménagements possibles de nos structures culturelles, législatives, territoriales ou encore administratives.
De Bashô à Miyazaki au Japon, ou de Thoreau à Mary Oliver aux États-Unis, cette sensibilité au vivant, ou au sauvage n’est, en poésie, ni contemporaine ni strictement occidentale. Néanmoins, l’essor depuis les années 1990 du mouvement écocritique réactualise cette pensée suivant un axe politique, mais aussi littéraire, qui vise à dire l’altérité de la nature sans la civiliser ou la cultiver, mais en plaidant pour des décentrements. Vis-à-vis de la figure de l’artiste, destitué par le collectif Wu Ming. Vis-à-vis du statut d’ « objet », conféré à la nature comme seul cadre de l’expérience humaine en dépit de l’agentivité des sujets non humains. Vis-à-vis encore de nos sensibilités à l’espace comme le plaide Tom Ingold. Vis-à-vis enfin du caractère politique de la sensibilité, qui met en tension l’idée du vivre-ensemble avec celle du « faire-ensemble », ou d’un faire par le vivre.
À cet égard, les noues, très utilisées dans les approches urbanistiques « Haute Qualité Environnementale » (HQE) sont par exemple porteuses d’un nouveau rapport urbain à l’eau. Chantées par Marielle Macé dans « Nos Cabanes », ces fossés peu profonds recueillant les eaux de ruissellement racontent un rapport à l’eau et à son cycle que le 20 e siècle ne considérait pas, au point que la cartographie manque de code pour les identifier. Elles marquent notre patrimoine bâti d’une réintroduction de tiers-paysages. Sans usage pour l'homme, ces derniers sont pourtant centraux dans la renégociation en cours de la place de « l’habiter », que cela soit vis-à-vis de l’eau, ou vis-à-vis d’une faune urbaine en pleine évolution. Les noues sont le signe d’une alliance relationnelle contre la ville imperméable, elles marquent un urbanisme plus sensible au non-humain, et moins prompt à l’anthropisation. Un urbanisme qui ménage avant d’aménager.
C’est donc à un repositionnement du poète au cœur et comme chœur du monde sensible qu'appellent Jean-Claude Pinson, Pierre Vinclair, Albane Gellé, Fabienne Raphoz, ou encore Alain Damasio dans un autre style. Traquer les « signifiances », soit le mode émergent, celui du pas encore, celui du à-venir, avec Jean-Christophe Bailly, comme pour faire naître une véritable écologie de l’attention. Une manière d’« habiter poétiquement le monde », renouant avec la tradition romantique hölderlinienne. Une position qui « élargit » notre rapport aux mondes et crée ce « Nous » ouvert au non-humain. La conséquence de cette position renégociée est aussi à chercher du côté des nouvelles formes de poésie orales, du côté des moments qu’elle offre, tels que les nombreuses scènes ouvertes qui animent villes et campagnes. Il s’agit alors de considérer la relation à autrui comme le lieu privilégié de la créativité. Si la poésie est l’art d’une relation entre un émetteur et un récepteur actif, c’est à une interrogation politique que l’écopoétique invite, se faisant par-là mode de résistance.
Parce qu’il suffit d’une goutte…
C’est aussi à une révolution intime que nous invitent aujourd’hui artistes et poètes, contre cette « crise de la sensibilité » qui nous prive de la vue du vivant. Non pas d’un point de vue perceptif, mais d’un point de vue mental. Si « voir est toujours un acte de sélection », selon Estelle Zhong-Mengual, l’art et la poésie peuvent nous apprendre à voir, c’est-à-dire nous aider à former à l’égard du non-humain une attention dont nous sommes aujourd’hui dépourvus. Le concept d’ « invite » formulé par le psychologue James J. Gibson permet de mesurer la portée possible de ces changements.
Accompagnant la perception physique d’un objet, l’invite en est la représentation symbolique directe, elle pousse à agir différemment vis-à-vis de l’objet perçu. Elle en révèle, pour celui qui observe, les opportunités d’action. Ainsi, le fleuve ré-interrogé au prisme d’une écopoétique devient, au-delà d’un lieu de passage ou d’une ressource, un milieu de vie, espace d’interdépendances et de responsabilités à l’égard de ses riverains. Comme une invitation à réinterroger nos usages du monde, et à voir, pourquoi pas, dans la situation géographique de la Métropole, là où les eaux se mêlent, le lieu d’une nouvelle alliance, avec nos voisins fluviaux, et l’ensemble du non-humain.
« Une goutte d’eau puissante suffit pour créer un monde et pour dissoudre la nuit. Pour rêver la puissance, il n’est besoin que d’une goutte imaginée en profondeur. L’eau ainsi dynamisée est un germe ; elle donne à la vie un essor inépuisable ».
Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves