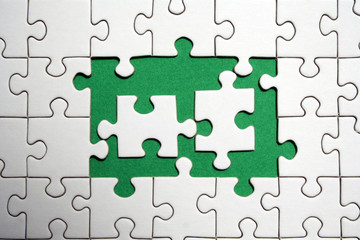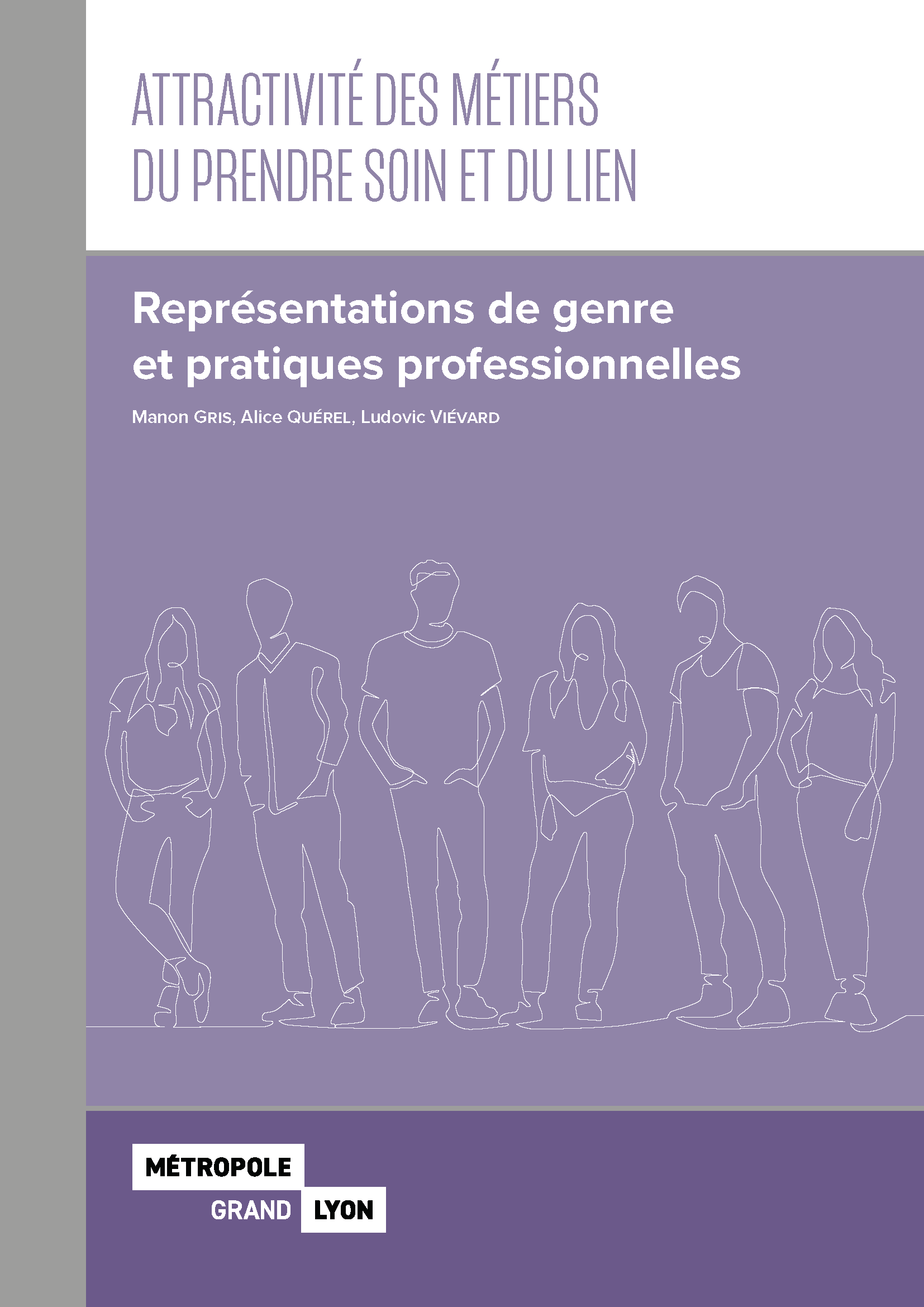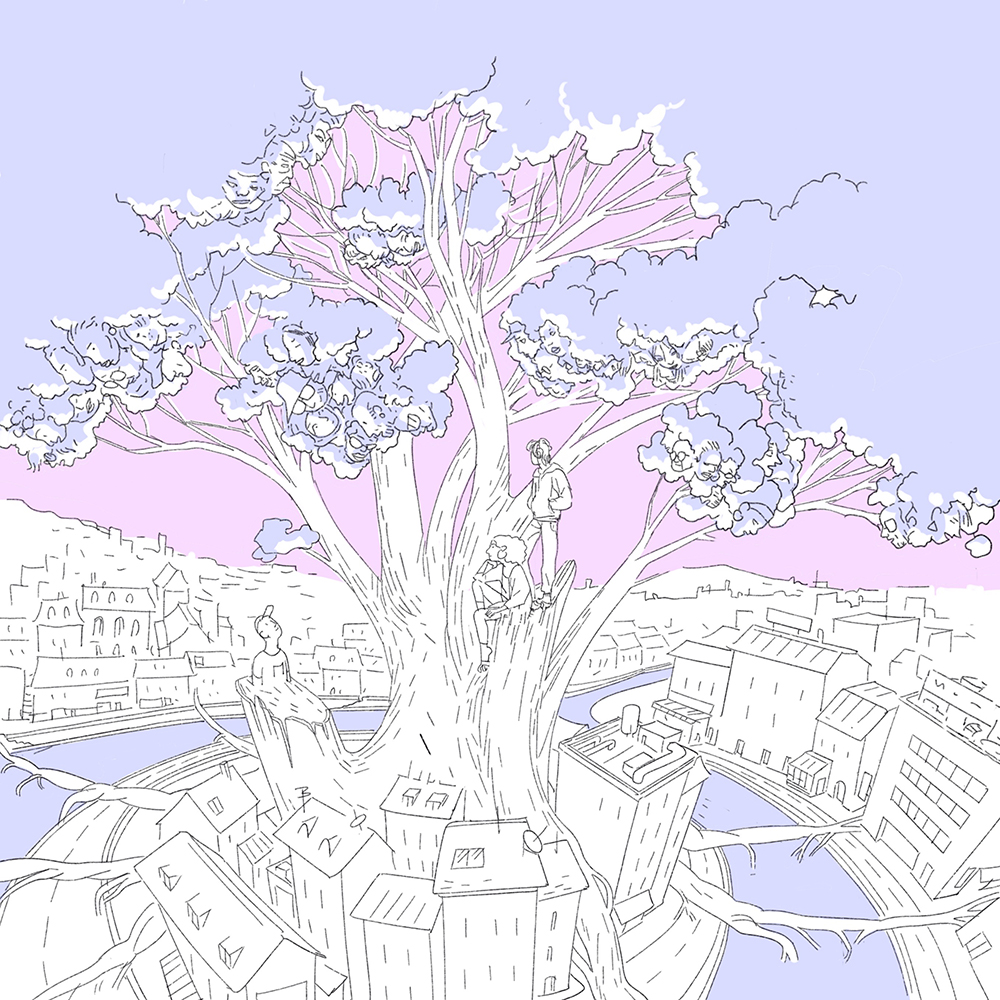La question sociale entre intégration, exclusion et insertion
Le terme intégration est central dès la naissance de la sociologie française à la fin du XIXe siècle avec Durkheim avec la définition minimale suivante : processus par lequel un individu prend place dans la société. Ce terme, dont le sens va glisser dans les années 1980 vers des questions ethniques (l’intégration des populations d’origine immigrées), va être fortement réinterrogé dans les années 1960 et 1970, pour amener les nouveaux concepts d’exclusion puis d’insertion.
Les travaux de Michel Foucault, par exemple, s’intéressent à la manière dont les sociétés traitent leurs marges sociales en favorisant des processus d’enfermement des populations déviantes qui produiraient de l’exclusion. Pour Foucault, que ce soit du côté de la prise en charge de la folie ou de la naissance de la prison, les sociétés produisent de l’exclusion en traitant ces marges sociales et en souhaitant enfermer les déviants. L’exclusion est alors pensée comme processus de mise à l’écart de la société. C’est René Lenoir qui, en 1974, ouvre vraiment le débat médiatique avec son ouvrage « Les exclus ». La notion d’inadaptés sociaux est alors en vogue et il les évalue à un « français sur dix » sous-titre de l’ouvrage. En remplacement de la notion d’inadaptés sociaux, la notion d’exclusion va faire florès jusqu’à la grande loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
Pourtant, dès le début des années 1980, Marcel Gauchet et Gladys Swain reproblématiseront l’approche de Michel Foucault sur la folie en insistant sur la mise à l’écart temporaire des individus comme condition future de leur insertion dans la société. Si les fous sont mis à l’écart de la société, le travail de l’insertion et du soin va leur permettre de réintégrer cette société, en leur conférant en particulier une identité sociale. Le débat théorique insertion/exclusion était lancé.Mais avant l’émergence du terme exclusion dans l’espace médiatique et politique, des transformations s’étaient déjà opérées. Jusqu’aux années 1970, la notion d’intégration rendait compte de la place des individus dans la société à partir de leur entrée dans celle-ci par le travail. À partir de la fin des années 1970, c’est la notion d’insertion qui émerge et rend compte d’une plus grande labilité et difficulté du parcours d’intégration traditionnel pour les publics qui vivent la montée du chômage. Le discours de l’insertion se déploie, au départ, pour une catégorie spécifique de publics : les jeunes. Le rapport Schwartz pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (16-25 ans) paru en 1981 en reste un exemple marquant. Puis, peu à peu, le terme va viser aussi les publics adultes au chômage : ce sera la mise en place à partir de 1989 du Revenu Minimum d’Insertion, auquel d’ailleurs, à l’époque, les jeunes de moins de 25 ans n’ont pas droit. Ces politiques d’insertion, naissantes dans les années 1980, se voulaient provisoires à leur origine, mais ce provisoire va perdurer et devenir un état permanent, permettant, par là-même, de continuer à alimenter le discours de l’exclusion.
Au début des années 1990, avec en particulier, les travaux d’Alain Touraine, la question de l’exclusion est reformulée : il s’agit de savoir si les personnes sont dans la société ou en dehors de celle-ci. Pour Alain Touraine, la question n’est plus de savoir si les individus sont en haut ou en bas de la société dans une logique de classes sociales mais bien de savoir s’ils sont au centre ou à la périphérie de la société, c’est ce qu’il appelle le passage de sociétés verticales à des sociétés horizontales. Pour lui, la coupure entre le dedans et le dehors devient de plus en plus forte, tant elle produit des phénomènes de ségrégation.
Robert Castel pour sa part distinguait l’insertion de l’intégration en se demandant ce que serait une insertion sociale qui ne déboucherait pas sur une insertion professionnelle et donc sur l’intégration définie ici comme place donnée par le travail à un individu dans la société. Robert Castel pense les situations sociales sous une forme de continuum. Dans ce continuum, le risque est que les personnes sans travail ne soient l’objet que de tentatives d’insertion sociale sans que celle-ci ne débouche sur une insertion professionnelle, qui, pour cet auteur, est synonyme d’intégration. D’une certaine façon, toutes les politiques d’insertion se sont construites sur un amont d’insertion sociale préalable à l’intégration ou à l’insertion professionnelle, avec le risque de produire des insérés permanents (toujours en insertion sociale) qui ne pourraient s’intégrer (i.e accéder à l’insertion professionnelle)…
Une méfiance théorique vis-à-vis de l’exclusion
Très vite, Robert Castel se méfiera du mot exclusion et préférera parler de désaffiliation. En 1995, il distingue trois zones de cohésion sociale : la zone d’intégration correspond à une association travail stable / insertion relationnelle solide, la désaffiliation qu’il préfère au terme d’exclusion désigne une absence de participation à une activité productive et à un isolement relationnel, et enfin, il évoque une troisième zone : la zone de vulnérabilité qui conjugue la précarité du travail et la fragilité des supports de proximité.
Sur le plan politique et médiatique pourtant, le terme d’exclusion continue à faire florès avec la loi de 1998 de lutte contre les exclusions. Celle-ci est élaborée en parallèle de la montée d’un discours relatif à la lutte contre les discriminations, en particulier, sous le poids de la Commission Européenne. L’époque est alors au « lutter contre ». Elle va peu à peu passer au « lutter pour ».C’est qu’au début des années 2000, nous allons assister à une re-sémantisation du sujet. Petit à petit, les mots vont changer, il s’agira de lutter pour l’insertion ou l’inclusion ou pour le droit à la non-discrimination. Dans le champ de la lutte contre les discriminations, Marie-Christine Cerrato-Debenedetti montre très bien comment, à partir des années 2000, la promotion du droit devient la ressource politique pour traiter d’un sujet qui peine à être pris en charge par les politiques publiques… Il s’agira alors de lutter plus pour des droits que contre des discriminations. On retrouvera un phénomène similaire dans le champ éducatif avec le passage de la lutte contre l’échec à la lutte pour la réussite ou dans les questions de décrochage scolaire avec la lutte contre le décrochage ou la lutte pour la persévérance scolaire.
La montée du discours de la cohésion sociale et des politiques d’activation
La question de la performativité devient centrale : dire l’exclusion pourrait la faire; dire la cohésion éviterait l’exclusion. Par exemple, tout le discours émergeant dans les années 2000 autour du vivre ensemble renvoie à la crainte centrale des sociétés modernes : la peur de leur dislocation, de la montée des logiques de sécession et de séparatisme social, de la montée constante des inégalités, et finalement de la mise en crise du concept même de société. Jacques Donzelot insistera par exemple sur la nécessité de « faire société » dans un contexte où celle-ci se déferait.
C’est dans ce passage du « lutter contre » au « lutter pour » que le discours de la cohésion sociale va alors se diffuser sous différentes formes. L’expression va rapidement se développer tant au niveau national qu’européen. La Commission Européenne lors du sommet de Lisbonne en 2000, sommet qui vise bien à renforcer la compétitivité européenne, en fera un de ses mots d’ordre.
À l’articulation classique de l’économique et du social se substitue celle de la cohésion sociale et de la compétitivité.
François Dubet développera ce point et estimera en 2009, dans la suite de la crise financière de 2008, que le concept d’intégration correspondait à la société et que la cohésion sociale correspond aux nouvelles formes de la vie sociale et donc à une crise du concept de société. Pour lui, dans l’ancien modèle de la société, l’intégration reposait sur des institutions solides, garantes de stabilité. Avec la cohésion sociale, cette stabilité s’effrite et fait place à une plus grande effervescence qui oblige une plus grande activation des individus, et potentiellement le renforcement des phénomènes de concurrence entre individus. En d’autres termes, la cohésion oblige à déplacer le poids de la construction d’une place aux individus dans la société à ces mêmes individus, alors qu’auparavant, c’est la société qui leur faisait place. La montée croissante de la « société des individus » met en crise le concept de société. Les politiques d’activation et la dynamique de l’égalité des chances se déploient alors. Le discours de l’injonction à l’autonomie des personnes en difficulté devient central dans de nombreuses politiques publiques et il accompagne le passage des politiques d’insertion à des politiques d’activation que la mise en place du revenu de solidarité active, expérimenté à partir de 2007, exemplifie pleinement. Tout se passe comme si les pouvoirs publics cherchaient à penser la place des individus dans la société non plus sous le seul angle de leur travail mais bien aussi sous l’angle de leur capacité à participer et à s’investir et à investir ce qui leur est proposé. Les politiques d’activation sont triples : elles visent une meilleure activation des dépenses publiques, elles visent une meilleur activation des dispositifs proposés aux publics (avec l’attention aux non-recours aux droits par exemple) et enfin elles visent une plus grande activation des bénéficiaires.
L’arrivée de l’inclusion
Dans la suite du discours de la cohésion sociale, le discours de l’inclusion devient, peu à peu, central dans l’espace médiatique et politique. En France, la loi de 2005 pour les personnes handicapées oblige à revisiter à nouveaux frais, entre autres, la question de la scolarisation des enfants concernés, dans la suite des recommandations européennes qui dès les années 1990 invitaient à lutter contre les discriminations liées au handicap. Même si le terme d’inclusion, n’est pas dans la loi de 2005, il ne le sera qu’en 2013 avec la loi sur la refondation de l’école, la notion d’école inclusive se développe visant des publics handicapés au départ, tous les publics aujourd’hui, en particulier, sous le poids de la prise en compte des décrocheurs scolaires. C’est à partir de 2010 dans les stratégies européennes que la notion d’inclusion se développe. La stratégie Europe 2020 vise en effet une « croissance intelligente, durable et inclusive » La Commission Européenne la définit ainsi : « l‘inclusion sociale consiste à permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés,de participer pleinement à la société, et notamment d’exercer un emploi ». Charles Gardou la définit comme un «chez soi pour tous » avec l’idée que mettre les individus dans la société ne suffit plus mais qu’il faut penser pour tous le droit de jouir de l’ensemble des biens sociaux qui ne sont la prérogative de personne. Le discours de l’intégration s’est estompé et s’est mis à viser les populations d’origine immigrée.
Le débat insertion/exclusion a évolué, l’inclusion et le terme inclusif se généralisent. Ils marquent un refus principal : celui de la mise à l’écart. Si l’intégration visait à faire rentrer des individus dans la société, l’inclusion vise à penser l’accueil des individus dans un ensemble commun. Il ne faudrait pourtant pas que, derrière les transformations des termes que nous venons de rappeler, la question des inégalités se trouve comme effacée ou gommée tant elle ne cesse d’alimenter les débats théoriques ou médiatiques. Fondamentalement, que ce soit au plan urbain ou social, ce dont il s’agit à travers le terme d’inclusion, c’est bien de penser les conditions d’accessibilité à la ville, à la société, à l’école. Mais ces conditions d’accès invitent à une inversion de la charge de la preuve : ce n’est plus aux individus à déployer toutes leurs ressources pour accéder mais bien plutôt à la ville, à la société, à l’école de créer les conditions permettant cette accessibilité généralisée.