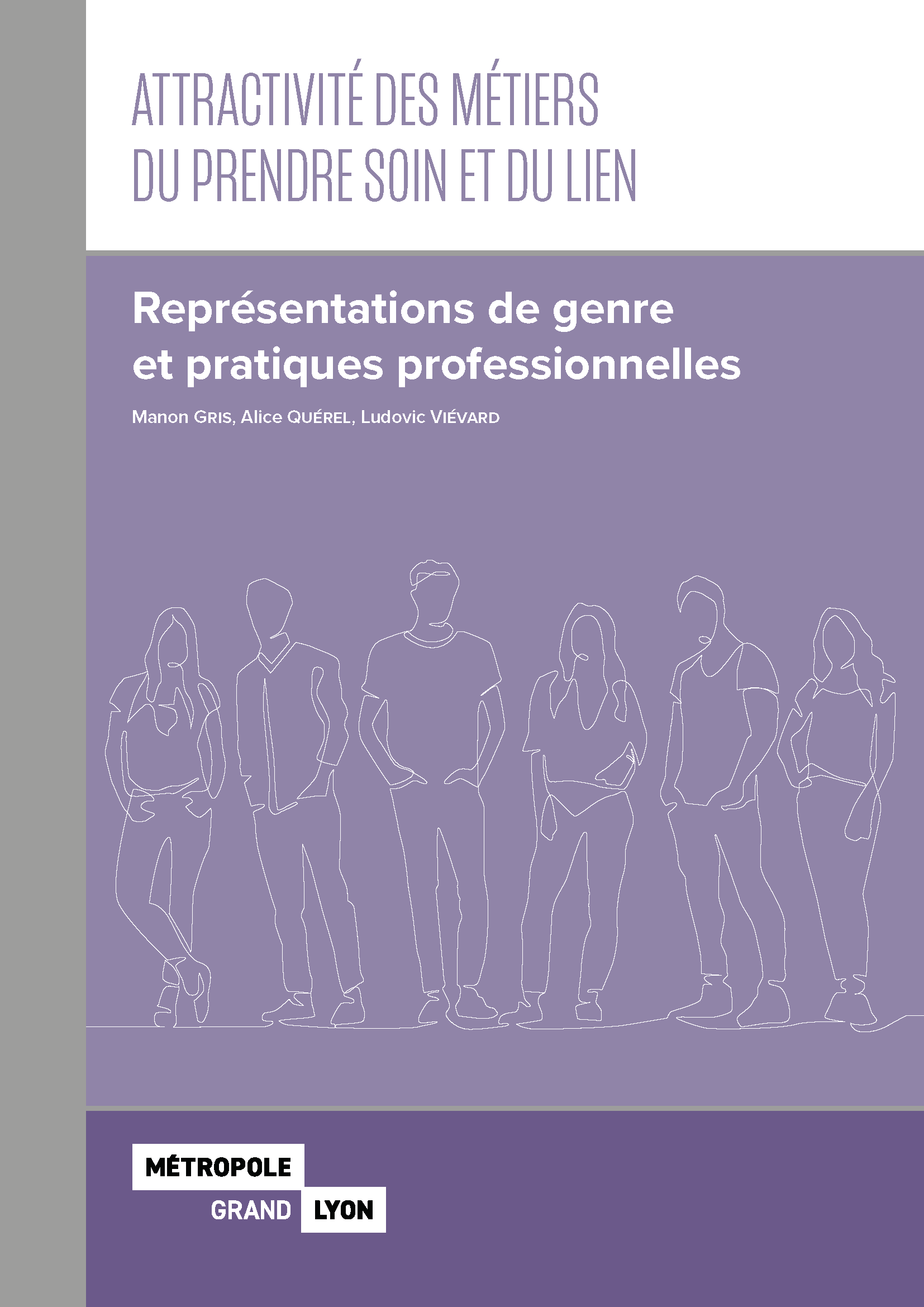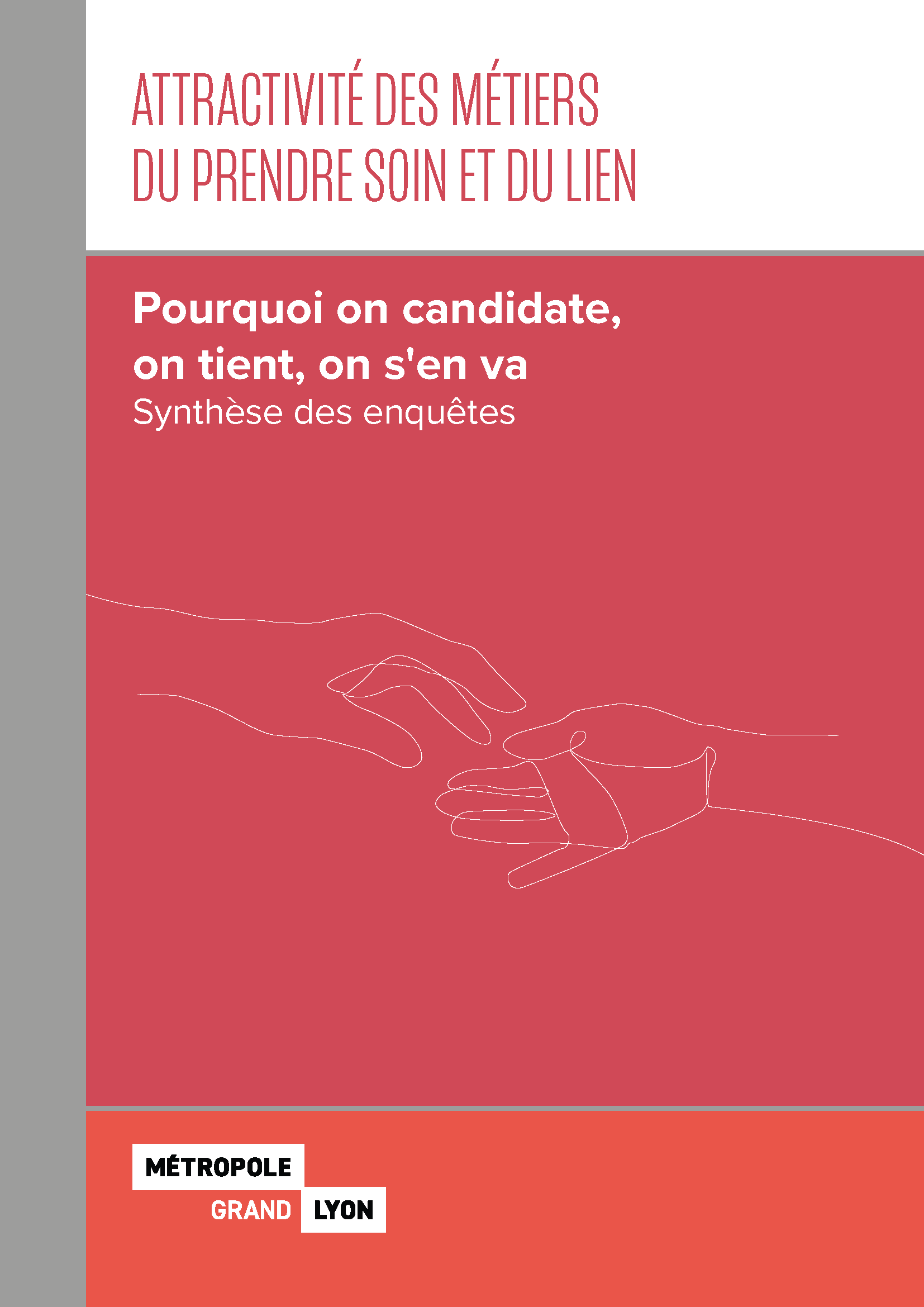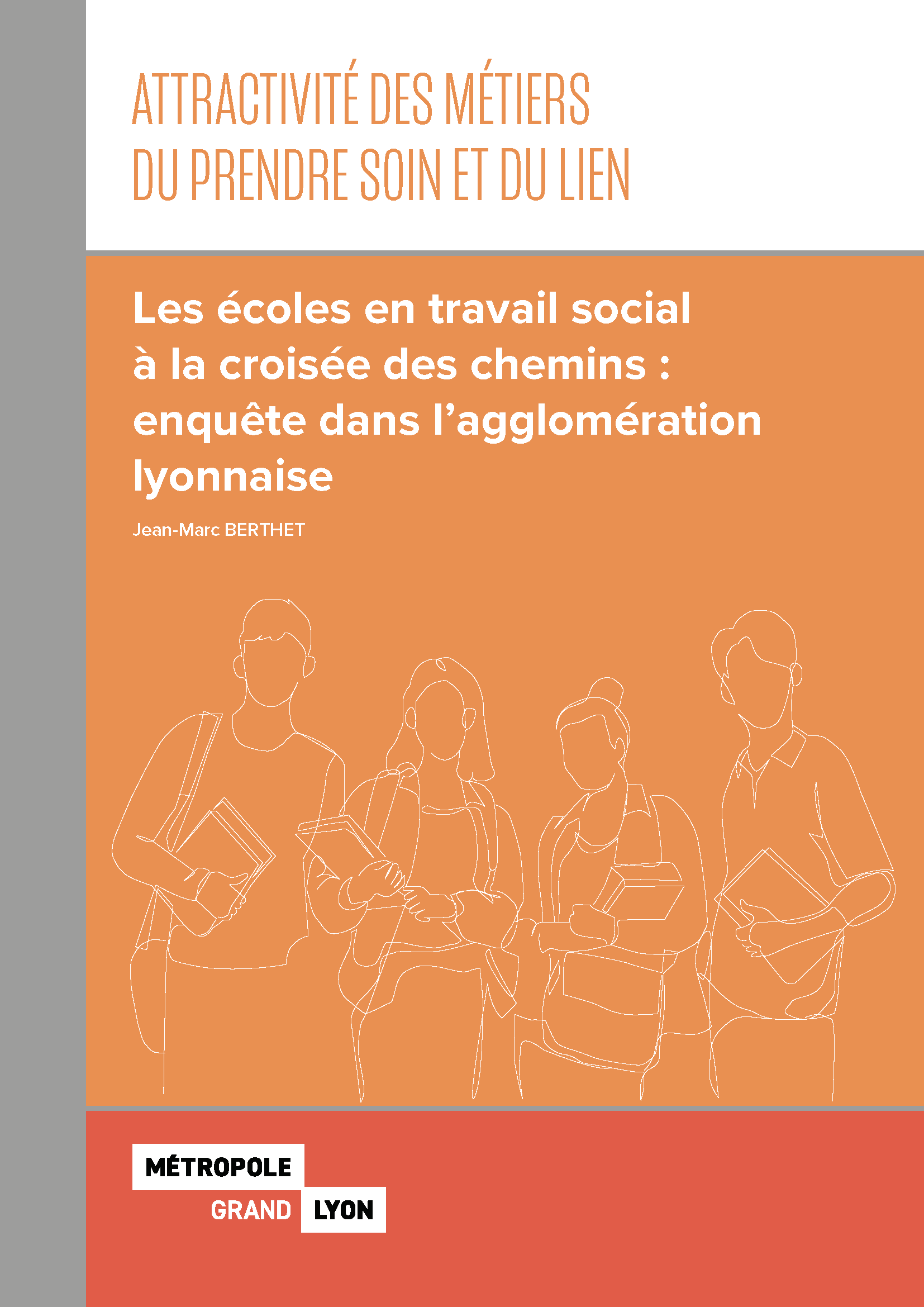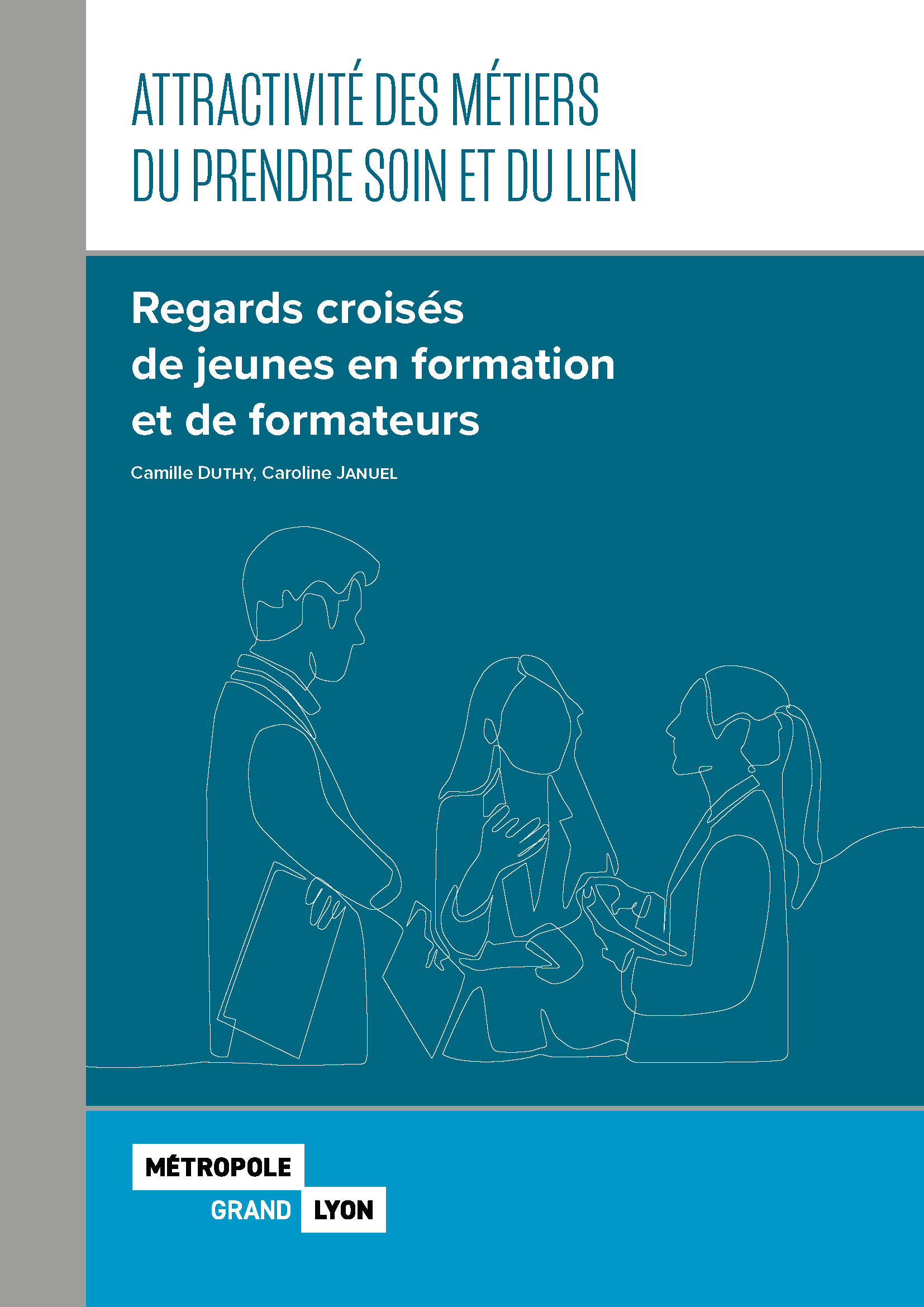Qu’est-ce qui, dans votre parcours de vie et de recherche, vous amène aujourd’hui à proposer le modèle d’une société inclusive et à prendre l’initiative d’un appel national ?
Mon itinéraire m’a confronté, il est vrai, à la diversité dans différents lieux du monde. J’ai notamment vécu aux Îles Marquises, où la culture maori, ses conceptions de la communauté et de la vie humaine m’ont interrogé. Dans cet archipel du Pacifique central, le plus distant au monde de toute région continentale, j’ai souvent songé à ce qu’affirmait, en son temps, Marcel Mauss : il existe, affirmait-il, non des peuples moins ou non civilisés, mais uniquement des peuples de civilisations différentes. On peut dire, de la même manière, qu’il n’y a pas plusieurs humanités, mais seulement des visages, des silhouettes, des situations singulières au sein d’une même humanité. Dans leur diversité niche l’universel ; dans l’infini bariolage des situations de vie se révèle l’unité. Tel est le fondement même de mon livre sur la société inclusive. J’y aborde, entre autres, la question de la hiérarchisation des vies, qui conduit à considérer différemment les injustices, les discriminations et les maltraitances ; à dénoncer les unes et à ignorer ou passer les autres sous silence, selon leurs victimes.
Vous évoquez l’appel national dont je viens de prendre l’initiative. Il s’inscrit dans la même démarche. D’une part, il répond à un devoir de vérité et de justice envers les enfants, les femmes et les hommes, fragilisés par la maladie et le handicap, exterminés en Allemagne par le régime nazi, et également condamnés à mourir en France par abandon sous le régime de Vichy. D’autre part, c’est une manière d’en appeler à une intelligence collective de la fragilité, en un temps où s’affiche volontiers la force et où les liens avec les plus vulnérables se désagrègent sous des regards qui se détournent. L’on sait que du fantasme de puissance et de performance au darwinisme social, il n’y a qu’un pas. D’où la nécessité de ne pas oublier et d’installer des contre-feux.
Sur quels fondements une société inclusive peut-elle s’édifier ?
Dans mon dernier ouvrage, je propose cinq axiomes, au sens premier de « ce qui est jugé digne », les concevant comme les arcs-boutants sur lesquels mérite de s’appuyer l’édifice à construire ensemble. Le premier soutient que nul n’a l’exclusivité du patrimoine humain et social. Le deuxième affirme que l’exclusivité de la norme c’est personne et que la diversité c’est tout le monde. Le suivant rappelle qu’il n’y a ni vie minuscule ni vie majuscule. Le quatrième avance que vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions. Le dernier souligne que tout être humain est né pour l’équité et la liberté.
En affirmant que nul n’a l’exclusivité du patrimoine humain et social, vous soulignez d’emblée que le mouvement inclusif va à l’inverse même de la propension à considérer certains biens comme des exclusivités…
Oui, il ne suffit pas de vivre sur un même territoire pour appartenir à sa communauté, encore faut-il pouvoir en partager le patrimoine éducatif, professionnel, culturel, artistique, communicationnel. Des étrangers, des populations isolées ou nomades, des minorités linguistiques ou culturelles et des membres de bien d’autres groupes défavorisés ou marginalisés ne bénéficient pas pleinement de ce droit. C’est aussi le cas de la plupart des personnes en situation de handicap, auxquelles je m’intéresse ici prioritairement.
Pour les personnes en situation de handicap, comment les phénomènes d’exclusion se manifestent-ils ?
En réalité, ni le système actuel des Droits de l’homme, censé protéger et promouvoir leurs droits, ni les normes et mécanismes en vigueur ne parviennent à leur fournir une protection adéquate. Les privations de patrimoine humain et social, dont elles sont victimes, prennent différentes allures.
Dans la plus extrême, les personnes en situation de handicap sont mises, de manière radicale, au ban de leur communauté d’appartenance. On les éloigne comme pour éviter une contagion. La croyance inavouée qu’elles seraient « naturellement autres » et leur supposée improductivité les condamnent à un huis clos. Cela en fait des êtres atopos, sans place dans la société. Rendues invisibles, ontologiquement gommées. Dans nombre de cas, elles sont orientées vers des lieux limitrophes, dissociés, où elles vivent entre parenthèses, où elles s’éreintent à tracer un impossible chemin. Dans la plupart des cultures, la même tentation perdure : placer ces personnes spéciales dans des lieux spéciaux sous la responsabilité de spécialistes. Tenues à une certaine distance des activités collectives, du continent des autres, insularisées, elles ne sont que des visiteurs épisodiques de l’espace commun. Aux spécialistes et autres spécialisés de s’en occuper dans des structures dédiées.
Enfin, si elles ne sont pas, directement ou indirectement, maintenues au-dehors, elles peuvent connaître un exil à l’intérieur. On les accepte sans toutefois les considérer comme des acteurs sociaux dignes de participer à la vie de la cité. Des lignes de démarcation les placent en retrait du mouvement général. Des regards indifférents ou stigmatisants les « infirment ». Si on les croise, ici et là, on tourne la tête, on regarde ailleurs. Ou bien on les observe de loin. Dans les couloirs de circulation bien balisés, on ne traverse guère pour les rejoindre ; on ne se risque pas à trop de proximité.
Ces mécanismes d’exclusion sont-ils nouveaux ?
Evidemment non. L’Histoire de la folie à l’âge classique de Michel Foucault met au jour les variations, au fil du temps, des mécanismes et modalités d’exclusion. Les sociétés, montre-t-il dans cette enquête historico-anthropologique, se caractérisent « selon la manière qu’elles ont de se débarrasser, non pas de leurs morts, mais de leurs vivants ». Les sociétés à bannissement, comme dans l’Antiquité grecque, chassent et exilent les non-conformes. Les sociétés à rachat ou à réparation compensent, convertissent en une dette le dommage subi par la personne exclue. Les sociétés massacrantes ou purifiantes, comme en Occident à la fin des siècles médiévaux, punissent, torturent, tuent ou pratiquent des rituels purificatoires. Les sociétés enfermantes, à l’instar de celles des XVIe et XVIIe siècles, en une période où l’on arrêtait les vagabonds, créent des institutions de séquestration et incarcèrent.
À l’origine des phénomènes d’exclusion, il y a des micro-pouvoirs, pour reprendre le vocable de Michel Foucault, qui entravent l’accès au patrimoine commun, par définition ouvert à tous.
Pourtant, dans toute société, on accepte tacitement que des biens ne soient pas accessibles dans les mêmes conditions à tous…
C’est une réalité à combattre, car une société ne peut se concevoir comme un club dont des membres pourraient accaparer l’héritage social à leur profit pour en jouir de façon exclusive et justifier, afin de le maintenir, un ordre qu’ils définiraient eux-mêmes. Elle n’est non plus un cercle réservé à certains affiliés, occupés à percevoir des subsides attachés à une « normalité » conçue et vécue comme souveraine. Tentés de constituer une petite société à leur usage et de délaisser la grande. Une société n’est pas davantage un cénacle où les uns pourraient stipuler à d’autres, venus au monde mais empêchés d’en faire pleinement partie : « Vous auriez les mêmes droits si vous étiez comme nous ».
Chacun est héritier de ce que la société a de meilleur et de plus noble. Personne n’a l’apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. Ce que les hommes se doivent les uns aux autres est incommensurable. Leurs servitudes originelles les rendent interdépendants. Leurs destins sont enchevêtrés.Leurs vies sont liées dans un ensemble, tissé de singularités, dont chaque membre porte une parcelle du sort commun. Notre héritage social vertical, légué par nos devanciers, et notre héritage horizontal, issu de notre temps, composent un patrimoine indivis. Chaque citoyen a un droit égal à bénéficier de l’ensemble des biens sociaux, qui se définissent par leur communalité : la ville, les transports, les espaces citoyens, les salles de cinéma, les bibliothèques, les structures de sport et de loisirs, etc.
L’idée de société inclusive ambitionne donc de désamorcer chez l’Homme sa tendance à instituer la relation à l’autre sur le mode de la domination, à vouloir s’approprier certains biens…
Georges Bataille et Maurice Blanchot, entre autres, ont décrit sans les nier, cette violence et cette tendance à la prédation qui habitent l’être humain et les sociétés. L’iniquité du partage patrimonial en représente une forme.
L’idée de société inclusive tourne le dos à toute forme de captation, qui accroît de fait le nombre de personnes empêchées de bénéficier, sur la base d’une égalité avec les autres, des moyens d’apprendre, de communiquer, de se cultiver, de travailler, de créer et de faire œuvre. En effet, écartée des biens communs et dépossédée de possibilités de participation sociale, comment une existence pourrait-elle s’accomplir ? La perspective inclusive va à l’encontre de la dérive amenant à donner davantage aux « déjà-possédants » et des parts réduites à ceux qui, ayant le moins, nécessiteraient le soutien le plus affirmé.
Elle remet en question les mécanismes par lesquels les premiers augmentent leur avantage sur les seconds, en réalisant des plus-values et en capitalisant les conforts. C’est ce processus des avantages cumulés que Robert K. Merton, fondateur de la sociologie des sciences, a appelé l’effet Matthieu, en référence à une phrase du Nouveau Testament : « A celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans l’abondance, mais à celui qui n’a rien, il sera tout pris, même ce qu’il possédait ». Il convient toutefois de préciser que l’évangéliste Matthieu plaçait ces paroles dans la bouche d’un homme riche auquel, plus loin, il promettait l’enfer.
L’adjectif inclusif s’oppose donc à exclusif ?
Si j’interroge l’étymologie, je remarque que l’adjectif exclusif, né au XVIIIe siècle, qualifie ce qui appartient uniquement à quelques-uns, à l’exclusion des autres, par privilège spécial et, à ce titre, n’admet aucun partage. Prononcer ou jeter l’exclusive signifiait déclarer l’exclusion de quelqu’un. Le verbe exclure, apparu deux siècles plus tôt, voulait dire, originellement, ne pas laisser entrer, ne pas admettre, fermer avec une clé, tenir quelqu’un à l’écart de ce à quoi il pourrait avoir droit. Par la suite, il a pris le sens de rejeter une chose jugée inconciliable avec une autre. L’adjectif inclusif traduit clairement un double refus. D’une part, celui d’une société et de structures dont les seules personnes « non handicapées » se penseraient propriétaires, pour en faire leurs privilèges ou leurs plaisirs exclusifs, selon les mots de Montesquieu et de Rousseau. D’autre part, le refus de la mise à l’écart, dans des ailleurs improbables, de ceux que l’on juge gênants, étrangers, incompatibles.
Inclure et intégrer, est-ce la même chose ?
Non, les deux optiques se distinguent. L’objectif de l’intégration est de faire entrer dans un ensemble, d’incorporer à lui. Il s’agit de procéder, comme on le dit en astronautique, à l’assemblage des différentes parties constitutives d’un système, en veillant à leur compatibilité et au bon fonctionnement de l’intégralité. Un élément extérieur, mis dedans, est appelé à s’ajuster à un système préexistant. Ce qui est ici premier est l’adaptation de la personne : si elle espère s’intégrer, elle doit, d’une manière assez proche de l’assimilation, se transformer, se normaliser, s’adapter ou se réadapter. Par contraste, une organisation sociale est inclusive lorsqu’elle module son fonctionnement, se flexibilise pour offrir, au sein de l’ensemble commun, un « chez soi pour tous ». Sans neutraliser les besoins, désirs et destins singuliers et les résorber dans le tout.
Concrètement, comment fait-on pour inclure ?
« Mettre dedans » ne suffit pas. Autorise-t-on chacun à apporter sa contribution singulière à la vie sociale, culturelle et communautaire. Favorise- t-on l’éclosion et le déploiement de ses potentiels, si ténus soient-ils ? Cela implique d’offrir toute une gamme d’accommodements et de modalités de suppléance, afin de garantir l’accessibilité des dispositifs, ressources et services collectifs. Cela étant, ces accommodements ne se limitent pas à une action spécifique pour des groupes tenus pour spécifiques. Ils visent à améliorer le mieux-être de tous. Qu’ils soient architecturaux, sociaux, éducatifs, pédagogiques, professionnels ou culturels, les plans inclinés sont universellement profitables. Ce qui est facilitant pour les uns est bénéfique pour les autres.
Une société inclusive n’est pas de l’ordre d’une nécessité liée au seul handicap : elle relève d’un investissement global. Ce qui prime est l’action sur le contexte pour le rendre propice à tous, afin de signifier concrètement à chaque membre de la société : « Ce qui fait votre singularité (votre âge, votre identité ou orientation sexuelle, vos caractéristiques génétiques, vos appartenances culturelles et sociales, votre langue et vos convictions, vos opinions politiques ou tout autre opinion, vos potentialités, vos difficultés ou votre handicap) ne peut vous priver du droit de jouir de l’ensemble des biens sociaux. Ils ne sont la prérogative de personne ».
Vous portez une attention particulière à la prise en compte de la singularité…
L’optique inclusive se caractérise effectivement par la capacité collective à conjuguer les singularités, sans les essentialiser. Des singularités, parfois désarmantes, en relation avec l’infini d’autres singularités, à l’intérieur d’un tout, où chacun a le droit de se différencier, de différer. Et, en même temps, d’habiter, d’être, de devenir avec les autres ; d’apporter au bien commun sa biographie originale, faite de ressemblances et de dissemblances, sans être séparé de ses pairs, ni confondu avec eux, ni assimilé par eux. Selon les mots d’Aimé Césaire dans sa Lettre à Maurice Thorez en 1956, on peut se perdre « par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l’universel ».
Il n’existe pas, d’un côté, la singularité extraordinaire des personnes en situation de handicap et, de l’autre, la singularité ordinaire. Les frontières sont brouillées. Nous sommes tous, en situation de handicap ou non, « singuliers pluriels » selon la formule de Jean-Luc Nancy. Des êtres intermédiaires entre un plus et un moins, un mieux et un pire, un en-deçà et un au-delà. Entre résistance et fléchissement face aux vicissitudes de la vie. Des circonstances adverses peuvent, sans prévenir, faire voler en éclats la certitude de se croire installé, comme membre inamovible, sur le bon versant du destin. Celui-ci peut nous jeter, à tout instant, hors de la condition ordinaire ou commune. Nul n’est à l’abri d’être rendu étranger à la norme collective. Etranger au cours habituel de la vie.
Justement, votre deuxième axiome remet en question l’exclusivité de la norme. Pourtant, toute société n’a-t-elle pas besoin de normes sociales pour fonctionner ?
S’il est vrai que toute société est normative, la visée inclusive vise à contrecarrer ce que j’appelle la centrifugeuse culturelle qui renvoie en périphérie ceux dont l’existence même déconstruit les modèles et archétypes dominants. Au-delà des institutions politiques, matérielles ou symboliques normatives dont naturellement toute société procède, elle s’élève contre l’emprise excessive d’une norme qui prescrit, proscrit et asphyxie le singulier. L’exclusivité d’une norme, culturellement construite, au gré du temps ou des cultures, et imposée par ceux qui se conçoivent comme la référence de la conformité, aggrave les rapports de domination et de violence, auxquels sont exposées les personnes dont un dysfonctionnement physique ou mental amplifient la dépendance.
La catégorisation et l’indexation, à l’aune desquelles la singularité s’efface, sont une autre conséquence de la dictature de la norme. C’est l’absolutisation de l’identité catégorielle d’une personne qui produit son exclusion. Catégoriser, c’est en soi diviser, séparer et éliminer, pour mettre en ordre la société. Tracer des frontières qui instaurent des rapports de domination-subordination et d’opposition. L’étymologie du mot catégorie, qui signifie littéralement « accusation, blâme», révèle le vrai visage de la catégorisation : une mise à distance des situations humaines singulières et concrètes. Comme si ce n’était pas assez de leur fragilisation identitaire, on tend ainsi à ranger les personnes en situation de handicap dans une classe déclassée et on les identifie à elle. On les dépouille de leur identité et de leur nom. Quelque chose qui ressemble à une perte de soi et à une incarcération. Leur uniformisation et leur anonymat générique en donnent une vision abstraite et quantitative. L’expression au pluriel « les handicapés » évoque des membres d’un ordre humain et social différent, affligés d’une infériorité par rapport à la condition « normale ». Rabaissés à leur défi cience érigée en nature, à partir de laquelle on en vient à prédire leur devenir. On entrave ainsi leurs projets personnalisés d’éducation et de vie et on met à mal les possibilités d’interaction avec elles. Sur l’autel des catégories, on sacrifie le caractère le plus décisif de toute existence : son essentielle originalité, sa plasticité ; la construction de soi, toujours inachevée, indécise, sans limite définitivement établie ; l’incertitude de toute identité.
Remettre en cause ces catégorisations est donc pour vous une condition indispensable ?
Oui, pour forger un « nous », un répertoire commun, une communauté où la solidarité avec les plus fragiles est dictée par une proximité de destin, dont Ludwig Feuerbach faisait la définition même de l’humanité. Il nous appartient d’édifier non des barricades mais des passerelles entre les territoires compartimentés et clos. D’ouvrir des voies inédites à ceux qui attendent dans des impasses ; de faciliter la circulation de la sève dans le tronc commun. L’enjeu est d’élargir la Terre, comme le voulait Paul Claudel. Il s’agit de s’extraire des replis qui assèchent pour se projeter au dehors et s’ouvrir à la toute-humanité, à laquelle aspirait Edouard Glissant. De se frotter à d’autres, s’acculturer, « s’altérer », « faire monde » à partir du singulier, du métis, du divers avec ses bizarreries et discontinuités : la chose n’est pas spontanée, il faut la provoquer. L’exclusivité de la norme c’est personne, la diversité c’est tout le monde.
Votre troisième axiome amène aussi à repenser la vulnérabilité…
Parmi les ressorts profonds d’une société inclusive, il y a le rejet de la sacralisation de la puissance, proche par ses excès, ses contradictions et ses failles, du darwinisme social. L’idée de société inclusive implique une intelligence collective de la vulnérabilité, conçue comme un défi humain et social à relever solidairement. Parce que nul n’est invulnérable. La vulnérabilité peut à chaque instant exploser en nous. C’est ce que le handicap met au grand jour. Notre société, ivre de ses rêves de puissance, refuse de l’admettre. Oublie-t-on cet état de fait : dans les pays où l’espérance de vie excède 70 ans, une personne passe ainsi en moyenne huit années de sa vie en situation de handicap, que celle ci soit consécutive à une déficience physique, sensorielle ou liée à un trouble mental, cognitif ou psychique, d’ordre congénital ou acquis. Le handicap ne constitue pas une exception ou une dérogation à la règle. Il est l’une des facettes, l’un des aspects spécifiques des problèmes généraux de notre humanité. Le miroir grossissant.
Il semble que la notion de dignité soit centrale pour qu’une société soit inclusive ?
En effet. Une société inclusive se caractérise par des institutions qui ne donnent pas l’occasion aux citoyens de se sentir humiliés et où ces derniers n’en humilient pas d’autres. On y considère les autres, non de manière humanitaire, mais comme des humains, dont la dignité a une totale latitude de s’exprimer. C’est l’une des conditions d’une société inclusive : elle ne peut se construire que contre les institutions politiques, les comportements et les usages rabaissant les plus fragiles. Elle ne peut accepter le processus d’infra-humanisation qui frappe, plus que tout autre, les personnes en situation de handicap, provoquant des « arrêts de vie », à la mesure d’un sentiment de non-sens de l’existence et de discordance avec le monde. Il nous faut admettre que toute forme d’ostracisme est le symptôme d’une pathologie du développement social. C’est la maladie d’une communauté humaine en mal de sens, par dérèglement, par carence et, spécifiquement, par incapacité, non à maintenir l’ordre social, mais à assurer à ses membres les conditions de la réalisation de soi. Cette pathologie a pris pour nom « aliénation » chez Jean-Jacques Rousseau, de « dissolution des liens communautaires » pour Ferdinand Tönnies. Georg Simmel parla de « dépersonnalisation des relations » et Max Weber de « désenchantement du monde ».
Une société inclusive constitue également une réponse au besoin de reconnaissance, d’attention, de sympathie et de considération : « L’essence de mon être est-elle dans les regards des autres ? », s’interrogeait Rousseau, qui voyait dans ce besoin vital la porte d’entrée dans l’humanité. Être reconnu, c’est se voir attribuer une place et une valeur, en tant que contributeur à la vie collective.
Vous insistez sur la fonction des mots…
Oui, pollens de vie ou de mort, dignes ou indignes, les mots peuvent créer et fortifier ou, à l’inverse, infra-humaniser et déréaliser. Ce sont des regards, des « passants mystérieux de l’âme » (Victor Hugo), dont on sous-estime la portée. L’objectif inclusif est d’abandonner les mots-frontières au profit de vocables-liens.
Que seraient ces « vocables liens » ?
Pourquoi continuer, par exemple, à parler d’enfants ou d’adultes intégrés à l’école ou dans les lieux professionnels, comme si l’on devait incorporer des éléments exogènes ne procédant pas d’un ensemble commun ? Pourquoi ne pas dire simplement scolarisés ou en activité professionnelle ?
Pour dépasser les clivages et permettre à une histoire en commun de s’écrire, notre société a besoin de mots et de concepts partagés, inclusifs, en cohérence avec le droit de tous au patrimoine social, sans toutefois gommer la diversité et la spécificité des situations. L’égalité et la liberté ne suffisent pas à forger une société sans exclus : il y faut de la fraternité dans les mots comme dans les comportements.
Le quatrième axiome souligne la différence entre vivre et exister. Pouvez-vous l’expliquer ?
Une société inclusive ne défend pas seulement le droit de vivre mais celui d’exister. Le vivre renvoie à nos besoins biologiques. L’exister spécifie les hommes. Il se situe sur le versant de l’esprit et de la psyché ; des relations à soi, aux autres, au temps et à son destin ; de la possibilité de devenir membre d’un groupe et de s’impliquer dans sa société d’appartenance.
Dans cette optique, on parle d’empowerment pour désigner l’estime de soi, la compétence personnelle, le désir de participation sociale et la conscience critique. Ce processus ne relève pas seulement de caractéristiques personnelles, il dépend d’un environnement familial, communautaire et social ; il repose sur les ressources et les droits de la personne et de sa communauté d’appartenance. Transformer notre culture pour faire advenir une communauté vraiment humaine, c’est autoriser les personnes en situation de handicap à exister en favorisant l’expression de leurs potentiels, de leurs désirs et de leur parole. Par-delà les limites apparentes, cela enjoint de valoriser les compétences enfouies, les ressources, le génie singulier ; de permettre à la fois de vivre et d’exister.
Le déni de leurs aptitudes, fussent-elles infimes, annihile leur envie de se mettre en mouvement, de se projeter. Il les « infirme ».
Le dernier arc-boutant, sur lequel, dites-vous, repose une soutient inclusive, avance que tout être humain est né pour l’équité et la liberté. Comment articulez-vous ces deux valeurs ?
Les discriminations constituent dans une certaine mesure l’un des crimes sociaux de notre temps, comme le fut l’exploitation des couches sociales défavorisées au XIXe siècle. Celle qu’ont dénoncée Victor Hugo, Emile Zola ou encore Jules Vallès, révolté, jusqu’au bout, par les injustices de la société bourgeoise et de l’éducation qu’elle dispensait. Des discriminations directes résultent de critères, de dispositions, de pratiques, de législations, de politiques moins favorables. Des discriminations indirectes découlent de carences, apparemment plus neutres mais génératrices d’évidents désavantages : par exemple, le défaut d’accessibilité des locaux professionnels pour les personnes affectées d’une déficience motrice, ou la non-adaptation des sites informatiques qui exclut celles atteintes d’une déficience visuelle.
Une refondation de l’idée d’égalité, comme relation sociale, suppose, comme le prône Pierre Rosanvallon dans La société des égaux, de passer d’une logique de réparation des pannes du social à la conception d’une action sur la matière de ce social. Dans nombre de cas, des politiques sociales créatives et équitables permettraient de prévenir et d’atténuer les conséquences du handicap. C’est ainsi que, dans sa Théorie de la justice, John Rawls qualifiait de « biens premiers » les droits, les libertés, les opportunités sociales et les garanties de respect offerts à chacun et égaux pour tous. Il associe la notion d’équité à celle de justice sociale. Plus précisément, il considère l’équité comme antérieure à l’essor des principes de justice.
Que faut-il comprendre ?
Une société inclusive est une société consciente que l’égalité formelle n’assure pas l’égalité réelle et peut même nuire à l’équité. John Stuart Mill caractérisait la liberté comme le droit de donner forme à son existence dans un contexte favorable à la réalisation de soi. La perspective inclusive, appuyée sur l’équité, la liberté et les capabilités, telles que définies par Amartya Sen, implique un accès naturel, libre et équitable, à tout pour tous. Une accessibilité multidimensionnelle et universelle.
Il s’agit, d’un côté, de supprimer les obstacles et barrières dans le parcours d’une personne, afin d’optimiser l’essor de ses ressources : motivation, pouvoir d’agir, capacité d’auto-détermination et de résilience. De l’autre, d’inventer des moyens et des pratiques facilitant sa participation au monde commun.
Vous avancez le principe d’équité, et non celui d’égalité…
Le principe d’équité, au caractère subjectif, n’est effectivement pas synonyme de celui d’égalité, objectivement évaluable car le plus souvent énoncé dans le droit positif. Il consiste à agir de façon modulée, selon les besoins singuliers, pour pallier les inégalités de nature ou de situation. Si des situations identiques appellent des réponses identiques, les citoyens les moins armés et les plus précarisés légitiment des réponses spécifiques. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen confie d’ailleurs au législateur le soin d’identifier, dans l’intérêt supérieur, les différences à reconnaître ou à ignorer, précisant que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Pour peu qu’elles soient justes et bénéfiques, tant pour la personne que pour la collectivité, ces distinctions préviennent les risques d’indifférenciation et de nivellement de l’action sociale et finalement préviennent l’altération du principe d’égalité.
La négation des singularités (attachées à l’âge, au sexe, aux aptitudes, aux inclinations, aux origines, au milieu et aux circonstances de vie, au fonctionnement inégal de notre corps et de notre esprit…) entrave la justice, conçue en termes d’exigences d’équité. Le handicap exige de la sorte d’accommoder les ressources ordinaires en matière de santé, de bien-être, d’éducation, d’acquisition de savoirs ou de compétences, de sécurité économique et sociale.
Vous accordez une place importante à ces accommodements ?
Oui, parce qu’ils permettent d’articuler le singulier et l’universel, le divers et le commun, ils sont la condition même de l’égalité et de la liberté.
Ils permettent de rétablir un continuum dans l’itinéraire de vie : accessibilité, autonomie et citoyenneté ; vie affective, familiale, et sexuelle ; accompagnement de la petite enfance, scolarisation et formation ; activité professionnelle ; art et culture ; sports et loisirs.
Finalement, qu’est-ce que ce nouveau cadre de pensée interroge de façon fondamentale ?
Il interroge puissamment notre forme culturelle, où la maladie, le handicap, la fragilité et la mort sont scotomisés. Il questionne les lieux d’éducation gouvernés par la norme, le niveau et le classement. Il remet en cause les milieux professionnels arc-boutés sur des standards. Il bouscule la communauté sociale, soumise aux principes de conformité et d’utilité, fracturée par un schisme entre des citoyens préservant leurs exclusivités et les autres, plus fragiles, qui semblent encombrer et répondre à une certaine fatalité.
Chacun a le droit inaliénable de prendre part, toute sa part à la vie de la Cité, en bénéficiant, autant que de besoin, d’aides, de médiations ou d’accompagnements. Être inclusif n’est donc pas faire de l’inclusion, pour corriger a posteriori les dommages des iniquités, des catégorisations et des ostracismes. C’est redéfinir et redonner sens à la vie sociale dans la maison commune, en admettant, que chacun est légataire de ce que la société a de plus précieux ; que l’humanité est une infinité de configurations de vie et une mosaïque d’étrangetés ; que la fragilité n’est pas synonyme de petitesse ; qu’il ne suffit pas aux hommes de venir au monde et que, jusque dans leurs plus secrets replis, ils désirent se sentir exister ; que l’équité et la liberté constituent le ciment d’une communauté humaine.
Par où faudrait-il commencer pour aller vers cette société inclusive ? Quel message pourriez vous adresser à la collectivité, en l’occurrence celle du Grand Lyon ?
Ici comme là-bas, pour travailler le sol culturel et faire advenir une société inclusive, il n’existe pas d’œuvre plus utile, plus « productive », que celle d’éduquer, de permettre l’accès au savoir, à la culture universelle. Parce qu’elle catalyse, donne un élan novateur, elle contribue à modifier en profondeur notre culture, frappée du sceau de la diversité des réalités de vie, des projets, des besoins. Elle permet de réduire les inégalités, la dissymétrie, ou plutôt la coupure entre les mondes, que je considère comme l’un des faits les plus préoccupants de notre temps. Elle « fait communauté » en lieu et place d’une réalité en fragments épars, d’univers étrangers les uns aux autres. N’est-ce pas la signification même de la collectivité humaine que constitue le Grand Lyon ?