Violence et usagers : 16 leviers d’action aux mains des organisations

Étude
Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant
Interview de Jean-Pierre HOSS

<< J’ai été frappé par la vivacité de la vigilance démocratique à Lyon, par l’importance de l’idée de résistance >>.
"La vidéosurveillance consiste à placer des caméras de surveillance dans un lieu public ou privé pour visualiser et/ou enregistrer en un endroit centralisé tous les flux de personnes au sein d'un lieu ouvert au public pour surveiller les allers et venus, prévenir les vols, agressions, fraudes et gérer les incidents et mouvements de foule." (Wikipédia)
Entretien avec Jean-Pierre Hoss, conseiller d'Etat, Président délégué du Collège d’éthique de la vidéosurveillance de Lyon.
Qu’est-ce que le Collège d’éthique de la vidéosurveillance ?
C’est une institution assez originale, que le Maire de Lyon a souhaité créer pour faire dialoguer ceux qui étaient plutôt favorables à l’installation de caméras dans les espaces publics et ceux qui y étaient hostiles. C’était en 2003. À l’époque, le débat sur cette question était assez animé dans toute la France. Et cette initiative était une première, à part, je crois, une expérience à Vaulx-en-Velin. Aujourd’hui, d’autres villes y réfléchissent… Le Collège est original dans ses objectifs comme dans sa composition, qui traduit ce souci de dialogue sur des questions conflictuelles. Il est composé pour un tiers d’élus, de toutes les tendances politiques représentées au conseil municipal de Lyon ; pour un tiers de responsables d’associations oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme ; et pour un tiers de « personnalités qualifiées » (recteur, avocat, représentants des commerçants...). Sur le plan juridique, c’est une commission extra-municipale. C’est-à-dire que le Maire de Lyon en est le président, je n’en suis que le président délégué.
Pourquoi avez-vous été sollicité, à votre avis ?
Je pense que le fait que je sois conseiller d’Etat a beaucoup joué. Le Maire de Lyon voulait quelqu’un qui ait une image d’indépendance, quelqu’un qui soit un peu « au-dessus de la mêlée », si l’on peut dire. Pour ma part, c’est un sujet qui m’intéressait. Et puis j’aime bien la gestion des conflits. J’aime bien la diversité, la diversité des opinions… Et là, je dois dire que j’ai été servi !
Qu’est-ce qui vous a marqué dans l’exercice de cette fonction ?
J’ai découvert qu’il existait à Lyon une vie associative très importante en matière de défense des droits de l’homme. Je ne veux pas généraliser à partir de cette expérience, mais j’ai été frappé par la vivacité de la vigilance démocratique à Lyon, par l’importance de l’idée de résistance ; résistance au pouvoir…, à l’abus de pouvoir. Une certaine défiance vis-à-vis du pouvoir. Je pense que ce militantisme est nourri de l’héritage de la Résistance. Parmi les personnalités marquantes du Collège figurent des gens qui ont vécu la guerre dans leur adolescence. Ils puisent leurs convictions dans ce passé-là, dans la lutte que leurs parents ont menée contre l’oppression, contre le nazisme et tout ce qui s’est produit pendant cette période dans la région lyonnaise. Cet arrière-plan est très important.
Ces militants des droits de l’homme étaient contre la vidéosurveillance, je suppose ?
Oui, cette sensibilité-là était hostile à l’installation de caméras sur les espaces publics, dans la mesure où elle y voit un danger pour les libertés individuelles, mais aussi pour les libertés collectives, par exemple le droit de manifester. D’un autre côté, était également représentée la sensibilité — sur l’échiquier politique français, on la rangerait plutôt à droite — de ceux qui pensent que les caméras sont utiles pour prévenir la délinquance, identifier les auteurs d’agression : les commerçants, certains élus… Mais cette sensibilité avait gagné la Gauche. Parce que les choses évoluent. Nous avons d’ailleurs découvert dans le cadre d’un travail comparatif, qu’en Suède, alors que l’installation de caméras sur la voie publique n’est pas encore autorisée au niveau national, c’est plutôt la Droite qui est contre, au nom de la défense de la privacy, et la Gauche qui est pour, au nom de la sécurité conçue comme un droit des citoyens. C’était la même chose en France au moment de la Révolution : la sûreté figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comme l’un des droits fondamentaux.
Comment avez-vous travaillé, à partir de cet état des lieux conflictuel ?
Nous sommes partis de l’existant sur le plan législatif. Le terrain n’était pas vierge : le législateur s’était exprimé avec une loi en 1995, un décret d’application en 96, des circulaires du ministère de l’intérieur... Toute collectivité publique qui souhaite installer des caméras sur la voie publique doit obtenir une autorisation préfectorale, autorisation que le Préfet ne délivre qu’après avoir consulté une Commission départementale de la vidéosurveillance. Si un citoyen s’estime victime d’un abus, il peut déposer une réclamation auprès de cette commission ; il peut aussi saisir les tribunaux. L’objectif du Collège était d’aller plus loin, en donnant aux Lyonnais des garanties supplémentaires par rapport à celles prévues par le législateur. D’où l’idée d’élaborer une Charte d’éthique de la vidéosurveillance.
Pourquoi une charte « d’éthique » ?
Parce que notre rôle, dès le départ, était bien un rôle éthique. Nous n’avons pas de pouvoir de décision. Nous n’avons pas non plus de rôle juridique. Notre Collège ne peut que donner des avis. Entre l’espace juridique et le technique, il reste la dimension éthique, qui correspond à celle de la recommandation. La Charte devait traduire cette fonction éthique, en introduisant une déontologie dans l’approche de la vidéosurveillance. C’est-à-dire qu’on ne doit pas faire n’importe quoi avec ces caméras…, on va s’interroger pour savoir si les bienfaits de cette technique ne sont pas inférieurs aux risques qu’elle comporte pour les libertés. Nous avons donc élaboré ce document, en un peu moins d’un an de discussions. Il a été adopté à l’unanimité des membres du Collège, avant d’être soumis au conseil municipal, qui l’a adopté également à l’unanimité le 19 avril 2004. La Charte renforce les précautions relatives à l’information des citoyens, elle institue un droit de recours de ces derniers auprès du Collège d’éthique s’ils s’estiment victimes d’abus. Et elle s’ajoute au règlement intérieur du CSUL , le service municipal en charge de l’exploitation des images. Elle a été éditée en format de poche et distribuée dans les commissariats et les mairies d’arrondissement.
On est donc passé d’une situation d’opposition à une situation d’unanimité. Le débat sur les valeurs s’est-il estompé ?
Non, il est sous-jacent à tous nos travaux. C’est le débat sur les libertés, c’est « liberté versus sécurité ». Mais il se traduit différemment, parce que les membres du Collège ont accepté de tenir compte de la décision du conseil municipal d’implanter des caméras. Cela ne veut pas dire qu’ils en approuvent tous l’idée. En étant présents dans l’instance qui discute de la vidéosurveillance, qui peut même influencer les décideurs, les adversaires de ce dispositif font le pari qu’il est possible de freiner le mouvement, de « limiter les dégâts », en quelque sorte. On est donc passé d’un débat sur les principes à un débat sur les modalités : combien met-on de caméras, où doit-on les installer, qui a le droit de regarder les images, à quelles conditions les transmet-on à la police, combien de temps va-t-on les stocker ? etc.
Quel a été votre rôle, à la tête de ce Collège ?
C’était de faire exister le débat, de faire en sorte — tout en prenant acte du fait qu’il n’y avait pas de consensus sur le sujet — que les gens se mettent d’accord sur un certain nombre de règles. Au fond notre charte, c’est un compromis ; compromis, cela ne veut pas dire que l’on est tous d’accord, mais que l’on arrive à vivre ensemble malgré les désaccords. Ce qui représente un progrès sur le plan de la vie en société. C’est aussi du réalisme : au départ, les clivages sont forts sur le plan idéologique, et puis le compromis est possible moyennant une certaine dose de réalisme. Il faut dire qu’a pesé sur notre débat l’évolution de l’actualité : le terrorisme, les attentats de Madrid et de Londres…, qui ont conduit le législateur à renforcer la vidéosurveillance au niveau du pays. Et l’opinion publique a évolué en parallèle. Aujourd’hui il y a environ 200 caméras implantées dans les rues de Lyon. Ce qui est à la fois beaucoup et peu, par rapport à l’ensemble de celles qui sont installées dans les transports publics, dans les banques, chez les commerçants… : il y en aurait environ 2000. En 5 ans, notre Collège n’a reçu aucune réclamation de la part des citoyens, en dépit des nombreuses actions de communication que nous avons menées, dans le bulletin municipal, dans la presse locale, sur TLM… Cette absence de réclamation n’est pas seulement due au fait que les gens ne connaissent pas leurs droits : il y probablement aussi une acceptation plus grande de la vidéosurveillance.
Quels moyens avez-vous utilisés pour faciliter le dialogue au sein du Collège ?
Nous avons fait venir des universitaires, des experts, autrement dit des personnalités extérieures reconnues pour leurs compétences sur le sujet. Fonder le dialogue sur une base réputée objective aide à dépasser le conflit frontal entre opinions. Le travail comparatif nous a été très utile également. Nous sommes allés voir ce qui se passait dans d’autres villes européennes… Et nous avons fait évoluer notre rôle, en décidant de nous intéresser à l’efficacité de la vidéosurveillance. Il faut savoir en effet que les caméras coûtent très, très cher à la collectivité publique — et donc aux citoyens. En installation, et surtout en fonctionnement : actuellement, il faut un effectif de 25 agents environ pour assurer le visionnage des images à tout moment du jour et de la nuit.
Et qu’avez-vous conclu quant à l’efficacité du dispositif ?
Nous avons organisé un grand colloque en 2005, au cours duquel des spécialistes de différentes nationalités ont confronté leurs points de vue. Et nous nous sommes rendu compte qu’il était extrêmement difficile d’évaluer l’efficacité de la vidéosurveillance, surtout en milieu ouvert. Parce qu’un milieu ouvert, c’est un milieu qui bouge : même lorsque l’on constate une diminution de la délinquance sur un site surveillé, rien ne prouve que ce n’est pas parce que les délinquants se sont déplacés. C’est ce qu’on appelle « l’effet plumeau ». La seule grande étude réalisée à l’échelon international sur ce sujet l’a été par des Anglais. En dépit d’une démarche très rigoureuse, basée sur des mois d’observation et des centaines d’interviews, ils n’ont pas abouti à des conclusions nettes, que ce soit pour la prévention ou pour l’identification des délinquants.
Peut-on dire que les points de vue se sont rapprochés au sein du Collège ?
Je pense qu’ils ont évolué. Le débat persiste, notamment parce que certains pensent que les caméras concourent à l’idée de sécurité — plus qu’à la sécurité objective. Mais je crois que notre Collège a fait évoluer le point de vue de ceux qui étaient pour le « tout vidéo ». Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de le dire aux élus : compte tenu du coût très important et de l’efficacité incertaine de cette technique, il ne faut peut-être pas mettre des caméras partout. Et il faut rester vigilants, car le risque d'abus dans l’usage de la vidéosurveillance demeure.------------------
Ressources :
- La Charte d’éthique de la vidéosurveillance
- Les actes du colloque : « Evaluer la vidéosurveillance ». Premières rencontres du Collège d’éthique de la vidéosurveillance de Lyon. 17 novembre 2005.

Étude
Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant

Texte d'Anouk JORDAN
Les violences avec le public témoignent de la difficulté d’exercer le métier de travailleur social dans les organisations concrètes du travail que sont les collectivités territoriales.

Étude
Le volet social de l'Agenda 21 est composé de plusieurs thématiques et d’indicateurs chargés d’analyser chacune d’elles : la précarité, le logement, l’éducation, la santé, l’emploi, la sécurité, la démocratie locale.

Étude
La mission prospective et stratégie d’agglomération et la mission écologie urbaine du Grand Lyon ont initié depuis deux ans une réflexion sur le thème santé et environnement, et plus particulièrement sur les évolutions de l’alimentation dans la société mondialisée et urbaine d’aujourd’hui.
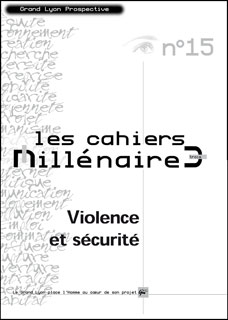
Étude
La violence et l’insécurité sont perçus aujourd’hui par les citoyens et par les élus comme un problème de société grave qui appelle des réponses éclairées mais fermes.
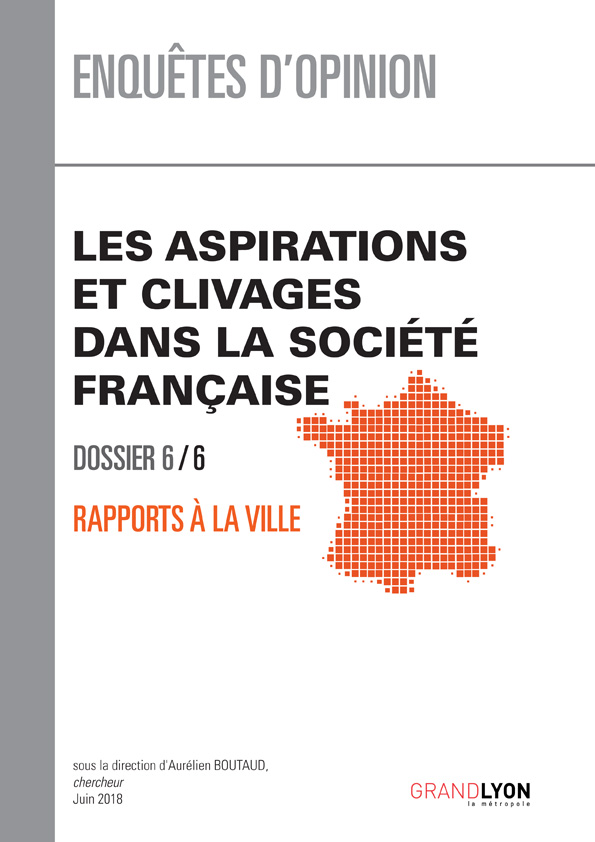
Étude
Les aspirations et clivages dans la société française.
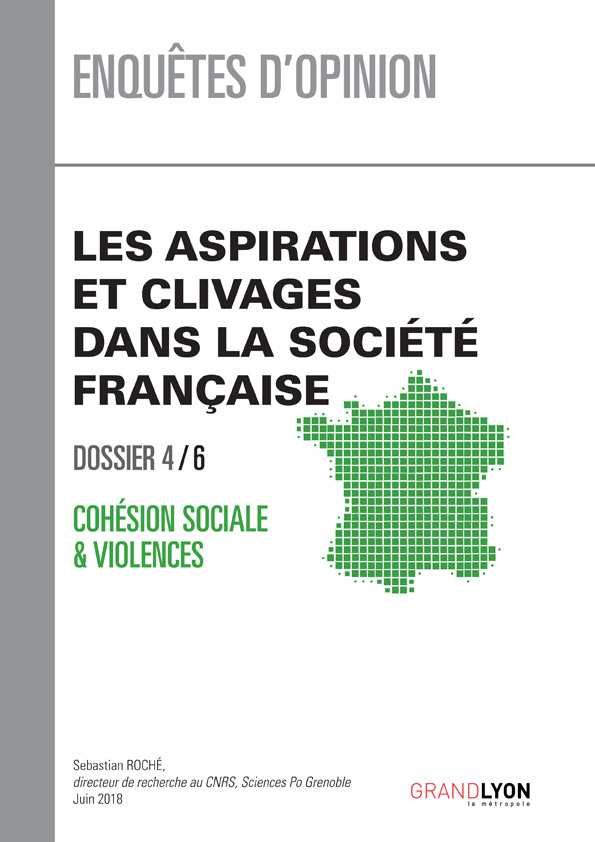
Étude
Les aspirations et clivages dans la société française.

Étude
Les apsirations et clivages dans la société française.

Étude
8 tendances sur les enjeux contemporains et à venir de la sécurité publique.