Les enjeux d’une politique destinée à encourager et favoriser l’innovation
Interview de Noël PAULl
Vice-président de Saint-Etienne Métropole en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Interview de Bénédicte MARTIN
<< Il y a une chaîne évidente entre les différents types de recherche. D’où l’importance de ne pas négliger la recherche amont sous peine de stériliser la recherche appliquée et l’innovation des prochaines années. >>.
Propos recueillis par Ludovic Viévard, le 22 mai 2006. L'innovation et la recherche à l'Ecole Centrale de Lyon et leur tranfert vers l'entreprise.
Comment définiriez-vous l’innovation ?
Du point de vue d’un laboratoire de recherche, l’innovation porte soit sur un produit innovant, soit sur une technologie innovante. Les entreprises travaillent le plus souvent sur des produits, nous davantage sur les procédés et nous aidons les entreprises à passer certains caps technologiques. L’avantage de travailler sur des technologies est qu’elles sont transférables et applicables à différents produits. A Centrale Lyon, faire de la recherche sur de nouvelles technologies ne pose pas particulièrement de problèmes car on dispose du financement pour le faire. En revanche, ce qui peut s’avérer un peu plus complexe, c’est le transfert vers l’entreprise.
L’innovation fait intervenir la recherche mais aussi d’autres acteurs. Pouvez-vous préciser le lien entre recherche et innovation ?
La recherche, normalement, est faite pour mener à l’innovation. Mais, quand on cherche, on n’est jamais sûr de trouver… Parfois on arrive à une impasse technologique, parfois on arrive à un gap technologique tellement important qu’il faut attendre des années pour que les innovations prennent corps. L’arrivée des nanotechnologies, aujourd’hui, vont rendre possibles beaucoup de choses que l’on pressentait hier sans avoir les moyens technologiques des les réaliser. On a ici un très bon laboratoire en nanotechnologies. Pour l’instant, il travaille peu avec l’industrie. C’est un choix. Les chercheurs font à la fois de la recherche amont, mais également de la recherche plus appliquée, et brevètent, notamment les bio-puces, qui sont en cours de valorisation.
Comment se fait la valorisation avec les entreprises ?
Beaucoup de nos procédés dépendent d’une demande de l’entreprise et donnent lieu à de la recherche collaborative. Cette dernière solution se pratique beaucoup avec les grandes entreprises et nous avons de bonnes relations, très bien établies, avec EDF, Michelin, Dassault, Renault, EADS, etc., ce qui représente des contrats pour près de 7 millions d’Euros en 2004 pour une école où travaillent moins de 200 chercheurs. Et encore, 80% de ce chiffre est réalisé par deux laboratoires, le Laboratoire de mécanique des fluides et acoustique (LMFA) — qui peut répondre à des demandes de types essais sur bancs ou en chambre sourde, modélisation, impact environnemental, etc. — et le Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes (LTDS) — qui peut répondre à des questions de tribologie, de physico-chimie, notamment l’analyse de surface. D’ailleurs en 2004, on était à la 8ème place du classement industrie et technologie qui fait un classement des 100 écoles d’ingénieurs travaillant avec les industriels.
Développer l’innovation est également une demande des PME. Est-ce que vous travaillez avec elles ?
Moins. C’est à la fois une question de culture et de moyen. Souvent, elles pensent qu’on ne travaille pas sur les mêmes échelles de temps. Toutes les entreprises veulent que leurs produits sortent vite, mais les grands groupes ont davantage la possibilité de se projeter et d’anticiper que les PME qui cherchent des réponses immédiates et vont plus spontanément se tourner vers un centre technique. Pourtant des réponses rapides, nous sommes également en capacité d’en fournir.
On essaye de se faire connaître auprès d’elles par le biais de la CCI et de l’ANVAR en faisant passer le message aux PME que nous avons des laboratoires capables de répondre rapidement à leur besoin, notamment grâce aux « ingénieurs de transfert ». Leur poste est autofinancé par des contrats gérés par la filiale, ils ne font pas de recherche fondamentale mais exclusivement de la prestation de service ou de la recherche collaborative avec des rendus rapides.
La création d’entreprises est aussi une manière de valoriser et de développer l’innovation. Y avez-vous recours ?
Oui et nous avons quatre créations en cours, que nous accompagnons avec l’appui de Créalys, qui est un incubateur d’entreprise. Entre 2000 et 2006, cinq sociétés ont été créées par des chercheurs de l’École et trois sont en activité. La difficulté pour ces sociétés est de parvenir à se maintenir dans un marché qui évolue sans cesse. Il faut donc qu’elles continuent à innover, ce qui explique qu’elles coupent rarement le cordon avec leur laboratoire d’origine. On peut donc continuer à travailler ensemble sur des avancées technologiques. La loi sur l’innovation permet aux chercheurs de demander une mise à disposition pendant deux ans, une période suffisante pour savoir si l’entreprise est viable. Si elle l’est, le chercheur peut quitter le laboratoire, si elle ne l’est pas, il peut y revenir.
Les entreprises créées sont-elles pérennes ?
On trouve de tout. Certaines sociétés décollent très vites, d’autres non et ferment. Certaines dépendent de grands donneurs d’ordres, peu réactifs. Or, quelques mois, ça compte beaucoup pour des sociétés en cours de création ou nouvellement créées.
Comment protégez-vous les innovations ?
On utilise beaucoup les brevets. Mais c’est long et c’est cher. Il faut donc préparer les budgets pour cela, sauf dans le cadre de la recherche partenariale où, le plus souvent, on essaie de négocier avec l’entreprise pour que ce soit elle qui prenne le brevet. Ensuite, ce qui est compliqué à faire, c’est le transfert technologique et la valorisation. Récemment, il y a eu un financement spécifique de l’ANR pour créer une structure de mutualisation de la valorisation de la recherche. Cette structure, Lyon Sciences Transfert, est portée par l’Université de Lyon et a pour principal objectif de recenser les brevets et les technologies qui dorment à l’échelle de l’agglomération et de les valoriser.
En dehors du fait que le brevet est un moyen de protéger, c’est également un moyen de mesurer l’innovation et donc de montrer aux autres qu’on innove. Est-ce que vous l’utilisez aussi comme cela ?
Dans le monde universitaire, ce qui nous valorise, ce sont moins les brevets que les publications. Or, lorsqu’on a publié, on ne peut plus breveter. Il faut donc arriver à trouver des solutions comme publier sans donner trop de détail puis breveter.
Intégrer les brevets aux CV des chercheurs, c’est envisageable ?
Depuis la Loi sur l’innovation, les brevets font partie des CV des chercheurs. Mais ça reste encore mineur comme pratique car le critère magistral reste la publication… nationale, internationale, avec comité de lecture, etc.
Est-ce qu’il n’y a pas aussi une question culturelle ? Un chercheur qui fait de la recherche fondamentale n’est-il pas davantage valorisé qu’un chercheur qui fait de la sous-traitance ? Et est-ce que ce n’est pas un frein à l’innovation ?
En tout cas, l’avantage de celui qui ne fait que de la recherche fondamentale est qu’il va pouvoir publier beaucoup plus qu’un chercheur qui travaille avec l’industrie. Par ailleurs, ces derniers ont moins de liberté, car ils voient leurs recherches orientées par les entreprises. Dans nos laboratoires, on pallie à cela en faisant en sorte que ces chercheurs viennent en soutient à des ingénieurs de transferts. Ce sont ces derniers qui font le transfert et la prestation de service, non les chercheurs qui sont là en accompagnement.
La distinction recherche fondamentale et recherche appliquée a-t-elle encore un sens ?
Oui, encore. La recherche appliquée est celle que l’on peut vendre directement aux industriels parce que se profile, en arrière plan, un produit, une échéance, etc., qui sont en accord avec des démarches industrielles. La recherche amont, par exemple celle que l’on fait en mathématiques à l’Institut Camille Jordan, produit des avancés dans le domaine des algorithmes qui vont aider au développement de certains modèles. Ces modèles vont ensuite être intégrés, dès qu’ils sont prêts, pour la recherche industrielle.
Il y a donc une chaîne : recherche fondamentale, recherche appliquée, innovation ?
Il y a une chaîne évidente entre les différents types de recherche. D’où l’importance de ne pas négliger la recherche amont sous peine de stériliser la recherche appliquée et l’innovation des prochaines années. Le Ministère de la recherche a bien identifié ce problème et a mis en place des labels « Carnot ». Il s’agit d’un nouveau programme lancé en décembre 2005 qui permet aux laboratoires travaillant avec les industries de recevoir de l’État un financement complémentaire afin de faire du « ressourcement », c’est à dire de renforcer la recherche amont.
Est-ce que la recherche amont bénéficie aussi de la recherche appliquée ?
C’est rare. Mais ça arrive, notamment lorsque la recherche appliquée rencontre des problèmes qui nécessitent de revoir des modèles théoriques. Disons que le sens naturel, c’est de descendre la rivière : d’aller de l’amont vers l’aval…
Pendant un temps, on a eu le sentiment que l’État se désengageait du financement de la recherche en laissant aux laboratoires le soin de trouver des alternatives auprès de l’industrie ce qui a fait parfois paraître les labo comme des sous-traitants qui pouvaient négliger un peu la recherche.
Ca a changé, notamment avec la conférence de Lisbonne de 2000 qui fixe l’engagement des pays européens à investir 3% du PIB dans la recherche et l’innovation.
Pourtant la France reste à la traîne de l’innovation ?
Il est vrai que si on regarde les indicateurs de l’innovation, la France vient derrière les pays d’Europe du Nord. Mais cela ne veut pas dire qu’on n’a pas les compétences pour y arriver. Je crois que cela tient surtout aux lourdeurs administratives, à la complexité de la recherche de financements, etc., qui font que les chercheurs sont assez peu motivés. Ces obstacles, les chercheurs des pays du nord ne les ont pas. Il y a certainement des solutions à prendre chez eux en terme de soutien à la recherche.
Et puis les choix stratégiques à faire ne sont pas encore faits. Il n’est pas certain qu’en France, en 2010, 3 % du PIB soient consacrés à la recherche tandis qu’en 2010 la Finlande ou la Suède en accorderont probablement plus de 5 %. Au plan de l’Union Européenne des efforts sont faits, mais en France, moins. Or l’innovation, ce sont les emplois de demain. Ce n’est pas tout de faire en sorte qu’il n’y ait pas de délocalisation. C’est bien, mais c’est de l’action pour demain. L’innovation, c’est pour après-demain et on ne doit pas se couper de cela. C’est souvent la tendance. On le voit dans les entreprises qui ont des soucis financiers. Elles freinent leurs dépenses de R&D. Ca leur permet de gagner du temps, mais ce sont des décisions qui se voient plus tard.
Ca va avec la fuite des cerveaux ?
C’est un vrai problème qui touche toutes les filières de la recherche. On a moins de frein pour travailler aux USA, au Japon ou au Canada. Aujourd’hui, on essaie de les faire revenir mais beaucoup de chercheurs qui sont partis ne reviendront pas car ils ont fait leur vie là-bas. L’État à pris la mesure du problème et a débloqué des fonds pour en faire revenir, mais, évidemment, moins qu’on le voudrait. Ce qui est important, c’est que ceux qui partent faire un post-doc au Canada, par exemple, sachent qu’ils peuvent revenir et qu’ils seront accompagnés pour trouver un poste.
On parle aussi d’un problème de formation. Les docteurs seraient plus performants pour la recherche que les ingénieurs, mais moins bien adaptés à l’entreprise.
Les ingénieurs sont formés pour être sur le terrain et n’ont pas bénéficié de la formation complémentaire par la recherche que constitue la thèse. Pour ce qui concerne les docteurs, beaucoup se destinent à l’enseignement et à la recherche pure, via le CNRS, l’INRA, etc., et ne se sentent donc pas du tout concernés par le monde de l’entreprise. Mais, effectivement, pour beaucoup d’autres, il faudrait développer les bourses CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche). Le doctorant est suivi à la fois par l’entreprise qui finance une part de sa thèse et par une école doctorale. Les chercheurs qui ont bénéficié d’une bourse CIFRE n’ont aucun problème pour se placer dans l’entreprise. Ils connaissent la recherche dans le monde de l’entreprise comme dans celui de l’université et sont à la jonction des deux. Par ailleurs, on essaie d’impliquer des doctorants dans les contrats de recherche européens. Ca leur donne une ouverture sur la recherche internationale ainsi que sur le monde de l’entreprise internationale.
La géographie de l’innovation implique des entreprises déjà créées qui cherchent à se développer, des laboratoires, etc. Y-a-t il un schéma type ?
Je ne suis pas sûre que la géographie joue énormément. C’est vrai que les pôles de compétitivité insistent sur l’importance de la proximité géographique, mais pour nous je crois que le plus décisif, ce sont les réseaux. Par exemple, pour le secteur de l’aéronautique, nous fonctionnons surtout par réseaux dans lesquels on trouve des grandes entreprises, des PME, des universitaires, etc. Il s’agit plus de liens de ce type que de proximités géographiques parce ce secteur d’application est assez éclaté et que les pôles se situent davantage à Toulouse ou à Paris. Mais ça ne nous empêche pas de travailler avec eux. Il est vrai que pour le pôle de compétitivité Lyon Urban Trucks, par exemple, on a des contacts locaux.
Pôle de compétitivité et clusters de recherche vont-ils changer quelque chose à votre façon de travailler ?
Il est un peu tôt pour le dire. On a encore des projets pluriannuels en cours et il y a des programmes qui se lancent à la fois dans les pôles de compétitivité et les clusters de recherche. Difficile de dire si cela va changer la donne chez nous. Ce que je pense, c’est que les anciens instruments de coordinations et de financements, type projets de recherche régionaux ou appels à projets du Ministère de la recherche, vont glisser vers des cadres plus définis, comme les clusters ou pôles, mais qu’on retrouvera finalement les mêmes acteurs avec les mêmes types de financements. Au final, tout cela sera mieux encadré et plus lisible, surtout de l’extérieur, mais ça se substituera à l’existant. Mais il faudra faire un bilan dans trois ans pour savoir ce qu’il en est.
Les clusters de recherche de la région obligent différents acteurs de la recherche à s’unir autour d’un projet pour du financement. Est-ce que ce n’est pas un moyen pour cette collectivité d’orienter la recherche ?
Oui, c’est vrai. Le risque, à terme, est que la recherche soit trop orientée et que cela ne laisse plus de place à l’émergence de projets issus des labos. Reconnaissons, quand même, que ce type de projets ne sont pas si nombreux et que nous avons des financements spécifiques, notamment au niveau de l’UE, pour permettre de la recherche plus atypique. Et puis, à Centrale, nous avons la chance d’avoir des financements d’origines différentes ce qui nous permet de ne pas être enfermé dans un projet particulier. Enfin, nous sommes très orientés Sciences de l’ingénieur et Informatique, domaines assez transversaux que l’on retrouve dans de nombreux secteurs comme les véhicules, l’aéronautique, etc. Cela nous permet de participer à beaucoup de projets.
Interview de Noël PAULl
Vice-président de Saint-Etienne Métropole en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Texte d'auteur
De 1978 à 2003, retour sur les grandes étapes de Lyon, métropole innovante dans le domaine de l'éducation.
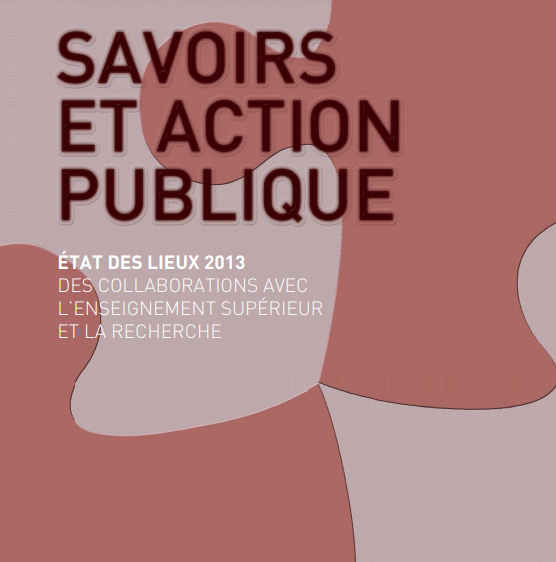
Étude
Cette nouvelle édition traduit un renouvellement significatif des projets engagés avec les sphères académiques. Parmi la cinquantaine de collaborations recensées, la recherche de connaissances au service de l’action apparaît comme un fil conducteur.
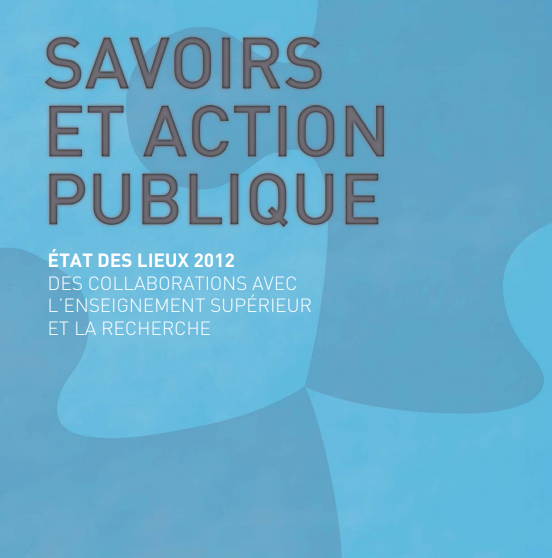
Étude
Cette nouvelle édition du livret des partenariats de recherche entre le Grand Lyon, l’Agence d'urbanisme de Lyon et les milieux académiques s’étoffe en présentant 52 collaborations engagées.

Étude
L’état des lieux présenté dans ce document montre que les collaborations du Grand Lyon et celles de l’Agence d’Urbanisme avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ne sont pas récentes.

Étude
Terreau de la radicalité ou laboratoires d'innovations éducatives et citoyennes ?

Étude
Pour les sciences sociales, le big data est-il une révolution, une illusion ou une extension de ses modes de faire ?

Étude
Accompagnement éducatif : les apports de la recherche académique.
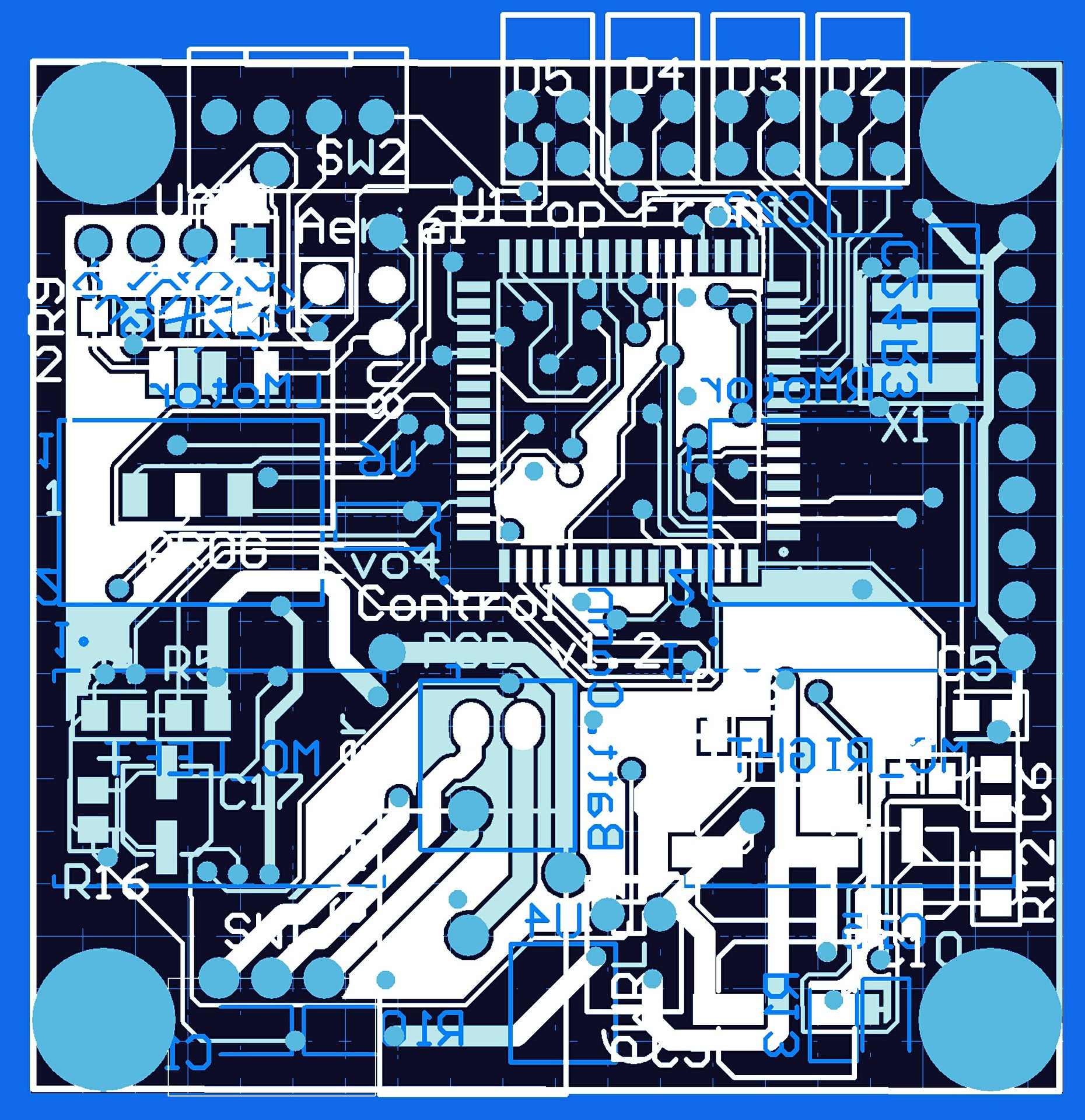
Comment les acteurs de la mémoire appréhendent-ils le passage d’une mémoire culturelle classique à une mémoire numérique ?