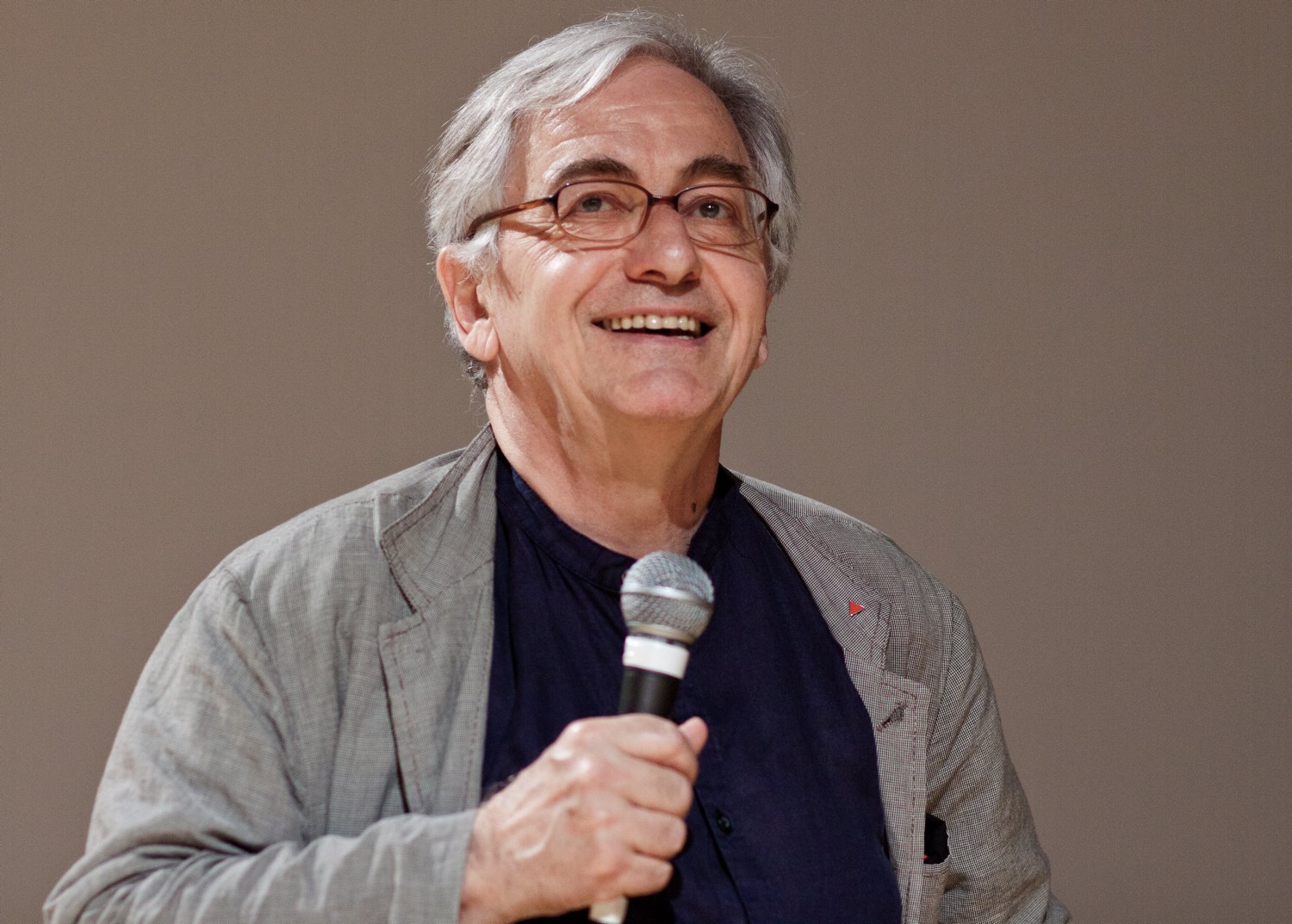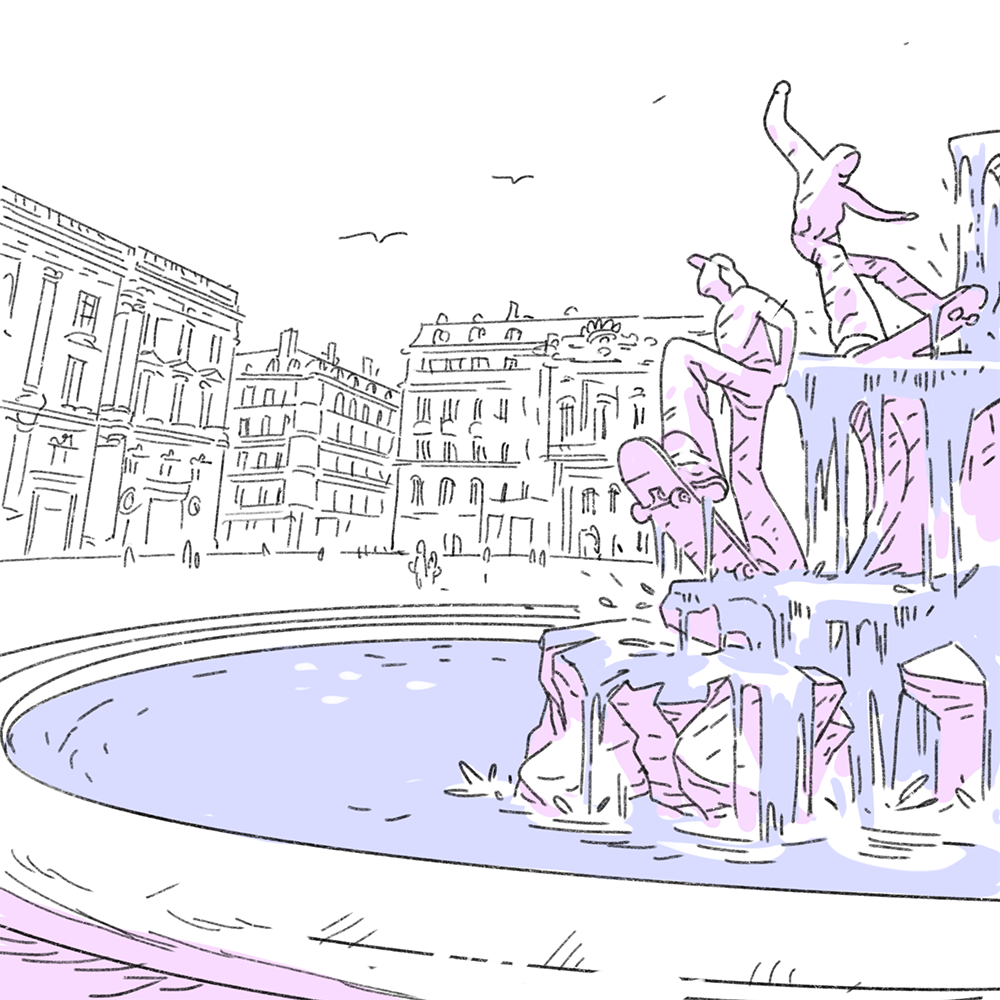À Paris, le mouvement se vit beaucoup plus comme une forteresse en dehors de tous les circuits culturels, à part le Théâtre Contemporain de la Danse qui prête des salles à certains groupes, à part Suresnes qui a invité des artistes américains pour tenter de relier le mouvement américain au mouvement parisien. Mais au quotidien, en ce qui concerne les créations ou les subventions, il n’y a pas eu ce qui s’est passé sur la région lyonnaise, où il y a eu assez vite, c’est-à-dire en 92-93, des commandes, des liens, des stages.
Il y a eu sur la région lyonnaise des échanges, non pas pour que les artistes perdent leur spécificité, mais pour qu’ils acquièrent des éléments qu’ils ne possédaient pas, comme l’utilisation de l’espace, l’écriture scénographique, la construction d’un propos (Käfig sur la cage, Accrorap sur la frontière, sur la guerre, etc.). À Paris on est plus dans le style, c’est-à-dire dans le travail individuel du danseur, avec un repli sur soi, une peur de perdre son identité. Lors des free-style, des affrontements entre les Parisiens et les Lyonnais, on s’aperçoit qu’il y une différence dans l’écriture de la danse, dans les pas, dans la manière d’aborder la danse.
Les Parisiens disent souvent aux Lyonnais, « ne perdez pas votre identité, restez bien dans le hip-hop, faites gaffe à ne pas devenir trop contemporains ». C’est un débat riche, nécessaire, et à mon avis moteur. Effectivement, est-ce qu’en montant sur scène je ne perds pas mon âme ?
Il y a un enjeu de société énorme à ce que ces artistes, du tag, du graf, de la danse, soient valorisés. La jeunesse française est créative, elle a un droit de parole. Avoir une possibilité d’ouverture vous transforme intellectuellement et culturellement. La Biennale de la Danse à Lyon a une influence énorme, c’est 2000 artistes qui vont venir défiler, cela veut dire que vous pouvez agir sur la société, que vous ne criez pas dans le désert.
Il n’y a donc plus à Lyon, contrairement à Paris, la violence comme seule solution pour être entendu. Ça, je l’ai entendu et vécu en de nombreux moments. Il y a par conséquent urgence à faire une place, à écouter ces artistes. Tous les courants de la société doivent pouvoir s’exprimer librement dans les lieux culturels, dans les opéras. Il n’y a pas qu’une culture blanche, issue d’une histoire elle-même attachée au fonctionnement de la bourgeoisie et des élites qui a un droit d’existence en France. Il faut que la démocratie puisse être une réalité dans la société française. À partir du moment où les artistes présentent de véritables œuvres, on doit les respecter, les programmer, leur donner de l’argent pour leurs créations. Ce combat-là est loin d’être gagné, surtout dans la région parisienne.