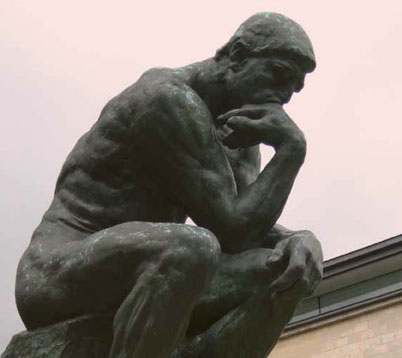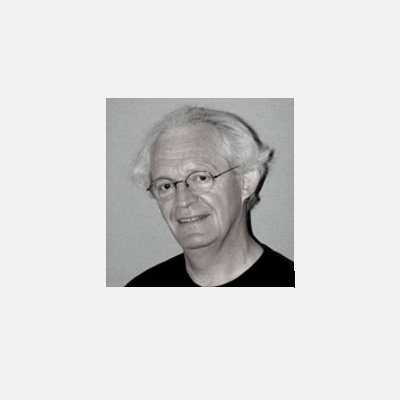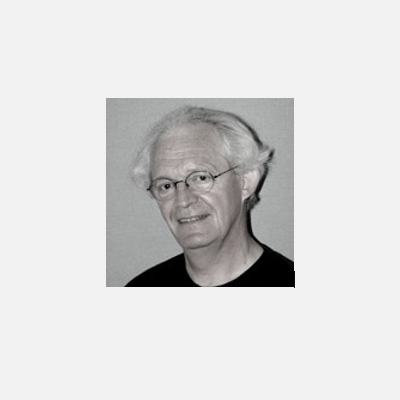« Moderne », tel se pense, tel s’affiche, Tony Garnier, membre du comité de direction de la revue La Construction moderne, membre du comité de patronage de L’Architecture d’aujourd’hui, membre de l’Union des architectes modernes. Tel le désignent ses élèves, disciples, commentateurs : « Pionnier du modernisme » (Henri Poupée), « Premier parmi les initiateurs de l’art moderne » (Pierre Bourdeix), « Architecte d’avant-garde » (Albert Morancé). Tel le désigne son principal commanditaire « Promoteur d’une Ecole nouvelle » (Edouard Herriot). Tel le classeront les historiens de l’architecture installant en majesté la triade Garnier (1869-1948), Perret (1874-1954), Le Corbusier (1887-1965).
Mais de cette revendication et de cette catégorisation il est permis d’extraire une question : qu’est-ce qu’être moderne, sachant que l’on ne peut prétendre à cette qualité qu’au regard de ce qui n’est pas, ou n’est plus, « moderne » A ce titre, cette revendication ouvre un triple rapport au temps : temps passé, dont on conteste les propriétés, dont on compte se libérer ; temps présent, que l’on entend honorer dans ce qu’il aurait de natif, d’inédit ; temps futur, dont peut prétendre se faire l’annoncier, le précurseur. La carrière d’un Tony Garnier, « l’initiateur », « le maître d’une Ecole nouvelle », fournit précisément l’occasion d’interroger la notion même de modernité. On verra, alors, qu’elle ne saurait se réduire, dans ce cas, à l’idée de discontinuité, de rupture, d’avant-gardisme. Il est permis, en effet, de la problématiser selon trois modes : celui du paradoxe, celui de la continuité, mais, aussi, assurément, celui de l’innovation.
Une modernité paradoxale
Tenu, en qualité de pensionnaire de la Villa Médicis, à des envois réguliers à l’Institut de France, Tony Garnier provoque la stupéfaction, pour ne pas dire le scandale, lors d’un premier envoi en 1901. N’informe -t-il pas ses honorables destinataires que, « reposant sur des principes faux, l’architecture antique fut une erreur », que « la vérité seule est belle » ?
Cette assertion péremptoire, manifeste d’un homme qui entend vouer son talent et dédier ses travaux à la grande cause de La Ville industrielle est à, coup sûr, l’indice d’une volonté de rupture. Rupture avec les protocoles de l’Académie, avec les injonctions institutionnelles. S’affiche ainsi la ruse de l’hôte de la Villa Médicis qui entend se servir de la renommée attachée au Prix de Rome pour déroger à ses attendus. Mais, si rupture il y a, concerne-t-elle bien le rapport à l’Antiquité ? L’écart que creuse Tony Garnier concerne, plus sûrement, les Ecoles dont il fut le témoin, le contemporain, et pour une part sans doute, le complice, si l’on prend en compte ses tout premiers travaux. Ces Ecoles sont celles de l’Eclectisme, où s’illustra magistralement son homonyme Charles Garnier (1825-1898), et celle de l’Art nouveau, que promeut son compatriote lyonnais, Hector Guimard (1867-1942). Encore convient-il de relever que l’Eclectisme architectural s’inscrit dans un temps qui est celui d’une démocratisation des pratiques artistiques et des conditions institutionnelles de leur enseignement. Le moment éclectique est, en effet, pensé, théorisé et assumé comme tel, dans une institution qui ne s’appelle plus Académie, mais qui a nom École des beaux-arts. C’est au sein de cette institution que sont mises en œuvre des procédures de travail innovatrices : l’atelier, au sein duquel l’élève choisit le maître et non le maître l’élève ; la mise en compétition et en concurrence des ateliers ; la formule du jury, qui emporte l’effet de la mise aux voix des projets élaborés. A ce titre Tony Garnier peut bien renier l’incapacité à arrêter un style et l’encombrement décoratif qui caractérisent l’Ecole éclectique, il ne peut en renier tout à fait l’esprit qui interdisait que l’art fût dépendant du bon vouloir du « prince » et de la hiérarchie des garants du bon goût.
En fait, la répudiation de l’Antiquité par Garnier ne fut jamais qu’un mot d’ordre provocateur. Mieux, le rapport à l’Antiquité n’a cessé de nourrir son œuvre, et s’il est parmi les pionniers de ce que l’on nomme « urbanisme », c’est bien en raison du modèle urbain antique qui l’inspire, opposable au désordre médiéval ou au chaos des conurbations industrielles naissantes. Et la monumentalité qu’il promeut a bien à voir, elle aussi, avec les fonctions et les proportions que l’Antiquité honorait : en témoigne la majesté du stade édifié dans le quartier dit de Gerland, à Lyon. Edouard Herriot ne s’y est pas trompé, lui qui, dans la préface à l’ouvrage de Garnier, Les Grands travaux de la ville de Lyon, le félicite d’avoir « interprété les leçons de l’Antiquité dans le sens le plus large… tout en proclamant par son exemple qu’une architecture doit être de son pays et de son temps ».
Et c’est alors que le paradoxe peut à la fois s’afficher et se dénouer. Ce paradoxe est celui du rapport entre la temporalité d’une innovation et celle de l’appel aux sources et modèles d’un passé reculé. Il est une façon de le condenser dans une formule : « retour vers le futur ». Car, dans le champ socio-historique, ne manquent pas les exemples de tels processus : ainsi d’une Renaissance européenne qui prétend enjamber des âges dits « obscurs » et se nourrir des canons intellectuels, esthétiques, des antiquités grecque et romaine ; ainsi des courants des réformes monastiques au 12e siècle, ou de la Réforme religieuse du 16e siècle, faisant retour aux archétypes d’une chrétienté originelle ; ainsi des révolutionnaires français invoquant Sparte ou se drapant dans la toge romaine ; ainsi des avant-gardes artistiques, dont Tony Garnier fut le contemporain, nourries par les arts « primitifs »… Le processus d’innovation, pas plus qu’aucun autre, ne peut naître de lui-même. Et quand il s’épure d’un passé proche c’est souvent pour appeler à lui le renfort d’un passé éloigné. A l’instar de ce que le poète Aragon a pu laisser entendre, les sociétés, comme les individus, ont « souvenance de l’avenir ».
Une Modernité en héritage
Consentons à nous éloigner de la conjoncture de l’année 1901, de ces années de formation au sein de la Villa Médicis, du rapport paradoxal que Garnier établit avec une Antiquité qu’il répudie tout en y trouvant son inspiration. Il est alors permis d’interroger les sources idéologiques de l’œuvre de Garnier dans des temps moins éloignés : celui des Lumières et celui des socialismes utopiques.
Il est, en effet, un critère décisif qui permet de rattacher l’œuvre de Garnier au moment des Lumières et plus spécialement à celui de la conception du monument éditorial que fut L’Encyclopédie : le critère est celui de l’utilité. Dans le contexte de l’édition et de la diffusion de L’Encyclopédie (1751-1772), instituer l’utilité en norme a une portée éminemment subversive. L’utilité se pense au regard de savoir-faire qu’il convient d’inventorier et de reconnaître ; l’utilité se pense au profit du plus grand nombre. On aura compris que la mise en exergue de l’utilité vise à mettre à bas les valeurs de luxe et les principes d’ostentation attachés aux moeurs aristocratiques, aux hiérarchies, statuts, fonctions relevant d’un ordre monarchique décrié. C’est à la plume de Diderot lui-même que l’on doit le très remarquable article Arts dans lequel il s’applique à inverser la hiérarchie convenue des arts libéraux et des arts mécaniques, dits encore arts serviles. Et les planches gravées qui complètent les volumes de L’Encyclopédie sont là pour attester que le monde des utilités s’édifie, non dans les palais et les églises, mais bien dans les ateliers et les manufactures.
Un peu plus d’un siècle plus tard, Garnier se fait le serviteur de la même cause. Mais les temps ont changé : « C’est à des raisons industrielles que la plupart des villes neuves que l’on fondera vaudront leur fondation » assure Garnier. Le temps n’est plus celui des agencements artisanaux, manu-facturés, mais celui des dispositifs machino-facturés dont Garnier peut observer la mise en oeuvre sur l’ensemble de la région lyonnaise. Les plans et dessins où Garnier projette sa cité industrielle font bien écho aux planches de L’Encyclopédie, tout en endossant la radicale nouveauté de la mutation industrielle.
L’appel à la veine idéologique des socialismes utopiques, lors de la conception de La Cité industrielle est patent. C’est à son contemporain Emile Zola, auteur d’un ultime roman, Le Travail, paru en 1901, que Garnier doit la référence explicite à Fourier. Pour autant, rien ne permet d’assimiler le projet de sa Cité industrielle à une entreprise phalanstérienne. Il nous faut donc ranger Garnier parmi les lecteurs attentifs de Zola, certes, mais non parmi les disciples de l’école fouriériste. Mais un socialisme dit utopique peut en cacher un autre. Et si l’on admet que Garnier ne fut pas seulement lyonnais mais sut se faire l’avocat du génie du lieu, il est légitime de l’inscrire dans la veine de l’Ecole qui, partie de Paris, trouva à Lyon sa terre d’élection, le saint-simonisme. C’est cette Ecole, en effet, qui soutint l’idée que les temps nouveaux seraient ceux de la société industrielle, réclamant une religion nouvelle, réclamant conséquemment que s’invente l’armée nouvelle, l’armée industrielle. Aux conflits guerriers relevant des temps monarchiques et impériaux était censée se substituer, à l’échelle européenne, à tout le moins, la mise en concurrence économique des Etats-Nations.
Que La Cité industrielle conçue par Garnier s’ordonne à proximité d’une voie d’eau majeure fournissant l’électricité, et qu’elle soit traversée par une importante voie ferrée, ne doit rien non plus au hasard. La Cité s’inspire directement, en fait, des sites lyonno-stéphanois, dans le cours de leur qualification industrielle. C’est bien à l’Ecole des mines de Saint-Etienne qu’est mise au point la première turbine hydro-électrique ; c’est bien à Saint-Chamond que s’installe la Compagnie des forges et aciéries de la marine ; c’est bien à Rive de Gier que les usines Hervier Frères produisent les premières briques de verre et que s’implantent les métallurgistes Marel et Arbel ; c’est bien à Lyon qu’est inaugurée, en 1896, la première usine hydroélectrique européenne, alors la plus puissante au monde, l’usine de Cusset ; c’est bien par Lyon que transite la voie du PLM, Paris-Lyon-Méditerranée ; c’est bien à Lyon que sont créés des écoles d’officiers et sous-officiers de l’armée industrielle : l’Ecole centrale (1857) et la Société d’Enseignement Professionnel du Rhône (1864). Et c’est bien au génie saint-simonien que Lyon doit d’être l’héritière de la première formule d’un « socialisme libéral » : socialisme de ceux qui prétendent mettre fin à « l’exploitation de l’homme par l’homme » en lui substituant une « amélioration de l’homme par l’homme » telle que soit effectivement améliorée « la situation matérielle, intellectuelle et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre » ; libéralisme des mêmes qui consentent à l’économie de marché et sont les acteurs du traité de libre-échange avec l’Angleterre. C’est sous cette empreinte idéologique et institutionnelle qu’il faut imaginer la mise en œuvre, à Rome, du projet de La Cité industrielle.
Une modernité à l’oeuvre
Mais alors, si malgré ses dires, Garnier est redevable à l’Antiquité, s’il est bien situé dans le lignage d’un Diderot et d’un Barthélémy-Prosper Enfantin[1], en quoi fut-il promoteur d’une Ecole nouvelle, puisque, indéniablement, il le fut. Il le fut, assurément, en raison d’un geste architectural d’épurement, soit l’éviction des compilations stylistiques et des maniérismes décoratifs de l’Ecole éclectique. Il le fut en raison de choix techniques, principalement celui du matériau antique réinventé, le béton. Il le fut en précurseur d’une pensée qui ne sera plus seulement celle du bâti, mais celle de l’urbanisme.
Mais il le fut, tout autant, en raison d’un programme idéologique et politique dont il se fit l’ardent et efficace serviteur. Le programme est celui des maires de Lyon : un maire-médecin, Victor Augagneur (1865-1931), républicain radical, recherchant ses alliances jusqu’aux socialistes guesdistes ; un jeune maire lettré, époux de la fille d’un médecin, Edouard Herriot (1872-1957), dont la figure va se confondre avec celle du Parti républicain radical et radical socialiste, mais aussi avec celle de la IIIe République. Si Herriot est bien « La République en personne », comme l’a suggéré son biographe, Serge Berstein, alors il est possible de demander ce qui s’est joué à Lyon, qui est d’une tout autre portée que locale. La réponse tombe assez vite si l’on consent à interroger ce qui fut le corps de doctrine du radical-socialisme français. Ce corps de doctrine, promu par l’économiste Charles Gide (1847-1932) et le politique Léon Bourgeois (1851-1925), le solidarisme, a pour horizon non plus seulement la République, mais la République sociale.
Cette Ecole, qui s’invente dans le contexte de l’affaire Dreyfus, tente d’obvier à ce qu’elle tient pour une triple impasse : celle du socialisme marxiste et des tenants de l’appropriation collective des moyens de production, dont la figure de proue est Jules Guesde (1854-1922) ; celle du libéralisme individualiste qui a pour avocat Léon Say (1826-1896), à qui l’on doit la formule « La charité a des limites, un bon placement n’en a pas » ; celle de la conformation catholique de la société, qui a pour champion le monarchiste Albert de Mun (1841-1914). L’Ecole solidariste se donne les moyens de cette triple réfutation en étayant sa démarche, non sur une philosophie de l’histoire, idéaliste ou matérialiste, mais sur la biologie, la physiologie et l’évolutionnisme ; en promouvant la thématique générale de l’interdépendance des composants de la nature ; en mettant à distance la figure rousseauiste de l’individu isolé ou son envers étatiste ; en défaisant abruptement le paradigme des droits de l’homme et en lui substituant celui de la triple dette : à l’égard des générations passées, présentes et à venir ; en instituant les humains en « associés solidaires » ; en honorant la philanthropie aux dépens de la charité.
C’est à partir d’une telle matrice que s’ordonne le moment « social » de l’ère républicaine française. La voie « supérieure » au collectivisme et au libéralisme qu’entend ouvrir le solidarisme permet en effet de répondre à de multiples visées. Prévention : les dispositifs de l’hygiène sociale, comme ceux du logement salubre et bon marché, permettant de lutter contre les causes de la mortalité infantile, de la tuberculose, de l’alcoolisme. Régulation : l’ordonnancement du travail s’effectuant par la voie d’une législation qui impose le repos dominical, voire la journée de huit heures. Garantie : les assurances, mutuelles ou étatiques, visant à protéger des risques majeurs de l’accident, de la maladie professionnelle, du chômage ; les cotisations de retraites devant assurer une vieillesse décente. Réparation : l’inégalité de fait étant compensée par la progressivité de l’impôt sur le revenu, par un accès gratuit, ou peu dispendieux, aux services publics, principalement ceux de la santé et de l’éducation[2].
De l’actualisation de ce programme répondent spécifiquement, à Lyon, les commandes adressées par Victor Augagneur, Edouard Herriot et leurs conseillers, tels Justin Godart (1871-1956), mais aussi les médecins Jules Courmont (1865-1917) ou André Latarget (1877-1947). Les œuvres de Tony Garnier se suivent, comme autant d’énoncés du programme solidariste : vacherie du parc de la Tête d’or assurant l’approvisionnement de l’institution de la Goutte de lait ; construction des abattoirs de La Mouche ; édification du stade de Gerland ; construction de l’Hôpital Grange Blanche sur des protocoles innovants ; construction de La Cité-jardin du quartier des Etats-Unis.
La modernité d’un Garnier peut, à présent, se décliner sur un tout autre mode que celui de l’affranchissement à l’égard des normes académiques, de la relégation des styles antérieurs surannés. Elle s’atteste bien dans les visées novatrices de l’architecte-urbaniste inaugurant un geste qui a pu s’apparenter à un protocole de table-rase et paru ouvrir une nouvelle page de l’histoire des arts. Mais il faut consentir à la penser comme effet de confluence. Confluence, bien accordée au génie du lieu, de l’esprit d’utilité des Lumières, de l’industrialisme saint-simonien, du solidarisme républicain. Si Herriot a pu passer pour « La République en personne », on peut avancer l’idée que Garnier fut le radical-socialisme en actes, ou le « solidarisme en personne ».
͢ Pour poursuivre, découvrez l’interview de Régis Neyret (1927 - 2019), journaliste, fondateur de Patrimoine Rhônalpin, ex-délégué général de la Halle Tony Garnier.