Ville intelligente, ville inclusive ?

Article
La smart city, concept apparu dans le sillage des nouvelles technologies numériques et de l’information, est-elle inclusive ?



Article
Tag(s) :
Le problème des quartiers de « banlieue » occupe la scène publique depuis maintenant une quarantaine d’années. Ses traitements médiatique (focalisation sur le spectaculaire : « rodéos », « émeutes », « violences urbaines ») et politique (création de la Politique de la ville et successions de mesures depuis le programme Habitat et vie sociale en 1977 jusqu’aux programmes de rénovation urbaine puis de renouvellement urbain et social des années 2000) contribuent paradoxalement à stigmatiser la banlieue par le diagnostic qui en est fait. Dans les années 1960, il était psychologique où l’on désignait par « sarcellite » le mal-être et l’isolement social dans les grands-ensembles [1]. À partir des années 1970, les jeunes hommes, immigrés ou descendants d’immigrés pour beaucoup, qui occupent l’espace public en bandes sont associés aux problèmes sociaux du quartier (délinquance, insécurité, chômage, errance juvénile, violence, trafics et consommation de drogues, etc.). La peur sociale se répand et la jeunesse masculine des classes populaires devient la nouvelle figure des « classes dangereuses » [2].
Dans les années 1990, ces représentations se sont accentuées et furent accompagnées d’un discours sur une contre-société qui se développerait dans les cités, où les jeunes, impliqués dans de multiples trafics, imposeraient leurs lois au détriment du droit commun, et où l’islam radical gagnerait progressivement du terrain [3]. De nombreux journalistes n’hésitent pas à employer le terme de « ghetto » et ses représentations symboliques [4]. Un ensemble de productions médiatiques alimentent ces représentations, qu’elles passent par le spectacularisme des reportages vidéo sur la police ou par des articles qui allient les notions « d’insécurité », de « délinquance », de « banlieue », de « radicalité » politique et religieuse, de « communautarisme », de « repli » et « d’entre-soi ». La perspective du ghetto s’adosse à un discours public qui relie l’immigration aux problèmes sociaux rencontrés dans les quartiers populaires. Les styles de vie qui s’y développent constitueraient une menace pour la République française : « l’intégration républicaine » serait mise en cause par la montée d’un « communautarisme religieux » [5]. Par ailleurs, la visibilité donnée au « problème des banlieues » [6] fut accrue par les émeutes de 2005, tantôt perçues comme de simples irruptions de violences juvéniles sans fondements politiques, tantôt symboles d’une revendication (proto)politique [7] de citoyens de seconde zone.
C’est dans ce contexte [8], qu’au tournant des années 2000, le paradigme du ghetto s’est renforcé, non sans controverse scientifique et semble s’être prolongé dans la décennie suivante. Si la notion ne fait que peu débat dans la sphère médiatique, tant il correspond à une catégorisation à la fois spectaculaire, chargée d’histoire et d’affect, et accessible dans l’imaginaire collectif, elle est plus critiquée en sciences sociales. Est-il raisonnable de parler de « ghetto » pour qualifier la situation des cités françaises ? Leurs habitants sont-ils parqués dans des « ghettos », contraints à y résider tout en souhaitant s’en échapper ? Qu’est-ce qui définit le « ghetto » et le distingue d’un autre quartier ? L’appropriation par certains sociologues d’un terme du sens commun est-elle pertinente ? Sur ces questions les chercheurs ne s’accordent pas tous. L’objectif de cette note est de faire le point sur l’usage d’une notion à fortes conséquences politiques et sociales en rendant compte des grandes lignes d’opposition.
Avant toute chose, il convient de rappeler que le terme de « ghetto » charrie une histoire qui renvoie fatalement à la comparaison avec les ghettos juifs, l’apartheid en Afrique du Sud ou les ghettos nord-américains. Le géographe Hervé Vieillard-Baron distingue plusieurs significations qui ont évolué dans « des directions incontrôlées ». Une première renvoie à l’histoire de l’exclusion des juifs au 16ème siècle à Venise ; une seconde à la géographie, au quartier cloîtré ; une signification sociologique évoque la marginalisation d’un groupe social ; sur le plan politique on pense à l’ostracisme du pouvoir envers une catégorie de population ; enfin, symboliquement, le ghetto est associé au stigmate d’un territoire et de ses habitants. Hervé Vieillard-Baron estime ainsi que l’usage d’un tel concept pour qualifier certaines situations dans les banlieues françaises relève de l’usurpation : « D’évidence, le concept, opératoirement mal déterminé du point de vue de son extension, reste très intuitif dans son intention. Son emploi est destiné à provoquer, à faire choc. En jouant sur les affects, le mot enferme l’objet désigné dans des représentations dangereuses par les connotations flottantes et péjoratives auxquelles elles renvoient. En se prêtant dramatiquement à la mise en scène, le mot ghetto fait écran - notamment à propos des ‘‘banlieues’’ sensibles où il conditionne les jugements portés de l’extérieur » [9].
En sciences sociales, la description des cités HLM comme des « ghettos » s’inscrit dans la filiation des travaux sur l’exclusion sociale des années 1980-1990 et mobilise le thème de la « relégation » [10]. Les banlieues sont décrites sur le mode du cumul de handicaps à l’aide d’indicateurs statistiques qui proposent une représentation défavorable des habitants (handicaps sociaux, échec scolaire, faiblesse des revenus, etc.). Les représentations statistiques du ghetto ont depuis été étayées par des analyses sociologiques plus riches [11]. L’approche de Didier Lapeyronnie apparaît comme la plus pertinente et la plus fournie : le sociologue a enquêté dans un quartier relégué de 5000 habitants d’une ville de taille moyenne. Sa méthode dite de l’ « intervention sociologique » combine des groupes de travail entre habitants et acteurs institutionnels avec des entretiens individuels et collectifs réalisés avec les habitants.
Dans son ouvrage intitulé Ghetto urbain, Didier Lapeyronnie tente de conceptualiser ce terme souvent employé dans le langage ordinaire. On ne saurait toutefois retenir une seule définition générique, tant l’analyse est florissante, rendant de ce fait la notion assez lâche. Plus qu’un espace urbain, le « ghetto » est avant tout un mode de relations sociales : « Il est une ‘‘construction sociale et morale’’, individuelle et collective, complexe et contradictoire. Il permet de répondre à une série de contraintes, pauvreté, isolement, racisme, domination institutionnelle, tout en créant d’autres problèmes et produisant d’autres blessures tant pour ceux qui y participent que pour ceux qui y vivent. […] Le ghetto n’est pas une situation. Il est une catégorie d’action dans un ensemble de rapports sociaux » [12]. Il est ainsi le résultat d’une « addition » de phénomènes de ségrégation raciale, de pauvreté, de relégation sociale et politique et d’isolement social, et d’une adaptation des habitants face à cette situation de relégation. Les structures les plus centrales au ghetto sont : « la ‘‘rue’’ avec sa culture et son occupation par les ‘‘jeunes’’, la famille, les règles de définition des relations entre les sexes et les formes d’identification raciales qui lient et parfois opposent les individus entre eux » [13].
S’il était difficile de parler de « ghetto » dans les années 1980, Didier Lapeyronnie estime qu’« aujourd'hui [en 2008], la situation a fortement évolué : le renforcement de la ségrégation urbaine et de la discrimination raciale, l'accroissement considérable du chômage et la formation d'une organisation sociale spécifique aux quartiers ségrégués, marquée notamment par toute une ''culture de la rue'' portée par des ''jeunes'', par la rupture de la communication entre les sexes et par l'usage endémique de la violence, autorisent à formuler l’hypothèse d'une formation logique de ghetto » [14]. Depuis quelques années, le quartier de « Bois-Joli » subit, comme d’autres, les effets sociaux du déclin industriel, des délocalisations et du chômage ouvrier accentuant un peu plus le contraste avec le centre-ville et les beaux quartiers dans lesquels résident les classes moyennes et supérieures. Il y existerait une forme de contre-société qui se positionnerait en rupture par rapport à la société majoritaire et qui délimiterait une frontière symbolique entre « eux » et « nous ». Le quartier tiendrait un rôle ambivalent dans la vie de ses habitants puisqu’il agirait à la fois comme un « cocon protecteur » face aux expériences d’altérisation [15] et de discriminations vécues mais représenterait également une « cage » coupant les individus des ressources de la société majoritaire.
Ainsi, le « ghetto urbain » se définit par la relégation sociale : la ségrégation socio-spatiale conjointe d’une image négative des quartiers « ghettos » conduisent à l’isolement, au rejet et à la méfiance. Si bien que l’étiquette négative du quartier structure les relations avec autrui et handicape lourdement ses habitants, notamment sur le marché du travail. Didier Lapeyronnie parle ainsi de « processus d’exil ». Et par-delà la rupture territoriale, le « ghetto urbain » représente un espace social et mental autonome : « lieu où cette population a fini par fabriquer des modes de vie particuliers, des visions du monde organisées autour de valeurs qui lui sont propres, bref une forme d’organisation sociale qui lui permet de faire face aux difficultés sociales et d’affronter les blessures infligées par la société » [16]. Il serait règlementé par des normes et valeurs sociales traditionnalistes en matière d’éducation parentale, de relations hommes-femmes, de mœurs sexuelles, de vie de couple, etc. L’intensité des liens d’interconnaissances à laquelle s’adossent une violence endémique, les règles de l’économie informelle et une surveillance accrue des habitants entre eux, participeraient à la normalisation de la vie sociale locale, régulant notamment les échanges et circulations de biens symboliques (rumeurs, réputations, honneur, etc.). Le monde du ghetto est un monde segmenté, dans lequel les individus se définissent les uns par rapport aux autres et occupent une position dans l’espace social, selon leur appartenance à un groupe d’âge, de genre, et/ou ethnique. Le racisme extérieur se rejouerait au sein du ghetto, par des formes d’identification raciale et de distinctions entre groupes ethniques.
Bien que les observations de Didier Lapeyronnie s’avèrent pertinentes sur de nombreux points, certaines analyses posent la question de leur généralisation d’une telle réalité sociale, à la fois à tous les habitants du quartier et à tous les quartiers ségrégués français. De même que l’on peut regretter une approche qui semble parfois céder le pas au misérabilisme, tant les registres négatifs du manque, du handicap social lié au ghetto sont omniprésents. Elles s’inscrivent dans un débat sociologique qui voit s’opposer depuis une vingtaine d’années les partisans du « ghetto » et leurs contradicteurs (par exemple le sociologue Loïc Wacquant propose, dans Parias urbains, d’appliquer au cas français la notion inverse d’« anti-ghetto »).
Hormis l’ouvrage de Didier Lapeyronnie, d’autres chercheurs se sont positionnés par rapport à l’usage de cette notion. C’est le cas du sociologue Thomas Kirzbaum et de l’économiste Frédéric Gilli qui estiment que le terme n’est pas adapté à la rigueur scientifique, mais que des résonnances avec l’histoire européenne ou américaine existent bel et bien. Le ghetto serait à la fois urbain mais également « culturel » et « mental ». Le sociologue Manuel Boucher, a également choisi d’employer le concept de ghetto pour qualifier le quartier qu’il a étudié dans Les internés du ghetto [17]. D’autres, tels que Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal, considèrent que le ghetto, comme espace physique de cumul des handicaps et d’assignation à résidence a une portée empirique : « Ainsi, nombre de quartiers classés en ZUS souffrent de plusieurs handicaps : géographique (urbanisme et architecture fonctionnels, environnement dégradé, enclavement...) ; socio-économiques (taux de chômage élevé, nombre important de personnes touchant des aides sociales...) ; scolaires (taux d’échec scolaire et de redoublement élevés...) ; sanitaires (faible présence de médecins, recrudescence de maladies oubliées...) les enfermant progressivement à l’intérieur d’un ensemble de frontières tant physiques et sociales que symboliques et représentationnelles. C’est dans ce sens que le recours à la notion de ghettoïsation – de plus en plus admise comme un concept semble-t-il –, voire de ghetto, revêt une pertinence heuristique » [18].
Hors champ sociologique, l’économiste Eric Maurin constate un « séparatisme social » et remarque que la société française serait marquée par la défiance et le repli dans un entre soi. L’ancien Maire de Vénissieux (1985-2008) et député du Rhône (1993-2012), André Gerin, a publié en 2007 un ouvrage destiné à interpeller la classe politique sur « Les ghettos de la République », sombrant dans le catastrophisme. Selon lui, la fracture sociale serait si forte dans certains quartier, et notamment aux Minguettes, que la violence sociale et physique qu’elle engendre contiendrait les germes d’une « guerre civile ».
Malgré ces représentations largement diffusées du ghetto, un certain nombre de sociologue réfutent l’usage du concept. Ce sont notamment les cas de Loïc Wacquant [19], de Pierre Gilbert [20] ou, dans une autre mesure de Jean-Marc Stébé [21]. Ils remarquent en premier lieu que les analyses du « ghetto » s’appuient sur des bases empiriques discutables. Méthodologiquement, cette vision leur paraît trop réductrice. D’une part, elles mobilisent des données statiques qui n’appréhendent pas les flux de populations pourtant bien réels, qu’ils s’agissent de mobilités régulières (déplacements quotidiens par exemple) ou pérennes (déménagement). D’autre part, les analyses par le « manque » et le « handicap » ne prennent pas en considération l’ensemble de la vie sociale, culturelle et associatives des quartiers populaires. En cela, elles se livrent au misérabilisme décrié par Jean-Claude Passeron et Claude Grignon [22] en se focalisant sur des pratiques ostensibles de culture juvénile ou des discours empreints de représentations stéréotypées sur la banlieue.
On oppose généralement à l’approche de Didier Lapeyronnie le travail de Loïc Wacquant. Ce dernier a en effet effectué une comparaison entre quartiers relégués de Chicago et de la Courneuve, basée sur des observations empiriques et statistiques réalisées dans les années 1990. Son étude se penche sur les évolutions institutionnelles et structurelles qui amènent à l’apparition des ghettos aux États-Unis. L’objet est alors quelque peu différent de celui de Didier Lapeyronnie qui analyse le « ghetto » comme un « espace social et mental » selon une approche par les expériences subjectives des individus [23]. Loïc Wacquant entend recontextualiser et historiciser les situations des quartiers populaires français et américains. Il propose une définition du ghetto basée sur quatre éléments [24] :
En suivant cette caractérisation, il apparait ainsi que la notion de ghetto n’est que très imparfaitement adaptée à la situation des banlieues françaises que Loïc Wacquant préfère qualifie d’« anti-ghetto ». Il y a en effet une différence majeure avec les États-Unis qui concerne l’intervention des pouvoirs publics dans les quartiers relégués. En France, l’État par l’intermédiaire de la politique de la ville a mis en œuvre une action publique sans commune mesure avec la situation de désertion institutionnelle observée à Chicago.
L’ensemble des travaux académiques qui mobilisent le concept de ghetto, s’il est hétérogène, se structure a minima autour de deux arguments :
Ainsi, la relégation socio-spatiale et l’enfermement sont deux piliers de la notion de ghetto. Or, ces thèses sont incapables de penser ni les échanges entre groupes sociaux, ni les mobilités quotidiennes hors du quartier qui caractérisent pourtant la vie de nombreux habitants.
Plusieurs études ont montré que les cités françaises ne sont pas des « nasses » mais plutôt des « sas », c’est-à-dire des lieux de passage et de brassage de populations. Contrairement à ce qu’affirme Didier Lapeyronnie, vivre en cité n’est pas toujours un choix subi, ni une contrainte [27]. Dans bien des cas, le déménagement dans un quartier HLM constitue une amélioration notable des conditions de résidence (confort ou superficie) et s’apparente à un tremplin vers une mobilité sociale et résidentielle. La précarité d’un territoire n’est pas incompatible avec l’amélioration des conditions pour de nombreux habitants. D’ailleurs les mobilités résidentielles des immigrés et descendants d’immigrés du Maghreb et d’Afrique subsaharienne sont fréquentes et souvent ascendantes (qu’elles soient directe ou intergénérationnelle [28]). L’arrivée dans le quartier fait alors office de « première installation ».
L’autre constat, celui de la ségrégation socio-raciale est réel mais les travaux de Loïc Wacquant viennent nous rappeler qu’il reste incomparable avec les configurations urbaines étasuniennes. Les exploitations de l’enquête TeO [29] le confirment. Néanmoins, on ne saurait se satisfaire d’une réponse par la comparaison outrancière pour balayer une telle réalité sociale. Le principal problème de l’approche statistique de la ségrégation est épistémologique : elle se réfère à des données statiques. Les sciences-sociales sont effectivement capables de mesurer un fort taux de concentration de pauvreté, de chômage, d’exclusion socio-raciale et d’autres d’indicateurs sociaux négatifs. En revanche, cette approche doit être combinée avec une étude des trajectoires résidentielles. Car sinon, les données récoltées et analysées ne sont que des photographies prises à un moment précis de la composition sociologique d’un quartier, mais rien n’indique que la photographie suivante, à un autre moment, ne concerne les mêmes personnes, quand bien même les caractéristiques restent identiques.
Les observations indiquent que les populations les plus stables quittent le quartier, pour être remplacées par les plus précaires. Statistiquement la population reste exclue et reléguée. Dans les faits, il y a une dynamique de renouvellement des habitants des quartiers en politique de la ville. Plusieurs études ont montré que les cités françaises sont à la fois des « nasses » pour les ménages les plus précaires mais également des « sas » de passage, pour les ménages qui accèdent à une forme de stabilité professionnelle. Les multiples opérations de renouvellement urbain depuis les années 2000 ont affecté la composition sociologique des quartiers et favorisé, pour certains, des trajectoires résidentielles ascendantes, alors que d’autres se sont endigués dans la précarité [30].
C’est enfin, une vision normative de l’ordre social qui fait apparaître la vie de quartier sous un angle purement négatif: « Cette vision de l’ordre social des cités contient au final de fortes tendances misérabilistes : les habitants y sont définis soit par leurs manques, soit par des dispositions faisant obstacle à leur intégration sociale » [31]. En plus de l’amélioration des conditions de vie, de nombreux habitants sont attachés à leur quartier, en raison de leur ancrage local ou de la proximité familiale et sociale. La force des habitudes, des réseaux de solidarités et d’entraide tissés avec le voisinage, la sécurisation qu’apporte la routine quotidienne et l’intensité des liens sociaux constituent des sources d’attachement au quartier, qui ne peuvent pas être pensées par le modèle de l’absence, du manque ou du handicap social. Les réseaux de voisinage peuvent offrir des ressources compensatoires face aux discriminations liées à l’origine sociale, ethnique et résidentielle. Ainsi, les travaux autour du « capital d’autochtonie » [32] montrent combien l’ancienneté de la présence dans un quartier et l’ancrage dans les réseaux sociaux locaux sont susceptibles de modifier le statut individuel local. L’effet du capital social n’est donc pas systématiquement négatif : « les réseaux de voisinage des quartiers pauvres ou des territoires ethniques peuvent offrir aux habitants des filières d’insertion professionnelle qui parfois compensent les faiblesses individuelles et les effets des discriminations » [33].
Insister sur les multiples dimensions de la vie sociale des quartiers permet de nuancer les thèses qui mobilisent le registre du capital social négatif. Celles-ci présentent les quartiers « ghettos » au travers de formes culturelles négatives, des jeunes de banlieue, afin de mettre en évidence les contradictions avec les normes majoritaires (violence, économie parallèle, culture de rue, sexisme, etc.). Mais, si ces observations sont indéniables, il est en revanche difficile de les généraliser à l’ensemble du quartier. Tous les habitants des cités ne sont en effet pas entièrement coupés du reste de la société. Ils ne développent pas uniquement des formes de vie sociale « négatives » qui les handicaperaient dans leur accès aux ressources de la société majoritaire. Beaucoup sont attachés à leur quartier et y vivent paisiblement au quotidien. De sorte que pour une grande partie des habitants, le quartier à la fois une ressource aussi bien qu’une contrainte qui prend sa forme objective dans les parcours de vie [34].
Un dernier reproche, souvent attribué aux thèses sur le « ghetto » est de ne se focaliser que sur une partie de la population. Pierre Gilbert montre que ce raisonnement procède par synecdoque. Autrement-dit, l’analyse élargit maladroitement des observations réalisées sur une catégorie minoritaire de la population en les généralisant à l’ensemble des habitants du quartier. Ce sont alors les pratiques et les représentations, de certains jeunes hommes des quartiers populaires qui font office de référentiel transposable à l’ensemble la population.
En se référant aux travaux de David Lepoutre [35], le ghetto urbain, tel qu’il est décrit, représenterait plutôt une sous-culture juvénile, « la culture des rues » qui disparaît bien souvent durant le passage à l’âge adulte [36]. Les groupes de jeunes, essentiellement masculins, qui occupent l’espace public local ne partagent pas les mêmes styles de vies que bien d’autres habitants d’un même quartier. De même qu’il existe des différences entre quartiers, il en existe aussi à l’intérieur même des quartiers. On ne peut pas réduire la diversité des profils à une même identité d’« habitant d’un ghetto » partageant une même culture sécessionniste avec la société majoritaire : les « effets de quartier » [37], les différences d’âges, de sexes, d’histoires familiales, d’origines sociales et migratoires, de parcours scolaires et professionnels conditionnent des expériences très hétérogènes du « ghetto ».
Sur le plan politique, une telle conceptualisation présente un danger, celui de renforcer le stéréotype. On le sait, les images collectives véhiculées sur les quartiers populaires stigmatisent les habitants des quartiers populaires [38]. Une telle logique transposée à l’analyse sociologique, constitue un danger pour le sociologue, qui se doit de contraindre son propos à la finesse d’analyse afin d’offrir une description d’une réalité sociale complexe sans risquer d’essentialiser des quartiers populaires et leurs habitants.
Malgré les lectures différentes du ghetto certaines convergences empiriques attestent d’une évolution des cités françaises depuis les années 1980 : services publics en déclin, relations de dépendance des familles pauvres aux travailleurs sociaux, place grandissante des économies souterraines dans l’ambiance générale du quartier, fonction sociale de la violence, expériences de l’indignité, du mépris et de la justice vécues par les habitants, chômage et déclin du monde ouvrier. Ces constats sont partagés par Loïc Wacquant et Didier Lapeyronnie. Ce qui les distingue en revanche, c’est la place accordée aux logiques de racisme et de différenciations de genre, comme le rappelle bien Michel Kokoreff : « L’une consiste à prendre acte des formes de paupérisation sociale et de marginalisation urbaine qui travaillent les espaces de relégation dont certaines cités et grands ensembles sont le symbole, sans aller jusqu’à considérer que la radicalisation de cette situation conduit au ghetto, mais sans non plus occulter le poids de l’histoire sociale de l’immigration et du racisme. L’autre hypothèse franchit le pas, considérant que, face aux effets conjugués de la pauvreté, de la relégation et de la discrimination, le racisme ne vient pas donner sens à cette logique : il participe à la formation du ghetto, ce qui renvoie à la logique coloniale. […] C’est ce qui distingue fondamentalement son diagnostic de celui de Wacquant, dont le raisonnement semble ne pas être le même pour les deux pays qu’il compare. S’il reconnaît en effet le poids de la division raciale et de l’origine ethnique dans un cas, il tend à dénier la réalité des processus de racialisation et d’éthnicisation des rapports sociaux dans l’autre, au risque de perdre l’acuité du regard global qu’il porte » [39].
Sur un plan politique, si le choix de ce terme a l’avantage de dénoncer les conditions d’existence dans les grands-ensembles français, parce qu’il est spectaculaire, il peut en revanche avoir une conséquence négative : parler de « ghetto » produit des effets de réel sur les habitants et leur manières de se représenter dans la société. Sa portée performative peut également influencer l’image collective sur les cités, renforcer certains stéréotypes et orienter, en bout de chaîne, les concepteurs des politiques publiques.
Loin de réserver les controverses conceptuelles à un champ scientifique détaché de tout ancrage social, les concepts sociologiques sont des lunettes, un prisme, une manière de regarder et de construire le réel. Ainsi, ce terme de « ghetto » est à la fois un concept qui permet d’analyser et de révéler le monde social et une notion qui engage des représentations collectives. Dès lors, il incombe au chercheur d’en questionner conjointement sa portée heuristique – ce qu’il apporte en termes de production de connaissances–, les conséquences stratégiques de son usage – les dimensions symboliques qu’il véhicule dans l’espace publique et politique – mais également ce qu’il produit en termes de rapports sociaux – envisagées dans leurs dimensions spatiale, historique et politique – lorsqu’ils font l’objet d’appropriations spécifiques par les acteurs. Ce questionnement est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit ici de qualifier un espace urbain et son mode d’organisation sociale ternis par une image sociale négative voire infamante. Doit-on se réapproprier un langage ordinaire qui fait collectivement sens, au risque d’en accentuer les représentations, ou une rupture épistémologique avec le discours commun est-elle nécessaire dans l’analyse sociologique des cités françaises ?
Une proposition de Jean-Marc Stébé, de raisonner en processus de « ghettoïsation » mérite d’être d’avantage creusée. Elle fournit plus de souplesse que la notion rigide et figée de ghetto. Elle offre ainsi une perspective processuelle, tendancielle et différenciée. En d’autres termes, elle admet que le ghetto n’existe pas forcément dans tous les quartiers HLM – voire dans aucun quartier français –, ni pour tous les habitants d’un même quartier. La ségrégation socio-spatiale, si elle constitue une tendance qui s’accroît depuis quelques dizaines d’années [40], n’en est pas au même stade que dans les ghettos étasuniens, comme le rappelle très justement Loïc Wacquant. De même que les dynamiques de contre-société, de d’enfermement, de délinquance, de ségrégation, de précarité, d’effets de lieu ou de résidence, d’origine migratoire, d’expériences de socialisation et de parcours diffèrent fortement selon les cas étudiés entre les quartiers mais aussi au sein du quartier. Comme l’explique Jean-Marc Stébé, penser en termes de « ghettoïsation » permet de « mettre en évidence des tendances à la concentration territoriale de la pauvreté à partir de dimensions spatiales, sociales, économiques, politiques, institutionnelles ou même ethnique » [41]. Il revient alors à prendre en considération ces transformations sociales des quartiers, les effets du temps, les différences de contexte tout en reconnaissant le caractère inopérant du concept de « ghetto ».
In fine, cette approche a le mérite de considérer les apports empiriques du « ghetto urbain » [42] tout en se distanciant de sa lecture statique et généralisante. Elle nous semble capable de penser les différences territoriales et sociales à un trois niveaux : entre quartiers populaires – ne pas essentialiser chaque grand-ensemble HLM tel un « ghetto urbain » – ; au sein du quartier – penser « les effets de quartier » [43] – ; et surtout entre les « sous-populations » habitant le quartier – la ghettoïsation, comme processus social et mental correspondrait plus à un « jeune de cité » engagé dans la « culture des rues » [44], qu'à un couple bi-actif en voie d’ascension résidentielle.
La ghettoïsation n’est cependant pas la panacée à toutes les critiques. L’une d’entre-elles qui mérite d’être prise au sérieux est la même que celle que l’on peut appliquer au ghetto : sur quelles délimitations et critères méthodologiques se fondent ce concept ; de quoi et/ou de qui parle-t-on exactement lorsque l’on désigne le processus de ghettoïsation ?
Depuis quelques années, plusieurs enquêtes sociologiques ont permis d'objectiver l’existence d’une ségrégation urbaine à différents niveaux [45] : la constitution de « ghettos » de riches, comme le suggèrent les recherches des sociologues Pinçon-Charlot [46], est statistiquement avérée. À l’aune de ces constats, les enjeux politiques de la répartition urbaine se posent : comment endiguer les mécanismes de segmentation des villes, qui génèrent de l’entre-soi et de l’exclusion sociale, renforcent l’inégale répartition des ressources collectives et participent de ce fait à la reproduction d’un ordre social inégalitaire ?
[1] Dans sa thèse sur Les classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine, Pierre Gilbert le décrit ainsi : « Les grands ensembles font ainsi l’objet de violentes campagnes de dénigrement dans la presse dès la fin des années 1950 et en 1963, une série d’articles sur la ‘‘sarcellite’’, mal des grands ensembles dont les femmes sont les victimes, fait la une de France-Soir » (p. 69).
[2] CHEVALIER Louis, « Classes laborieuses et classes dangereuses pendant la première moitié du XIXe siècle », Population, 14ᵉ année, n°3, 1959. pp. 577-578.
[3] Se référer au chapitre intitulé « Banlieue et exclusion », de l’ouvrage d’Emmanuelle Santelli, Les descendants d’immigrés, qui traite notamment des différentes figures associées aux jeunes de banlieues.
[4] C’est par exemple le cas du responsable éditorial du Monde Luc Bronner, qui s’essaye sur la « loi du ghetto » : BRONNER L., 2010, « La loi du ghetto », Enquête sur les banlieues françaises, Calmann-Lévy.
[5] Sur l’usage (ou le mésusage) de ce terme, se référer à MOHAMMED Marwan et TALPIN Julien, Communautarisme?, Paris, Presses universitaires de France, 2018.
[6] TISSOT Sylvie, L’état et les quartiers: genèse d’une catégorie de l’action publique, Paris, Seuil, coll. « Collection Liber », 2007.
[7] MAUGER Gérard, L’émeute de novembre 2005: une révolte protopolitique, Bellecombe-en-Bauges, Croquant, coll. « Collection Savoir-agir », 2006.
[8] L’ouvrage suivant propose une analyse synthétique de la question des cités françaises : Avenel CYPRIEN, Sociologie des quartiers sensibles, Paris, Armand Colin, 2013.
[9] VIEILLARD-BARON, Hervé. « Ghetto ». Hypergéo (en ligne), 2004, http://www.hypergeo.eu/spip.php?article471.
[10] La relégation renvoie à un processus d’exclusion, où les situations résidentielles sont subies.
[11] Sur ces questions des représentations de la banlieue, se référer à l’ouvrage de synthèse suivant :
[12] LAPEYRONNIE Didier, Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Paris, Robert Laffont, 2008, p. 23.
[13] Ibid. p. 18.
[14] Ibid. p. 13.
[15] Entendu comme le fait d’être renvoyé à une forme d’altérité (à ses origines, à sa couleur de peau, à une appartenance à un groupe social minoritaire, etc.).
[16] LAPEYRONNIE Didier, Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Paris, Robert Laffont, 2008, p. 11.
[17] BOUCHER M., 2010, « Les internés du ghetto. Ethnographie des confrontations violentes dans une cité impopulaire », Lectures, Les livres.
[18] MARCHAL, Hervé et STÉBÉ, Jean-Marc. 2010. La ville au risque du ghetto, Paris : Lavoisier, p. 57.
[19] WACQUANT Loïc, Parias urbains: ghetto, banlieues, État, Paris, Éd. la Découverte, coll. « La Découverte : Poche Sciences humaines et sociales », no 262, 2007.
[20] GILBERT Pierre, « “ Ghetto”," relégation"," effets de quartier". Critique d’une représentation des cités », Métropolitiques. eu, 2011.
[21] BOUCHER Manuel et Hervé MARCHAL, Banlieues, cités ghettos, bidonvilles, campements.... Définitions, mythes et réalités, Paris, L’Harmattan, 2019. Dans le chapitre 3, Jean-Marc Stébé prend formellement parti contre l’usage de ce concept. Il estime que le terme s’est banalisé dans les espaces médiatico-politique et scientifique mais « ne permet pas véritablement de rendre compte de la réalité complexe des quartiers HLM défavorisés notamment parce que la notion de ghetto plaque d’emblée un point de vue statique et négatif » p. 78.
[22] Un enjeu épistémologique des recherches sur les classes populaires, nous rappellent Grignon et Passeron, est de ne pas céder aux tentations misérabilistes ou populistes. Le danger, lorsque le chercheur est confronté à l’analyse des classes populaires et des phénomènes de domination et marginalisation des pauvres est de vouloir sauver la face en insistant sur les phénomènes de résistances et d’organisations et d’émancipation face à l’expérience de la domination et par cela de céder à la tentation du populisme. Son pendant inverse, tout aussi risqué, le misérabilisme, équivaut quant à lui à insister sur l’iniquité des mécanismes oppressifs et de la domination jusqu’à présenter les individus comme amorphes, désorganisés, sans ressource, passifs et incapables d’y faire face. Cf. GRIGNON Claude et Jean-Claude PASSERON, Le savant et le populaire: misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Gallimard: Le Seuil, 1989
[23] Pour une analyse comparative convaincante des deux ouvrages, se référer au texte de Michel KOKOREFF, « Ghettos et marginalité urbaine », Revue française de sociologie, Vol. 50, no 3, 16 septembre 2009, p. 553-572
[24] WACQUANT, Ibid., p. 10.
[25] Sur les logiques d’attribution discriminatoires voir par exemple : BOURGEOIS, Marine. 2013. « Choisir les locataires du parc social ? Une approche ethnographique de la gestion des HLM », Sociologie du Travail, vol. 55, n° 1 ; se référer également aux travaux de Christine Lelévrier.
[26] WACQUANT, Ibid. p. 10.
[27] Didier Lapeyronnie estime que « le ghetto suppose une ségrégation forcée et non choisie, imposée et non élective. Les habitants y vivent contraints, ne pouvant aller ailleurs tout en aspirant au départ » ; « Les habitants n’ont pas choisi d’y vivre. Ils se sont trouvés contraints par les circonstances de venir s’y installer. En aucun cas le quartier n’a été l’objet d’un choix » in, LAPEYRONNIE Didier, op. cit., p. 12 et p. 56.
[28] PAN KÉ SHON, Jean-Louis. 2011. « La ségrégation des immigrés en France : état des lieux », Population et sociétés, n° 477.
[29] PAN KÉ SHON, Jean-Louis et SCODELLARO, Claire. 2011. « Discrimination au logement et ségrégation ethno-raciale en France », Documents de travail de l’Ined, n° 171.
[30] Une enquête de l’observatoire de la politique de la ville, montre bien l’ampleur des mobilités résidentielles sur la région lyonnaise, dont les résultats sont objectivables à l’échelle du territoire national : Nicole FRENAY-PONTON et al., « Les mobilités résidentielles des ménages quittant les quartiers en politique de la ville. Enquête et récits de vie des habitants dans la métropole de Lyon », Observatoire national de la politique de la ville, rapport annuel 2017, p. 134-150.
[31] GILBERT Pierre, Les classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Transformations spatiales et changement social dans une cité HLM, Thèse de doctorat en sociologie, université de Lyon II, 2014, p. 76.
[32] RETIÈRE Jean-Noël, « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix. Revue des sciences sociales du politique, vol. 16, no 63, 2003, p. 121-143.
[33] GILBERT Pierre, op. cit., 2014, pp. 75-76. On pourrait toutefois interroger la fonction politique de ce voisinage. Autrement-dit, doit-on se satisfaire d’une telle situation où le voisinage endosse le rôle de ressource compensatoire face à des discriminations qui influencent durablement les parcours de vie ?
[34] L’ouvrage d’Emmanuelle Santelli, Grandir en banlieue : parcours et devenirs de jeunes Français d’origine maghrébine, Paris, CIEMI, coll. « Collection Planète migrations », 2007, montre combien le quartier est un élément central dans les parcours de vie d’une cohorte de jeunes ayant grandi dans la banlieue lyonnaise. C’est également un des objets de mon travail de thèse, que de démontrer l’ambivalence du rapport au quartier et ses effets, à l’âge adulte, sur les parcours d’individus ayant grandi en cité.
[35] LEPOUTRE, David, Cœur de banlieue: codes, rites et langages, O. Jacob, 1997.
[36] Un autre objectif de mon travail de thèse est justement d’aborder cette problématique : s’agit-il d’une culture juvénile qui disparaît avec le passage à l’âge adulte, ou la situation actuelle de précarité de l’emploi et de ségrégation socio-spatiale maintient-elle les individus, une fois adulte, dans une situation semblable au « ghetto » ?
[37] Emmanuelle Santelli a montré dans Grandir en banlieue que « L’effet de la localisation est très net et a de nombreuses répercussions sur la perception positive ou non du quartier. […] Il semble que la proximité géographique avec ce qui fait centralité soit un des éléments pour limiter l’effet de ‘‘mise à distance’’ qui est une des premières manifestations de l’exclusion sociale. Les jeunes qui vivent à proximité du centre-ville se sentent plus appartenir à ce dernier que les autres jeunes », in SANTELLI Emmanuelle, Grandir en banlieue, op. cit., p. 189.
Pour d’autres analyses sur les « effets de quartier » de référer au chapitre d’ouvrage suivant : AUTHIER Jean-Yves, « 16. La question des « effets de quartier » en France. Variations contextuelles et processus de socialisation », dans Le quartier. Enjeux scientifiques, action politique et pratiques sociales, Paris, La Découverte, 2006, p. 206-216.
[38] C’est d’ailleurs ce qu’observe Didier Lapeyronnie dans Ghetto urbain, notamment dans les pages 137 à 164.
[39] KOKOREFF Michel, op. cit., p. 568.
[40] PAN KÉ SHON Jean-Louis, « Ségrégation ethnique et ségrégation sociale en quartiers sensibles. L'apport des mobilités résidentielles », Revue française de sociologie, 2009/3 (Vol. 50), p. 451-487.
[41] BOUCHER Manuel et MARCHAL Hervé, Banlieues, cités, ghettos, bidonvilles, campements… Définitions, mythes et réalités, L’Harmattan, Paris, 2019, p. 78.
[42] LAPEYRONNIE, Didier, Ghetto urbain, op. cit.
[43] AUTHIER, Jean-Yves, « 16. La question des "effets de quartier" en France. Variations contextuelles et processus de socialisation ». Le quartier. Enjeux scientifiques, action politique et pratiques sociales, La Découverte, 2006, p. 206‑216.
[44] LEPOUTRE, David, op. cit.
[45] Se référer à l’ouvrage de synthèse suivant : Oberti Marco et Edmond Préteceille, La ségrégation urbaine, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2016.
[46] Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Les ghettos du Gotha. Comment la bourgeoisie défend ses espaces. Paris, Éd. Le Seuil, coll. Essais, 2007, 294 p.

Article
La smart city, concept apparu dans le sillage des nouvelles technologies numériques et de l’information, est-elle inclusive ?

Interview de Camille Peugny
Sociologue

Texte de Benjamin LIPPENS
Doctorant en sociologie, Benjamin Lippens présente ici son projet de recherche.

Ce dossier est créé en appui au travail de thèse « Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin Lippens, doctorant en sociologie.

Ce dossier est créé en appui au travail de thèse « Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin Lippens, doctorant en sociologie.

Ce dossier est créé en appui au travail de thèse « Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin Lippens, doctorant en sociologie.
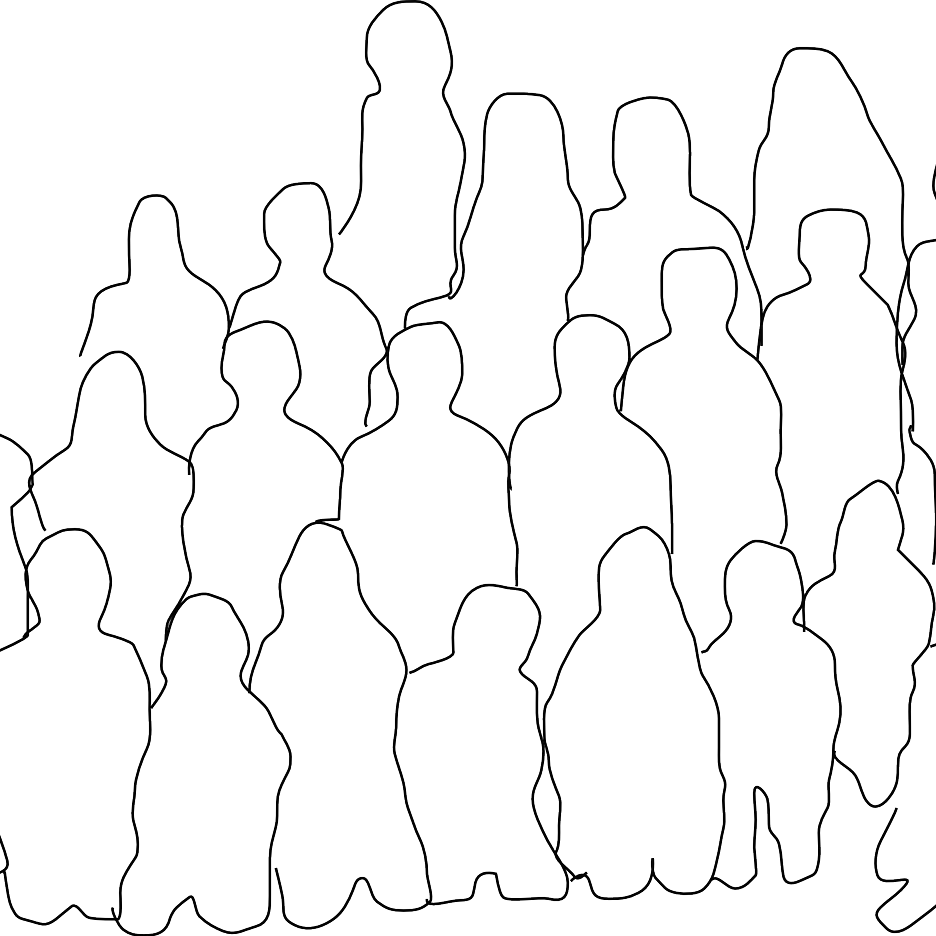
Texte de Pierre GROSDEMOUGE
Au-delà des indicateurs quantitatifs habituels, que nous apprennent les enquêtes sociologiques récentes sur cette question ?

Interview de André GERIN
Député Maire de Vénissieux en 2008

Interview de Bruno VOISIN
Sociologue à l’Agence d’urbanisme du Grand Lyon