Michel Desmurget : « C’est l’ensemble de notre humanité qui est impacté par les écrans »

Interview de Michel Desmurget
directeur de recherches en neurosciences à l'INSERM, à l'Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod
Interview de Laurent Chicoineau

<< La science, la connaissance c’est aussi du plaisir, le plaisir de comprendre et d’expliquer aux autres… >>.
Après avoir été chroniqueur scientifique à Radio France, puis concepteur multimédia, Laurent Chicoineau dirige de 2002 à 2017 le Centre de culture scientifique technique et industrielle (CCSTI) de Grenoble. Il est actuellement directeur du Quai des Savoirs, un nouvel espace culturel sur les sciences et l’innovation à Toulouse. Laurent Chicoineau a également éré professeur associé à l'Université Grenoble Alpes pendant 7 ans, où il était co-responsable du Master de communication scientifique et technique.
Quelles sont les caractéristiques de Quai des Savoirs, le centre de science que vous dirigez à Toulouse ?
Nous sommes un centre de science qui travaille sur le contemporain, sur l’actualité de la recherche et sur la prospective, avec un équipement très original parce qu’il assemble des compétences et des capacités multiples. Le Quai des Savoirs est un projet qui n’a que 2 ans et qui a connu quelques difficultés au démarrage. De ce fait, il n’a pas encore pris toute son envergure. Le challenge qu’on m’a proposé il y a quelques mois, c’est d’être à la fois sur une logique de mutualisation, de partenariat structurel et de projet.
Le Quai des Savoirs est un projet hybride, avec un bâtiment qui appartient à la Métropole de Toulouse et qui accueille du public d’une manière assez classique, à travers des expositions, des ateliers, des événements culturels, etc. C’est aussi un lieu d’incubation, avec la Cantine Numérique de Toulouse, et c’est le bâtiment Totem de la French Tech de Toulouse. Cet incubateur de start up accueille aussi des associations de culture scientifiques et techniques et un café. Planète Science Occitanie y a un bureau par exemple, ainsi qu’un théâtre de Toulouse. Cet assemblage de structure constitue une dynamique intéressante.
C’est un lieu que j’essaie de développer en promouvant la poly-disciplinarité : ne pas rester dans une simple juxtaposition de projets dans un bâtiment, mais générer une dynamique commune, même si évidemment tout le monde ne travaille pas avec tout le monde simultanément. Pour moi, et pour les fondateurs du projet, cela fait sens de réunir développement de l’économie numérique, espace d’exposition sur les enjeux de société, ateliers pour les petits, café où l’université vient faire des cafés science, associations qui conçoivent des produits de médiation pour la grande région Occitanie… Cette colocation intelligente est d’une grande richesse.
A quels objectifs, à quelles attentes doivent répondre les CCSTI, dont le premier a été créé à Grenoble, à la fin des années 70 ? Quels sont leurs liens avec l’Education Populaire ?
Aux débuts des CCSTI, il n’y avait pas de professionnels de la culture scientifique et technique, c’était d’abord une affaire de militants. Le Palais de la Découverte à Paris était la seule structure qu’on pourrait aujourd’hui considérer comme un CCSTI. C’est en province, et en particulier à Grenoble qu’est née une dynamique sur la CST. Autour de l’organisation des JO de 68, la ville de Grenoble s’est incroyablement modernisée. Il y a eu la création de la Maison de la Culture, la rénovation du Musée Dauphinois, une nouvelle approche pour le Musée des Beaux-Arts, etc. Un secteur science, porté par des universitaires de l’université de Grenoble, venus des SHS comme des sciences dites dures a été créé au sein de la Maison de la Culture dès la fin des années 60. Ces acteurs gravitaient aussi dans l’orbite de Peuple et Culture. Et c’est là qu’on retrouve le lien avec l’Education Populaire. Il y a donc une affiliation avec l’idéologie de Peuple et Culture, et avec l’Education Populaire qui est à la base du CCSTI de Grenoble. On retrouve cet esprit dans les autres CCSTI. C’est pour cela que les CCSTI se sont toujours sentis proches des milieux de l’Education Populaire, même s’ils ne sont pas (ou plus) labellisés comme tels par les institutions nationales d’Education Populaire.
A la Maison de la Culture, tout était fait pour que les gens puissent venir en famille, avec un minimum de contraintes, il y avait par exemple une garderie… Les scientifiques qui militaient pour la création de la Maison de la Culture étaient aussi des militants comme Cécil Guitart, qui était à Peuple et Culture… Quand je les ai interviewés, pour mon ouvrage sur l’histoire du CCST de Grenoble, ces acteurs considéraient que la science faisait partie intégrante de la culture, au même titre que le théâtre, le spectacle vivant, danse et musique, la médiathèque.. Il y avait une approche transversale, transdisciplinaire, tout à fait dans l’esprit de l’Education Populaire et d’action culturelle versus création artistique.
Quelle était alors la position des professionnels de la CST ? Est-elle différente de celle des animateurs de l’Education Populaire ?
On a vu émerger dans les années 80, un clivage entre les médiateurs culturels et scientifiques, ou plus exactement entre ceux issus des sciences sociales et ceux issus des sciences de la nature. On a d’un côté, des médiateurs scientifiques qui estimaient qu’il ne leur appartenait pas de prendre position. Pour eux, la technique et la science sont neutres. Le travail du médiateur est alors d’informer le public le mieux possible pour qu’il puisse se faire son opinion. C’est le public qui décidera s’il est pour ou contre telle ou telle question sur les OGM ou les nanotechnologies…. Et d’un autre côté, il y avait des médiateurs, issus eux plutôt du circuit artistique, qui travaillaient par exemple pour le théâtre, qui considéraient qu’il leur appartenait de prendre partie, notamment pour dénoncer les dérives ou les risques,à leurs yeux, de la société technologique. Il y avait pas mal de discussions, voire de conflits entre les équipes de médiations, sur la manière de concevoir leur mission, entre ceux qui voulaient vulgariser et ceux qui voulaient alerter.
C’est une tension que l’on retrouve encore aujourd’hui, même si le milieu s’est institutionnalisé et professionnalisé. Il s’est aussi autonomisé, à mon grand regret, car il se retrouve parfois à tourner en circuit fermé. Mais cette question de la neutralité de la science et de la technologie revient toujours dans les réunions, les conférences, les séminaires sur la culture scientifique et technique. Beaucoup de scientifiques des sciences dures, plus que ceux issus des sciences sociales d’ailleurs, pensent souvent que la science est neutre et que l’enjeu porte sur l’information du public. Tout en mésestimant les effets de parole d’autorité, de tribune, de distanciation.
Qu’est-ce qui a changé sur ces questions de médiation scientifique hormis Internet ?
Aujourd’hui, l’articulation avec le monde de la recherche et l’université est beaucoup mieux faite, car il y a des professionnels de la médiation et de la communication dans les universités et les centres de recherche. Cela a engendré une modification du rôle des CCSTI. Il ne s’agit plus seulement pour eux de faire de la communication scientifique, ils doivent se repenser et c’est tant mieux. De mon point de vue, cela permet de revenir à d’autres pratiques proches cette fois du milieu culturel et artistique. Car on peut avoir une approche artistique et culturelle pour parvenir à mettre en débat et en question la science et les innovations, pour apporter d’autres regards moins strictement pédagogiques.
En effet, la vulgarisation de la culture scientifique en a parfois appauvri la complexité en étant souvent dans des approches très et parfois trop didactiques. Parler de questions scientifiques en s’appuyant sur l’art et sur une muséographie contemporaine permet de déclencher des questionnements, de solliciter autrement le visiteur. Il me semble que les expositions de vulgarisation ne sont pas très efficaces. Elles ont perdu de leur pertinence dans un contexte où l’information et le savoir circulent différemment.
On n’a pas non plus analysé la transition entre animateurs socio-culturel et médiateurs. Tout d’un coup, les animateurs ont préféré qu’on les appellent des médiateurs. Or il me semble qu’il nous faut nous interroger sur ce que nous faisons. Qu’est-ce que ça signifie vraiment si on ramène ça aux pratiques de terrain ? L’idée de la médiation ça consiste à ouvrir, à donner des perspectives, à accompagner, à faire monter en capacité plutôt que de donner son savoir. Mais aujourd’hui, il y a pas mal de médiateurs qui sont en fait des guides conférenciers et qui font un travail d’animateur assez classique. Ce qui n’est pas forcément mal en soi, mais cela pose question.
Pourquoi la notion d’Education Populaire a-t-elle été marginalisée, alors que la question de l’appropriation critique ou simplement technique de ces technologies est toujours d’actualité ?
Oui, l’actualité est réelle. Et on n’a jamais autant parlé de capacitation, d’empowerment qu’au cours de ces dernières années. Pour ma part, je reste convaincu que ce que nous faisons, relève de missions d’Education Populaire. Mais il est vrai aussi que cette expression est connotée négativement aujourd’hui. L’Education Populaire renvoie à une image dépassée, voire sclérosée, enfermée sur elle-même. Ce processus de divorce ou de relation qui s’étiole entre Education Populaire et le mouvement de la culture scientifique et technique, est un effet collatéral du processus d’institutionnalisation du monde de la CST.
Plus largement, dans le monde économique, culturel, politique et médiatique, le mot « socioculturel » est devenu un gros mot… Et le terme d’Education Populaire est mis à distance. Or, ce secteur associatif peut se mobiliser, et le monde scientifique et même le monde politique n’est pas forcément à l’aise avec ça. On sait bien qu’il y a un enjeu de citoyenneté derrière. Il me semble que c’est lié au fait de l’institutionnalisation. C’est un effet collatéral, qu’on retrouve dans d’autres disciplines.
Par ailleurs, comme pour tout mouvement de pensée, il y a des choses qui étaient en pointe et qui deviennent désuètes. Par exemple on a parlé un moment d’art et science, d’art médiatique, d’art sociologique, d’art technologique… Ces notions, à part peut être pour la relation arts et sciences semblent dépassées. Il y a des effets de bulles, des modes, tout le monde s’approprie un concept, puis il éclate. Pour autant, cela ne veut pas dire que les acteurs et leurs institutions se soient arrêtés de se préoccuper de ces questions. Autrement dit, ce qui est intéressant, ce n’est pas l’appellation, c’est plutôt le fond, le cœur du sujet.
Malgré les points communs évidents entre les objectifs de l’Education Populaire et les missions des CCSTI, il y a néanmoins eu un divorce ?
Le problème de l’Education Populaire par rapport à la CSTI, c’est que la CST est aussi beaucoup basée sur la technique, l’informatique, le numérique. Or il faut avoir du goût pour cela. Si les gens ne s’intéressent pas à ces domaines, s’ils ne les utilisent pas eux-mêmes, cela ne fonctionnera pas, on sera au mieux dans une forme de prescription descendante. C’est un peu comme d’enseigner une matière qu’on n’aime pas… Il faut s’intéresser au sujet, faire par soi-même. Si je suis convaincu de l’intérêt du numérique, c’est que je le pratique, c’est que j’expérimente beaucoup, pour mon usage personnel, avec des réseaux professionnels, dans mes loisirs, dans mon travail…
Or sur ces questions du numérique au sens large, beaucoup de gens ont été dépassés, et les acteurs de l’Education Populaire n’échappent pas à ce syndrome. Les acteurs de l’Education Populaire n’ont pas fait évoluer leurs pratiques professionnelles, et il me semble qu’ils ont eu du mal à prendre le tournant du numérique. Cela s’explique aussi parce que l’Education Populaire a longtemps été dans une approche critique vis-à-vis des nouvelles technologies. Ils ont souligné les questions sociétales qu’elles posaient, qui ne sont pas à négliger, c’est vrai, mais sans non plus essayer de saisir ce qui était en train de se jouer.
Or le public auquel ils s’adressaient, et le public en général n’a pas non plus l’opportunité de se saisir du numérique. Dans les CCST, c’est notre travail, notre mission de service public que d’aider les gens à s’y familiariser. On parle souvent de Wikipedia, mais comment aller au-delà de la consultation ? On constate qu’il n’est pas si facile d’y contribuer pour un néophyte. Aussi avons-nous proposé des ateliers pour apprendre aux gens à être contributeurs. Plus largement, notre travail consiste aussi à diffuser ce que les geek pratiquent avec facilité. Ces spécialistes du numérique, souvent autodidactes, ne sont pas forcément très ouverts à ceux qui n’y connaissent pas grand chose. Il y a des communautés, qui défendent l’open source, comme Linux, mais qui sont peu à même de se faire entendre. Pour les néophytes en informatique, on a fait des « install party », car les militants de l’open source ne sont pas forcément pédagogues. Ce sont toutes ces passerelles d’outils de médiation qui n’ont pas toujours été développées par les animateurs de l’Education Populaire.
A propos de partage des connaissances, vous avez travaillé sur la production de Mooc. Que retirez-vous de cette expérience ?
On a produit et animé un Mooc dans le cadre du programme Investissements d’Avenir sur la médiation culturelle et scientifique sur les réseaux sociaux. Nous en avons fait un bilan positif, même si nous avons été confrontés à un problème que rencontre tous les organisateurs de Mooc : un taux de perte en ligne considérable. Un Mooc, c’est exigeant à suivre. Le public doit se mobiliser pour les cours, interagir, faire des propositions… Ce qui veut dire in fine qu’un Mooc présente non pas une forte barrière à l’entrée, mais sur la durée. S’agissant de notre expérience, nous avons contourné le problème en nous adressant à des professionnels, plutôt qu’au grand public. Nous avions pour cible la communauté des médiateurs culturels et scientifiques. On visait les gens travaillant dans des bibliothèques, des théâtres, etc. Lorsqu’on cherche à toucher un public ciblé, alors on a un meilleur taux de suivi.
Nous avons beaucoup échangé avec le public qui suivait ce Mooc, sans jamais donner de réponses. Le collectif qui organisait le Mooc était dans une logique de transfert d’expérience, mais ne se positionnait pas en expert. Ce qui m’a marqué, c’est cela : les utilisateurs se sont organisés, avec l’aide d’un community manager, pour pouvoir échanger pendant les semaines de la diffusion du Mooc. Et sur cette période, nous avons pu observer une expérience d’intelligence collective. Il y avait des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui au travers des activités que nous leur proposions, interagissaient entre eux, construisaient des propositions, essayaient de trouver des solutions à des problèmes ensemble.
Ainsi, dans un contexte particulier, avec un public ciblé, on a démontré que les outils numériques ont un réel potentiel de médiation, et qu’au-delà de ça, ils offrent des possibilités d’apprentissage, d’analyse, etc. Un Mooc reste cependant un projet assez lourd en termes financiers, humains, intellectuels : derrière un Mooc, il y a toute une ingénierie de fabrication et un travail d’animation très importants. C’est un investissement, ça ne se fait pas à la légère. On a eu d’autres propositions, mais qui n’ont pas abouti pour ces raisons d’investissement.
Quels sont les liens entre un fab lab, les makers et l’Education Populaire ?
Ils sont nombreux ! Nous avons créé un fab lab et je considère que c’est de l’Education Populaire. Avec Planète Science Occitanie et Science Animation à Toulouse nous sommes en train d’imaginer un maker space pour le Quai des Savoirs. Le « faire, » c’est notre culture depuis des années. Pourtant, pour les acteurs de la culture scientifique et technique, il n’a pas été toujours simple de s’emparer de la culture maker. La culture maker, n’est pas envisagée de la même façon selon les pays. En France, on parle de bricolage, et c’est souvent déconsidéré, on pense en général que ça n’est pas vraiment intéressant, alors qu’aux Etats-Unis, c’est noble quelqu’un qui bricole. Aux Etats-Unis, un maker c’est un Elon Musk en puissance, alors qu’en France on ne voit qu’un gentil papy en bleu de travail…
Cela change, mais il y a eu une résistance institutionnelle. Beaucoup de gens nous ont regardé de haut quand nous avons monté un fab lab à la Casemate. D’ailleurs, il est révélateur qu’il n’y ait pas eu d’atelier de bricolage à la Cité des Sciences avant notre programme Inmédiats ! Pourtant, quand on visite des laboratoires du CNRS ou du CERN ou de tout autre institution, on y voit bien des chercheurs et des chercheuses qui bricolent… Le fab lab c’est une actualisation de l’Education Populaire parce qu’il permet de s’interroger sur les usages, les données, la propriété, il n’est pas un simple lieu de transmission d’un geste technique.
On a donc vu de vrais effets avec le fab lab à la Casemate. Par rapport à l’Education Populaire classique, on nous a dit, c’est l’équivalent d’un atelier bois dans une MJC… Oui, mais à la différence près que nos machines sont à commandes numériques, ce qui n’est pas forcément le cas dans les ateliers bois. Et que plus largement, le numérique, une fois encore véhicule d’autres valeurs, permet de parler d’open source, de partager des plans, de développer une créativité commune, d’utiliser et de contribuer à des licences ouvertes, de s’appuyer sur les creative commons pour diffuser des projets initiés dans le fab lab, etc.
Par ailleurs, on questionne nos usagers sur la contrefaçon, sur la propriété intellectuelle… Autrement dit, un fab lab a d’autres fonctions que l’apprentissage et la transmission technique. J’y apprends que je n’ai pas le droit d’y faire un faux T-Shirt Nike, parce que c’est interdit… On a souvent été confronté à des discussions sur ces enjeux avec des jeunes. Plus largement, le fab lab ouvre aussi sur l’Internet des objets. On y a développé des projets avec des capteurs de données, et on s’est interrogé sur la l’usage des traces numériques. Donc, au-delà du bricolage, le fab lab ouvre sur de nombreuses questions.
Sur cette question de la participation, de nombreuses pratiques artistiques cherchent à associer les spectateurs, à les faire participer. Est-ce qu’on trouve la même chose dans le champ scientifique ?
S’agissant du visiteur, il est clair qu’il n’a jamais été considéré dans la culture scientifique comme un simple spectateur. C’est quelque chose de central pour l’ensemble des professionnels du domaine. On peut donc porter ça au crédit des CCSTI, à la Cité des Sciences et à l’ensemble des acteurs de la culture scientifique. C’est vraiment dans les gènes de la culture scientifique et technique. On le voit si on regarde les textes fondateurs des CCSTI comme ceux de Franck Oppenheimer, qui définissaient le projet d’exploratorium à San Francisco (San Francisco, c’est le modèle type de centre de science, qui a inspiré le monde entier). La question centrale, c’est celle de l’interactivité, de la manip’ (aux USA, ces lieux s’appellent des « hands on » museum). Aujourd’hui, dans les expositions scientifiques, les gens explorent. C’est devenu un axiome. On cherche à mettre les visiteurs dans une situation active, cela va du simple bouton à actionner, jusqu’à d’autres techniques plus sophistiquées. C’est un principe fondateur : les gens agissent pour comprendre, pour s’approprier.
De plus, l’idée de participation est allée au-delà des expositions : on s’intéresse à la participation citoyenne, à l’élaboration ou à l’appropriation des choix scientifiques et techniques, à la compréhension des enjeux, etc. C’est toute l’histoire des années 2000 avec la montée en puissance du débat public, proposant de nouveaux espaces délibératifs. Beaucoup d’acteurs de la culture scientifique en France et en Europe ont travaillé sur ces questions. Aujourd’hui, on connaît un « revival » de la science participative. L’interaction ne se résume plus à presser un bouton. Avec le numérique, on peut passer la main à des jeunes pour faire des vidéos scientifiques sur Youtube. On est aussi dans l’appropriation, une forme d’interaction très forte avec les visiteurs.
Comment réagissez-vous à la production d’information à vocation scientifique sur des plateformes de partage ?
Sur les plateformes on trouve des informations sur des innovations, comme d’autres qui portent sur des questions largement connues. Ce qui intéressant, c’est qu’elles sont en capacité de générer des voix nouvelles, qui parlent de science autrement. Bien sûr, cela comporte des risques d’erreur, mais il n’y a pas de littérature scientifique sans erreurs. Je ne partage pas le procès en méfiance qui est fait aujourd’hui à Youtube ou à Wikipedia ou aux informations qui circulent sur des plateformes. Evidemment, cela suppose d’avoir un bon appareil critique, pour être capable de distinguer ce qui est intéressant de ce qui l’est moins.
Du coup la question de l’interactivité avec le spectateur est plus complexe. J’ai un peu travaillé avec Experimentboy, un youtubeur qui propose des vidéos à caractère scientifique. Il y a une interactivité réelle, il propose des sujets, demande au public de voter pour choisir les sujets. Les gens le suivent et regardent ses vidéos. Il crée des relations avec ses visiteurs. Il crée des relations interactives, pas d’égal à égal, mais des vraies relations avec sa communauté. Cela dit, les youtubeurs scientifiques ne sont pas nécessairement à la pointe dans leur représentation de la science et des chercheurs. Certaines vidéos véhiculent parfois des stéréotypes, avec un chercheur en blouse blanche… On peut retrouver sur ces plateformes de la bonne vieille vulgarisation à la papa, qui ne se préoccupe pas de la dimension sociétale, des enjeux éthiques, économiques ou culturels des sciences. Là se trouve parfois la limite à ces démarches autodidactes.
Mais le plus notable à mes yeux, c’est que cela atteste d’un engouement pour la science que l’on retrouve dans le nombre d’inscrits dans les masters de médiation scientifiques, dans les associations scientifiques et donc avec ces youtubeurs scientifiques. Ça c’est un phénomène assez génial. Cela rappelle que la science, la connaissance c’est aussi du plaisir, le plaisir de comprendre et d’expliquer aux autres… C’est important pour soi et pour la société. Plus largement, tout cela contribue à ce que les gens développent un esprit critique, qu’ils soient en capacité de participer à notre démocratie, de développer le vivre ensemble, etc. Tout cela sur une base rationnelle, avec des faits et des connaissances qu’on peut partager..
Cela dénote aussi que la pratique des médias est aujourd’hui partagée, elle est appropriée par des gens capables de faire des vidéos et qui ont parfois une vraie écriture, qui sont des auteurs, sans avoir fait d’études audio-visuelles. C’est une richesse, cela ouvre la porte à de nouveaux publics qui à leur tour s’approprient des connaissances grâce aux nouveaux media et à un usage développé par des amateurs.
Cela a-t-il une incidence sur la manière dont vous travaillez, dont vous concevez vos productions ?
Une partie des publications sur Internet sont faites par d’autres acteurs que des spécialistes. Ce sont souvent des gens jeunes, ou des passionnés de sciences qui font des chroniques scientifiques avec leurs mots, avec une forme de décalage. Dans le « monde d’avant », plus régulé, quelqu’un qui n’avait pas de formation scientifique, ne devenait pas chroniqueur scientifique… Ce sont donc d’autres profils, qui disent la même chose que ce que dit la fac ou les labos, mais avec d’autres moyens. La forme qui change.
D’un certain côté, les youtubeurs ont donné un coup de vieux aux institutions de culture scientifique et technique. Ils arrivent avec leurs 300 000 followers, ils publient des vidéos, alors que nous n’avons parfois pas plus de 10 000 visiteurs pour une exposition. Le rapport au public est très différent. Certaines institutions s’en inquiètent, pour moi, il y a une relation à construire. Certains de ces youtubeurs néanmoins ont envie et ont parfois aussi besoin de la caution que peut leur apporter l’institution. Ils cherchent souvent à avoir des liens avec nous. Nous nous posons aussi la question de comment capitaliser sur les propositions faites par les youtubeurs, que pourrait-on construire dans la durée à travers ça ?
On parle de vérité alternative… N’est-ce pas préoccupant pour toutes les institutions qui diffusent un savoir perçu comme institutionnel ?
Pour ce qui concerne ce qu’on appelle les faits alternatifs, il y a effectivement une posture à tenir pour les responsables d’institutions. J’ai été courtisé par ReOpen 9-11, qui a une approche complotiste du 11 septembre, qui dit que l’attaque des tours new-yorkaises a été montée par la CIA, on nous ment, etc. J’ai été harcelé par eux, et je fais en sorte de ne pas leur répondre. Je n’entre pas dans le débat. Au Museum d’histoire naturelle, des collègues ont été assaillis par des associations créationnistes. Et ces gens-là ont aussi davantage de possibilités et de moyens pour se faire entendre.
Cela nous pose question et entre collègues, entre institutions : faut-il inviter un créationniste si l’on fait un débat sur l’évolution des espèces ? La réponse majoritaire c’est de dire non. Parce que ça n’est justement pas un débat. Sauf si bien sur un fait nouveau surgissait. On ne va pas débattre pour savoir si la terre est plate ou ronde, il y a suffisamment de preuves qui montrent qu’elle est ronde… Autrement dit, mon métier, c’est d’organiser des échanges, de poser des controverses. Mais ça n’est pas d’être totalement relativiste ! Je ne considère pas qu’on peut mettre au même niveau un chercheur en biologie des espèces et un créationniste, ils ne sont pas sur le même plan. Par contre, organiser des débats sur des questions que se posent des groupes sociaux, sur par exemple les effets négatifs des ondes, alors là, oui, bien sûr. Parce qu’on a des gens malades, parce qu’on a des scientifiques qui constatent des désordres et parce qu’on en a d’autres qui les contestent ou les relativisent.
Si c’est un sujet de débat parce qu’il y a des interrogations, si c’est de la recherche, alors nous avons un rôle à jouer. Mais si c’est présenté comme de l’alternatif, parce que la « vraie science nous ment », s’il y a des biais, s’il y a des groupes de pressions, s’il y a des méthodologies contestables, etc, non, ça n’est pas notre rôle de relayer ces discours. Même si je ne suis pas là pour défendre l’institution, je pense qu’il faut qu’on soit clairs et qu’on se positionne aussi par rapport à ces dérives.
Comment des institutions telles que les CCSTI peuvent-elles conserver un public et ne pas être à leur tour dépassées comme on pu l’être les associations d’Education Populaire ?
Notre rôle c’est aussi d’accompagner et parfois d’aider à être critique. Ce qu’il faut garder en tête, c’est que ce qui est en ligne demande un effort de la part du public. De même que cela lui demande un effort de venir jusqu’à nous, dans nos murs.
L’autre grand mouvement, depuis 2 ou 3 décennies pour les institutions, c’est la question du rapport au grand public. Pour moi, cela ne veut rien dire le grand public, c’est une catégorie qui n’existe pas. Les institutions seraient fondées sur ce rapport au grand public, alors que youtubeurs et les formes numériques de médiation, parlent de leur communauté, de leurs abonnés. Les institutions ont à réfléchir sur leur public : il n’y a rien de mal à abandonner l’idée de grand public, et à faire évoluer notre rapport au public. La ménagère de moins de 50 ans, c’est la pub des 60’, c’est pas 2020 ! Aujourd’hui, on n’est plus dans cette logique-là, la ménagère n’existe plus - si jamais elle a existé un jour. On se doit d’avoir une relation au public différente.
Mais c’est une révolution copernicienne, car dans les CCST, il y a comme un plafond de verre, on n’arrive pas à élargir nos publics, on a du mal à être pris au sérieux par le monde économique, par exemple. Comment peut-on faire ? Est-ce qu’on peut s’appuyer sur ce qui se développe par la culture numérique ? Est-ce qu’on peut considérer le public comme une communauté d’intérêt qu’on cherche à élargir et à faire vivre plutôt que parler du public comme des gens qui ne connaîtraient rien et qui attendraient tout de nous ?
Tout cet environnement qui change, cela nous a incité à faire bouger les lignes, à faire des expérimentations. Si nous faisons toujours des expositions, des ateliers et des rencontres, cela impacte sur les méthodes des professionnels et provoque un rapport au public différent. Il faut que l’on intègre que le public connaît aussi des choses, qu’il a des savoirs et que cela doit changer notre manière de travailler.
Les études de public nous disent que nos institutions demeurent dignes de confiance. Elles sont une référence, dans un monde où on est submergé d’informations, où on ne sait plus qui croire. L’institution est toujours porteuse de sens. C’est aussi pour cela que les youtubeurs essaient de travailler avec les institutions, pour obtenir une sorte de labellisation ou de reconnaissance. Dans notre époque post moderne, tout n’est pas noir ou blanc, il y a toujours une ambivalence. Il y a de nouvelles formes de diffusion du savoir qui apparaissent, mais les formes plus classiques perdurent, elles vont même travailler ensemble…
Certes, l’institution doit s’analyser mais elle doit aussi comprendre ses forces. Il y a une alliance à trouver, par rapport à ces nouvelles formes, qui ont d’autres dispositions que les nôtres. Notre ambition, c’est de trouver des moyens de coopérer, plutôt que de combattre ou d’ignorer de tels phénomènes, qu’ils soient visibles sur Youtube ou ailleurs.

Interview de Michel Desmurget
directeur de recherches en neurosciences à l'INSERM, à l'Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod
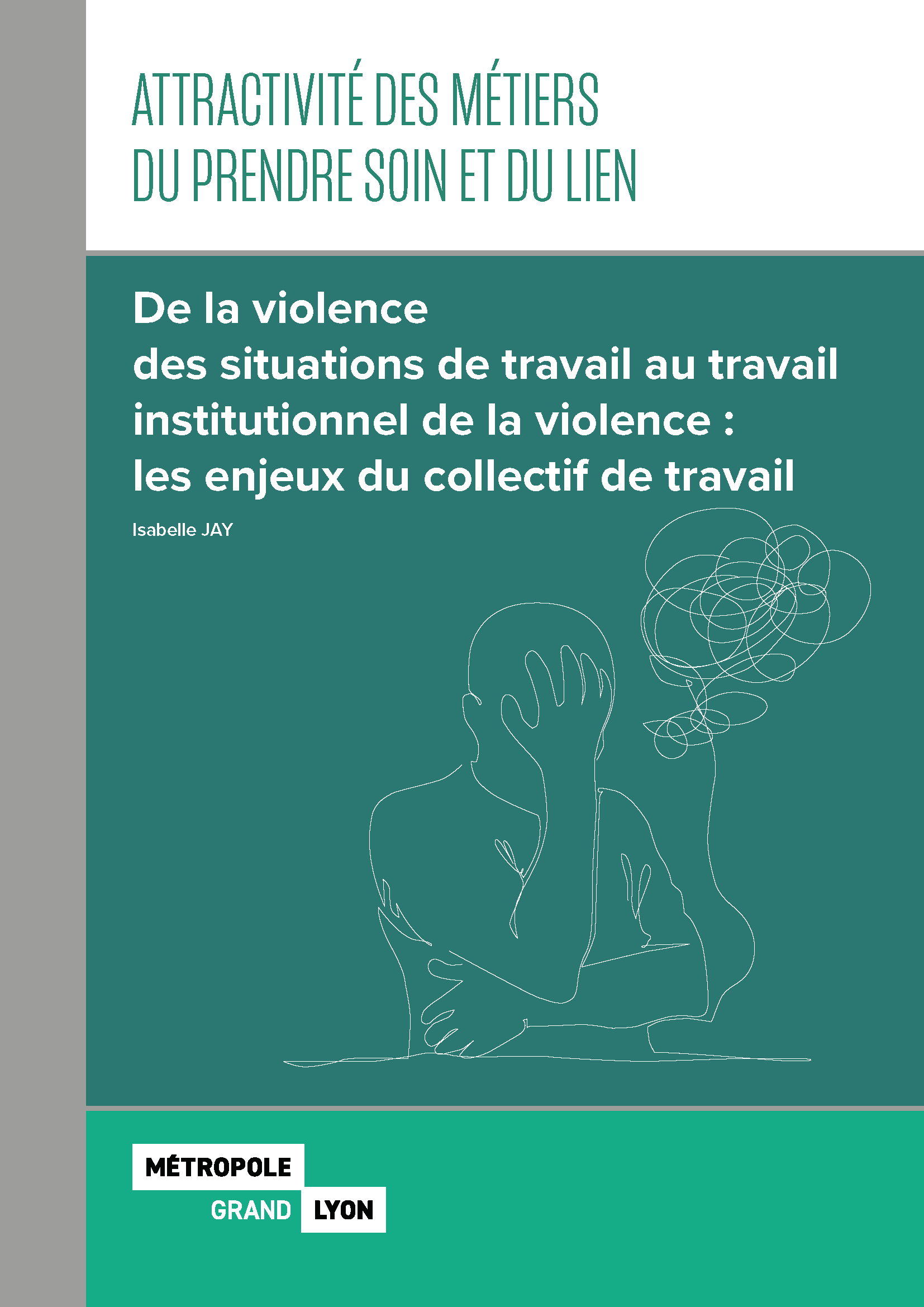
Étude
Lorsque les contraintes ne permettent plus aux professionnels de surmonter les aléas, quelle place donnée à l’autonomie et au collectif de travail pour affronter les difficultés ?

Article
Pour mieux imaginer l’offre culturelle proposée demain aux jeunes publics, acter les grandes transformations qui changent la donne dès aujourd’hui

Article
Un grand fou rire dans la ville jusqu’à l’aurore, une résidence citoyenne accueillie par l’Émeute de Lyon, « Carmen » hacké par nos ados. C’est à Lyon, en 2040.

Article
Et si demain le spectacle vivant se déroulait dans le métavers ?

Article
Quand les pratiques on line et URL se complètent et s’entremêlent.

Article
Une douzaine d’initiatives inspirantes de médiations culturelles. Pour en imaginer d’autres…

Article
De la « culture de la chambre » aux pratiques IRL, comment se construisent les pratiques culturelles et l’identité des jeunes aujourd’hui.
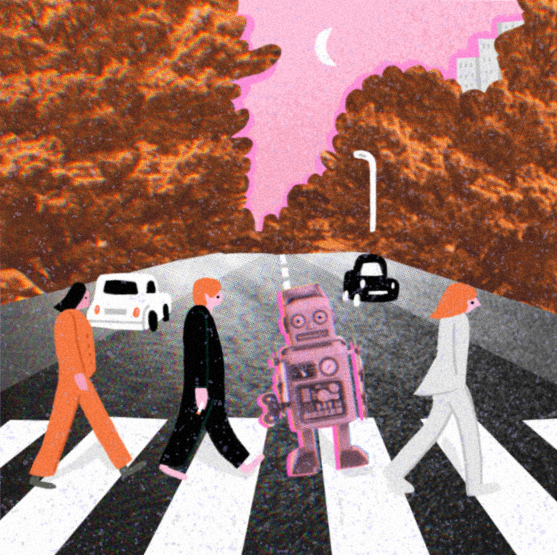
Retrouver dans ce dossier les fruits d’une démarche d’étude et d’enquête de plus d’un an, consacrée aux évolutions des relations entre jeunes publics, arts vivants et numérique.