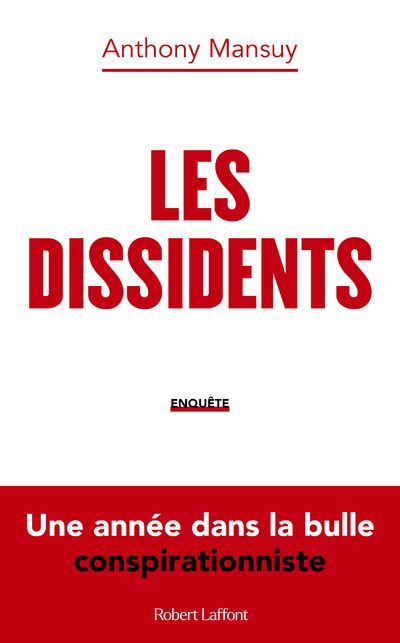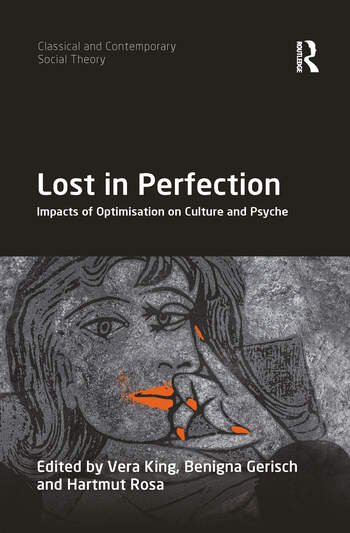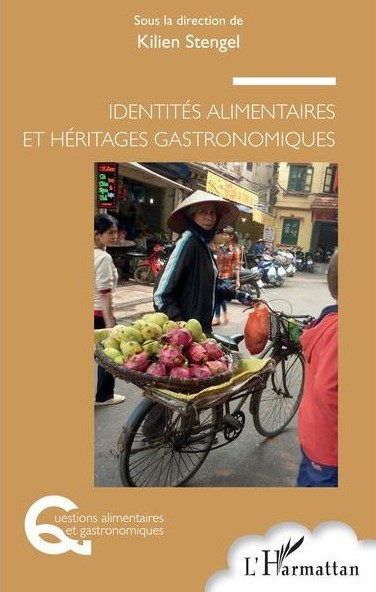Savez-vous qu’il faut en moyenne 6 000 litres d’eau pour produire un kilo de viande de porc ? Ou encore que 2 500 litres sont nécessaires pour fabriquer un tee-shirt en coton ?
Qu’elle provienne du ciel ou qu’elle soit puisée dans les milieux naturels, l’eau consommée par les activités humaines est aujourd’hui majoritairement utilisée pour l’agriculture.
Certaines industries comme la métallurgie, la chimie ou encore l’agroalimentaire sont également fortes consommatrices du précieux liquide. Quant aux ménages, ils consomment en France près de 150 litres d’eau du robinet par jour et par personne.
Ces chiffres nous rappellent une évidence : quelques-unes des ressources les plus vitales et les plus stratégiques dépendent directement de l’eau. Sans elle, « vous ne porterez plus de vêtements, vous ne conduirez plus de voiture, vous n’habiterez plus dans une maison, vous ne prendrez plus de petit déjeuner, de déjeuner, de dîner. L’eau est partout ».
L’homme qui parle ainsi n’est pas hydrologue. Ce n’est pas non plus un climatologue, ni même un écologiste, et encore moins un activiste. Il s’appelle Tom Rooney, et c’est un pionnier des marchés financiers de l’eau. Son témoignage est extrait de l’excellent documentaire réalisé par Jérôme Fritel intitulé Main basse sur l’eau.
Interview de Jérôme Fritel sur Arte, pour présenter son documentaire Main basse sur l’eau.
L’eau, une marchandise comme les autres ?
Le film de Jérôme Fritel débute en nous rappelant quelques faits incontournables concernant la ressource en eau, qui subit depuis quelques décennies deux évolutions notables dont tout laisse à penser qu’elles devraient s’accentuer dans les années à venir.
Premièrement, du fait du changement climatique, la ressource se raréfie en de nombreux points du globe – en particulier dans les zones qui sont déjà aujourd’hui les moins arrosées et qui seront encore davantage sujettes aux sécheresses à l’avenir. D’un autre côté, la demande en eau augmente fortement, du fait de la croissance démographique, mais aussi à cause de l’augmentation du niveau de vie matériel et de l’intensification des productions agricoles et industrielles. Cette double évolution génère des conflits liés à l’usage de l’eau et, dans bien des cas, elle pourrait mener à des situations de pénurie ou à des dégradations irréversibles des milieux.
Évolution de la consommation mondiale d’eau douce, 1900-2014 (Source : Our World in Data, 2022).
Pour nombre d’économistes, comme l’Australien Mike Young – l’un des principaux théoriciens de la financiarisation de l’eau – cette situation a une cause majeure : l’eau n’est pas suffisamment considérée comme un bien privé, ni même comme une marchandise. Parce qu’elle est a priori abondante, qu’elle n’appartient à personne et qu’elle n’a pas de prix, l’eau serait devenue l’objet de nombreux gaspillages. Une illustration symptomatique de la tragédie des communs, souvent mise en avant par les économistes libéraux. Pour Mike Young, comme pour la plupart de ses collègues, la solution semble évidente : il faut considérer l’eau comme une marchandise à part entière, et faire en sorte que son prix soit déterminé par les mécanismes de l’offre et de la demande.
La Grande-Bretagne thatchérienne, premier laboratoire de la privatisation de l’eau publique
On ne sera pas surpris de constater que c’est Margaret Thatcher qui fut la première à vouloir entièrement privatiser le secteur de l’eau domestique en Grande-Bretagne, dans les années 1980. Jusque-là publiques, les infrastructures de production et de distribution d’eau potable du pays ont à cette époque été cédées à des entreprises privées. Ces dernières ont alors appliqué les recettes propres au monde de la finance, consistant à rentabiliser au plus vite les investissements, à rémunérer généreusement les actionnaires et à sanctionner les mauvais payeurs en n’hésitant pas à leur couper l’eau.
Le reportage utilise quelques images d’archive ravageuses, tournées dans des villes anglaises de la fin des années 1980, et qui rappellent étrangement celles d’un pays en développement : on y voit des dizaines de britanniques qui se retrouvent à faire la queue, les bras chargés de bidons qu’ils espèrent pouvoir remplir dans les réserves d’eau publiques mises à leur disposition. Leur faute ? Ne pas avoir payé à temps leur facture.
En juillet 1989, des Londoniens privés d’eau du robinet viennent s’approvisionner dans une citerne publique (extrait du reportage de Jérôme Fritel, Main basse sur l’eau / © Magnéto Presse / Arte France).
Mais le documentaire nous rappelle que, dans cette opération, les mauvais payeurs n’ont pas été les seuls à être lésés. Au début des années 2000, la majorité des régies d’eau britanniques ont été rachetées par des fonds de pension « vautours » australiens, qui ont encaissé quelques dizaines de milliards d’euros de bénéfices avant de disparaître dans la nature, en léguant au passage près de 50 milliards de dette au consommateur d’eau britannique.
L’Australie et les USA, pionniers de la financiarisation de l’eau
Presque caricatural, le cas britannique aurait pu arrêter net le processus de privatisation. Pourtant, l’aventure de la financiarisation de l’eau ne faisait que commencer.
Elle s’est d’abord poursuivie en Australie, un pays qui se caractérise par un niveau de vie très élevé et une sécheresse quasi endémique – l’Australie étant le continent le moins arrosé au monde. Suivant les préceptes de Mike Young, et s’inspirant en grande partie de l’expérience des marchés du carbone, l’Australie a mis en place Waterfind, une place boursière spécifiquement consacrée à l’eau, sur laquelle n’importe quel investisseur peut se positionner. L’écrasante majorité des consommations d’eau étant liée à l’agriculture, c’est ce secteur qui est avant tout visé par la privatisation. Des quotas d’eau d’irrigation sont ainsi alloués aux agriculteurs, qui peuvent ensuite échanger leurs surplus sur le marché. Lorsqu’il pleut et que les réservoirs d’irrigation sont pleins, la demande est très faible et les prix de l’eau s’effondrent immédiatement ; mais dès que les précipitations se font plus rares, les prix grimpent à toute vitesse, envoyant un signal clair aux utilisateurs : ils doivent modérer leurs consommations.
Grâce à la plateforme Waterfind.com, spéculer sur l’eau devient un jeu d’enfant (Source : https://www.waterfind.com.au/)
Le modèle s’est ensuite implanté aux États-Unis, avec des investissements massifs réalisés dès 2008 par le géant de la finance Goldman Sachs. Mais il aura fallu attendre l’Accord de Paris sur le climat pour que le marché américain se structure et que les investisseurs se persuadent enfin que l’eau allait devenir le « nouveau pétrole » du 21ème siècle. En Californie, où les tensions sur la ressource en eau sont assez comparables à celles que connaît l’Australie, une place boursière est alors apparue, parfois nommée le Nasdaq de l’eau. N’importe qui peut y acheter en quelques clics des actions qui correspondent potentiellement à plusieurs milliers de mètres cube d’eau… et espérer que la prochaine sécheresse fera grimper les prix !
Des dégâts collatéraux qui commencent à se voir
Le reportage de Jérôme Fritel fait intervenir de nombreux acteurs de ces marchés, qui répètent à l’envie les mêmes arguments sur la rareté de l’eau et la nécessité de lui donner un prix par le biais du marché. Mais il donne également la parole aux usagers, en particulier aux agriculteurs, qui ont une perception parfois bien différente de la situation. Le documentaire montre par exemple que certaines exploitations à très haut rendement sont parvenues tant bien que mal à s’adapter, en créant des postes de water manager en leur sein. Le métier de ces nouveaux gestionnaires de l’eau consiste à surveiller en continu les évolutions des cours sur les marchés, afin de choisir les créneaux d’ouverture des vannes d’irrigation les plus rentables.
La situation est en revanche beaucoup plus compliquée pour les petites exploitations. David Owen témoigne de ces difficultés. Au bord des larmes, ce fermier australien explique devant la caméra de Jérôme Fritel le genre de dilemmes auxquels sont confrontés de plus en plus de fermiers australiens et américains. Suite à une vague de chaleur et de sécheresse, il a finalement dû se résoudre à arrêter son activité, faute de pouvoir accéder à l’eau dont il avait besoin pour nourrir ses animaux. Pourtant, à l’heure de la digitalisation, il lui aurait suffi d’un simple clic sur son téléphone portable pour ouvrir les vannes des réservoirs et permettre à ses animaux de boire à leur soif. Mais du fait de la spéculation, et malgré les stocks encore disponibles, un tel geste aurait eu une conséquence fatale pour son activité, en plombant irrémédiablement le bilan de son exploitation.
Un fermier australien assiste à la mise en enchère de sa ferme, faute d’avoir pu payer l’eau dont il avait besoin (extrait du reportage de Jérôme Fritel, Main basse sur l’eau / © Magnéto Presse / Arte France)
La résistance s’organise : l’eau comme bien commun
Révoltée par ce type de situations, Maude Barlow considère qu’il est urgent de changer de logique en interdisant la spéculation sur l’eau. Cette militante canadienne défend l’idée d’un accès universel à ce qu’elle considère comme un bien commun de l’humanité. Un principe qu’elle est d’ailleurs parvenue à faire voter à l’ONU, malgré l’opposition des États les plus engagés dans le processus de marchandisation – au premier rang desquels on retrouve bien entendu les USA, la Grande-Bretagne et l’Australie.
Jérôme Fritel montre que la résistance est en train de s’organiser un peu partout autour du globe.
Ailleurs, comme à Dublin ou à Rome, la contestation s’organise et les populations manifestent pour suivre d'autres chemins, réclamant que l’eau soit à nouveau considérée comme un bien commun, seul moyen à leurs yeux de gérer durablement la ressource tout en la mettant au service du plus grand nombre.
On regrette d’ailleurs que le reportage n’explore pas davantage ces formes de gestion alternatives. On aurait aimé, par exemple, que soit présentée l’idée de tarification progressive, dont le but est de concilier gestion économe et accès universel à un bien commun. Mais il est vrai qu’un tel sujet mériterait facilement un reportage à lui seul. Le film de Jérôme Fritel se contente donc d’ouvrir en conclusion quelques perspectives, en insistant sur ce fait irréfutable : entre un modèle de gestion mercantile et une approche par les biens communs, la bataille de l’eau ne fait sans doute que débuter.