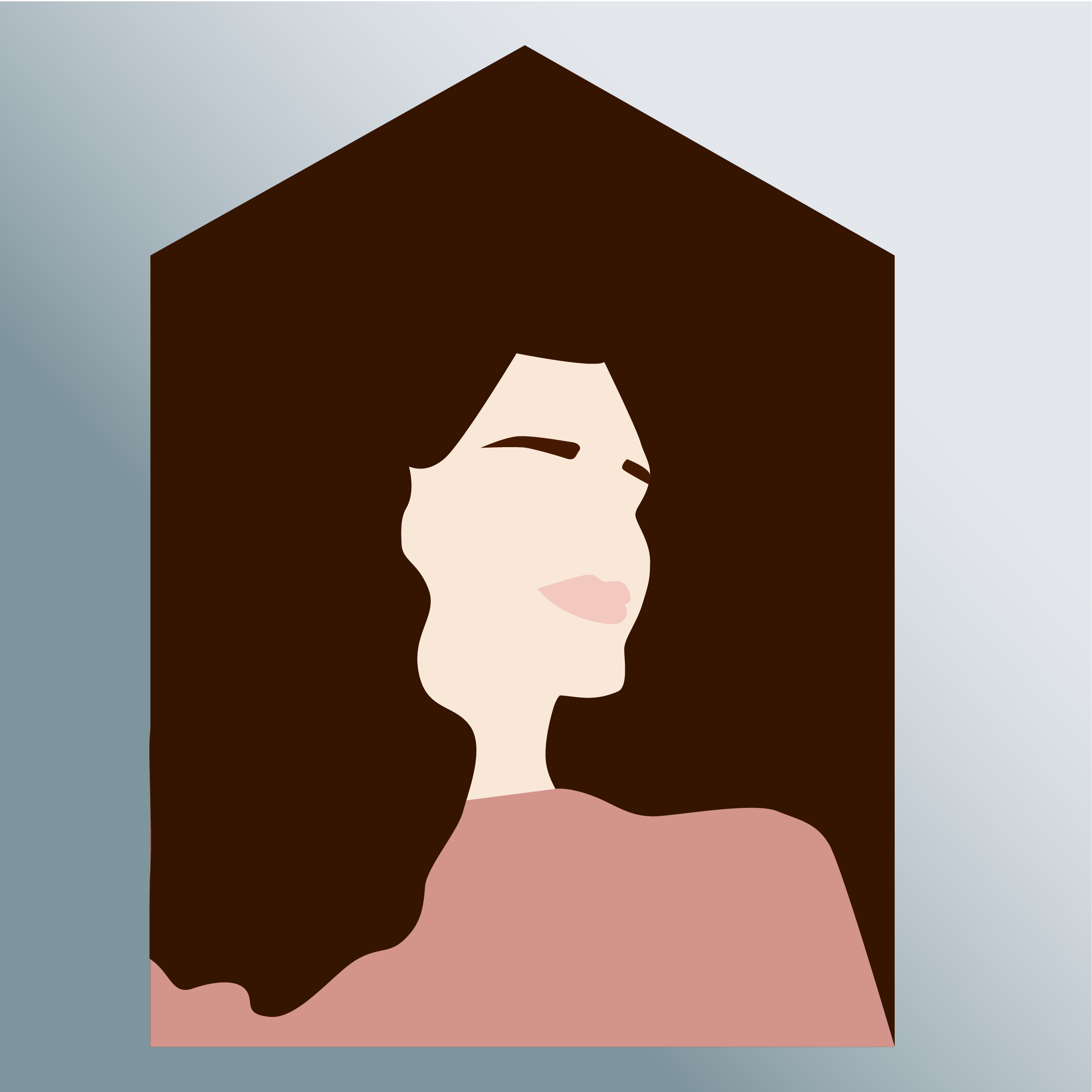Ce risque existe. Les acteurs privés importants ne s’inscrivent pas forcément dans une logique ne serait-ce que d'aménagement du territoire, alors que les bailleurs sociaux ont le plus souvent une assise territoriale extrêmement importante, et n’agissent pour certains, en tout cas les OPH, que sur un territoire qu’ils connaissent bien, en partenariat avec les collectivités, etc. L'arrivée d'acteurs, comme vous dites, « déterritorialisés » pose un certain nombre de problèmes, d'autant plus dans un contexte où le foncier est particulièrement contraint. Les logements de haut standing que l'on construit dans des endroits où il y aurait potentiellement besoin de logements abordables, c'est du logement abordable qu'on ne construit pas parce qu'il y a une contrainte foncière, il ne faut pas se voiler face.
Après, hélas le parcours résidentiel des ménages est déjà cassé. Aujourd'hui, dans les zones tendues, les locataires du parc social ont le plus grand mal à en sortir, et pas par manque de volonté. Ce sont des changements sociologiques, un vieillissement de la population du parc social qui peut expliquer en partie la baisse de la mobilité résidentielle. Mais c'est principalement lié au fait que, pendant des années, les prix n’étaient pas ce qu’ils étaient. Les aides publiques, par contre, pour faire de l'accession sociale à la propriété étaient importantes. Il y avait donc un parcours résidentiel qui se créait. On sortait assez facilement du logement social pour accéder notamment à la propriété.
Désormais, les ménages qui sont dans le parc social n'ont plus les moyens d'accéder à la propriété, et de toute façon, ils n'ont pas les moyens d'aller dans le parc privé. Il y a donc deux façons de voir les choses. On peut se dire que de toute façon, le parcours résidentiel est cassé, donc pour faire justement de la mixité sociale, autant produire des logements qui ne sont pas forcément des logements dont la construction émane du besoin du territoire en question, mais qui va permettre de faire de la mixité, avec du logement un peu plus haut de gamme. C’est un aveu d'échec, mais cela peut se comprendre.
L'autre façon de faire, c'est d’essayer de reconstruire le parcours résidentiel des ménages. De ce point de vue-là, par exemple les Offices Fonciers Solidaires que je mentionnais tout à l'heure avec les OFS/BRS, cela constitue une certaine forme de réponse : on est conscient du fait que vous êtes aujourd'hui dans le parc social et que votre parcours résidentiel est bloqué, vous n'arriverez pas à accéder à la propriété dans les zones chères parce que vous n'avez pas les capacités financières de le faire. On crée donc une marche supplémentaire dans l'ascension du parcours résidentiel entre l'accession à la propriété et le parc social, la marche OFS/BRS. Là encore, c’était un choix politique des collectivités locales. Est-ce que l'on a envie de faire de l'OFS/BRS ? Ou est-ce que l'on préfère la montée en gamme ?