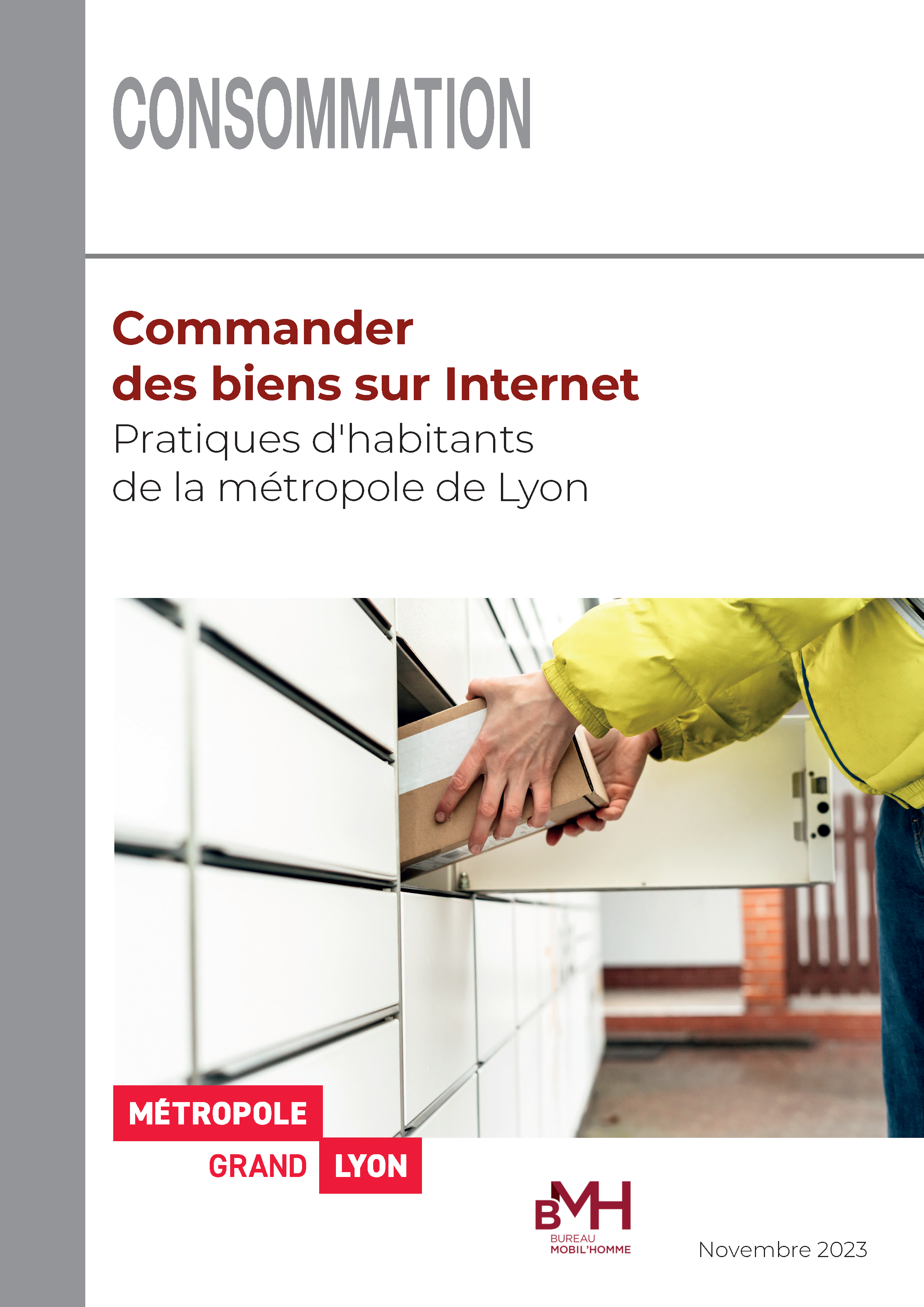Le concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) s’est répandu il y a une vingtaine d’années en France et à travers le monde, en devenant un enjeu majeur tant pour les activités économiques que pour la société civile et les institutions publiques. L’idée s’est propagée de manière explicite, portée par un mouvement hétérogène composé d’une part, d’aspirations et d’exigences d’organisations diverses issues de la société civile et d’autre part, de réactions ou d’anticipations d’entreprises soucieuses de préserver leur image auprès de l’opinion. Ce développement s’est effectué sans véritable définition communément acceptée de la RSE et il a donné lieu à de nombreuses acceptions et interprétations, provoquant ainsi bien des confusions et des malentendus.
Différentes conceptions des relations entreprises-société en débat
On considère généralement que la notion a émergé explicitement aux Etats-Unis dans les années 1950. S’appuyant sur des valeurs morales et religieuses faisant appel à l’éthique personnelle du dirigeant d’entreprise, l’entreprise est considérée comme un « être moral » qui a des devoirs consistant à assurer le bien-être des travailleurs, de leurs familles et de la communauté ; elle doit promouvoir de manière volontaire des mesures et des actions sociales destinées à corriger, à réparer les dommages causés par l’activité économique, en pratiquant le mécénat, la philanthropie, des actions caritatives qui se situent donc « hors business ».
Cette conception fut progressivement supplantée, à partir des années 1970-80, par une conception utilitariste qui abandonne le caractère moralisateur pour affirmer que le comportement social de l’entreprise doit servir sa performance économique. Se développe alors l’idée, toujours très présente aujourd’hui, que les exigences de rentabilité et de compétitivité seront d’autant mieux satisfaites si l’entreprise se montre socialement responsable, en étant réactive à la demande sociale et à l’écoute de ses « parties prenantes » (stakeholders) afin de prendre en compte leurs aspirations. En soignant son image, sa réputation, elle est censée gagner en légitimité pour poursuivre ses activités. Les actions volontaires susceptibles de profiter à l’entreprise sont choisies en fonction d’une analyse coûts-avantages.
Ces conceptions de la RSE ont été combattues dès les années 1960 par des auteurs libéraux qui dénoncèrent son caractère subversif ; le plus connu, le Prix Nobel d’économie Milton Friedman, contesta le fait qu’on puisse attribuer aux dirigeants d’entreprise d’autres responsabilités que celles de veiller à la profitabilité de leur affaire dans l’intérêt des seuls actionnaires. Mais il ne s’opposait pas systématiquement à la RSE, si celle-ci pouvait s’avérer leur être profitable…
La conception la plus récente est apparue dans les années 1990, en particulier en Europe, dans un contexte de politisation des préoccupations environnementales et sociétales. Elle part de l’idée que l’entreprise est encastrée dans la société et qu’elle ne peut être indifférente aux grands défis de son temps. En d’autres termes, l’entreprise n’existe que par la société qui permet son existence et elle lui est donc redevable en adoptant un comportement responsable qui consiste à contribuer à la production de biens communs et/ou à éviter des impacts négatifs pour l’environnement naturel et humain.
L’institutionnalisation de l’« entreprise responsable »
Ses démarches de responsabilité, volontaires ou contraintes, sont encadrées par des normes substantielles universellement admises et doivent intégrer les préoccupations extra-économiques dans le cœur de son activité, en mettant en œuvre des politiques de prévention, d’anticipation, voire de précaution. Celles-ci sont articulées aux politiques publiques ayant pour objectif le développement soutenable (ou durable) : triple préoccupation de l’efficacité économique, de la sauvegarde de l’environnement naturel et de la cohésion sociale. C’est la raison pour laquelle nous l’avons appelée conception de « soutenabilité ».
Dans les discours et les pratiques d’entreprise, ces conceptions sont très souvent mêlées et font l’objet d’adaptations syncrétiques, voire éclectiques. La définition de la Norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations (2010), résultat d’une vaste et longue discussion mondiale, en est l’une des meilleures illustrations (1) . La définition de l’Union européenne, fournie par une Communication de la Commission en 2011, est aussi le fruit de longues années de concertation et s’en inspire en consolidant quelques avancées (1) :
« responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. Pour assumer cette responsabilité, il faut au préalable que les entreprises respectent la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux. Afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité sociale, il convient que les entreprises aient engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base, ce processus visant:
– à optimiser la création d’une communauté de valeurs pour leurs propriétaires/actionnaires, ainsi que pour les autres parties prenantes et l’ensemble de la société;
- à recenser, prévenir et atténuer les effets négatifs potentiels que les entreprises peuvent exercer ».
Les références normatives internationales en matière de RSE sont nombreuses2. Outre la Norme ISO 26000 (norme privée) et la Communication de la Commission européenne, les plus importantes et les plus citées sont la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les conventions fondamentales de l’OIT, avec sa Déclaration tripartite de 1998 (faisant obligation à tout pays, même non signataire, de les respecter) et les conventions internationales de protection de l’environnement (Rio, Kyoto…). Ces dernières années, plusieurs textes émanant d’organisations inter-étatiques sont venus enrichir cet arsenal normatif :
- les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (révisés en 2011) ont la particularité d’avoir été adoptés par une quarantaine d’Etats, parmi les plus grands, qui se sont engagés à les faire respecter par leurs entreprises en quelque endroit du monde où elles opèrent ;
- les Principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l’Homme, adoptés par le Conseil des droits de l’Homme, mais qui supposent une transposition dans les droits nationaux ;
- Le Pacte mondial, une initiative du Secrétaire général des Nations Unies, qui énonce dix principes que devraient respecter toutes les entreprises à travers le monde.
Tous ces textes présentent la particularité de couvrir des champs très larges : respect des droits de l’Homme, de l’environnement, des consommateurs, conditions et relations de travail, concurrence, corruption, développement,… La référence au développement durable n’exclue pas les questions sociales, au sens strict, de même que la locution « responsabilité sociale » inclue les aspects sociétaux et environnementaux.
On s’oriente vers une reconnaissance d’un certain nombre de caractères communs à la compréhension de l’acronyme RSE, à savoir :
- l’accent mis sur les impacts (ou les effets) qu’une entreprise provoque sur son environnement et la société au sens large,
- le respect de la législation comme l’une des composantes de la RSE (et même pour l’Union européenne, un préalable),
- la conception de la RSE comme une intégration des préoccupations sociales et environnementales dans les activités de l’entreprise et non comme des mesures « hors business », tels que le mécénat, la philanthropie ou les actions caritatives.
Comment les entreprises interprètent-elles ou déclinent-elles ces exigences ou ces préconisations ?
Il existe toute une panoplie de stratégies et de dispositifs, à l’examen desquels on peut tenter de graduer l’engagement des entreprises dans des démarches de RSE, depuis le déni jusqu’à des formes très intégratives des préoccupations sociales et environnementales.
Des dirigeants voulant ignorer l’insertion de leur entreprise dans leur environnement sociétal déclarent ne pas être concernés par des objectifs autres qu’économiques et financiers. Cette position est plus difficile à tenir pour les grandes entreprises soumises à des pressions institutionnelles plus fortes et obligées de légitimer leurs actions auprès de leurs parties prenantes, voire de publier des informations environnementales ou sociales sur les impacts de leurs activités (comme c’est le cas en France, depuis 2002, avec la loi NRE, obligation étendue par la loi Grenelle 2). Les stratégies d’évitement sont alors les plus fréquentes. Elles veulent donner une image de conformité, en déguisant leur non-conformité aux attentes sociétales par des actions symboliques modifiant très peu leurs comportements : adoption d’un code de conduite sans dispositifs de vérification, divulgation ciblée d'informations pour détourner l’attention, politiques de « greenwashing » ou de « fairwashing ».
Lorsque les entreprises sont en forte visibilité médiatique, l’écart entre les pratiques et la communication ne peut être tenable longtemps et les entreprises vont être amenées à aligner, a minima, leurs pratiques sur leur discours. Elles passent alors par des stratégies de compromis ou des stratégies de manipulation. Les stratégies de « compromis » cherchent à gagner du temps, préserver au maximum les intérêts économiques en mobilisant l’argument du risque de suppression d’emplois ; elles cherchent également à retarder la réglementation.
Les entreprises qui développent des stratégies de manipulation cherchent à influencer ou à contrôler les pressions institutionnelles : pratiques de lobbying auprès des décideurs publics, présence dans les comités définissant les normes, mobilisation de contre-expertise scientifique. La rhétorique mobilisée s’appuie sur des conflits potentiels entre l’intérêt économique traduit en termes de perte de compétitivité ou de destructions d’emplois et l’intérêt sociétal en termes de santé, de pollution...
A côté de ces stratégies, on trouve des entreprises qui répondent, à des degrés divers, aux attentes sociétales. Parmi celles-ci, de nombreuses entreprises considèrent que ces actions doivent être totalement séparées de leur « business » ; elles pratiquent la philanthropie et le mécénat. Lorsque les Etats n’ont pas les moyens d’assurer la fourniture de services essentiels de santé, d’éducation..., les entreprises peuvent être conduites à les prendre en charge, comme c’est souvent le cas dans les pays en voie de développement où la philanthropie est souvent au cœur du concept de responsabilité de l’entreprise envers la société.
En fait, il existe tout un continuum d’actions qui mêlent à des degrés divers philanthropie et activités économiques de l’entreprise et la frontière n’est pas facile à tracer. A côté des actions philanthropiques pures (dons à des associations caritatives), on peut distinguer les actions non directement liées à l’activité de l’entreprise mais ayant un impact sur son image, les actions qui répondent aux attentes des parties prenantes tout en restant hors du cœur de métier de l’entreprise et enfin les actions qui touchent directement ses décisions stratégiques.La constitution de fondations pour des actions de mécénat est la forme la plus fréquente de ces stratégies séparées de l’activité ; elles cherchent à construire une image favorable tant externe qu’interne, mais elles n’ont aucun impact direct sur le métier de l’entreprise. Les actions de marketing philanthropique où la marque s’engage à reverser un pourcentage du prix pour une cause humanitaire sont des actions ponctuelles, relatives à une très faible part du chiffre d’affaires ; elles sont aussi des stratégies d’image, séparées des conditions de production de l’activité.
Pour être en conformité avec les normes internationales recommandées, une véritable responsabilité sociale d’entreprise suppose une intégration des objectifs du développement durable et des attentes des parties prenantes au cœur des activités de l’entreprise et de son management. Compte tenu de la diversité des champs concernés et de la complexité des changements attendus, cette prise en compte est plus ou moins globale.
La conception et la production de produits ou de services « responsables » ont pour objectifs de diminuer les externalités négatives environnementales ou sociales liées à la production ou à l’usage des produits. Dans le domaine environnemental, par exemple, elles concernent l’éco-conception ou l’ACV (Analyse du Cycle de Vie), le développement de l’économie circulaire ou de l’économie des fonctionnalités ; quelques tentatives d’ACV sociale ont également été développées. Dans le domaine social/sociétal, les actions concernent l’amélioration des conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, la non-discrimination, l’égalité hommes-femmes, etc.
Le volet relatif à la gestion de la relation fournisseur est au cœur de l’intégration de la RSE dans les chaînes d’approvisionnement. Une vision défensive consiste à mettre en place des dispositifs de protection à l’égard des risques de réputation liés aux pratiques de fournisseurs non conformes aux valeurs socialement acceptables, comme dans l’exemple emblématique de la filière textile-habillement. Une vision plus politique confie à l’entreprise la mission de diffuser les valeurs et les bonnes pratiques sociales et environnementales auprès de ses sous-traitants et fournisseurs.
Quelques rares entreprises tentent d’intégrer de manière multi-dimensionnelle tous les volets du développement durable en plaçant dans leurs systèmes d’information et leurs processus de contrôle des indicateurs non-financiers de performance destinés à créer une dynamique susceptible de faire évoluer la culture organisationnelle de l’entreprise auprès des cadres et de l’ensemble des salariés.
Enfin, les stratégies « bottom of the pyramid » (BOP) sont censées constituer de nouvelles approches de la responsabilité d’entreprise en incorporant les pauvres dans le marché mondial ; en fait, il s’agit de nouvelles opportunités de profit pour les firmes multinationales, car, si les pauvres ont individuellement un faible pouvoir d’achat, ils représentent un marché considérable à l’échelle planétaire (4 milliards d’individus). Quant au social business qui se distingue de la BOP, il s’est développé comme substitut à la dérégulation et au retrait de l’Etat des services publics et constitue également de nouvelles sources d’activité pour des entreprises privées (aide à la personne, santé…) en marchandisant des services d’utilité sociale. La situation ambigüe de certaines ONG, dans des pays du Sud, qui, faute de pouvoir trouver des partenaires publics pour des projets de développement, créent des entreprises ou s’associent avec des entreprises existantes pour répondre à des besoins non satisfaits, ne change pas la nature du phénomène.
Le mouvement contemporain de la RSE peut laisser penser que celui-ci conduirait à une ré-interrogation profonde des représentations de la nature et du rôle de l’entreprise dans la société. Il l’est en partie dans la mesure où la société civile organisée interpelle les milieux d’affaires afin de limiter les impacts négatifs des entreprises comportant des préjudices ou des risques affectant les populations et l’environnement naturel et afin de concevoir des modes opératoires de « production responsable ». Il ne l’est pas dans la mesure où le capitalisme financier continue de dominer les activités économiques en faisant fi des intérêts des parties prenantes autres que les actionnaires et des défis globaux de notre temps. Au travers de ce double constat, c’est le statut de Société Anonyme (SA), modèle aujourd’hui dominant, qui se trouve interrogé. Le primat accordé à l’actionnaire conduit en effet à privilégier la maximisation du profit, alors que sa responsabilité est limitée et qu’il peut faire courir à d’autres des risques que lui-même n’encourra pas. La société dans son ensemble joue ainsi le rôle d’assureur du risque pris par les actionnaires. Cette assurance est gratuite et l’assureur ne se voit reconnaître aucun rôle dans le contrôle du risque. Cela devrait conduire à revoir le pouvoir actionnarial et à donner à la société des moyens de se protéger contre l’irresponsabilité actionnariale.
Or, jusqu’à maintenant, le mouvement de la RSE, même s’il est, à l’origine, la résultante de l’interaction entre les pressions de la société civile et la réactivité des milieux d’affaires, a fait en grande partie l’objet d’une capture managériale qui en a détourné le sens, en l’instrumentant au profit de démarches volontaires visant à rehausser la réputation d’entreprises en perte de légitimité.1. « Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui :
- contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;
- prend en compte les attentes des parties prenantes ;
- respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ;
- est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en oeuvre dans ses relations».
2. L’ISO 26000 en a recensé environ 130, sur lesquelles elle s’appuie.