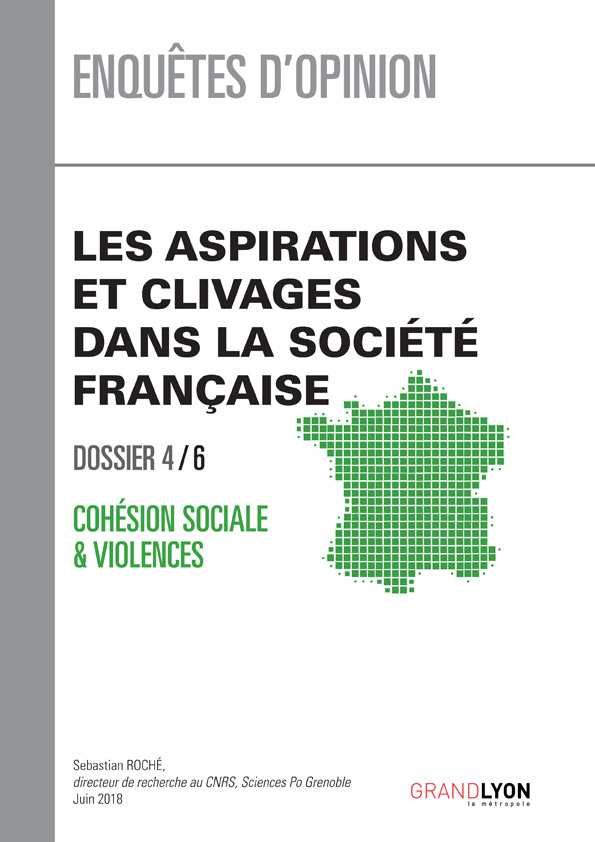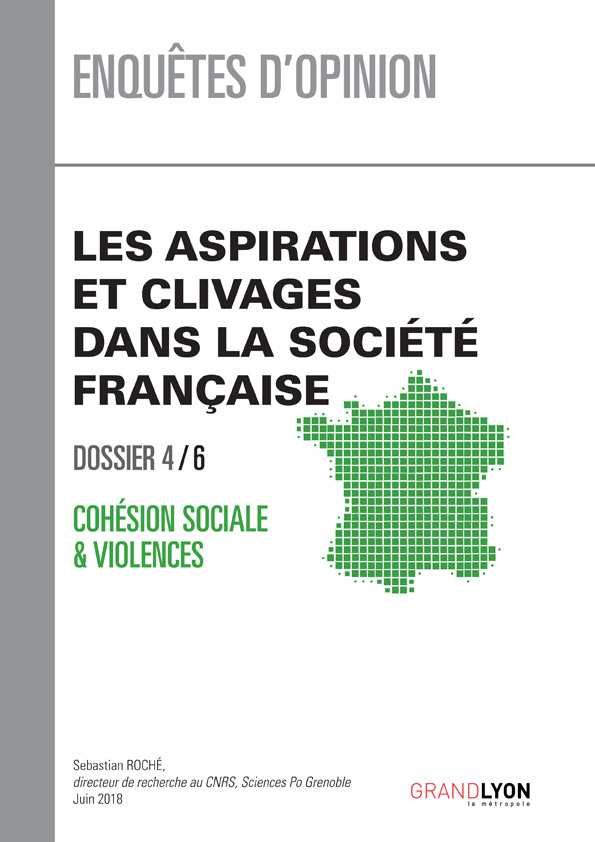Les incivilités sont des désordres qui se donnent à voir au sein de l’espace public et qui ne rapportent rien de matériel. Tagger sa chambre n’est pas une incivilité, mais le faire sur le mur de l’immeuble oui. Elles sont le contraire du vol, qui cherche à se faire invisible et qui profite monétairement à l’auteur. Certains de ces désordres constituent des infractions c’est-à-dire des atteintes à la loi pénale, d’autres pas. Mais, dans les deux cas, les policiers et magistrats ne s’en occupent guère. Le caractère licite ou non de ces actes importe moins que leur perception. Les incivilités suscitent, chez l’usager de l’espace public, la crainte - ce qu’on appelle le sentiment d’insécurité – et influent sur son comportement. Il ressent une appropriation privative par des tiers d’un espace commun, une atteinte à sa capacité d’usage quotidien de l’espace en question. La question du partage de l’espace public dans sa dimension physique (par opposition à l’espace public du débat) recouvre profondément celle de l’incivilité.
Les formes prises par les incivilités sont extrêmement variables : rassemblements de personnes, dégradations, salissures, souillures, parfois simplement un « détournement d’usage » (utiliser une montée d’escalier comme un salon de coiffure, un abri bus comme un lieu de discussion). Ce sont des frictions entre usagers des lieux.
La définition des normes de partage de l’espace ne peut s’envisager sans que la légitimité de celui qui les formule ne soit établie. Or, aujourd’hui, nul n’est en mesure d’attribuer, ni sur un plan théorique ni sur un plan pratique, cette légitimité, c’est-à-dire de répondre aux questions : qui a le droit de proscrire (d’interdire) et de prescrire ce que chacun de nous doit faire au milieu d’un espace qui est à tout le monde.
Si vous êtes chez vous, vous fermez la porte, et vous dites «voilà, chez moi c’est comme ça !». Mais si vous êtes dans un espace public, il n’apparaît pas clairement qu’il y a un propriétaire légitime pour dire quel est le bon comportement et ce qui acceptable ou inacceptable. Nous savons qu’il y a des règles, mais nous trouvons à l’intérieur de nous-mêmes la puissance de nous donner des règles supérieures aux règles sociales connues (que nous pouvons énoncer si on nous le demande). Le problème vient du fait que les autres reconnaissent leurs propres règles comme valant plus que les miennes. Chacun estime que s’il ressent quelque chose, cela suspend les règles : urgence, frustration, injustice, droit à quelque chose etc… Oui, il est interdit de se garer ici, mais si je ne le fais je vais être en retard pour récupérer ma fille à l’école. Il n’y a pas de règles partagées indiscutables : on peut toutes les discuter. Pire, ou mieux, la discussion n’est même pas reconnue comme une méthode pour trancher : au bout des arguments il y a le fait que les opinions se valent parce qu’elles sont émises par des individus égaux, et qu’elles sont leurs choix sincères. Peu importent les arguments raisonnables, ma position est aussi juste que la tienne. Ceci débouche sur la violence dans les relations interpersonnelles.
Pour une part, l’évolution des sociétés riches (enfin, qui l’étaient car la prospérité tend à se déplacer hors de l’Occident) qui ont placé l’épanouissement individuel au cœur de leur dynamique explique la difficulté. Ce n’est plus une distance entre groupes sociaux qui fait question, mais le droit des individus à juger par eux mêmes de ce qui est bon. Par exemple, au nom de l’égalité entre les sexes, on pourrait refuser de tenir la porte aux dames. Dès lors que les normes de sociabilité ne s’imposent plus de haut en bas, il y a autant de « bonnes » raison d’adhérer à ces principes que de les refuser, ça dépend de chacun.
Souvent, les incivilités sont associées dans le débat public au « manque d’éducation ». Ce n’est sans doute pas erroné de penser qu’il existe un lien entre la socialisation des individus et leurs comportements. Mais, cette vision néglige par trop le poids des situations. Dans une explication par l’intériorisation des « bonnes manières », c’est à dire l’acquisition de normes « une fois pour toutes » par différentes méthodes dont l’éducation, les situations ne sont pas intégrées. Qu’est-ce qui fait que l’on se comporte de façon gênante ou même insupportable ?
Dans les rues de la ville, rares sont ceux qui s’engagent pour faire savoir leurs valeurs au quotidien : dans la rue, le métro, le bus etc… Il pourra y avoir une manifestation publique collective pour dénoncer tel ou tel fait, mais l’engagement personnel quotidien est marginal. Si quelqu’un double dans une file d’attente, les gens, dans leur immense majorité, ne vont pas réagir. Et, même ceux qui vont essayer ne sont pas certains d’avoir l’assentiment de ceux qui se sont fait doubler. Dans un cas d’agression physique, en dehors du cas où sa propre mère se fait frapper devant soi, la tendance est à l’apathie : on ne sait pas comment intervenir, on ne sait pas si on doit le faire, et on ne sait pas si celui à qui on va porter secours le ferait à notre place. Tout cela concourt à nous faire rester à l’écart, nous nous déclarons incompétents. Pourquoi ? L’incivilité de l’autre c’est finalement la liberté de chacun. Dans les espaces publics, chacun applique la règle suivant laquelle rien de ce qui s’y passe ne le concerne.
Comprendre les relations de l’incivilité avec la ville s’avère d’autant plus ardu qu’il serait erroné d’établir un lien fixe entre l’une et l’autre. L’histoire démonte que la ville n’est pas, par essence, un lieu spécialement incivil. Ce sont les populations urbaines plus aisées et éduquées qui, depuis le XVIIIe siècle au moins, renforceront les codes de civilité. Urbanité, civilité, mœurs policés, tous ces mots sont synonymes et renvoient à la ville (urbs, civis, polis). Mais, à partir de la deuxième partie du XIXe siècle se concentre en ville une grande part des maux de la société. Violence rime désormais avec milieu urbain. C’est donc bien la manière dont les gens vivent la ville et la manière dont elle est structurée qui importe davantage que la densité de sa population.
La ville contemporaine est marquée par la mobilité, et son corollaire l’anonymat. Les urbains recherchent l’indifférence mutuelle maximale. Ignorer l’autre est devenu une règle essentielle à la survie urbaine, comme les premiers sociologues dits de l’école de Chicago l’avaient noté il y a plus d’un siècle maintenant. En ville, les individus ne sont pas seuls: ils établissent des réseaux qui les préservent de l’isolement. Mais les lieux sont anonymes : dans les espaces traversés, prédominent l’indifférence, la superficialité ou l’ostentation qui sont autant de traductions d’un même rapport à un environnement peuplé d’inconnus. Cette situation doit beaucoup à la fonctionnalisation de l’espace. Plus l’espace est segmenté par fonction, plus on y est mobile et moins on croise de personnes connues.
Les protagonistes de la production de la ville alimentent cette tendance en créant des lieux spécialisés (pour se loger, se distraire, travailler). Le cloisonnement des différentes stratégies des acteurs urbains qui vendent leurs services renforce cette réalité (logeur, transporteur, parcs de loisirs). Un espace existe suivant la manière dont les organisations le définissent et le gèrent. La police et les travailleurs sociaux, s’ils interviennent dans un même espace, ne le partagent pas à proprement parler. Pas plus qu’un logeur et un transporteur urbain, a fortiori s’il promeut des systèmes sans interaction humaine. Dans ces conditions, on comprend que les règles de civilités soient mises à rude épreuve : aucun collectif résidant sur un territoire ne peut les garantir.
Face à cette situation d’incertitude quant à l’existence d’un garant des normes de partage des lieux, différentes tendances se dégagent et se combinent entre elles :
- L’affirmation de l’indifférence comme règle de base de la vie urbaine, comme précédemment discuté, voire le repli sur soi ;
- Recourir à la privatisation des espaces. La propriété permet de légitimer l’exercice d’un pouvoir sur les lieux : le lieu est clos physiquement, réservé à ceux qui sont membres de la collectivité (par exemple résidentielle) et, éventuellement, gardé. Il a son règlement. Mais, évidemment, ce n’est possible que pour certaines classes de lieux, et limité par le pouvoir d’achat des personnes ;
- La tentation de favoriser un « entre soi », des gens « comme nous » de manière à réduire l’hétérogénéité ou la mixité socio-économique des espaces se fait également jour. Les espaces sont alors plus ségrégés. On sélectionne, à travers le type d’espace, les autres. Il est potentiellement ouvert à chacun, mais,en pratique, sélectif. Ce peut être sur une base économique ou religieuse ou une autre encore. Le besoin de règles communes explicites s’évanouit en même temps que s’homogénéisent les valeurs, les attentes et les comportements des individus. Cette option favorise ce que dans les années 70, on appelait, négativement, le « contrôle social »;
- La demande d’une plus grande pénalisation de la vie sociale, c’est-à-dire l’appel à la régulation par les policiers et les juges. Il est pratiquement impossible dans les sociétés contemporaines de prendre cette voie, principalement pour des raisons de coûts et de délais de réponse, sans pouvoir développer ce point ici.
Je défends ici qu’une autre voie existe face à l’absence de gestion des « règles d’usage » de l’espace. Il s’agirait de faire émerger un « garant des lieux », d’une forme collective de veille sur un espace ouvert à tous. Evidemment, il n’est pas aisé d’en fixer tous les contours. Le concept de garant serait de veiller sur l’espace sans rechercher à exclure ou à filtrer sur la base des profils des personnes, de ne pas freiner la mixité des publics et il de réaliser ces tâches précisément par l’attention donnée aux comportements des usagers présents. Entre l’absence de règle et le contrôle absolu, il y a place pour une notion, celle de « règles d’hospitalité» ou de « règles d’usage des lieux ». Leur existence conditionne l’espérance de sauvegarde de la mixité sociale, à l’opposé des tentations de la ségrégation et de la privatisation. Des règles opposées à tous garantissent que des publics hétérogènes puissent cohabiter dans les mêmes lieux tandis que l’absence de ces règles conduit à l’évitement mutuel et à la ségrégation.
Mais, comment faire exister un garant des lieux qui promeuve des règles d’hospitalité ? Nous avons dit que la mobilité accrue a certainement fait perdre à la veille sociale ordinaire toute efficacité. La détermination par l’espace s’est dans le même temps affaiblie : on est de moins en moins défini par le lieu où l’on se trouve, et nous circulons tous en permanence. Pourtant, on constate aussi que la délimitation d’espaces fragmente l’univers urbain et fait varier en fonction de la nature des espaces fréquentés, les droits du citoyen à en jouir. Cette situation conteste donc à certains citadins le droit universel à se déplacer en tout lieu de la ville. Nous défendons que deux éléments sont essentiels, l’un physique, l’autre organisationnel :
- La codification des usages des lieux par la l’aménagement des espaces et la signalisation, par exemple par un marquage au soldes files d’attentes comme c’est le cas à Tokyo sur les quais de leur train à grande vitesse. Ces indications quant à l’usage sont des « prises », elles nous disent quoi faire sur un autre registre que celui de la loi, ainsi un cendrier sur une table nous dit que la pièce est « fumeur ». La conception, le bornage et la veille sur l’espace d’influent fortement sur la civilité et le service. Ainsi la poste a refondu l’organisation de ses agences, comme les banques.
- La production de la civilité et de la tranquillité implique qu’on structure les lieux de telle manière qu’une véritable veille humaine puisse s’y exercer. D’une part, je pose que les règles sociales ne se défendent pas toutes seules, et, d’autre part, que seule une présence humaine permet d’affirmer une norme car cela suppose l’énonciation. Il faut donc veiller à la fois à établir des garants d’espaces ayant leur propre délimitation, et également à rechercher la coordination entre ces différents garants pour que la continuité urbaine soit une réalité (à l’opposé de la ségrégation).
En pratique, les deux aspects se mêlent. La construction des limites physiques de l’espace se matérialise par l’affirmation concrète de « seuils », des points d’entrée dans un lotissement, un bus, un établissement scolaire… Cela implique, par exemple, la réintroduction de la pratique de « l’entrée par l’avant » dans les bus et la signalisation de l’usage du bus à tous les clients. A l’école, dès le début de l’année, ou lors de l’emménagement dans un immeuble, les règles doivent être présentées à chacun. Une fois franchi le seuil, le sentiment de la continuité des règles dans l’espace et dans le temps doit s’imposer. Or, la plupart du temps les gestionnaires des lieux ne sont pas soucieux de cet aspect (par exemple, dans les transports, les différents personnels qui y travaillent ne sont pas vêtus de la même manière et les usagers ne les identifient pas comme une « unité », comme autant d’agents contribuant à la qualité des lieux, du service et à leur sécurité).
Le rappel des règles peut être nécessaire à chaque usage de l’espace. Pour construire un garant il faut une présence continue. Sa présence partielle ne permet ni aux usagers de se sentir rassurés ni de les pousser à affirmer par eux-mêmes un certain nombre de codes et de règles (par exemple de ne pas frauder, ne pas dégrader ou salir). Si les usagers ont pu être impliqués dans la définition des règles – ce qui est d’autant plus difficile que les flux sont massifs – ils seront plus enclins à les faire respecter. Encore faut-il que la règle soit perçue comme juste et qu’elle soit rendue publique et édictée sans ambiguïté. Le critère de justesse de la règle est très important. Les règles qui sont appliquées à l’endroit ou à l’encontre des usagers de l’espace doivent leur apparaissent comme justes et compréhensibles. Le processus ne doit pas être discriminatoire (par exemple on va contrôler tous les titres de transports, et pas seulement ceux des personnes qui ont une tête qui ne revient pas à l’agent),être affichées et claires afin que personne n’ait l’impression d’être piégé.
En résumé, le garant des lieux est établi pour fournir un accueil, une assistance et une veille (y compris par l’exercice de la réprobation). La définition de « seuils » est la condition de l’hospitalité des lieux, elle permet au garant des lieux de marquer sa présence. Ce dernier opère d’abord par l’aménagement de l’espace partagé en donnant des signes de l’usage (des prises), par le marquage physique des lieux et l’organisation des flux. Il travaille ensuite par le rappel des règles, lors de la première arrivée (ou prise d’abonnement ou autre), ou à chaque usage. Il intervient ensuite en analysant la fonction des lieux (par exemple la fréquentation d’un parc public, pour adapter les horaires d’ouverture et de veille), et en cherchant à mobiliser les usagers (on peut penser à un établissement scolaire qui responsabilise les adolescents en leur confiant des fonctions). Dans ce système, les interventions des agents visent d’abord la réactivité aux incidents de faible intensité (ce ne sont pas des « crises »), et le contrôle est perçu comme juste. Les agents veillent à éviter la privatisation d’une partie du lieu (coin de la gare, fond du bus). La ritualisation des règles et la personnalisation (le chef d’établissement est devant sa grille et connaît ses élèves) facilite l’appropriation des règles par l’usager du lieu.
Nombre d’organisations ont perçu le problème des incivilités, surtout du fait de leur coût économique ou de l’impact sur leur activité principale. Les hypermarchés ont été les premiers à réagir, pour des raisons évidentes : la gêne ressentie freine la consommation du client. Mais, du côté social, les choses ont commencé à changer et les gardiens d’immeubles ont fait un retour, certes timide. La présence humaine dans les transports en commun s’est développée, sous les doux noms d’agents d’ambiance ou de médiateurs notamment. Une bonne partie des « emplois jeunes » en milieu urbain a été orientée vers ce but par les municipalités. Des correspondants de nuit ont éclos dans les métropoles. Ces diverses initiatives ne participent pas d’un plan d’offensive idéologique, raisonné et coordonné. Elles traduisent plutôt une prise de conscience par des professionnels attentifs aux besoins sociaux.
Cette analyse de la situation, plus ou moins formalisée, a conduit à l’émergence de l’affirmation de la protection des espaces collectifs par des professionnels nouveaux :en effet, ni les habitants, ni les professionnels habituels n’ayant le désir, la compétence ou la légitimité à assumer ce rôle. On observe dans diverses organisations l’avènement d’une nouvelle catégorie de fonctions : les professionnels de l’ordre en public. Le but recherché ne consiste pas seulement en la définition d’un gardien mais plutôt en un système de veille, de réprobation douce ou encore de prescription-proscription des comportements de la vie quotidienne, bref de l’ordre en public ou des « règles d’hospitalité ». Il s’agit d’une professionnalisation de la réprobation par l’assistance ordinaire, la veille et la réprimande dans les espaces collectifs.
Ce choix de traiter des situations se distingue de celui de la répression au nom de la loi par recours à la sanction pénale via ses agents et également de la prévention centrée sur la personne comme totalité. Ce n’est pas non plus de la « prévention situationnelle », qu’on définit par le fait d’augmenter les coûts liés à la commission d’un délit comme lorsqu’on met des barreaux aux fenêtres car, dans ce cas la solution est d’augmenter le filtrage ou limiter l’intrusion à l’entrée des lieux et non pas de s’assurer que l’espace est utilisé conformément à des règles valides pour chacun. Ce travail apparaît éloigné des missions historiques et des métiers des opérateurs de services comportant des espaces collectifs. Les « opérateurs des lieux », c’est-à-dire les organisations qui y distribuent un service (loger, transporter par exemple) n’étaient historiquement guère impliquées dans la production de la civilité, même si les choses ont évolué de ce point de vue depuis 20 ans (il existe aujourd’hui des « chefs de gare voyageurs, des agents de civilités, des pictogrammes qui nous disent ce qu’on doit éviter). La conséquence de cette approche consiste à faire parfois reposer la production du lien de civilité sur des entreprises commerciales. Cela peut sembler curieux, mais traduit le phénomène de privatisation au double sens du terme de service qui n’est plus uniquement ou principalement dans les mains des pouvoirs publics et qui est également « mis sur la marché » par des entreprises qui peuvent avoir un statut public ou privé mais servent des clients dans des lieux. La réaffirmation d’un garant des lieux passe donc pour un préalable à l’instauration de règles d’hospitalité. En amont, l’intégration au processus de production de la ville les contraintes des futurs gestionnaires des espaces physiques constituerait un facteur facilitant l’émergence de garants des lieux reconnus. Le point crucial est la capacité des organisations à définir des normes en relation avec les usagers, parfois en les mobilisant pour arriver à les produire, mais également la capacité à se coordonner sur un territoire donné pour défendre au quotidien ces mêmes normes, ces « règles d’hospitalité ». La configuration de l’espace ne peut prétendre résoudre à elle seule la question des phénomènes d’incivilité, notamment du fait de ses déterminations socio-économiques, mais elle peut y contribuer grandement. Garantir les lieux implique qu’il faut y assurer une veille humaine. Et, que s’y coordonnent des organisations qui feront, par la suite, vivre l’espace en y distribuant un service.