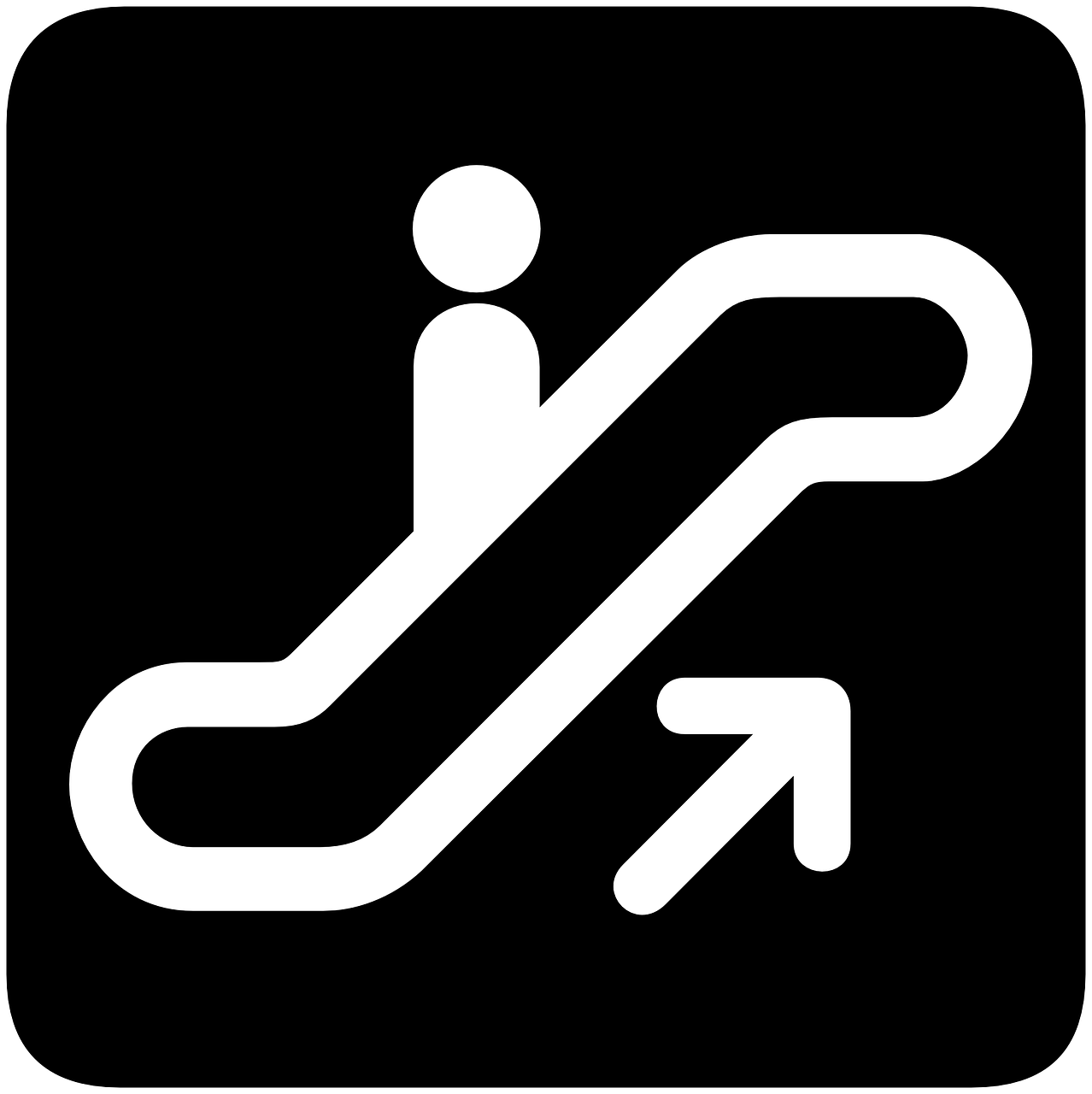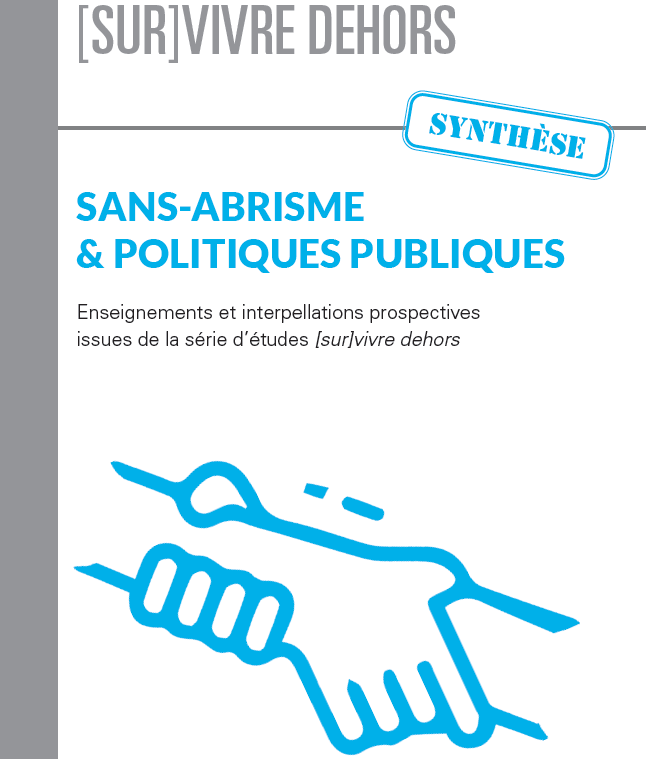Le livre de Stéphane Hessel a provoqué un fait éditorial d’une puissance et d’un impact hors du commun. À Lyon, en décembre 2011, à l’initiative des éditions Golias et de Paul Ariès, le politologue lyonnais avocat de la thèse de la décroissance, est paru le numéro 1 de la revue Les Zindigné(e)s !. En septembre 2012, la chaîne franco-allemande Arte a mis à la disposition de ses clients deux œuvres du réalisateur Tony Gatlif : un film, Indignados, et un documentaire, Indignez-vous !, censés nous plonger dans « la réalité dense et palpable d’une Europe révoltée ».
Un fait de langage est là : la création d’un substantif, « un(e) indigné(e) », dérivé du participe passé d’un verbe usuellement employé dans sa forme pronominale, « s’indigner », ou passive, « être indigné ». Un fait de société est là : il se présente comme un mouvement « inédit » d’extension mondiale. Le premier rassemblement des indignados s’est tenu à Madrid en mai 2011 ; la formule a essaimé de New York à Tel-Aviv, d’Athènes et de Dakar à Zurich… Le quotidien Libération y a trouvé matière à un titre synthétique : « Année 2011, année des indignés ». L’interprétation de ces faits de société peut se faire sous deux conditions : se situer à l’amont du phénomène éditorial et de mobilisation ; se donner comme objet d’étude la condition de ces phénomènes qui a trait à des faits de langage — soit la contrastées et d’usages différenciés du terme « dignité ». C’est à ces modifications de sens et d’usage que peut se rapporter l’effet d’injonction du texte de Stéphane Hessel. Une leçon d’ordre à la fois historique et anthropologique s’en dégage : elle a rapport à la contrainte du « Au nom de quoi ? ». Cette contrainte ordinaire de justification de nos pratiques est aussi celle qui commande, dans ses moments majeurs, le rapport au droit dans nos sociétés.
Du statut et de la fonction à la personne
À la lecture de quelques appareils lexicographiques de référence, du XVIIe à la fin du XIXe siècle, les sens du mot « dignité » ne varient pas. Il désigne une matière jugée d’importance ou, mieux encore, une fonction civile ou religieuse éminente. Le sens de statut éminent d’une personne se conserve, actuellement, dans la langue des distinctions honorifiques et, spécialement, celle de la Légion d’honneur, où l’on distingue les « grades » de chevalier, officier, commandeur, des « dignités » de grand officier et grand-croix. Mais un tel emploi relève plutôt de l’exception que de l’usage commun. Il faut attendre la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française, en 1932, pour qu’aux sens anciens de la dignité de la fonction s’ajoute la définition suivante : « Au sens philosophique ou moral, la dignité désigne le fait que la personne humaine ne doit jamais être traitée comme un moyen, mais comme une fin en soi.» Cette définition est empruntée à un texte de Kant — la deuxième section des Fondements de la métaphysique des mœurs, parus en 1785. Dans ce texte, le philosophe distingue radicalement la personne humaine de toute autre entité en inscrivant la personne dans l’ordre de la non-évaluabilité. Est digne, sous cette condition, ce qui ni ne se mesure ni ne s’étalonne : « Ce qui est supérieur à tout prix, ce qui n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité. » Tout autre objet est censé pouvoir faire l’objet d’un « prix marchand » ou d’un « prix de sentiment ».
Cent cinquante ans d’évolution
La langue commune a mis près de cent cinquante ans à enregistrer l’acception philosophique et morale détachée des sens premiers sociohistoriques. Nous sommes, à présent, les témoins et acteurs d’un emploi de plus en plus pressant de cette acception philosophique et morale et de sa dissémination dans de multiples champs. En témoignent celui des mœurs comme celui du droit. Dans le champ des mœurs, les débats sur les conditions de la fin de vie ont mis en exergue, durant la dernière décennie, deux conceptions antithétiques de la dignité. Dans Le Monde du 6 avril 2008, après avoir évoqué le décès de Maurice Abiven, pionnier français des soins palliatifs, Jean-Yves Goffi propose le titre : « Le dilemme sans fin de l’euthanasie ». Le dilemme est celui qui oppose une conception de la dignité opposable à autrui et à l’individu lui-même parce qu’elle concerne la vie, tenue pour sacrée, et une conception où l’individu est censé avoir un pouvoir souverain sur sa propre existence et, partant, sur sa propre fin. L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), membre des fédérations mondiale et européenne des Right to Die Societies, est l’avocate de cette dernière acception. Dans le champ du droit interne, une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 paraît exemplaire. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, à propos des articles régissant la garde à vue dans le code de procédure pénale, le Conseil a annulé quatre de ses articles. Trente considérants ont servi la justification de ces annulations, parmi lesquels le dix-neuvième est ainsi libellé : « Tout être humain est titulaire de droits inaliénables et sacrés, conformément au préambule de la Constitution de 1946. La sauvegarde de la dignité de la personne est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. » On relèvera, ici, que la catégorie de dignité n’est jamais qu’un élément constitutif d’un ensemble de droits posés comme «sacrés» et «inaliénables».
Du logement digne à la dignité des cultures
Ce serait un leurre, cependant, que de tenir l’usage actuel de l’acception entendue dans son sens philosophique et moral comme exclusif. En témoigne l’emploi du terme « dignité » dans le champ des politiques publiques, de la culture, comme dans celui de l’espace civique où résonne, désormais, l’injonction lancée par Stéphane Hessel en 2010. De cette mobilisation de la notion de dignité dans un sens qui demeure rapporté à la notion de dignité humaine, mais qui a tout autant rapport aux conditions objectives de son accomplissement, témoigne la catégorie récemment advenue de «logement indigne». Elle est censée couvrir l’ensemble des situations d’habitat qui constituent un déni du droit au logement et qui portent atteinte à la dignité humaine. Elle s’applique aussi bien aux logements ordinaires qu’aux structures d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile.
Les traités européens, la Charte des droits fondamentaux, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concourent, quant à eux, à assurer ce même lien entre «existence digne» et conditions de logement.
Le musée parisien des Arts premiers, édifié en réponse à la commande présidentielle de Jacques Chirac, s’est voulu, quant à lui, «instrument de paix qui témoigne de l’égale dignité des cultures et des hommes». Le syntagme « dignité des cultures », qui jouxte celui de «dignité des hommes», ne réfère plus à la personne ni à un statut ou une fonction relevant de distinctions et hiérarchies civiles ou religieuses. Il réfère, plutôt, à ce que, dans le langage de l’Unesco, on nomme « patrimoine immatériel ». Il réfère, possiblement, aux entités collectives ou personnes morales qui sont les répondants de ce patrimoine. Dans le stupéfiant «effet Hessel», les indignados sont bien ces cadets qui ont accepté de « prendre le relais » d’un aîné leur adressant, au nom des idéaux de la Résistance, l’injonction «Indignez-vous !». Le champ d’inscription de la catégorie « dignité » est, cette fois, celui d’un haut lignage politique appelant une action conduite en référence à un double dispositif : celui, national et programmatique, du conseil français de la Résistance, et celui, universel et déclaratif, du texte de 1948. Il en va, encore, de cette constellation saisissante des slogans et mots d’ordre de l’hiver et du printemps 2010-2011 qui a permis aux acteurs tunisiens puis égyptiens desdits « printemps arabes » de conduire leurs revendications et leurs luttes au nom de la «dignité du peuple».
Un indice historique
Le tableau des acceptions et usages qui s’est construit en très longue durée montre une variabilité historique de la sémantique de la dignité et une relation équivoque des notions de droit et de dignité. Une modification des plans de référence est également à l’œuvre, du référent «droits de l’homme» au référent «dignité». Il n’est pas difficile de situer, dans le temps, pareille modification du plan de référence.
L’année 1989 peut être considérée comme le point d’orgue d’un processus historique qui a permis le « triomphe » de la cause des droits de l’homme, marqué, sur l’échelle internationale, par l’effondrement du mur qui symbolisait l’antagonisme des systèmes capitaliste-parlementaire et collectiviste dictatorial. Mais il se marque aussi, sur l’échelle nationale française, quand presque toutes les opérations du bicentenaire de la Révolution française ont actionné la référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. On a parlé d’une «droidlhomisation» de l’espace public, jouant sur des échelles aussi bien internationales que nationales. Si l’on consent à cette interprétation, le paradoxe est double. Il est celui d’un « triomphe » qui annoncerait non un déclin, mais un relatif effacement. 1989 peut être tenu comme ce moment où culminent les effets possibles de la référence aux droits de l’homme, mais où s’amorce sa mise en position subalterne. L’intelligence de ce processus est possible en prenant en compte un autre paradoxe qui s’attache au document même qui appelle et induit la référence aux droits de l’homme, soit la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Son article 1 déclare les hommes non pas « égaux en droit », mais « égaux en dignité et en droits ». Nous supportons aujourd’hui les effets de cette très discrète préemption du droit par la dignité qui emporte un changement significatif du plan de référence. L’attribution et l’exercice des droits sont toujours conditionnés (par l’âge, le sexe, la nationalité…) ; la dignité ne peut être qu’inconditionnelle : elle n’est pas attribuée et ne s’exerce pas ! Elle est reconnue… ou déniée.
L’attendu philosophique de cette préemption a été avancé au XVIIIe siècle, par un philosophe des Lumières, par ailleurs piétiste protestant, Emmanuel Kant. Mais il n’a pu produire l’effet déclaratif consigné dans le texte de 1948 qu’en raison d’un contexte éminemment tragique, celui de la démesure d’un crime de masse qui visait non pas tel délit ou tel crime, non pas tel acte ou telle idéologie, mais, selon la formule d’André Frossard, le seul fait «d’être né». À la démence raciale autorisant la barbarie nazie et aux effets sans précédent de la dictature d’État, la réponse doctrinale des rédacteurs de la déclaration de Philadelphie, en 1944, puis de René Cassin, d’Eleanor Roosevelt et de leurs conseillers, auteurs de la Déclaration universelle de 1948, a été de mettre en exergue la catégorie métajuridique de la «dignité». Cette catégorie qui conjoint des sources philosophiques et théologiques est bien métajuridique : l’appareil doctrinal que mobilise une grande partie des conseillers francophones de René Cassin est ostensiblement théologique. Dans le lignage d’un Thomas d’Aquin, la dignité de la personne humaine est posée comme un reflet et un effet de la suréminente dignité des personnes divines.
Ce pivotement s’opère dans les derniers mois de la seconde guerre mondiale. L’exception des crimes perpétrés n’a pas seulement conduit à la promotion d’une catégorie juridique nouvelle, celle du « crime contre l’humanité » ; elle a, en sus, autorisé la constitution d’un plan de référence métajuridique inédit. L’effet d’onde de cette conjoncture est tel que, cinquante ans plus tard, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, signée et proclamée le 7 décembre 2000, ouvre ses six chapitres par un titre entièrement dédié à la notion de dignité. Lui succèdent les chapitres de la liberté, de l’égalité, de la solidarité, de la citoyenneté, et de la justice. Cet ordre d’exposition n’a pas été construit arbitrairement.
Un indice anthropologique
Ce double plan de référence crée une configuration singulière, troublante si l’on admet que la langue de la dignité n’est pas celle du droit. Elle l’est, plus précisément encore, si l’on admet que la formulation «Les humains sont égaux en dignité» relève d’un oxymore, c’est-à-dire d’une alliance de termes contraires. Selon l’acception kantienne, dont nous sommes les héritiers, la dignité ne s’apprécie que pour autant qu’elle échappe à toute idée de mesure! Qu’atteste l’équivoque doctrinale d’une «égalité en dignité et en droits» instituée depuis 1944-1945 ? L’actualisation d’une contrainte de type anthropologique que nous pouvons dire de référence-révérence. Référence, si référer est «se tourner vers (quelqu’un, quelque chose) qui représente la source, l’origine, l’autorité sur laquelle on s’appuie, on se fonde». Révérence, si révérer est «honorer, respecter ce qui est revêtu des caractères du sacré». Cette contrainte peut encore être dite contrainte d’invocation. Rappelons, ici, le sens premier du geste d’invocation qui est d’appeler sur soi la protection ou la force attachées à une entité qui «transcende», c’est-à-dire qui «passe au-delà», qui «surpasse». C’est à la «dignité» des personnes, des peuples, des cultures… qu’est désormais impartie la fonction de fonder notre cadre institutionnel, de désigner l’horizon de sacralité sur lequel s’inscrit notre espace public. En rédigeant la déclaration de Philadelphie ou celle de 1948, leurs auteurs n’ont pas fait que désigner, dans le « ciel des idées », une nouvelle constellation, celle de la dignité. Ils ont ouvert une possibilité de réponse à la question du «Au nom de quoi ?» sur un mode singulier puisque, tout à la fois, il appelle la langue du droit et l’excède. Ce faisant, ils réitèrent le geste des constituants américains ou français qui n’avaient pas seulement placé leurs travaux sous les auspices de la déité chrétienne, mais avaient, eux aussi, invoqué une catégorie métajuridique — celle de « nature », dégageant l’espace de l’énoncé de droits dits «naturels». Ainsi se vérifierait la thèse longuement argumentée par l’anthropologue Pierre Legendre. Le fondement des collectifs humains ne peut pas ne pas être «dogmatique» : il se veut assuré, certain, en même temps qu’il échappe, se dérobe. Ni le référent «nature» ni le référent «dignité» n’appellent la démonstration. Ils relèvent bien plus d’une position axiomatique, si l’on entend par là que l’instrument nécessaire à la démonstration ne se démontre pas. Il en va du destin des humains de procéder par invocation du non-démontrable. Mais tel est, aussi, le génie des humains de convertir la puissance attachée aux valeurs. L’invocation de la dignité n’a pas seulement fourni un nouveau motif déclaratif. Elle a ouvert des voies nouvelles dans l’ordre des mœurs, du droit,de la politique.